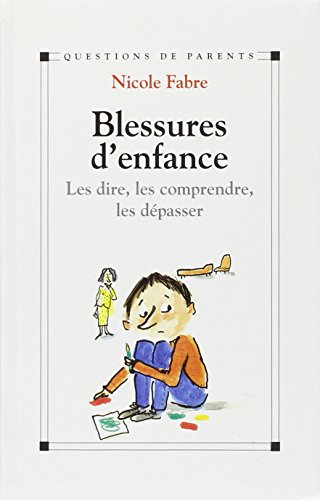La psychanalyste Nicole Fabre raconte [1]. Antoine, 10 ans, a des résultats scolaires peu satisfaisants malgré un QI normal. Ses parents s’interrogent sur l’opportunité d’une psychothérapie. Le père est trop occupé. La mère, « diaphane », est le porte-parole de son mari. « Selon elle, tout était normal sauf les résultats en classe. L’accouchement ? normal. L’alimentation ? normale. Le sommeil ? normal. Les jeux et les loisirs ? normaux, de son âge… L’humeur ? normale, rien à en dire. L’atmosphère à la maison ? normale, rien de particulier ».
Nicole Fabre fait appel à des tests projectifs qui tous montrent une angoisse impressionnante. Antoine a « peur d’être abandonné, peur de faire des cauchemars, peur de mourir, peur que les parents meurent, peur de s’endormir ».
Alors, « avec précaution », la psychothérapeute demande à Antoine s’il parle de ses peurs à ses parents. « Non, bien sûr ! » En revanche, il accepte qu’on en parle à quatre et « complètement », précise l’enfant.
Les parents s’installent, la mère minuscule et le père, juge. Antoine est très ferme sur le tabouret qu’il a choisi. Nicole Fabre confirme l’intelligence d’Antoine et affirme que les échecs scolaires sont dus à une inhibition très grande et que celle-ci est due à l’angoisse.
« La toute petite maman écoutait avec attention. Et du père semblait émaner un silence réprobateur qui peu à peu épaississait l’atmosphère du bureau. Seul Antoine avait l’air à l’aise. Il a pris la parole : ‘Oui. C’est vrai je suis angoissé, tout le temps.’
« Le père alors a rompu le silence, et c’était comme autant de coups frappés dans l’épais nuage qui nous avait enveloppés : ‘Angoissé ? Angoissé ? Où as-tu appris ce mot ? L’angoisse, ça n’existe pas…’ Antoine, très ferme, a repris la parole : ‘Je suis angoissé, je te dis. J’ai peur tout le temps’, et il a énuméré sa peur de l’échec, sa peur qu’on ne l’aime plus, sa peur de voir ses parents l’abandonner ou se disputer, sa peur de mourir, sa peur de s’endormir le soir. Le père tentait de le faire taire, mais Antoine ne se taisait plus pendant que sa mère, affolée, se limitait à dire ‘Antoine, Antoine…, arrête !’ Finalement, le père s’est tourné vers moi, et mon juge m’a condamnée : ‘Madame, cet enfant ne connaissait pas le mot angoisse avant de venir ici. C’est vous qui le lui avez appris. Vous lui avez appris l’angoisse.’
« Il est évident que je ne reverrais pas Antoine. J’ai dit que s’il ne connaissait pas le mot – ce qui est regrettable à dix ans –, il en connaissait la réalité. Et même le fait d’être angoissé ne limite pas les qualités de courage que son père attendait de lui et cherchait à lui inculquer. Bien au contraire ».
D’ailleurs, la belle énergie d’Antoine en était le témoignage, lui qui disait : « J’ai peur de tout, et tant pis si tu ne me crois pas. Moi, je ne suis pas comme toi. Et ça ne m’empêchera pas de réussir quand même ».
Non, ce n’est pas un exemple caricatural, tiré d’un film des années 50 type À l’est d’Eden ! L’ouvrage dont il est extrait date de 1999. Et la colère que vous ressentez peut-être à l’égard de ce père si peu compréhensif, Nicole Fabre dit la ressentir sous la forme d’une amertume : aurait-elle dû se taire ?
Cet exemple montre d’abord combien l’angoisse blesse la relation à l’autre (faussant les relations avec les parents), à l’intelligence, rend sot.
Il montre aussi combien les mots sont porteurs d’un savoir libérant. Ils sont plus que la quantité d’information qu’ils véhiculent. Comme il est important d’apprendre tôt aux enfants certains mots. Ce qui vaut de l’angoisse vaut par exemple aussi du désir, de la honte, de la tristesse. Il faut parfois attendre une psychothérapie, des décennies plus tard, pour enfin dire sa culpabilité, pleurer la mort d’un être cher survenue dans la petite enfance.
Il montre enfin combien le pouvoir s’exerce non seulement sur l’interdiction des affects, mais sur l’interdiction des mots les signifiant. Autrement dit, la blessure concerne non seulement la vie affective mais la pseudo-conscience morale, le surmoi [2]. C’est vrai au plan individuel, c’est aussi vrai au plan sociopolitique, ainsi que la science-fiction l’a mis en scène (1984 de George Orwell, Farenheit 451 de Ray Bradbury).
Inversement, ne jugeons pas trop vite l’enfant qui se tait face à l’humiliation. Combien ont entendu leur silence interprété négativement, alors qu’ils tentaient seulement de survivre. Nicole Fabre, encore elle, rapporte l’exemple d’un homme se rappelant, avec rage et désespoir, lorsqu’il ramenait à la maison une mauvaise note. Il tentait de garder sa dignité et se taisait, tant son découragement était grand. Or, autour de lui, tout le monde y allait de son commentaire : « Ils disaient tous que je m’en moquais, que j’étais un raté, que je le suis toujours » ; « et le cœur sec, en plus, il s’en fout [3] ! » Ce n’est pas vrai. C’est impossible. L’expérience montre que les enfants apparemment les plus indifférents, les plus taiseux ou, inversement, les plus moqueurs, sont souvent les plus sensibles. Là encore, l’issue réside dans la parole juste posée, par soi ou par l’autre, sur la souffrance. Mettre en mots les maux…
Pascal Ide
[1] Nicole Fabre, Blessures d’enfance. Les dire, les comprendre, les dépasser, coll. « Questions de parents », Paris, Albin Michel, 1999, p. 18-20.
[2] Cf. Pascal Ide, Mieux se connaître pour mieux s’aimer, Paris, Fayard, 1998, chap. 3.
[3] Nicole Fabre, Blessures d’enfance, p. 21.