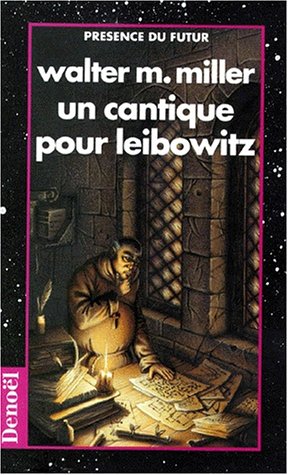La nouvelle d’anticipation de Walter M. Miller Jr., Un cantique pour Leibowitz, offre un superbe exemple de don en retour qui dépasse le premier don en beauté, voire en inspiration [1].
Walter Michael Miller, Jr. (1923-1996) ne publia que ce seul roman de son vivant. Salué par le prestigieux prix Hugo du meilleur roman en 1961, il est toujours considéré comme l’un des meilleurs écrits post-apocalyptiques et fait régulièrement partie de la liste des cent meilleurs romans de science-fiction.
Le titre de l’ouvrage est métonymique : il appelle le tout qui rassemble trois nouvelles (publiées dans The Magazine of Fantasy and Science Fiction entre 1952 et 1957, puis rassemblées en 1960) du titre de la première d’entre elles. Elles présentent néanmoins un point commun, puisque chacune d’elle décrit la vie d’une communauté monastique installée dans l’abbaye de saint Leibowitz, située sur le territoire nord-américain, à une époque différente, chacune étant postérieure de 600 ans (et la première distante de ces mêmes six siècles de notre époque) : xxvie siècle, xxxiie siècle, xxxviiie siècle, et chacune ayant un titre à résonance biblique commençant par Fiat, respectivement : Fiat homo (renvoyant à Gn 1,26), Fiat lux (Gn 1,3), et Fiat voluntas tua (Mt 6,10). De fait, non seulement le texte est parsemé, presque à chaque page, de citations en latin tirées de la Bible et, plus encore, de la liturgie, mais il défend une thèse réjouissante et très équilibrée sur les relations entre la raison et la foi : d’un côté, la foi lutte contre l’obscurantisme antiscientifique ; de l’autre, la science sans conscience morale et religieuse, n’est que ruine de l’âme. Bref, la religion, en l’occurrence chrétienne, milite pour le renouveau de la science autant que pour sa régulation éthique. Même si Pauwels et Bergier ont rendu célèbre la nouvelle de Miller en insérant un substantiel résumé au terme de la première partie de leur ouvrage inclassable inspiré par la tradition hermétiste [2], l’esprit qui baigne Un cantique pour Leibowitz et le roman est bien l’Esprit que le Christ a révélé et envoyé pour animer son Église [3]. Un élément autobiographique est éclairant. Ayant servi dans l’armée de l’air américaine pendant la Seconde Guerre mondiale comme ingénieur radio et mitrailleur, Walter Miller participa à 53 missions de largage de bombes au-dessus de l’Italie. Or, l’une d’entre elles a consisté à détruire la prestigieuse abbaye bénédictine de Monte Cassino qui fut fondée par saint Benoît de Nursie et où séjourna saint Thomas d’Aquin enfant. Le traumatisme de cette destruction est à la source de Cantique.
Résumons le récit avant de le commenter.
À la fin du xxe siècle, une grande apocalypse nucléaire appelée le « Grand Déluge de Flammes » ravage la planète Terre. Le feu dévaste une grande partie des constructions humaines et tue de nombreux hommes. Mais il y a pire. Une partie de ceux qui descendent des survivants à la catastrophe est génétiquement dégénérée de manière monstrueuse (jusqu’à être bicéphale). En proie à une immense colère, ces survivants ont décidé de punir toute personne porteuse de savoir : il est le responsable de l’actuel malheur de l’humanité. Pour cela, ils ont lynché les scientifiques, les techniciens et les enseignants, sans oublier les politiques. Et ils ont brûlé tous les livres – même les livres sacrés. Dans ce monde désolé autant que désolant, le savoir et même la simple capacité à lire sont donc considérés comme un crime. Désormais, notre planète est habitée par des « Simples d’esprit » qui revendiquent haut et fort leur ignorance. Toutefois, un ingénieur, Isaac Leibowitz, devenu veuf après le Déluge, rentre chez les Cisterciens et quelques années plus tard, fonde un ordre monastique, l’ordre albertien – par référence à saint Albert le Grand, saint patron des hommes de science et maître de saint Thomas d’Aquin –, dont la vocation est de sauver les derniers ouvrages qui ont échappé à cette vengeance obscurantiste. « Les membres de l’Ordre étaient des ‘contrebandiers en livres’ ou des ‘mémorisateurs’, selon la tâche qu’on leur assignait » (p. 73). Il fonde aussi l’abbaye de Leibowitz, quelque part entre l’ancien Grand Lac salé et El Paso, avant de mourir en martyr, tué par une troupe de Simples d’esprits.
L’histoire commence quelques siècles plus tard, lorsque frère Francis Gérard de l’Utah, un jeune novice de 17 ans qui est membre de cette congrégation et ne fait « pas de nette séparation entre le Naturel et le Surnaturel » (chap. 4, p. 59), fait sa retraite très ascétique dans le désert situé à quelques kilomètres de l’abbaye. Il y rencontre par hasard un vieil ermite grincheux qui lui indique la présence de l’entrée d’un abri anti-atomique d’avant l’apocalypse en écrivant à la craie deux signes mystérieux : צ ל.
Descendant un escalier qui s’enfonce dans le sous-sol, frère Francis découvre un squelette blanchi par le temps et, non loin, une boîte rouillée remplie de documents originaux datant de la première moitié du xxe siècle, ayant donc « échappé aux flammes furieuses de la Simplification » (chap. 2, p. 34) et signés I. E. L. Serait-il possible que ce soit les initiales d’Isaac Edward Leibowitz ? Quand frère Francis rentre à l’abbaye, sa découverte fait grand bruit dans la communauté qui est persuadée que le vieil ermite n’est autre que Leibowitz en personne et les papiers de précieuses reliques écrites de sa main.
Mais les rumeurs inquiètent le Père abbé, Arkos, surtout lorsque le père Cheroki, prieur de l’abbaye, lui révèle que les signes mystérieux sont en fait deux lettres de l’alphabet hébraïque, lamed et tsadé (car elles se lisent de droite à gauche), l’initiale et la finale de Leibowitz. En effet, il craint que cette rumeur ne nuise au procès en béatification de leur fondateur. Il punit alors le jeune novice pour avoir semé le doute dans la communauté et ne pas avoir apporté un démenti catégorique à l’identité de l’ermite. Non seulement il lui interdit désormais de s’approcher des ruines, mais il retarde ses vœux pendant sept années consécutives, l’obligeant à faire retraite sur retraite dans le désert.
Jusqu’au jour où un dominicain de la curie inquisitoriale, directement arrivé de la Nouvelle Rome (la ville de Rome ayant été anéantie), arrive au couvent en affirmant qu’il désire rencontrer le frère Francis pour l’interroger sur les reliques et sa rencontre avec le prétendu Leibowitz. L’inquisiteur ayant confirmé que les notes étaient très probablement de la main de celui qui était désormais bienheureux, le novice est finalement autorisé par l’abbé à prononcer ses vœux. Il devient alors copiste et assistant de frère Horner. À ses moments libres, il copie l’une des reliques, un plan qui porte le titre sibyllin : « Système de Contrôle Transistoriel pour Élément Six-B ». Sans rien comprendre à sa signification, frère Francis l’enlumine à la manière des moines médiévaux.
Les années passent et le procès en béatification de Leibowitz touche à sa fin. Mgr Malfreddo Aguerra, postulateur de la cause, se rend au monastère pour y rencontrer le frère Francis afin d’attester des miracles à porter au bénéfice de Leibowitz et ainsi défendre sa cause devant le Saint-Père. Se rendant dans la salle des copistes, Mgr Aguerra contemple le parchemin qui n’en est qu’à ses débuts et pourtant s’exclame : « Quelle beauté ! […] Finissez-le, frère » (chap. 8, p. 98). Quelques mois plus tard, c’est au tour de Mgr Flaught, l’Advocatus diaboli, chargé d’une contre-enquête à propos de la canonisation de Leibowitz, de rendre visite au même humble moine et d’admirer, lui aussi, le futur chef d’œuvre.
Quelques années plus tard, le pape publie le décret en vue de la canonisation du Bienheureux. L’abbé Arkos apprend à frère Francis qu’il est officiellement invité à la cérémonie et, tout en portant l’original qu’est le plan tracé par le futur saint, lui enjoint de faire cadeau au pape de l’enluminure du schéma électronique sur laquelle il a travaillé pendant quinze ans. Frère Francis part, seul, sur les chemins dangereux de la région. Et nous voici (enfin !), arrivés à l’épisode qui justifie cette note.
Le moine se fait soudain attaquer par un voleur accompagné de deux comparses encapuchonnés provenant de la vallée des Difformes. Le voleur sans nom lui prend son âne, fouille son maigre baluchon, n’y trouve rien d’intéressant, puis ouvre l’autre paquet qui contient la relique et sa copie enluminée. Frère Francis explique qu’il a mis quinze ans pour la faire, ce qui laisse le voleur interdit et méprisant : « Mais pourquoi ? Travail de femme ! » (chap. 10, p. 110). Il récuse toutes les propositions du moine pour garder la précieuse relique, y compris de le tuer. Mais, au regard désespéré, le voleur – avec cette empathie cognitive (et non pas affective) qui caractérise les meilleurs manipulateurs – comprend qu’il peut tirer un meilleur parti de ces simples papiers : il propose au frère de garder la copie et de lui redonner la relique contre la somme de deux heklos d’or à son retour de la Nouvelle Rome. C’est alors que, muet de stupéfaction, Francis se rend compte que le voleur s’est trompé : il a confondu la relique sacrée avec la copie. Il reprend son chemin, bénissant le voleur et remerciant Dieu « d’avoir créé des voleurs aussi désintéressés – et aussi ignorants » (Ibid., p. 112). Frère Francis est trop humble pour comprendre que la raison de la confusion réside dans la beauté de sa copie enluminée.
Arrivé à Rome, le moine albertien participe à la cérémonie de canonisation et obtient un entretien avec le pape Léon xxi à qui il raconte son périple et ses péripéties. À la réaction compatissante du Pontife regrettant qu’on lui ait volé la copie, frère Francis répond avec son humilité coutumière, non sans faire allusion à l’observation blessante du voleur : « C’était une bien pauvre hose, Très Saint-Père. Je regrette seulement d’avoir perdu quinze ans à la faire ». Mais le pape réplique aussitôt : « Perdu ? Mais comment ? Si le voleur n’avait pas été trompé par la beauté de votre œuvre, il eût pu prendre la relique, n’est-ce pas ? » (chap. 11, p. 119). Et, en signe de gratitude, plus, en « témoignage spécial de notre affection » (Ibid., p. 120), Léon xxi confie à Mgr Malfreddo Aguerra de lui donner une bourse contenant les deux heklos d’or qui permettront de racheter l’enluminure.
Peu importe la suite et fin pour l’instant. Habituellement, l’on interprète cette nouvelle (et première partie) comme « le passage d’une culture de la superstition à une civilisation du savoir raisonné. Il faut que l’Homme éclairé remplace l’Homme obscurantiste : Fiat homo » (site cité ci-dessus). Si l’on précise que cette nouvelle civilisation et cet Homme sont aussi religieux, cette conclusion est assurément vraie. Mais elle est insuffisante. Le récit de Walter M. Miller est une superbe illustration de cette loi selon laquelle, loin d’être une itération, le don en retour peut être encore plus admirable que le primo-don. « Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes [μείζονα] », dit Jésus à ses Apôtres (Jn 14,12). En effet, de prime abord, la copie faite par frère Francis n’est qu’une répétition du modèle, donc du premier don – d’autant qu’il reproduit un plan qu’il a reçu du saint fondateur lui-même. La première finalité de la reproduction est la conservation des originaux sur parchemin qui s’altèrent avec le temps. En réalité, frère Francis l’enrichit considérablement. D’abord, il découvre que le fond bleu du plan – « le bleu de Leibowitz » – qu’il s’était longuement appliqué à reproduire et pour lequel, comme tant d’autres copistes, il avait dépensé beaucoup d’encre et de temps, « était simplement le résultat d’un certain processus de reproduction bon marché » (chap. 7, p. 87). L’original était en noir et blanc. Mais, quand il découvre son erreur (et celle des autres moines), il ne le dit pas au frère Horner par « charité ». Plus encore, après un moment de découragement, il reçoit de cette découverte « une nouvelle impulsion à ses propres projets » (Ibid.). Il peut profiter de cette nouvelle surface pour l’embellir. Certes, il n’en change pas « d’un cheveu la forme ni le plan général » (Ibid., p. 88). Mais il peut réaliser un « effet de couleur » « important » et « beau » : « Quand frère Horner illuminait un M majuscule, le transformant en une jungle merveilleuse de feuilles, de baies et de branches, avec quelque serpent rusé, il restait néanmoins lisible en tant que M, et frère Francis ne vit aucune raison de penser qu’il ne pourrait en être de même avec le schéma ». C’est ainsi qu’« il fit des douzaines de croquis préliminaires », décidant de placer « tout en haut du parchemin une représentation de la Trinité, et tout en bas, l’écusson de l’Ordre Albertien » (Ibid.), bref, comme il explique au père abbé, « Une copie enluminée » (Ibid., p. 89. Souligné dans le texte). Et nous avons assez vu plus haut combien l’enluminure fut reçue par les personnes les plus variées comme possédant une beauté sublime et en tout cas largement supérieure à l’original, au point que même le rusé bandit s’est trompé. Or, le pape y lit un signe de la Providence – comme si le flot initial qui inspira Leibowitz continuait à couler, avec et par amour, au travers l’œuvre de son fidèle disciple.
Deux données confirment que Miller nous conte bien un don en écho. La première est l’attitude même de frère Francis. De manière générale, toute l’histoire met en scène non pas un « simple d’esprit » – le site parle d’« un jeune novice un peu simple d’esprit » –, mais d’un esprit simple, au sens le plus évangélique du terme, c’est-à-dire une âme humble, obéissante, persévérante, vraie, reconnaissante et bonne – autant de vertus attachées à la dynamique dative de l’amour. De manière particulière, dans le passage ci-dessus, nous voyons frère Francis exercer certaines de ces vertus, comme la charité, l’espérance persévérante (il aurait pu se décourager d’avoir dépensé autant d’énergie en vain pour représenter la couleur bleue) et l’obéissance (même s’il n’a pris l’initiative d’enluminer que dans le cadre général l’autorisant à y occuper le temps libre qui lui reste). Mais, surtout, sa motivation première à rehausser sa copie est la gratitude : « Cette copie dépouillée ne suffisait pas. Elle était froide, sans imagination et ne commémorait d’aucune manière visible les saintes qualités du Beatus » (Ibid., p. 86. Souligné par moi). Et, si le lecteur n’a pas compris, il est ajouté que le frère agit en prononçant une action de grâce : « Glorificemus, pensait Francis en travaillant aux ‘perpétuels’ » (Ibid.). Or, la gratitude est l’acte autant que la vertu perfectionnant la réponse du don.
Une confirmation est fournie par une autre donnée narrative qui interroge. En réalité, cette dernière se réfracte en trois. La première est la manière dont ce récit s’achève. Sur le chemin du retour, frère Francis va au devant du voleur non pas seulement pour lui « racheter » (chap. 11, p. 122) la copie enluminée avec les deux heklos d’or, mais pour répondre à sa question « Pourquoi ? ». Or, sans crier gare, il est tué par les deux complices encapuchonnés du voleur. Cependant, le plus étonnant n’est pas cette fin brutale et insignifiante, mais la manière dont elle est racontée, comme un banal fait divers, en une ligne. Les Difformes affamés s’approchent derrière Francis qui, assis, attend le voleur et, par mégarde, font rouler un caillou. Celui-ci se retourne. Miller écrit alors : « La flèche le frappa juste entre les deux yeux » (Ibid., p. 123). Rien n’est ajouté. Les deux dernières pages qui suivront ne mentionneront même plus le nom du moine et parleront encore moins des réactions du couvent à son absence.
La deuxième donnée est le temps passé, narrativement coûteux pour l’auteur et (peut-être) lassant pour le lecteur, à décrire les offices liturgiques, soit réguliers, dans le monastère, soit séculiers, dans la majestueuse basilique de la Nouvelle Rome. La dernière donnée concerne l’ensemble des trois nouvelles : elles ne mettent pas en scène non seulement de protagoniste commun (ce que les distance répétées de six siècles suffit à expliquer), mais des héros ou des anti-héros.
L’explication de cette banalisation et de cette anonymisation n’est pas l’impersonnalisation ou l’indifférence aux personnes – tout montre, au contraire, l’affection et même l’admiration que Miller leur porte. L’interprétation semble être la suivante : pour lui, le plus important réside dans la communauté (qui est une communauté ecclésiale). Or, l’acte premiet et constant de cette communauté est, avec la transmission, c’est-à-dire la communication, c’est-à-dire encore la transformation des dons reçus en dons offerts, la louange. Voilà pourquoi le récit montre en détail moines et fidèles en train de bénir Dieu. Voilà pourquoi le titre de la nouvelle est A Canticle for Leibowitz. Miller-Leibowitz souligne donc la centralité de cette réponse d’amour qu’est la gratitude et, plus encore, que le même élan de retour eucharistique anime celui qui bénit son Créateur et celui qui quête la vérité présente dans la créature.
Dans la multiplication actuelle très mode des récits dystopiques (post-apocalyptiques), la tentation est souvent de renvoyer dos à dos science et religion. Tel est par exemple le cas d’un autre roman loué comme l’une des références majeures en science-fiction, Spin [4] : face à la menace lancinante d’un engloutissement de la Terre par l’explosion finale du Soleil, les deux jumeaux qui, avec le narrateur, sont les principaux protagonistes, choisissent, l’un (Jason) la voie de la science, l’autre (Diane) celle de la religion – toutes deux présentées, surtout la seconde, comme de trompeurs chemins salvifiques. Qu’il nous est bon de constater que, dans ce genre, l’une des toutes premières œuvres et l’une des plus inspirées a su paisiblement concilier ce que ses héritières ont réactivement dissocié.
Pascal Ide
[1] Walter M. Miller Jr., Un cantique pour Leibowitz, trad. Claude Saunier, coll. « Présence du futur » n° 46, Paris, Denoël, 1961 : éd. rev. et compl. par Thomas Day, coll. « Folio. Science-fiction » n° 85, Paris, Gallimard, 2001. Nous citons la première éd. (qui est moins précise dans les termes, mais identique quant au fond), en notre possession. Je remercie Gabriel Morin de m’avoir poussé à relire cette nouvelle que j’avais découverte dans la coll. « Le Livre de poche. Grande anthologie de la science-fiction », éd. Démètre Ioakimidis, Jacques Goimard et Gérard Klein, Paris, Librairie générale française, sous le titre Histoires de la fin des temps ou Histoires de survivants à une époque où le genre dystopique était minoritaire. Notre résumé s’inspire en partie de la notice, consultée le 16 août 2021 : https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Un-cantique-pour-Leibowitz.html
[2] Cf. Louis Pauwels et Jacques Bergier, Le matin des magiciens. Introduction au réalisme fantastique, coll. « Folio » n° 129, Paris, Gallimard, 1960, p. 267-301.
[3] Cf. Sebastian Musch, « The Atomic Priesthood and Nuclear Waste Management – Religion, Sci-fi Literature and the End of our Civilization », Zygon. Journal of Religion and Science, 51 (2016) n° 3, p. 626-639.
[4] Cf. Robert Charles Wilson, Spin, trad. Gilles Goullet, coll. « Folio. Science-fiction » n° 362, Paris, Gallimard, 2015.