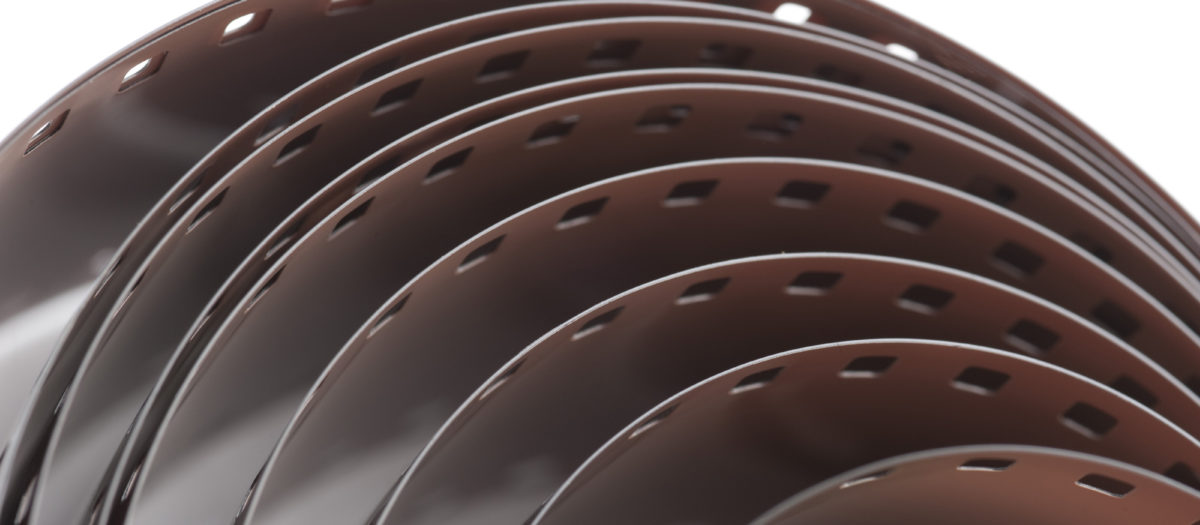Chapitre 5 : Fightclub
Fightclub, drame américain de David Flincher, 1999. Avec Edward Norton, Brad Pitt et Helena Bonham Carter.
Les scènes se déroulent de 0 h. 4 mn. 36 à 0 h. 9 mn. 57 (scènes 4 et 5) et de 0 h. 28 mn. 10 sec. à 0 h. 30 mn. 05 sec. (scène 11).
- a) Résumé de l’histoire
Le narrateur de Fight Club (Edward Norton) est un expert en assurances, spécialisé dans les accidents de voitures. Trentenaire célibataire désabusé, il souffre d’insomnie chronique et, plus encore, de son existence monotone. Il consulte un médecin qui refuse de l’assister par médication et lui suggère de participer à des thérapies de groupe contre des addictions et des maladies invalidantes. Le narrateur rejoint ainsi un groupe de victimes du cancer des testicules et s’aperçoit que se faire passer pour une victime lui permet de se sentir en vie et de soigner son insomnie rebelle. Il décide d’intégrer d’autres associations d’entraide. Il remarque alors qu’une femme, Marla Singer (Helena Bonham Carter), participe comme lui à toutes les thérapies de groupe. Incommodé par la présence d’un autre imposteur, il négocie avec elle pour qu’ils se répartissent les différentes séances hebdomadaires. Un troisième coup de tonnerre change définitivement son existence : revenant d’un voyage d’affaires, il fait la connaissance d’un charismatique vendeur de savon, Tyler Durden (Brad Pitt) qui lui laisse son numéro de téléphone à tout hasard. De retour chez lui, le narrateur découvre son appartement détruit par une explosion de gaz. Il décide de téléphoner à Tyler et les deux hommes se rencontrent dans un bar. Leur discussion sur le consumérisme amène le narrateur à se faire inviter chez Tyler pour y passer la nuit.
- b) Commentaire de la scène
Ce film corrosif est intéressant parce qu’il illustre deux réalités actuelles : l’hyperconsommation brute et son contraire qui est une autre forme, subtile, de consommation.
La première scène se déroule avant la rencontre avec Marla. Pour soigner son mal-être, le héros va des Alcooliques Anonymes aux Outremangeurs Anonymes en passant par le groupe des Acheteurs Compulsifs. Autrement dit, la société d’hyperconsommation s’étend des réalités matérielles aux réalités spirituelles. Elle l’excuse : Edward Norton souffre d’un stress aigu (aujourd’hui, on parlerait de burn out) que la médecine ne sait pas soigner et qui se traduit par une insomnie rebelle qui le transforme en zombie. Elle montre aussi que le mécanisme est toujours la recherche de soi, narcissique et seulement affective. Elle en atteste enfin le caractère illusoire : la présence de l’autre bouscule sa narcose mensongère, ici l’apparition de la jeune femme, Marla Singer.
Dans la seconde scène, l’on voit que, pour sortir de l’illusion de la consommation comme cause du bonheur, la tentation est grande de passer par le contraire, c’est-à-dire la sobriété pour la sobriété.
Le diagnostic est indéniable. Après son apologue du duvet, Tyler Durden le résume en une phrase : « Nous croyons posséder les choses, mais ce sont les choses qui nous possèdent ». Cette formule choc déclenche une supernova dans la tête du narrateur. Tyler ajoute un élément clé : « Mais c’est toi qui choisis, mec ». Autrement dit, le passage de l’hyperconsommation à l’anticonsommation n’est pas automatique ; il suppose une décision. Ce changement, radical, est-il une libération ? La suite et surtout la fin du film (que je dévoile donc maintenant, émoussant une bonne partie de son intérêt pour celui qui veut le voir) montre que le réalisateur n’a pas cédé à l’illusion symétrique.
De prime abord, le narrateur devient enfin lui-même. Il laisse libre cours à ce qu’il désire être. En découvrant le combat jusque dans ses excès, il cesse d’être réactif, pour devenir proactif. En choisissant un mode de vie sans exigences consommatrices, il cesse d’être la proie d’une société prédatrice. En mettant à distance – non sans violence – son supérieur, il se fait enfin respecter.
Au fait, pourquoi le narrateur n’est jamais nommé – au contraire de tous les autres personnages principaux ? Un homme libre n’est-il pas quelqu’un qui dit « je », qui est donc doué d’une identité repérable ?
Certes, le narrateur ne vit plus sous le regard des autres, il vit maintenant sous son propre regard. Mais de quel regard s’agit-il ? Celui qui, enfin, l’unifie et donc le pacifie tout en l’ouvrant ? Ou celui d’une partie de lui-même, et de la partie refoulée qui est la plus violente. En termes freudiens, le narrateur a opté pour le ça contre l’idéal du moi, en termes platoniciens, pour le cheval noir, contre le cocher qui doit régler l’énergie des deux chevaux, noir (l’agressivité) et blanc (le désir), qui nous conduisent.
La deuxième vie du narrateur s’avère donc tout aussi narcissisique que la première – la destruction en plus : elle est négatrice de tout lien avec la société (anarchie) et avec l’autre (l’incapacité à reconnaître Marla) et, pire encore, fait exploser sa personnalité, la clivant en une pathologie d’ordre psychotique.
Pascal Ide