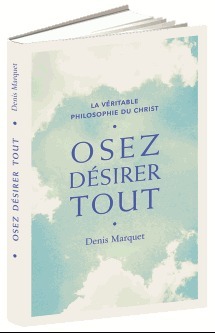Typographié en bleu, agréable de lecture, l’ouvrage de cet auteur à succès [1] qu’est Denis Marquet (DM) [2], La véritable philosophie du Christ [3], a de quoi séduire [4]. Toutefois, cette philosophie christique n’est pas chrétienne. Décryptage.
1) Un chemin
L’ouvrage du philosophe, romancier et thérapeute – qui s’est fait connaître par son livre sur l’éducation Nos enfants sont des merveilles [5] –, se présente au fond comme un parcours. Comme le très célèbre sermon de Bénarès où le Bouddha a condensé l’essentiel d’une doctrine qui est d’abord une pratique (l’auteur le cite p. 42-43), il pourrait se décliner en quatre étapes : 1. diagnostic symptômatique (discerner les signes) ; 2. diagnostic étiologique (discerner la cause) ; 3. thérapeutique symptômatique (traiter les signes) ; 4. thérapeutique étiologique (guérir la cause).
- Multiples sont les signes de souffrance actuelle : la préoccupation de l’inessentiel ; le souci de qui prétend être nécessaire ; l’avidité pour les biens extérieurs qui finissent toujours par nous manquer et nous frustrer.
- La cause de ces multiples maux est unique : l’homme « désire partiellement » (p. 65) ; autrement dit, il n’écoute pas le désir d’infini présent dans son cœur. Plus encore, il n’en vit pas : « lorsque nous cherchons à combler par des biens finis un désir infini, nécessairement nous sommes frustrés nous souffrons. Telle est notre maladie existentielle » (p. 52). Ne pas vivre de ce désir d’infini rend proprement « malade » (p. 20).
- Le remède consiste dès lors à désirer rien moins que l’infini, c’est-à-dire Dieu. Le sous-titre le dit et le texte le répète (beaucoup !) : « Osez désirer tout », c’est-à-dire l’infini. Autrement dit, la sagesse contre l’avidité.
- Désirer l’infini ne suffit pas. Encore faut-il l’attendre de l’infini, c’est-à-dire le demander à Dieu et le recevoir de lui : « L’infini, nous ne pouvons que le recevoir » (p. 193).
2) Des stimulations
Se positionnant avec équilibre entre un libéralisme occidental malade d’un désir seulement tourné vers le fini et un bouddhisme oriental qui renonce au désir – même si « la relation du bouddhisme au désir est plus complexe qu’on ne le dit parfois » (p. 49) –, l’ouvrage opte en faveur d’une philosophie christique. Contre le bouddhisme, elle défend la positivité du désir : certes, « la voie du Bouddha et la voie du Christ proposent un diagnostic proche. Notre désir est malade » (p. 48) ; en revanche, « la guérison christique ne consiste pas à renoncer au désir, mais à réparer le désir » (p. 49). Contre le consumérisme insatiable autant qu’insatisfait parce qu’il cherche « l’infini dans le fini » (p. 58), la philosophie du Christ promeut le désir de l’infini. Plus encore, La véritable philosophie du Christ peut faire du bien, et pas seulement à des peu croyants, mais aussi à des catholiques. Notamment pour les raisons suivantes (dont la liste n’est pas exhaustive [6]) :
- DM rappelle que l’homme est habité par un désir d’infini et que tous les manques ressentis n’ont pas d’autre sens que de lui rappeler cet appel de l’infini. « La philosophie du Christ est une philosophie du bonheur » et « un bonheur qui repose sur l’audace d’oser désirer l’infini » (p. 15). La conséquence concrète en est que l’homme est appelé à cesser de donner la « priorité » à « ce qui n’est qu’accessoire » (p. 39) et de
« le considérer comme un reste » (p. 40). « Ce que le Christ propose, c’est une voie pour entrer dans une parfaite abondance » (p. 39). Il est aussi salutaire pour le chrétien de réentendre : « Notre désir d’infini peut-il être comblé ? Prudemment, la sagesse [humaine] affirme que non. Le Christ répond oui » (p. 60).
DM le formule aussi avec d’autres catégories. L’homme est tiraillé entre sa nature divine qui désire intensément et pleinement l’infini, et sa condition humaine qui le conduit à attiédir son désir et désirer le fini (p. 70-72) ; cette condition est « ce que l’on appelle la ‘chute’ » (p. 117).
- DM permet au chrétien absorbé par l’extérieur de redécouvrir le « lieu juste » qui est « à l’intérieur de nous-mêmes » (p. 46). En ouvrant le premier chapitre sur la parole de Jésus : « Cherchez d’abord son règne [de Dieu] et sa justice, et tout cela vous sera donné de surcroît » (p. 36 : Mt 6,33), il énonce ainsi deux règles de vie salutaires : orienter son désir sur ce qui est prioritaire, l’infini : « La philosophie du Christ nous appelle à réorienter notre désir » (p. 58) ; croire que le reste sera donné. Autrement dit, se centrer sur le désir d’infini qui est intérieur et cesser de vivre selon la logique du besoin qui est extérieur et inessentiel (p. 45-48).
- DM invite à sortir d’une vision étroitement moralisante et culpabilisante. Il rappelle, par exemple, que « la véritable philosophie du Christ » « prohibe absolument » le fait d’« être dans le jugement » (p. 28). En relisant notamment le récit de la chute, en Gn 3, il rappelle aussi de manière heureuse que le serpent tente l’homme en l’invitant à se substituer à Dieu ; or, en voulant être l’origine de son être (cf. p. 95), l’homme refuse d’être « manque » (p. 90). De ce point de vue, certains lecteurs, qui ne sont pas familiers de la théologie du corps, ont été touchés par l’interprétation de cette mystérieuse honte originelle, que DM appelle « honte existentielle » (p. 97) : désormais, l’homme existe « comme objet du regard d’autrui » (p. 97) ; dès lors, ma souffrance est « que mon apparaître trahisse ma vérité » (p. 98). Le mal dicte le remède, dessine le « retournement » : « Cesser de me croire engendré par le regard des autres sur moi pour me connaître engendré par un amour infini » (p. 101). Autrement dit, guérir, c’est passer de l’extérieur à l’intérieur – « Obnubilé par l’extérieur, […] je ne sais plus écouter mon intériorité » (p. 103) –. Nous n’avons pas quitté l’unique intuition de l’ouvrage que DM décline avec rigueur : l’homme qui a Dieu, c’est-à-dire l’infini, pour « véritable origine » (p. 105), est fait pour l’infini ; inversement, en demandant à l’autre, qui est fini, de le combler, il cherche à combler sa brèche infinie en se recevant du fini.
- DM affronte l’objection selon laquelle les commandements du Christ sont impraticables. Comment être parfait « comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5,48 : p. 172) ? Une nouvelle fois, DM retourne une difficulté onéreuse en une solution lumineuse. Il interprète la tension entre l’impossible et le nécessaire, comme l’occasion pour l’homme de s’appuyer sur Dieu seul : « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible » (Mt 19,25 : p. 173). « La philosophie du Christ demande à l’être humain ce qu’il est incapable d’accomplir afin qu’il laisse Dieu l’accomplir en lui » (p. 174). Il est bon de lire : « Il s’agit de laisser la grâce nous rendre parfaits » (p. 183). Il est bon qu’à longueur de pages, DM rappelle, voire rabâche que « le règne de Dieu n’est possible que si je retire le moi de sa position d’origine » (p. 163) pour redonner à l’infini sa juste place.
- Ainsi, avec beaucoup de cohérence, DM ouvre l’homme en aval et en amont. Il ne se contente pas, dans ses premiers chapitres, de montrer que l’homme est malade de se nourrir de ce poison qu’est le fini, mais il établit, dans son dernier chapitre, qu’il ne peut recevoir cet infini divin que de l’infini, c’est-à-dire de la grâce. L’infini est la finalité (oméga) de l’homme, parce qu’il en est aussi l’origine (alpha).
Ce faisant, notre auteur ébauche une philosophie du don (en particulier dans le chapitre 6). Comment ne pas se réjouir de lire : « De Dieu, ce mystère absolu, la Bible nous enseigne qu’il est, et qu’il donne son être ; donc, que son être est don » (p. 191. Souligné dans le texte), même si nulle référence n’est donnée ? Ou de lire que l’« un des aspects les plus essentiels, et les plus méconnus, de la philosophie du Christ réside dans sa théorie de l’abondance » (p. 202), surtout lorsqu’est aussitôt conjurée l’interprétation libérale de l’abondance qui est recherche égoïste de son intérêt (cf. p. 202-204).
- DM revalorise la pensée symbolique, perdue selon lui depuis le xviie siècle, au profit de la seule pensée rationnelle (p. 83 s). La seconde porte sur ce qui est extérieur à nous et a conduit au développement technoscientifique performant que nous connaissons. La première, « l’intelligence symbolique, elle, porte sur un ordre de réalité qui se passe à l’intérieur de nous et qui est toujours actuel » (p. 84). Cette découverte de l’intelligence symbolique conduit au passage du grec à l’hébreu [7], y compris dans le Nouveau Testament : « le grec des Évangiles » est « semé d’hébraïsmes » (p. 127). Bref, « l’enseignement du Christ parle davantage au cœur […] qu’à la tête » (p. 25).
Certes, le chrétien n’ignore souvent pas ces vérités, mais, à la lecture de DM qui les formule de manière nouvelle, unifiée, humoristique, concrète, dialogante [8] et simple, il en redécouvre la profondeur existentielle. Par exemple, lorsqu’il dit : « Il m’est impossible de combler la brèche entre ma nature et ma condition. [Donc] il est nécessaire que cette brèche soit comblée » (p. 189), notre auteur dit quelque chose de la doctrine classique de la grâce selon laquelle Dieu n’est pas seulement le terme surnaturel de notre vie (la cause finale), mais aussi son origine surnaturelle (la cause efficiente).
3) Des interrogations. Une accentuation trop grande sur l’infini
Cela posé, l’ouvrage requiert une évaluation précise – d’autant plus qu’il se présente avec emphase comme La véritable philosophie du Christ (cf. p. 24-25). Pointons d’emblée le principe implicite qui, à mon sens, commande tout le propos : le désir d’infini sacrifie le fini. Il n’est jamais énoncé avec une telle limpidité, mais, omniprésent, il fonde une bonne partie des affirmations de DM.
Cette clé de lecture permet de lever les ambiguïtés, voire les erreurs, théoriques et pratiques, fourmillant dans l’ouvrage.
a) Une négation du mal
« Penser en termes de culpabilité n’est en rien suivre la philosophie du Christ » (p. 121). C’est au nom même du refus de la finitude que DM récuse le mal et le péché.
En effet, le mal est « une certaine absence de bien » (p. 91 [9]). Or, l’absence est une privation. Donc, le mal n’existe pas ; seuls « ses effets existent » (p. 92) : « Si le bien est tout ce que Dieu crée, le mal désigne nécessairement une réalité qui n’est pas créée par Dieu » (p. 93). DM est ainsi conduit à des affirmations simplistes autant qu’irrecevables : « Dieu ne connaît pas la distinction du bien et du mal » (p. 90) ; « Parfaitement innocent, il [Dieu] ne voit pas le mal. Il n’est qu’amour » (p. 118) ; « La connaissance du bien et du mal n’a aucun objet réel » (p. 122).
Non seulement, le mal est privation du bien, et donc finitude, mais il consiste toujours à préférer le fini à l’infini. Pour le montrer, le chapitre 2 propose une réinterprétation de l’épisode de la chute en Gn 3 qui fait fi du péché. En effet, le désir avide n’est pas un mal, mais « vise mal » (p. 57). Et si DM accepte de parler de péché, il reconduit le terme à son étymologie, autant grecque qu’hébraïque : « rater la cible » (p. 57).
Au chapitre 3, DM réinterprète aussi la parabole de l’enfant prodigue (cf. Lc 15,11-32) au-delà du péché : il n’y a « aucun mal dans cette expérience que fait l’humain de s’éloigner de Dieu » (p. 115). D’une part, le fils ne faute pas puisque son expérience de la faim était nécessaire pour qu’il prenne conscience du manque qui est en lui : « n’avons-nous pas besoin de souffrir pour nous souvenir de notre vrai désir ? » (p. 120). D’autre part, le père « respecte sa liberté, et mieux : il collabore à son désir » (p. 119) ; d’ailleurs, à son retour, « il accueille son fils sans aucun jugement, non comme un pécheur » (p. 118). En faisant de cette parabole un rite d’apprentissage et du péché originel une crise de croissance adolescente, DM retrouve l’interprétation que les Lumières avaient proposée, annulant toute la dramatique de la chute et donc du salut [10].
Puisque DM récuse la culpabilité, l’homme apparaît beaucoup plus blessé que pécheur : « Notre maladie est existentielle » (p. 42). D’ailleurs, la « dualité du bien et du mal dont la Bible nous apprend qu’elle est la racine même de notre maladie » (p. 44).
À celui qui objecterait que, si nous manquons parfois d’innocence, nous sommes donc alors coupables, DM répond par une analogie qui est plus qu’une analogie : « Personne n’est coupable de faire un cauchemar. Il s’agit juste de se réveiller, et de redécouvrir la conscience du réel. Et le réel, c’est l’innocence » (p. 132). Ainsi, la conversion est reconduite à un éveil. DM ne retrouve-t-il pas – non sans paradoxe, parce que nous rencontrerons plus bas son anti-hellénisme – la doctrine socratique de la vertu-science qui réduisait la faute à une ignorance, et annulait donc la liberté ?
Et à celui qui objecterait que Jésus lui-même parle de péché, par exemple à la femme adultère : « Va et ne pèche plus » (Jn 8,10), DM répond que Jésus « formule sa philosophie de l’innocence dans le langage de ses auditeurs qui ne connaissent que le jugement et la culpabilité » (p. 126). Prouvant une chose et son contraire, notre auteur tombe sous le critère poppérien de la non-réfutabilité.
Voilà aussi pourquoi il prétend que « les conséquences du péché originel peuvent être, dès à présent, dépassées et annulées » (p. 39), alors que la doctrine du Concile de Trente a toujours maintenu que demeure ce qu’elle appelle d’une expression aujourd’hui assez impénétrable, « le foyer de concupiscence ». DM porte son réquisitoire contre la doctrine du péché originel lui-même (p. 84-86), avec des arguments simplistes depuis longtemps récusés par la théologie et une ignorance de l’actuelle évolution sur la doctrine des limbes d’ailleurs confondues avec l’enfer [11].
DM en tire une dernière conséquence : puisqu’il n’y a de jugement que du péché, « il n’y a donc pas de jugement dernier ». D’ailleurs, le jugement porte sur le bien et le mal ; or, « Dieu ignore le mal » (p. 129).
b) Une négation de la morale
Voilà aussi pourquoi, surfant sur une vague bien actuelle, DM affirme que « la philosophie du Christ exclut toute forme de morale » (p. 167), et y consacre tout le chapitre 5 de son livre. En effet, loin d’annuler l’exigence, le Christ « la pousse à son maximum » (p. 170). Par exemple, au commandement « Tu ne commettras pas d’adultère » physique, il en substitue un beaucoup plus radical : « Tu ne commettras pas d’adultère dans ton cœur » et dans ton regard (cf. Mt 5,27-28 : p. 170). Or, « une morale pense le bien et le mal en relation avec la réalité concrète », donc de manière relative. Par conséquent, étant absolu, « l’enseignement du Christ n’est pas une morale » (p. 171). Autrement dit, c’est encore au nom de l’infini, qui se traduit ici en termes de radicalité ou d’excès, que DM nie toute éthique : « Jésus n’a pas de vision du bien ; il a besoin de la perfection » (p. 175). Comme si per-fectum ne signifiait pas, étymologiquement, « ce qui est achevé » et que bonum n’était pas l’être dans son achèvement, donc dans sa per-fection [12] ? Qu’il est regrettable que notre auteur ignore l’enseignement de la Tradition qui a toujours intégré ce surcroît : « La mesure d’aimer est d’aimer sans mesure [13] ». Si les vertus morales (découvertes par les Grecs) sont mesurées par un juste milieu, les vertus théologales (énoncées par l’Évangile) sont, elles, sans mesure [14].
Dès lors, pour DM, l’infini devient l’unique source de la joie et la finitude source de tristesse : nous sommes ainsi « entre la joie sans limite qui est notre nature et la souffrance de notre condition » (p. 216). Ricœur affirmait de manière encore trop stoïcienne que « l’homme est la joie du oui dans la tristesse du fini [15] ». La véritable formule chrétienne serait plutôt celle-ci : l’homme est la joie reconnaissante du oui pour la médiation positive du fini.
c) Une négation de la foi et de la grâce
De prime abord, DM accorde une grande place à la foi : « la foi joue un rôle essentiel dans ma vie » (p. 51). Il parle de la grâce et de la foi, qu’il relit à partir du don et de la réception : « La grâce est don […]. La foi est la disposition qui permet de la recevoir » (p. 247). Mais s’agit-il de la vertu théologale et du don surnaturel de la grâce ?
Certes, la foi est fermement distinguée de la raison : celle-ci est limitée au savoir passé et aux possibles expérimentés, alors que la foi est ouverte au tout-possible qui peut advenir. Elle est une sorte de contact avec la Source intérieure infinie qui ne cesse de couler en moi. Néanmoins, en dépassant le savoir, la foi demeure enclose dans la conscience – « la foi est l’ouverture de la conscience humaine à une dimension intérieure qui transcende les limites du savoir » (p. 248) – et ne s’identifie en rien à un don surnaturel ; elle consiste encore moins en la rencontre de la personne de Jésus. C’est ici que les assertions de celui qui propose une « philosophie du Christ » se rapprochent le plus de la gnose [16]. La grâce étant une participation finie à la nature divine (cf. 2 P 1,4), comment s’étonner que DM en ignore l’essence ?
Trois signes le confirment, qui tous sont des avatars de la préférence exclusive accordée à l’infini.
D’abord, DM accorde une préférence exclusive à l’expérience, versus la foi et la grâce. « La philosophie du Christ […] s’adresse à des êtres qui osent faire des expériences » (p. 194) ; « Le chercheur spirituel ne doit pas croire, car nous croyons toujours ce qui nous arrange, mais expérimenter » (p. 195). Cette expérience – du cœur et non de la raison (cf. p. 25) – s’accorde là encore avec cette philosophie de l’infini : limitée ni par le concept ni par le dogme, elle s’adapte noétiquement à l’infini ontologique du Dieu qui se donne.
Ensuite, la source de la grâce est l’amour divin ; or, DM ne parle jamais d’amour – sauf à la toute fin… pour reconnaître qu’il en a « très peu parlé » (p. 255). Mais, justement, l’amour est ce qui introduit de l’altérité, donc de la limite.
Enfin, l’ouvrage est traversé par la tentation quiétiste. Il s’ouvre sur un commentaire de la parabole de Jésus sur les lis des champs qui « ne peinent ni ne filent » : Jésus « évoque la possibilité de vivre sans travailler ! » (p. 37) Au terme, il affirme que « la grâce n’a pas besoin de temps, car elle agit dans le temps de manière immédiate » et « s’adresse à des êtres qui n’ont pas le temps : voilà pourquoi elle « n’a jamais été aussi actuelle » (p. 188). Bref, « il s’agit d’arrêter de prétendre être celui qui fait les choses » (p. 190) ; « Je n’ai donc rien à faire » (p. 201). Au royaume du pur infini, le moi qui compte parmi les réalités finies, doit donc aussi être remisé. Cet absolu de la grâce ne va pas sans un refus de la psychologie : « La notion de travail sur soi suppose toujours un moi en position d’origine », alors que « la philosophie du Christ enseigne au contraire à retirer le moi de la position d’origine et de laisser cette place au divin » (p. 281, note 31).
d) Une négation du moi
Toujours au nom de ce primat unilatéral de l’infini, DM critique fortement non seulement l’ego – la philosophie du Christ « veut sa mort » (p. 255) –, mais aussi le moi : « Dès que je fais quelque chose, c’est encore moi qui suis à l’origine ; c’est moi qui règne en moi » (p. 189). Voilà pourquoi il en arrive à nier la liberté comme capacité de choix pour la réduire, de manière stoïcienne, à être une simple capacité de consentement (en l’occurrence au souffle divin qui me traverse) : « Ma liberté ne tient pas dans le fait de faire des choix et de donner mes raisons. Tout cela est une illusion. Néanmoins, je suis libre. Car j’ai la capacité de discerner les forces qui me traversent » (p. 235). Bien évidemment, le passage de la vertu au don, qui caractérise l’entrée dans les Quatrièmes demeures, est un passage de l’activité à la passivité spirituelle. Mais tous les spirituels savent que le don n’a jamais annulé la vertu.
DM valorise tellement la Source divine en nous, qu’il annule notre capacité à être source dans la Source. L’homme en est réduit à être une simple courroie de transmission : « L’homme ne peut être l’origine de l’infini, mais peut être traversé par l’infini » (p. 215. Souligné dans le texte). Notre auteur le formule dans un énoncé paradoxal : « On ne peut donner que ce que l’on n’a pas » (p. 212) – ignorant sans doute que cette formule est d’origine plotinienne et caractérise l’Un, qui est l’autre nom de Dieu pour le mystique grec [17].
En écrasant le fini, DM en arrive à écraser l’épaisseur même du temps. Voilà pourquoi il soutient cet autre paradoxe : « vivre la gratitude avant d’avoir reçu », parce que « la gratitude est l’attitude qui permet de recevoir la grâce » (p. 219).
e) Une exténuation de la raison
Puisque la philosophie grecque a identifié le fini au parfait, donc l’infini à l’imparfait, DM attaque la pensée grecque qui est « une philosophie étrangère à [l]a pensée » du Christ (p. 25). Outre l’ignorance, étonnante pour un philosophe, que, le premier, le philosophe grec Plotin, a proposé une philosophie positive de l’infini, notre auteur recycle l’opposition facile et éculée de Jérusalem et d’Athènes [18].
En opposant trop durement pensée grecque et pensée hébraïque, intelligence rationnelle et intelligence symbolique, DM projette au plan épistémologique la tension du fini et de l’infini pour récuser le premier au nom du second.
f) Une négation des médiations
Tout ce qui est extérieur est matériel, donc, limité ; seul l’intérieur est spirituel, donc peut être véritablement infini, ou ouvert à celui-ci. DM se méfie des médiations extérieures. D’où l’aveu de son ambivalence dès son « plus jeune âge » : « les enseignements religieux [du Christ] qui m’étaient transmis m’empoisonnaient », mais « ils abritaient une profonde et radicale vérité » (p. 18) qui « touchait une partie plus profonde de mon être » (p. 19).
Puisque l’institution est finie, limitée, DM s’oppose à « une certaine transmission religieuse qui l’a […] institutionnalisée » (p. 14), autrement dit à l’Église, ce qui ne peut pas ne pas plaire à l’« esprit du temps », auquel dans la même phrase DM s’oppose aussi avec courage. C’est ainsi qu’il consacre un chapitre entier (4) à parcourir l’histoire de l’Église en prétendant montrer que celle-ci a trahi l’Évangile. En effet, à la parole du Christ annonçant « le règne de Dieu est à l’intérieur de vous » (Lc 17,20 : p. 140), elle a substitué un règne tout extérieur. À vrai dire, DM fustige surtout « la modernité [qui] ne veut pas le règne de Dieu, mais le règne du moi » (p. 147).
Devant cette méfiance généralisée à l’égard des institutions et des médiations, l’on pourrait poser une question à DM : au nom de quoi privilégier la Bible ? Celle-ci fut constituée par l’Église, se reçoit d’une Tradition. N’y a-t-il pas là une contradiction ?
g) Une identité problématique du Christ
L’image que DM propose est-elle adéquate à ce que le Christ montre et dit de son être ?
De Jésus, sont surtout retenues les paroles. Mais quelles paroles ? Jésus apparaît comme un guérisseur et non comme un sauveur. Jésus est venu pour « guérir » et proposer « une thérapie » (p. 42) : son « enseignement […] permet à chacun de parvenir à la santé parfaite » (p. 43). Ce faisant, à aucun moment, il n’apparaît comme celui qui accomplit l’Ancien Testament. DM déroule ainsi les conséquences du primat de l’infini : ne sont retenues que les paroles de Jésus ouvrant l’homme à son infinité intérieure.
Tout aussi cohérente est la position de DM sur les actes de Jésus, en particulier sur le miracle qu’il estime non pas impossible, mais peu pertinent. En effet, pour une « intelligence symbolique », seule importe « la réalité intérieure et toujours actuelle ». Or, le miracle est un signe sensible, extérieur. Donc, « la réalité du miracle comme événement extérieur et dans le temps importe peu » (p. 206). Ainsi réinterprété, le miracle de la multiplication des pains (Mt 14,13-21 : p. 205) « nous dévoile l’attitude existentielle qui rend possible de créer en soi, autour de soi et à travers soi une abondance qui a sa source en Dieu » (p. 209). Pour une fois, paradoxalement, DM pèche par défaut d’infini. En accentuant unilatéralement l’intériorité, c’est-à-dire l’immanence, il minimise la transcendance du mystère.
Enfin, DM ne parle pas de la passion du Christ. Mais comment s’en étonner ? En toute cohérence avec le principe herméneutique d’infinité, comment considérer comme signifiant (au sens étymologique), ces souffrances qui inscrivent le Christ dans la finitude ?
Cela veut-il dire que, pour DM, Jésus serait Dieu ? Mais la question même de Dieu est-elle pertinente ? De fait, notre auteur parle beaucoup plus de l’infini que de Dieu. Et toujours au nom du primat de l’infini sur le fini. Voilà pourquoi il répond à la question « croyez-vous en Dieu ? » par une « pirouette » : « je ne saurais répondre ni par oui ni par non » (p. 50). En effet, définir, c’est, étymologiquement, délimiter. « Or, Dieu est le concept d’un être infini » (p. 51). Aussi DM refuse-t-il d’adhérer « à aucune idée de Dieu » (p. 51). Ainsi, Jésus apparaît comme un maître de sagesse pour l’homme et non comme le révélateur du Père (cf. Jn 1,18 ; 14,6.9).
h) Une conception ambiguë de l’infini
Enfin, cet infini dont parle sans cesse DM n’est jamais ni décrit, ni interrogé. En effet, il y a trois sortes d’infini : l’infini matériel, c’est-à-dire cosmologique ; l’infini intérieur ou spirituel, c’est-à-dire anthropologique ; l’infini proprement divin, c’est-à-dire théo-logique. Or, ce dernier se caractérise non pas tant par sa transcendance que par sa descendance, si je puis dire, c’est-à-dire son caractère descendant : Dieu prend lui-même l’initiative de se révéler. Mais, si DM défend « la transcendance » (p. 29), il part toujours du désir de l’homme, c’est-à-dire de son intériorité qu’il dilate au maximum. Le Christ et le Dieu dont il élabore la philosophie sont donc subtilement, mais réellement, mesurés par l’homme. « Dieu est le nom que je donne à l’infini qui me manque […]. C’est en ce sens que je ‘crois’ en Dieu. J’ai foi en mon désir » (p. 59). La véritable philosophie du Christ constitue donc un nouvel avatar de ce que Balthasar appelle « la voie anthropologique » [19].
Conclusion
Le pape François va répétant que ce dont, avec la miséricorde, notre monde a le plus besoin aujourd’hui, c’est le discernement. Comment ne pas se réjouir qu’un philosophe propose une « véritable philosophie du Christ », « ouvre à ce qu’il y a de vivant dans les Écritures [20] », en parle positivement, se nourrisse de ses enseignements, interprète ses paraboles, ne le cite pas simplement à côté de Gandhi ou du chef amérindien Seattle. Mais, au fait, de quel Christ nous parle-t-il ?
En sacrifiant le fini sur l’autel de l’infini, en optant pour l’intérieur contre l’extérieur, le philosophe-thérapeute propose un mixte ou plutôt une mixture improbable bouddhisto-chrétienne [21]. Avec beaucoup de rigueur et de vigueur, conjuguant pensée et vie, DM déroule toutes les conséquences de ce qu’il pense être une philosophie du Christ, mais n’est au fond qu’une philosophie spiritualiste (mais naturaliste) de l’infini.
En termes métaphysiques autant que théologiques, DM nie les causes secondes pour mieux faire valoir l’efficace de la Cause première. De même que l’infini annule le fini, de même, selon lui, la dynamique divine ne peut agir que si la dynamique humaine est devenue inactive. Tout au contraire, la théologie catholique – dont la forme est inclusive et non pas exclusive – tient qu’entre le Créateur et la créature, il n’y a pas concurrence (« ou Dieu ou l’homme »), mais concours (« et Dieu et l’homme »). Autrement dit, il n’y a ni univocité (erreur bouddhiste), ni équivocité (erreur de DM), mais « analogie » (Sg 13,5 [22]).
Disons-le encore autrement, dans les termes d’une métaphysique de l’amour-don. La dynamique du don distingue trois moments : recevoir, s’approprier, se donner. Or, DM valorise considérablement la réception – « La philosophie du Christ a donc pour seul objectif de nous apprendre à recevoir » (p. 220) –, accorde très peu de place à la donation, c’est-à-dire à l’amour – nous l’avons vu ci-dessus – et aucune à l’appropriation – c’est-à-dire au moi. S’il honore l’infini qui est à l’origine et au terme, DM exténue par trop la finitude qui accueille ce don et le redonne. L’insistance unilatérale sur cette vérité biblique, trop oubliée par le libéralisme, l’impatience des limites [23], a conduit DM à nier cette autre grande vérité biblique qui, elle, est trop désavouée par le bouddhisme : la bénédiction des limites. Pour reprendre une image de saint Bernard, DM propose une philosophie du canal et non pas de la vasque [24].
Contre ce nouvel avatar de la christologie infinitisante qu’est le monophysisme (Jésus recyclé en monergisme et monothélisme, Maxime le Confesseur confessait la double volonté, finie et infinie du Christ et disait de lui qu’il est la synthèse du fini et de l’infini. Un millénaire plus tard, à la dialectique hégélienne digérant toute figure finie dans l’infinité de l’Esprit absolu, Kierkegaard se refusait, lui aussi, de sacrifier l’un des deux pôles et affirmait que dans l’existence humaine converge l’instant et l’éternité, le fini et l’infini.
[1] Il est auteur de six livres. Son premier roman, Colère (Paris, Albin Michel, 2001) s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires.
[2] Pour une première présentation du parcours atypique de l’auteur, cf. Claire Lesegretain, « Denis Marquet, chercheur sur la ‘voie christique’ », La Croix, 13 mai 2016, en ligne, consulté le vendredi 26 avril 2019 : https://www.la-croix.com/Religion/Denis-Marquet-chercheur-voie-christique-2016-05-13-1200759832
[3] Denis Marquet, La véritable philosophie du Christ. Osez désirer tout, Paris, Flammarion, 2018.
[4] Il a été invité sur Radio Notre-Dame comme « grand témoin ». Cf. l’émission en ligne, consultée le vendredi 26 avril 2019 : https://radionotredame.net/emissions/legrandtemoin/05-11-2018/
[5] Paris, NiL, 2012.
[6] Comment, par exemple, ne pas se réjouir de la réfutation de Nietzsche au ras même de sa critique du christianisme comme prétendu « ressentiment contre la vie » (p. 66) ?
[7] D’où l’intérêt pour la lecture quelque peu discutable d’Annick de Souzenelle (note 39, p. 269).
[8] DM dialogue avec un objecteur inventé, maladroitement appelé Lecteur Zéro, même s’il tente de le justifier (p. 38).
[9] Citation rapportée à saint Thomas, mais qui provient des Grecs, décidément mal aimés
[10] Cf. Bernard Pottier, Le péché originel selon Hegel. Commentaire et synthèse critique, Namur, Culture et Vérité, 1989, Partie conclusive, p. 215 s. Cf. aussi l’état des lieux du même auteur, « Interpréter le péché originel sur les traces de Gaston Fessard », Nouvelle revue théologique, 111 (1989), p. 801-823.
[11] Cf., par exemple, Dom Jean Pateau, Le salut des enfants morts sans baptême d’après saint Thomas d’Aquin. Où est Abel mon frère ?, Paris, Artège Lethielleux, 2017 ; Étienne Dumoulin, « Le salut des enfants morts sans baptême. À propos de l’ouvrage de Dom Jean Pateau », Revue thomiste, 118 (2018), p. 313-330 ; Jean-Marie Hennaux, « Faut-il encore parler des limbes ? », Nouvelle revue théologique, 135 (2013) n° 3, p. 549-568 ; « Le salut des enfants morts sans baptême » Nouvelle revue théologique, 2019 (141) n° 1, p. 114-125.
[12] Cf. Saint Thomas d’Aquin, Somme de théologie, Ia, q. 5, a. 1.
[13] Saint Bernard de Clairvaux,Traité de l’amour de Dieu, dans Œuvres mystiques, trad. Albert Béguin, Paris, Seuil, 1953, p. 29. L’origine de la formule est augustinienne : « Amandi Deum modus est sine modo » (S. Augustin, 11e sermon, Vingt-six sermons au peuple d’Afrique, trad. François Doubleau, coll. « Études augustiniennes », Paris, Brépols, 1996, 22009, p. 59-67).
[14] Cf. Saint Thomas d’Aquin, Somme de théologie, Ia-IIæ, q. 64, a. 4 ; IIa-IIæ, q. 24, a. 7.
[15] Paul Ricœur, Philosophie de la volonté. II. Finitude et culpabilité. 1. L’homme faillible, Paris, Aubier, 1960, p. 156.
[16] C’est ainsi que cette suspicion généralisée à l’égard du fini, conduit DM à des formulations ambiguës lorsqu’il assimile la distinction nature-condition avec la distinction du spirituel et du charnel (p. 207).
[17] Cf. Jean-Louis Chrétien, « L’un donne ce qu’il n’a pas », Archives de Philosophie, 43 (1980) n° 2, p. 263-277 : La voix nue. Phénoménologie de la promesse, coll. « Philosophie », Paris, Minuit, 1990, p. 159-174.
[18] Pour une fine réfutation de cet antihellénisme, cf. Benoît XVI, Discours à l’Université de Ratisbonne, 12 septembre 2006.
[19] Cf. Hans Urs von Balthasar, L’amour seul est digne de foi, trad. Robert Givord, Paris, Aubier-Montaigne, 1966, rééd. Saint-Maur, Parole et silence, 1999, chap. 2.
[20] Claire Lesegretain, « Denis Marquet… ».
[21] Voilà pourquoi, notamment en insistant sur « les clés de l’abondance » auxquelles il accorde un chapitre entier (6), les développements de DM ne sont pas sans rappeler la « loi d’attraction », dans son interprétation moniste.
[22] Cf. aussi Concile Latran IV, 1215, Dz 804.
[23] Cf. l’œuvre de sagesse de Stanislas Fumet, L’impatience des limites. Petit traité du Firmament, Lyon, Éd. du Livre Français, 1942.
[24] Je me permets de renvoyer à Pascal Ide, Le burnout. Une maladie du don, Paris, L’Emmanuel et Quasar, 2015, p. 56-58.