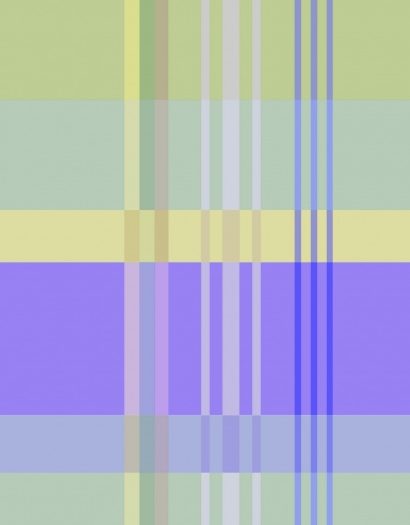E) Évaluation critique
1) Topique
Élisabeth Roudinesco remarque que la critique du freudisme fut successivement : c’est une science allemande pour barbares germaniques ; Freud ramène tout au sexuel ; et aujourd’hui : « Maintenant, on n’accuse plus la psychanalyse d’être responsable du malaise individuel – par exemple d’inciter à divorcer –, mais on a tendance à lui reprocher de ne rien guérir [1] ». Cela me semble un peu court…
Le psychanalyste jésuite (il tenait à ce titre sans la conjonction de coordination « et ») belge Louis Beirnaert propose une typologie quadripartite [2]. Certes, sa proposition intéresse au premier chef la question des relations de la foi et de la psychanalyse ; mais, la philosophie posant l’existence d’une Cause première transcendante et d’une âme spirituelle et immortelle en l’homme, on peut d’une certaine manière rapprocher foi et philosophie dans cette perspective. Il faudra donc élargir ce qui va être dit de la foi à la philosophie notamment de l’homme [3].
- La position exclusiviste. Cette première position, celle du refus réciproque, consiste à dire, côté psychanalyse qu’elle conduit nécessairement à l’abandon de la foi et côté foi chrétienne, à refuser la psychanalyse comme essentiellement athée et antireligieuse. Un bon exemple en sont les positions du professeur de psychiatrie juif Henri Baruk (dont l’antifreudisme est virulent) ou du philosophe contemporaine Michel Onfray.
- La position dualiste. Cette seconde position se fonde sur un modus vivendi départageant la réalité en deux champs bien délimités : le pathologique, l’infantile et l’archaïque auquel s’intéresse la psychanalyse ; le religieux proprement dit dont traite la foi [4].
- La position homologue. Une troisième position dans laquelle Beirnaert range Antoine Vergote est « le discours de l’homologie [5] ».
- La position moniste. Elle est illustrée par la perspective de Beirnaert lui-même [6] qui veut se situer à un stade plus originel, plus radical et plus fondamental, le seul qui, selon notre auteur, rende pleinement compte de l’acte analytique [7].
Détaillons quelques autres exemples. Une grande partie des auteurs que je vais citer sont des chrétiens, voire des catholiques [8], tant nombreux sont ceux qui se sont passionnés pour Freud et parfois plus encore pour Lacan [9].
a) Les positions exclusivistes
Ainsi que nous l’avons vu, elle se distribue en deux posture contraires : les encensements idolâtriques qui pèchent par défaut de critique et les critiques tout aussi conditionnels qui pèchent par excès de critique. Selon la première, Freud nous a enfin révélé la vérité sur l’homme : ce qu’il dit est vrai de tout homme et en éclaire les profondeurs jusque là cachées. Tout à l’inverse, selon la seconde, le fondateur de la psychanalyse a, selon ses propres mots, introduit le « poison » dans la connaissance que l’homme prend de lui-même. Faut-il préciser que l’un engendre l’autre comme le contraire engendre son contraire ?
1’) La freudolâtrie
Cette « adoration » de Freud se caractérise, certes, par une admiration sans borne pour le maître, mais plus encore, par le non-dit, le silence sur les multiples ombres que nous avons épinglées, chemin faisant et sur la culpabilisation excessive de quelques boucs émissaires bienvenus, au premier rang desquels on trouve Fliess et Jung. Les études et les biographies se taisent notamment sur :
– la névrose du maître (cf. plus bas pour le détail) ;
– les erreurs de diagnostic. Par exemple, selon le témoignage par ailleurs dithyrambique d’Abram Kardiner : « L’homme qui avait inventé de concept de transfert ne savait pas le reconnaître quand il se présentait. Une seule chose lui avait échappé. Oui, bien sûr, j’avais peur de mon père quand j’étais petit, mais, en 1921, l’homme que je craignais, c’était Freud en personne. Il pouvait me donner la vie ou la briser, ce qui n’était plus le cas de mon père [10] »). De même, Freud adressa à Theodor Reik un médecin américain Newton Murphy, qui désirait suivre une cure ; or, il présentait des signes de psychose et l’analyse n’est adaptée qu’au névrosé. Bref, les « psychanalystes continuèrent tranquillement à ignorer les erreurs cliniques du maître idolâtré [11] » ;
– les mécompréhensions profondes de la société de son temps dont nous avons donné un certain nombre d’illustrations. Roudinesco a cette formule heureuse : Freud « a le sens de la mémoire plutôt que de l’histoire [12] ».
– les intrusions : par exemple, dans l’analyse de Horace Westlake Frink, psychiatre et psychanalyste, souffrant de psychose maniaco-dépressive, qui partageait sa vie entre son épouse et sa maîtresse qui était aussi son ancienne patiente ( !), Freud le poussa à divorcer de son épouse légitime ; plus encore, la maîtresse, Angelika consulta Freud qui lui conseilla de divorcer et d’épouser Frink [13]. Nous reviendrons sur la fusion.
Même Jones n’échappe pas à cette cécité dans sa monumentale biographie.
Vienne même, dans les années 1920, bruissait d’un œdipianisme universel, selon Elias Canetti : « Chacun, même les fils posthumes, rencontrait son Œdipe et, pour finir, toute la société se trouvait également coupable, nous étions en puissance amoureux de notre mère, meurtriers de notre père […]. Au moment de mon arrivée à Vienne, c’était devenu le thème d’un bavardage universel et insipide dont personne ne s’exceptait [14] ».
2’) Le Freud-bashing
Tel est le nom donné, outre-atlantique, à l’anti-freudisme radical. La bibliographie est considérable, qu’elle soit d’origine américaine ou d’origine continentale, notamment française [15].
a’) Bref exposé
Une illustration tristement… illustre est fournie par l’ouvrage de Michel Onfray [16] ; une autre, moins fameuse, mais tout aussi idéologique, est le pavé, plus impressionnant par le volume (952 pages !) que par le contenu, du chirurgien urologue matérialiste Gérard Zwang [17]. Mais, plus sérieux, on peut noter l’ouvrage de Jacques Bénesteau, psychologue clinicien, qui souligne notamment qu’aucun des cas suivis par Freud n’a été guéri ou même amélioré [18].
Faut-il distinguer les attaques contre la doctrine et contre la personne, tant Freud et la psychanalyse a tout fait pour lier la première à la seconde ?
Nous avons donné différents exemples, chemin faisant. L’un des exemples prétendument fondés sur la vie de Freud est celui de la liaison avec Minna, sœur de Martha, d’où en seraient découlés un enfant et un avortement [19].
En faveur de la plausibilité de la thèse : la proximité topographique (non seulement, la présence de Minna sous le même toit, mais la contiguïté de sa chambre avec celle de Martha et de Sigmund) ; la proximité affective (elle appelle Freud son cher « Sigi » et répondait au téléphone « Frau Professor Freud ») et effective (elle accompagne volontiers Freud dans ses voyages du mois de septembre ; voire, en août 1898, elle a séjourné à lui à Maloja en Engadine) ; la réciprocité, c’est-à-dire la générosité de Freud à son égard. Il n’y a guère d’autres arguments, notamment en faveur de l’avortement. Par exemple, Onfray affirme que Freud obligea Minna à avorter d’un enfant né de lui en 1923… date à laquelle Minna a cinquante-huit ans…
Contre cette thèse [20] : le choix radical de Freud pour l’abstinence, pour une éthique stoïcienne, ascétique ; la proximité de Minna avec Martha ; le peu de féminité de Minna qui avait grossi, alors qu’on sait la sensibilité de Freud au charme féminin ; son indifférence aux ragots ; son attitude amicale ou plutôt de camaraderie ; etc.
La cause de la rumeur vient de Jung dans son entretien avec Kurt Eissler après la mort de Freud : « la plus jeune sœur [de Martha] avait un gros transfert [Übertragung] sur Freud et lui n’y était pas insensible [insensible] ». Et, à Eissler lui demandant si Freud avait eu une liaison avec Minna, Jung répond : « Oh, une liaison ? Je ne sais pas jusqu’à quel point, mais, mon Dieu, on sait bien comment c’est, n’est-ce pas [21] !? »
b’) Évaluation
Une telle prolifération de la réception négative doit être évaluée historiquement, c’est-à-dire factuellement : telle est sans doute l’une des justifications de la biographie de Freud rédigée par Élisabeth Roudinesco, qui conjure à juste titre les légendes ou les mythes freudiens. Elle doit aussi être interrogée, ce qui suppose le regard croisé de l’historiographie et de l’herméneutique : c’est ce que font par exemple Paul Ricœur et encore Élisabeth Roudinesco [22]. Elle doit enfin être intégrée doctrinalement : au nom de la vérité, et au nom d’un principe « dialectique » : toute affirmation argumentée contient une part de vérité ; plus l’opposition est virulente, plus elle révèle l’insu des partis en présence ; autrement dit, plus le conflit entre deux postures semble inévitable et incompressible, plus il appelle une synthèse supérieure ; autrement dit encore, il y a de fortes chances que les positions en opposition se positionnent par réaction, et non par proaction. [23]
b) Les positions dualistes
Résumons à grands traits l’histoire des premières rencontres entre la psychanalyse et le catholicisme [24]. La réaction spontanée fut celle de la suspicion et, pour un bon nombre, du rejet. Les raisons ne manquaient pas : le matérialisme affiché de Freud [25] et de nombre de ses disciples ; le déterminisme ; la déconstruction archéologique non seulement de la religion, mais de toutes les activités supérieures de l’homme (art, culture, morale, etc.) reconduites à un jeu de pulsions inconscientes. Tout était-il donc à rejeter dans la psychanalyse freudienne ?
1’) Roland Dalbiez
Son accueil dans le monde catholique fut grandement aidé par le travail décisif opéré par un professeur de philosophie, Roland Dalbiez, qui aboutit à une thèse de doctorat publiée en 1936, considérable non seulement par la taille monumentale (1.200 pages), mais aussi par le sérieux de l’information, la rigueur de l’écriture. L’hypothèse décisive est résumée dans son titre : La méthode psychanalytique et la doctrine freudienne [26]. Pour éviter le double écueil symétrique du rejet et de l’accueil inconditionnels, le philosophe de Rennes distingue la méthode, qu’il accueille avec grand intérêt, et la doctrine – englobant les relectures déconstructrices proposées par Freud de la culture, de l’art, de la morale et de la religion –, qu’il critique au nom de son scientisme [27] et de son réductionnisme.
Peu importe ici le détail [28]. Ce qui m’importe est le geste posé par Roland Dalbiez qui est riche d’enseignement pour l’attitude que je souhaiterais proposer vis-à-vis des nouvelles thérapies : distinguer la méthode (les outils) qui est bonne et la doctrine (l’interprétation) qui requiert un discernement. Dalbiez s’est refusé à une triple solution de facilité : l’opposition (la suspicion vis-à-vis de la psychanalyse conduisant à son rejet), la fusion (l’adhésion massive et acritique à la même psychanalyse) et la juxtaposition (plaçant côte à côte psychanalyse et foi chrétienne, déclarant ces deux discours hétérogènes et indifférents l’un à l’autre, donc chacun légitime dans son ordre). Contre la première attitude, le philosophe adopta l’accueil généreux, contre la deuxième, le discernement, contre la troisième, l’appel à la régulation opérée par la sagesse philosophique. En elles se cristallise la juste posture que cet ouvrage souhaiterait adopter : l’accueil et le discernement – celui-ci faisant appel à la distinction entre méthode et doctrine, ou mieux, interprétation.
Cette herméneutique peut se résumer en deux citations :
« L’influence de Freud sur la psychiatrie et la psychopathologie s’est traduite par une véritable résurrection de la croyance en l’efficacité du psychisme [29] » ; « L’œuvre de Freud est l’analyse la plus profonde que l’histoire ait connue de ce qui, dans l’homme, n’est pas le plus humain [30] ».
2’) Jacques Maritain
Ce fin travail de discernement opéré par Dalbiez marqua durablement la réception de Freud dans le public chrétien. Il influença, par exemple, un autre philosophe français, beaucoup plus connu, Jacques Maritain. Sans génie, celui-ci opéra une distinction tripartite qui ne fait qu’amplifier, en la reprenant, celle du professeur de Rennes.
« C’est à une division tripartite qu’il faut avoir recours : nous distinguerons la méthode psychanalytique, la psychologie freudienne, la philosophie freudienne ; et je dirai tout de suite que sur le premier plan (méthode psychanalytique), Freud apparaît à mon avis comme un investigateur de génie ; sur le troisième plan (philosophie freudienne ) à peu près comme un obsédé ; sur le deuxième plan, sur le plan intermédiaire (psychologie freudienne), comme un psychologue admirablement pénétrant dont les idées, activées par un étonnant instinct de découverte, sont gâtées par un empirisme radical et par une métaphysique aberrante, inconsciente d’elle-même [31] ».
3’) Rudolf Allers
Dans son ouvrage non traduit, La genèse éthique de la personne [32], Rudolf Allers, psychiatre d’orientation adlérienne et philosophe allemand, procède notamment à une évaluation de la psychanalyse. Influencé à la fois par Scheler (son personnalisme axiologique) et par une psychologie et une ontologie néothomistes, il affirme que la personne est orientée vers une « fin-maximum » qui est la valeur transcendantale, que la conscience du sujet ne peut totalement appréhender. Ainsi, Allers critique Freud, à l’instar par exemple d’un Frankl ou d’un Abraham Maslow, en fondant une psychothérapie prenant en compte la motivation et le sens spirituel de l’homme.
c) Les positions homologues
Je qualifierais volontiers ces positions d’intégratives. Après avoir donné trois exemples, je m’étendrai plus longuement sur la proposition ricœurienne.
1’) Michel Henry
La relecture que Michel Henry propose de Freud se fait d’un point de vue philosophique : « C’est en tant qu’hériter de Descartes que Freud est ici étudié [33] ». La critique se fait en deux temps.
« Si, faute de moyens appropriés, le freudisme fut contraint de rejeter dans un arrière-monde les formes élémentaires de l’expérience, si l’affect fut ramené à la pulsion, et la pulsion à un système énergétique conforme aux schémas scientifiques de l’époque, il reste possible de reconnaître, derrière ces constructions spéculatives, à travers ces emboîtements d’hypothèses à l’infini, la figure même de cette vie – la nôtre [34] ».
Le premier temps est positif : « Le projet cartésien qui coïncide avec le projet même de la philosophie est une recherche du commencement ». Or, ce commencement est une apparition, une représentation. Heureusement, une rupture se produit qui nous fait passer de la représentation (Apollon) à la vie (Dyonisos), grâce à Schopenhauer, Nietzsche et Freud.
Malheureusement, et voilà le second temps, négatif, de la critique, après que Freud « accède à un domaine qui est le tout autre de la représentation, le domaine de la vie », « à peine la pulsion a-t-elle été reconnue pour elle-même comme pulsion vitale qu’elle tombe aussitôt sous la loi de la représentation ». Confirmation passionnante vient de la place occupée par la pulsion de mort. N’est-ce pas lié au primat de la représentation ? « D’où l’aspiration de la vie à sa propre mort. La mort comme essence de la vie ».
Autrement dit, Henry cherche le don vraiment originaire, son jaillissement, et non pas sa solidification en concept.
Mais sa critique ne vaut-elle pas plus pour Lacan qui absorbe la pulsion dans le jeu des signifiants ? En regard, le biologiste Freud est toujours respectueux du dynamisme de la chair, même si la parole occupe une place grandissante chez lui ?
2’) Paul Toinet
Le prêtre philosophe Paul Toinet a consacré plusieurs livres à la psychanalyse. Selon lui, la grande erreur de Freud est de décider de « reconstruire l’ensemble de l’anthropologie en fonction de sa ‘science’ particulière [35] ». Il s’interroge aussi de manière très juste sur le refus freudien de se confronter à la philosophie [36].
3’) Deux scientifiques
J’ajoute les noms de deux chercheurs en psychologie et en psychiatrie qui, ayant développé une approche originale de la personne et de ses traumas, mériteront une analyse à part dans un chapitre ultérieur (non abordé dans cette version) : Viktor Frankl (la logothérapie) et John Bowlby (la théorie de l’attachement). Ces critiques expérimentales sont intégratives.
4’) Paul Ricœur
Le philosophe français Paul Ricœur relève de cette approche homologue, car il affirme par exemple qu’il existe une ressemblance profonde entre l’analyse et l’expérience de la foi. Par exemple, il y a une « parenté de structuration entre le Père selon l’Œdipe et le Père selon la foi [37] ». Plus globalement, presque trente ans plus tard, tout en critiquant son maître Dalbiez qu’il admire [38], Ricœur, accueille lui aussi la psychanalyse dans le champ de la philosophie en opérant une distinction entre, pour faire court, les pulsions qu’elle révèle et l’esprit qu’elle refuse [39].
« Je n’ai pas cru qu’on pouvait confiner Freud dans l’exploration de ce qui, dans l’homme, est le moins humain ; mon entreprise est née de la conviction inverse : c’est parce que la psychanalyse est de droit une interprétation de la culture qu’elle entre en conflit avec toute autre interprétation globale du phénomène humain [40] ».
nous abordons la troisième et dernière partie de son maître-ouvrage De l’interprétation [41]. À noter qu’un bon résumé (quoique bien partiel) des thèses essentielles est donné dans une conférence. Nous nous en inspirerons pour situer le propos de Ricœur en commençant :
a’) Légitimité d’une approche philosophique de Freud
On comprend que cette question de la légitimité soit préalable. Nous partirons pour cela de la première partie de son article « Une interprétation philosophique de Freud ». Ricœur veut faire une lecture philosophique de Freud, ce qui ne laisse pas de poser deux questions (et même objections) graves :
1’’) Peut-on distinguer la lecture de Freud et une interprétation philosophique de Freud ? [42]
En particulier, la doctrine freudienne fait référence à un apprentissage et à une technique. Cela ne met-il pas Freud à part des penseurs habituels ?
« Je dis que Freud peut être lu comme nos collègues et nos maîtres lisent Platon, Descartes, Kant ». Et Ricœur d’avancer trois arguments : « Freud a écrit une œuvre qui ne s’adresse pas à ses élèves […] mais à nous tous ». De plus, « je prétends que ce qui apparaît dans la relation analytique n’est pas radicalement autre que ce que le non-analysé peut comprendre ; je dis bien comprendre et non pas vivre ». Enfin, « c’est Freud qui est venu sur notre terrain […] parce que l’objet de son investigation , ce n’est pas […] le désir humain » mais « c’est le désir, dans un rapport plus ou moins conflictuel avec un monde de la culture, avec le père et la mère… » Plus précisément, la psychanalyse nous parle des pulsions en terme de signes, car elle est un œuvre de parole. Elle est donc « homogène […] à la totalité de l’expérience humaine que la philosophie entreprend de réfléchir et de comprendre ».
2’’) Peut-on reprendre le discours freudien dans un autre discours ? [43]
En effet, « il est toujours possible de considérer l’entreprise philosophique qui prétendrait l’intégrer (l’œuvre de Freud), comme la suprême dénégation, la plus astucieuse des résistances ». Ricœur oppose deux arguments à cet « exclusivisme fanatique de certains freudiens ».
Tout d’abord, la psychanalyse ne nous livre pas une vision totalisante du réel humain. Freud lui-même l’avoue : « Dans cette obscurité, l’expérience psychanalytique ne projette qu’un seul et unique rayon de lumière [44] ». Et cette limite est autant extensive que compréhensive. Bref : « il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre qu’il n’y en a dans toute notre psychanalyse ».
Ensuite, « la doctrine et l’expérience analytiques […] comportent une discordance, une faille, qui appelle l’interprétation philosophique ». La raison ultime est que la psychanalyse « opère avec des notions appartenant à deux plans différents de cohérence, à deux univers du discours : celui de la force et du sens », celui de l’énergétique et celui de l’herméneutique, pour reprendre la catégorisation qui courre dans tout l’ouvrage De l’interprétation. L’exemple type est la distinction existant entre le concept strictement psychophysiologique d’instinct et la notion centrale dans le freudisme de pulsion : celle-ci « n’est accessible que dans ses rejetons psychiques [45] ».
3’’) Quelle est la perspective philosophique de Ricœur ? [46]
En effet, s’il y a une lecture de Freud, il y a des interprétations philosophiques de Freud. En l’occurrence, « celle que je propose se rattache à la philosophie réflexive », et ce, dans le prolongement dans l’étude sur la Symbolique du Mal. Précisons : « mon hypothèse de travail philosophique, c’est la réflexion concrète, c’est-à-dire le Cogito médiatisé par tout l’univers des signes ». Autrement dit, Ricœur se demande ce qu’il advient du sujet du Cogito abstrait cartésien lorsque Freud est passé. Nous verrons plus bas la réponse que Ricœur donne finalement.
4’’) Remarque complémentaire : relations de la psychanalyse et de la philosophie réflexive
Cette question se subdivise en deux.
D’abord, « qu’arrive-t-il à une philosophie de la réflexion quand elle se laisse instruire par Freud ? » [47] Ricœur répond carrément : « après Freud, il n’est plus possible d’établir la philosophie du sujet comme philosophie de la conscience », car la conscience et le sujet ne coïncident plus depuis la découverte freudienne de l’inconscient et de l’importance du désir comme donateur de sens. En effet, Ricœur estime que l’on situe l’apport de Freud en formant le concept d’’archéologie du sujet’. Plus encore, « la conscience […] n’est plus une donnée […] ; elle est une tâche, la tâche de devenir conscience ». Le sujet est donc en crise, la conscience est un problème autant qu’une tâche [48]. Bref, « ce qui émerge de cette réflexion, c’est un Cogito blessé », car il « se pose, mais ne se possède pas ».
Ensuite, inversement, la philosophie a un complément à apporter à l’analyse freudienne [49]. Il faut doubler la réflexion freudienne sur l’archè par une réflexion sur le télos. Pourquoi ? Parce que « le concept d’archéologie est lui-même un concept réflexif ; l’archéologie est archéologie du sujet ». Or, pas de sujet sans télos, puisque le sujet est donateur de sens. Et Ricœur de montrer en détail que « l’appropriation d’un sens constitué en arrière de moi, suppose le mouvement d’un sujet tiré en avant de lui-même par une suite de ‘figures’… »
b’) Exposé de l’interprétation critique
Nous ne donnerons que les lignes de crête et nous nous attarderons davantage sur la quatrième partie où Ricœur touche le cœur du problème. Passons les questions préliminaires de méthode et d’épistémologie [50] .
La démarche de Ricœur procède en trois temps.
Tout d’abord [51], la conscience n’est plus le lieu et l’origine du sens. Le Cogito, selon un mot qui résumerait bien la pensée de Ricœur est blessé [52]. En effet, la psychanalyse invite, par sa topique et son économique à déplacer le lieu du sens vers l’inconscient ; or, celui-ci est une origine, un archè ; et de plus, nous ne pouvons en disposer : nous n’en avons pas la maîtrise. Nous en tirons donc la double conséquence que la conscience n’est plus totalisante du sens et que cette crise, ce dessaisissement du sujet vient de son indicible archéologie.
Procédant ensuite [53] de manière dialectique, Ricœur procède maintenant à une antithétique de la réflexion toute tournée vers la téléologie. En effet, l’interprétation archéologique est l’envers d’une genèse progressive du sens à travers des figures successives. Et c’est Hegel (le Hegel de la Phénoménologie de l’esprit) qui a servi de modèle inversé pour constituer ce mouvement de figures de l’esprit.
Mais pourquoi l’arché renvoie-t-il à un télos ? Nous touchons là une des intuitions centrales de l’œuvre de Ricœur.
« Il faut bien voir que le concept d’archéologie est lui-même un concept réflexif ; l’archéologie est archéologie du sujet […]. Car l’appropriation d’un sens constitué en arrière de moi, suppose le mouvement d’un sujet tiré en avant de lui-même par une suite de ‘figures ‘ dont chacune trouve son sens dans les suivantes [54] ».
Voilà pourquoi, « la psychanalyse concerne la réalité humaine dans son ensemble [55] ». En effet, le désir est d’emblée en situation de culture. « Ainsi se dessine un vaste domaine qu’on peut appeler la sémantique du désir [56] ». On comprend enfin la position de Ricœur par rapport à son premier professeur de philosophie qu’est Roland Dalbiez : « Mon travail se distingue de celui de Roland Dalbiez sur un point essentiel : je n’ai pas cru qu’on pouvait confiner Freud dans l’exploration de ce qui, dans l’homme, est le moins humain ; mon entreprise est née de la conviction inverse : c’est parce que la psychanalyse est de droit une interprétation de la culture qu’elle entre en conflit avec toute autre interprétation globale du phénomène humain [57] ».
Enfin [58], reste à réconcilier ces deux pôles en tension que sont l’archéologie et la téléologie. C’est la notion de symbole qui va nous permettre d’y arriver ; et plus précisément d’herméneutique du symbole [59]. Car, selon le mot célèbre qui termine les trois ouvrages sur l’approche phénoménologique de la volonté, « le symbole donne à penser » [60]. Développons ce dernier point.
1’’) Principes et présupposés
a’’) La théorie du symbole chez Ricœur
Cette théorie est en fait présupposée. Ricœur donne une approche très systématique du symbole à partir de six notes qui tentent d’en cerner l’essence de plus en plus près. Suivons l’exposé [61].
- Les trois premières sont positives et vont du plus général (générique) au plus particulier, empruntant sans l’expliciter la démarche logique de la définition par genre et différence :
– Genre lointain : le symbole est un signe, puisqu’il vise à communiquer un sens. Et de le montrer inductivement pour les symbole naturels, le rêve et l’image poétique.
– Genre prochain : le symbole est cette espèce de signe qui « recèle dans sa visée une intentionnalité double ». Ricœur oppose ainsi le signe technique qui est parfaitement transparent et ne dit que ce qu’il veut dire en posant le signifié et le symbole qui est opaque « parce que le sens premier littéral, patent, vise lui-même analogiquement un sens second qui n’est pas donné autrement qu’en lui ». (on retrouve là une distinction proche de la différence que Jean de Saint-Thomas mettait entre signe formel et signe instrumental).
– Espèce : les deux sens du symbole sont en relation de proportionnalité ; sens littéral et sens symbolique sont analogue d’une analogie de rapport. Et nous comprenons alors la signification du syntagme « le symbole donne à penser ». Le symbole « est donnant parce qu’il est une intentionnalité primaire qui donne analogiquement le sens second ».
- Les trois dernières notes sont négatives et visent à écarter du symbole les interprétations erronées :
– La différence la plus importante est celle qui existe entre le symbole et l’allégorie.
Celle-ci correspond au signe technique que nous distinguions du symbole à l’occasion de la seconde distinction ci-dessus. La grande différence tient à ce qu’interpréter une allégorie est traduire, percer le déguisement, de sorte que « une fois la traduction faite, on peut laisser tomber l’allégorie désormais inutile ». Par contre, on ne peut jamais se passer du sens littéral du symbole car c’est par lui et par lui seulement que l’on accède au sens symbolique. Celui-ci donne son sens en trans-parence et non pas en tra-duction.
– Le symbole dont nous traitons n’est pas non plus le symbole de la logique symbolique. En effet, ce dernier est le comble du formalisme, c’est un caractère au sens leibnizien, un élément de calcul. Or, le symbole dont nous nous occupons est essentiellement lié et lié à un contenu : il n’est donc pas vide, puisque c’est à travers son contenu primaire que l’on accède au contenu latent.
– Enfin, « comment distinguer mythe et symbole ? » Il y a différentes interprétations.
Ricœur opte pour opposer mythe et symbole comme espèce à genre. En l’occurrence, le genre symbole se distingue en symbole élémentaire et « symbole développé en forme de récit, et articulé dans un temps et un espace non coordonnables à ceux de l’histoire et de la géographie selon la méthode critique ». Exemple : « l’histoire de l’expulsion d’Adam et Eve du Paradis est un récit mythique ».
- Notez une précision éclairante de Ricœur sur ce qu’il appelle les différents « niveaux de créativité des symbole [62] » . En effet, les conceptions dévaluées du symbole s’alimentent le plus souvent à la confusion existant entre les symbole les plus sédimentés comme ceux du rêve et les vrais symbole prospectifs à l’œuvre par exemple dans le travail poétique.
b’’) La surdétermination du symbole [63]
« Ce que la psychanalyse appelle surdétermination ne se comprend pas en dehors d’une dialectique entre deux fonctions que l’on pense en opposition, mais que le symbole coordonne dans une unité concrète ». Or, quelles sont ces deux fonctions ? La fonction archéologique et la fonction téléologique, ainsi que nous venons de le voir. Aussi, « les mêmes symbole sont porteurs de deux vecteurs :d’un côté, ils répètent notre enfance, en tous les sens » du terme. « De l’autre, ils explorent notre vie adulte : ‘O my prophetic soul’, dit Hamlet. « Mais, nous rappelant ce qui a été dit sur la nature profonde du symbole, il faut bien saisir que ces deux fonctions, « unité du cacher-montrer », ne sont ni séparables réellement ni extérieures : « c’est en plongeant dans notre enfance » que les symbole « représentent la projection de nos possibilités propres sur le registre de l’imaginaire ». Ils « sont véritablement régressifs-progressifs ». Ils réalisent donc « l’identité concrète entre la progression des figures de l’esprit et la régression vers les signifiants-clefs de l’inconscient ». Et cela vaut pour le domaine des images et des concepts, mais aussi des désirs : « C’est avec les désirs empêchés, convertis, que nous nourrissons nos symboles les moins charnels ».
La confirmation par excellence en est ce que dit Ricœur de la sublimation dont il estime à juste titre que Freud a manqué l’interprétation : elle est « la fonction symbolique elle-même, en tant que coïncident en elle le dévoilement et le déguisement ».
2’’) Application générale [64]
Ricœur met alors en œuvre et manifeste la fécondité de sa théorie du symbole comme unité du double dynamisme archéologique et téléologique du sujet. Pour ce il reprend la distinction tripartite (d’origine kantienne) des sentiments qu’il avait développée dans l’Homme faillible [65]. Par induction (complète), il montre alors que ces trois sphères de sens que sont l’avoir, le pouvoir et le valoir ne sont pas constituées par l’investissement libidinal (l’économique, le politique et le culturel en se réduisent pas à des pulsions) [66] mais peuvent cependant être investies par la libido. Ricœur le manifeste cursivement pour l’avoir et le pouvoir [67] mais s’étend plus longuement sur le valoir, et développe à cette occasion ce qu’il a dit en passant sur la sublimation [68].
Mais comment le symbole unifie-t-il ? « C’est dans la structure intentionnelle que le symbole enveloppe à la fois l’unité d’une hylétique (cf. plus bas) et la diversité qualitative des visées et de intentions, selon que prédomine en lui le déguisement de sa hylé et le dévoilement d’un autre sens spirituel [69] ».
3’’) Application à la religion [70]
« Si la psychanalyse rencontre la religion comme facteur culturel, son attitude est nécessairement iconoclaste, indépendamment de la foi ou de la non-foi du psychanalyste » En effet « la psychanalyse ne parle pas de Dieu, mais du dieu des hommes ; pour elle, la religion c’est l’illusion qui appartient à la stratégie du désir [71] ». Il est possible de préciser : Ricœur note avec soin, ainsi que nous l’avons noté que Dieu culpabilise et console ; ces deux affects fondamentaux, la crainte de la punition et le désir de la consolation sont d’ailleurs les « deux points sur lesquels nous avons encore à apprendre de Freud [72] ».
Ricœur, fidèle à la pensée barthienne, lève d’emblée toute ambiguïté, tout danger de réduction rationaliste de la foi : « Je n’ai aucun moyen de prouver l’existence d’une problématique authentique de la foi à partir d’une phénoménologie de l’esprit [73] ». « Mais si une problématique de la foi a une origine autre, le champ de sa manifestation est celui-là même que nous avons exploré jusqu’à présent [74] ». En effet, la foi naît de ce que s’anéantit dans notre chair le Tout-Autre comme logos. Aussi « en se rendant ainsi ‘immanent’ à la parole humaine, le Tout-Autre se donne à discerner dans et par la dialectique de la téléologie et de l’archéologie [75] ». ()
Mais le fait que la phénoménologie du sacré ne prolonge pas une phénoménologie de l’esprit invite à une rupture. Et l’oubli du caractère non-totalisant engendre la religion. Celle-ci fait déchoir le symbole du statut de signe sacré en objet sacré (cette critique est très révélatrice du climat barthien dans lequel se meut la conception religieuse de Ricœur). D’où le mot fameux : « C’est pourquoi il faut toujours que meure l’idole afin que vive le symbole [76] ».
c’) Évaluation critique de la critique de Ricœur
Cette synthèse qui a connu un vif succès (comme de vives critiques : cf. par exemple l’article de Michel Torr) est puissamment charpentée et très suggestive. Elle n’est pas sans appeler une critique. Le point délicat de l’exposé de Ricœur nous semble être le monisme du symbole, son unicité. Donnons-en quelques formulations typiques :
« L’interprétation freudienne fournit en quelque sorte une hylétique des affects (je prends ici la hylé ou ‘matière’ au sens husserlien du mot) ; elle […] vérifie ce que Kant avait entrevu, lorsqu’il disait qu’il n’y a qu’une seule ‘faculté de désirer’ ; c’est du même amour, dirions-nous, que nous aimons l’argent et que, enfant, nous avons aimé nos excréments [77] ».
« La filiation énergétique atteste qu’il n’y a jamais qu’une libido et seulement de destins variés de la même libido ». Reste que « la novation de sens requiert une autre herméneutique [78] ».
« Freud rend bien compte de l’unité fonctionnelle du rêve et de la création (artistique), mais la différence qualitative, la différence de ‘but’ qui dialectise la pulsion, lui échappent [79] ».
Passons maintenant à la critique. L’unicité du symbole entraîne automatiquement l’unicité du jeu des facultés le fondant. Et Ricœur a fort bien vu le caractère inévitable de cette conséquence. L’unité intentionnelle dont il traite ne peut faire l’économie de la nécessaire et radicale (au sens propre) distinction des puissances : ici, mais en un tout autre sens, l’arché (le donné des facultés avec leur tension « naturelle » vers leur objet) précède la visée du télos qu’implique la structure intentionnelle construite par le symbole.
Comment concilier cette unicité du symbole avec la thèse psychologique centrale de l’aristotélicothomisme qu’est la spécification des facultés par leur objet formel ? Ou, pour le dire autrement, le symbole au sens où l’entend Ricœur efface la distinction existant entre les facultés sensibles et les puissances spirituelles.
Ce n’est pas le lieu de montrer ici le bien-fondé du principe fondamental de la spécification de la faculté par son objet formel : comment justifier autrement la distinction entre le psychisme et l’esprit ? En effet, l’homme n’est pas doué d’une intuition de l’essence de son âme, contrairement à ce que pouvait croire un Descartes. Il ne peut donc percevoir qu’il est être d’esprit que par la médiation de l’opération de son intelligence et de sa volonté qui pour être en acte ne sont jamais dénuées d’objet (celui-ci englobant le sujet se prenant pour terme de son appréhension).
Formulons autrement notre critique en partant des catégories même de Ricœur : au total pour lui, la liberté est au terme, au télos, mais pas au principe, à l’arché ; celle-ci est le lieu de la seule libido (des puissances sensibles principalement désirantes). Mais si la liberté est au point d’arrivée, c’est que d’une certaine manière, elle était au point de départ. Nul doute qu’elle soit appelée à s’épanouir, et même à s’actualiser, ce qu’elle ne fait guère à l’origine. Mais cet épanouissement n’est pas création de son être ; reste que pour le percevoir, il faut distinguer entre puissance et acte (ce dont nous redirons un mot plus loin). Un axiome métaphysique dit d’ailleurs que le plus ne germe pas du moins. Il trouve ici une application éclairante.
Nous rejoignons ici la critique que le Père Labourdette adresse à la notion freudienne de sublimation que Ricœur ne purifie pas de toutes ses équivocités :
« Freud veut dire par sublimation qu’une activité en réalité sexuelle se déploie sur un plan en apparence tout spirituel et très noble [80]. Pour lui, religion, art, littérature, à plus forte raison mystique, ne sont que sexualité sublimée. Ainsi entendue, cette notion est parfaitement inacceptable. Elle repose sur cette incapacité si nette chez Freud à distinguer les objets formels et à concevoir les différenciations essentielles qu’ils imposent. Bien loin d’être pour lui, comme pour nous, une réalité qui s’impose à nos puissances, s’empare de leur activité, les qualifie, les spécifie, l’objet est toujours plus ou moins selon lui une création, une projection de notre psychologie profonde, son ‘expression’ [81] ».
De fait, il nous paraît par exemple difficilement recevable de parler d’une seule faculté de désirer [82] . Comment dès lors distinguer volonté et affectivité sensible, à moins d’éliminer toute tendance appétitive de l’une de ces deux facultés.
d) Les positions monistes
1’) Louis Beirnaert
Pour le psychanalyste Louis Beirnaert cité plus haut [83], le propre de la démarche psychanalytique, en dialogue avec la foi chrétienne tient à l’approche « de ce que les formations religieuses voilent – autant qu’elles le dévoilent – à savoir la vérité du manque constitutif du sujet du désir [84] ».
Autre clé : pour Beirnaert, la psychanalyse, loin de ne considérer qu’une région de l’homme, celle qui n’a rien à voir avec le sacré, envisage le tout de l’homme et même de la foi : « c’est du tout de la foi qu’il s’agit [85] ».
« Le psychanalyste peut éclairer le moraliste en lui découvrant que dans ce sujet moral gît un autre sujet pris dans le réseau des signifiants inconscients qui marquent son désir. Celui pour lequel on légifère, le sujet de la morale précisément, se trouve donc pour laisser entrevoir cet autre sujet, qui, lui n’est pas accessible à la morale [86] ».
2’) Denis Vasse
Un autre psychanalyste jésuite, Denis Vasse [87], emprunte aussi à la psychanalyse, ici lacanienne, les concepts principaux pour penser de manière neuve l’homme en sa posture spirituelle.
Denis Vasse ne cache pas sa dette à l’égard de Lacan. C’est ainsi qu’il utilise volontiers son néologisme « parlêtre [88] ». Il lui reprend même son concept de Réel le réinterprétant d’une façon qui ne laisse pas de demeurer insatisfaisante car elle introduit un dualisme : « Pour Lacan, le réel est l’instance, l’élément logique nécessaire par lequel s’indique l’impossible à imaginer dans tout ce que nous imaginons, ce qui ne vient pas de notre activité psychique, de notre désir ou de nos pulsions, mais qui les fonde en vérité [89] ».
La problématique du désir est centrale pour le religieux parisien. En effet, ce dernier est « l’essence de l’homme, et son accomplissement n’est pas de l’ordre de la satisfaction mais de l’ordre de la surabondance de la vie donnée qui justifie un désir infini, le désir en tant qu’il est vie de Dieu [90] ».
L’imaginaire se caractérise notamment par l’illusion du plein saturant. En effet, il renvoie à l’origine ; or, dans l’interprétation freudo-lacanienne, cette origine est régression archaïque, fusion océanique avec la mère, bonheur sans faille et tout-puissant ; l’imaginaire renvoie donc à un plein illusoire ; dénué de toute altérité, le monde du fantasme ne peut donc conduire au désir. Inversement, le symbolique naît de la faille et du refus de la refermer, donc du consentement au vide, à la non-saturation, qui permet l’altérité, le désir et l’événement, c’est-à-dire le surgissement de nouveauté.
Une citation parmi beaucoup, mais particulièrement claire : « Le renoncement est le pivot du mouvement de conversion du besoin en désir [91] ». Cette phrase joint quatre mots essentiels qui sont autant de concepts, dynamiquement articulés. Ces mots-concepts sont besoin, désir, conversion et renoncement. La dynamique ou mouvement comporte deux termes opposés, le point de départ (terminus a quo) et le point d’arrivée (terminus ad quem), le passage lui-même et le moyen du passage.
- Le point de départ est le besoin ; le point d’arrivée est le désir.
- Puis leur mouvement qui est une conversion, c’est-à-dire un changement radical, dont le besoin est le point de départ naturel, donc nécessaire, et le désir, le point d’arrivée libre et nullement nécessaire. Détaillons ce dernier point.
Si notre corps dit notre limite dans le temps et l’espace, si les pulsions (qui se rattachent à la corporéité ?) introduisent dans la jouissance sans fin, indéfinie (celle du mauvais infini), le désir, lui, dit une effraction par laquelle l’infini surgit : « Dans nos limites conjuguées de temps et d’espace où l’homme prend corps, nous sommes convoqués à l’épreuve d’un désir qui nous traverse et nous fonde en cette charnière du corps qui crie [92] ».
Vers quel objet tend ce désir ? Désir de Dieu ? On voit bien le souci de sauver la transcendance du désir face aux pulsions, et ainsi souligner la part spirituelle. Mais que peut être un désir qu’aucun objet ne vient spécifier, déterminer ? L’Autre demeure innommé (car il n’est ni Dieu, ni autrui, ni un bien indéterminé), de sorte qu’il concède trop à une sorte d’anthropologie négative. Il est révélateur que Vasse cite Lacan se référant à Freud : « Nous enseignons suivant Freud que l’Autre est le lieu de cette mémoire qu’il a découverte sous le nom d’inconscient, mémoire qu’il considère comme objet d’une question restée ouverte en tant qu’elle conditionne l’indestructibilité de certains désirs [93] », c’est-à-dire, de ce que Vasse appelle le désir. Bref, à l’instar de Lacan, mais dans un tout autre sens, Vasse affirme qu’il y a chez l’homme du non thématisable, du préréflexif. Mais ils le tirent soit dans un sens archaïque, soit dans un sens spirituel indéterminé [94].
Du côté du sujet, le désir se signale par la joie versus la jouissance. En effet, la joie se définit comme « la motion – la mise en mouvement de l’âme – qu’éprouve une personne dont le désir inconscient s’accomplit. Si le désir de l’homme est le désir de l’Autre, l’accomplissement du désir, la joie, vient de ce que la rencontre avec l’autre rend présente la Parole (l’Autre) qui les unit dans la différence depuis toujours et pour toujours [95] ».
- Enfin, le moyen ou le passage (terminus per quem) obligatoire pour ce mouvement : le renoncement ou le vide. Lacan dénombre certaines ruptures décisives dans l’avènement du sujet ou « parlêtre » : la coupure du cordon, le sevrage, l’interdit de l’inceste.
Pour accéder de la pulsion au désir, l’homme doit accepter de renoncer à l’immédiateté et à la maîtrise, se laisser altérer par un Autre qui survient à l’improviste. Cet arrachement n’a rien de spontané : « Nous préférons jouir d’être rejetés de la vie plutôt que de découvrir dans nos vies le refus de souffrir d’en vivre ou, si l’on veut, le refus de désirer [96] ». Aussi le renoncement humanisant qui ouvre au désir requiert-il un combat. C’est ce que signifie une expression qui enchante Denis Vasse et, de fait, riche de sens : « Souffrez que je vous parle [97] ».
Concluons. L’une des intuitions de Vasse est d’étudier l’homme en situation blessée. Il note par exemple qu’on ne peut pas dire « qu’il y ait abstraitement deux catégories séparées : le réel d’un côté et l’imaginaire de l’autre, mais le réel se manifeste comme ce qui ne peut pas s’imaginer au cœur de la réalité perçue dans un livre, dans un sermon, dans la méditation [98] ». En outre, Vasse respecte la spécificité de la démarche de foi et, par exemple de ne jamais confondre « L’Autre du désir et le Dieu de la foi », selon le titre d’un de ses derniers ouvrages. De plus, « l’ontologie de Vasse est celle du don », remarque Jean Michel Maldamé [99]. En effet, dans la vision chrétienne, le don a un visage, le visage de Celui qui s’est révélé à nous comme Amour (cf. I Jn 4, 8.16). Aussi le corps de don devient-il un corps mis en relation avec Dieu. Et comme double est la relation au don, double est la relation à Dieu : comme origine et comme terme, comme alpha et comme oméga (Ap 1, 8). Denis Vasse l’exprime admirablement dans son grand ouvrage Le temps du désir, selon la terminologie du désir qui est exactement complémentaire (le décalque en creux) de celle du don : « En édifiant son corps, l’homme répond de ce qu’il est : désir de Dieu. Il est désiré par Dieu et il le désire. Il est l’écho d’un désir qu’il ne peut pas concevoir, mais dont il témoigne [100] ».
3’) Antoine Vergote
Le psychanalyste belge croyant Antoine Vergote [101] adopte aussi la posture moniste. Centrons-nous sur un de ses derniers ouvrages qui traite de la sublimation [102]. Il n’est pas dupe de la situation paradoxale de cette notion chez Freud, en élabore la notion et semble même, en traitant de la création esthétique, éthique ou religieuse, y lire une réalité anthropologique irréductible à l’inconscient, dont la source serait ce que l’anthropologie classique appelle la volonté, volonté qui est plus que la liberté et s’enracine dans l’infinité du désir : « un procédé a lieu qui ne prolonge plus la série causale, un procédé que l’on ne comprend plus en fonction de ses antécédents, un procédé qui peut même être le premier d’une série [103] ».
La sublimation est finalisée : « Dans la sublimation, le sujet ne séjourne donc pas auprès de lui-même, mais il est activement orienté vers la chose elle-même, se projetant vers elle ; ‘chose’ signifie ici la réalité dont il s’agit et qui est autre et autrement signifiée dans la peinture, la poésie, la religion, l’amour humain [104] ».
Reste que certaines formules sont problématiques : « La psychanalyse a montré que la conscience et le moi sont des fonctions à l’intérieur d’une structure psychique et que le langage, la conscience et l’agir ne peuvent se réaliser que portés par un inconscient fait de représentations refoulées et toujours actives [105] ».
4’) Maurice Bellet
Le rôle joué par Maurice Bellet sur nombre d’intellectuels en France fut considérable. Ce prêtre catholique, psychanalyste, philosophe et écrivain, né en 1923, a écrit une quarantaine d’ouvrages dont quatre relatifs à la psychanalyse [106]. Sa thèse est la suivante : la psychanalyse est la propédeutique à la théologie, du moins à la pensée du religieux.
La raison, inspirée par Lacan encore plus que par Freud, vient de la relation à l’Autre. Le propre de la psychanalyse est de conduire le sujet des illusions à la relation à l’Autre, c’est-à-dire à un autre espace du dit qui, enfin sort du même pour conduire à l’inconnu. Or, la théologie est un discours sur celui qui, justement, résiste à toute maîtrise et même toute compréhension. La psychanalyse devient dès lors le moyen, pratique, pour entrer dans cette déprise des illusions du désir, des fausses évidences. Elle devient l’équivalent actuel du doute cartésien, mais appliqué au sujet qui sait que le critère de clarté est lui aussi une illusion. Elle propose un chemin pour, en plein, entendre autrement et, en négatif, détruire les idoles du « comme si ».
Le positif est bien entendu le rappel de l’altérité divine, de son étrangeté contre une raison toute-puissante, un ego orgueilleux. L’inconvénient est le soulignement (unilatéral, réactif, qui ouvre finalement à une sorte d’apophatisme, à un cogito humilié.
Plus encore, cet Autre dont on sait qu’il est sans visage, irréductible à Dieu ou à l’être, emprunte en fait les traits du desiderium videndi Deum, la polarité concrète en moins ; sa logique est celle de de l’irrequietum cor. Comme l’angoisse selon Heidegger. Sécularisation venue de l’indépassable horizon de la finitude.
On retrouve la même intuition chez Raymond Lemieux, québécois qui a produit un travail considérable [107] au carrefour de la sociologie, de l’histoire, de la psychanalyse, des sciences du langage et de l’éthique de la connaissance. À l’instar de Maurice Bellet [108], il estime que l’Autre doit travailler autant la psychanalyse que la théologie. Un passage résume bien sa pensée : l’Autre renvoie « à une organisation de l’esprit, c’est-à-dire à une méthode qui vise à aborder ce qu’on ne connaît pas. Dans chaque cas, il désigne une instance qui leur échappe et à laquelle le discours essaie de bricoler une constance, avec l’intention de pouvoir en vivre. De là leur trompeuse ressemblance : pour l’un et l’autre le sens ne se trouve pas d’emblée, ne se découvre pas mais il faut l’inventer, en bricoler les signifiants à partir des matériaux que fournit la culture, matériaux désormais éparpillés, ce qui ne facilite pas la chose. L’instance de l’Autre est d’abord celle d’une absence. Elle renvoie à l’expérience de la séparation, de la mise en abîme du désir dans l’entre-deux des subjectivités désirantes : un ab-sens, c’est-à-dire un sens qui ne se conçoit que d’être ailleurs. Les mystiques évoquent volontiers cette mise en abîme qui soutient leur désir, jusqu’à y prendre le risque d’abîmer leur vie puisque rien – ils le savent de leur nuit obscure – ne peut le garantir [109]». Tout y est, y compris la fascination de l’universitaire pour la mystique qui permet de donner un lieu qui ne soit pas absurde à cette sortie de la raison logique.
e) Détermination personnelle
Où nous situons-nous ? Entre Dalbiez et Ricœur. Nous inclinerions plus volontiers du côté du premier du fait de la précision des distinctions qu’il ose poser et qui permettent de sauver la méthode psychanalytique en écartant l’idéologie freudienne. Mais le second a pointé une vérité centrale du freudisme qui paraît avoir échappé à Dalbiez et qui est l’interférence profonde des dynamismes psychiques infra-humains et de la vie de l’esprit : Freud ne sépare jamais le désir de sa sémantique (pour parler comme Ricœur), de son enracinement culturel. Certes, la solution proposée sur fond de monisme pulsionnel nous paraît irrecevable, mais elle a au moins le mérite de s’affronter à cette question brûlante et fort délicate qui est celle du statut de la surdétermination dont le sublime (la sublimation) n’est qu’une des modalités. En ce sens, il ne s’agit pas tant de critiquer Dalbiez que de le prolonger : à sa réinterprétation de l’analyse freudienne de l’infra-humain il faudrait adjoindre une étude de l’articulation psychisme-esprit qui tienne compte de la théorie ricœurienne du symbole émondée de ses ambiguïtés anthropologiques. [110]
Refusant d’idolâtrer la psychanalyse, autant que de le diaboliser, je dirai volontiers que Freud parle de l’homme, mais de l’homme blessé. Il nous parle pas seulement de ce qui, en l’homme, n’est pas humain, selon le mot célèbre de Roland Dalbiez ; mais il traite de ce qui, en tout l’homme, est affecté par l’anarchie de la sensibilité blessée. Par méthode, par pratique, Freud n’a accès qu’à des personnes meurtries et non à la personne en ses dynamismes fonciers : tel est le lieu d’où il parle, comme nous allons le revoir en rencontrant les principaux concepts freudiens : l’inconscient, le transfert, les pulsions de mort, etc. Freud traite des mécanismes de l’homme, non de ses dynamismes qu’il ignore. Il ignore que la bonté foncière de l’homme est plus antique que ses blessures.
Freud ne parle pas de l’homme, mais de la blessure et, plus encore, de la blessure de l’affectivité. La blessure étant universelle, voilà pourquoi les mécanismes qu’il décrit valent pour tous. Et s’il dévoile les profondeurs, inconscientes, Freud a oublié qu’il existe aussi une psychologie des hauteurs.
Mon attitude à l’égard de Freud est nuancée : il s’agit d’en sauver la profonde vérité sans se laisser pièger par son pessimisme et sa tendance réductrice. Que notre positionnement puisse être à son tour lui-même soupçonné par des psychanalystes de métier est sans doute inévitable, surtout si l’on part du principe selon lequel seul peut parler de psychanalyse celui qui est pratiquent. Paul Ricœur a fait justice, à mon sens définitivement, de cette prise de position passablement idéologisée. Elle n’est pas sans rappeler le refus de certains chrétiens à envisager le phénomène de l’athéisme sous prétexte qu’il est extérieur à la foi ; mon propos s’adresse non pas aux pratiquants, mais à tout homme de bonne volonté.
Pascal Ide
[1] Interview dans Télérama, n° 2496, 12 novembre 1997, p. 80.
[2] Notamment développée dans Louis Beirnaert, L’expérience du désir et la naissance du sujet (psychanalyse, éthique et psychologie mystique), Travaux et conférences du Centre Sèvres, n° 18, Paris, Médiasèvres, 1989 ; et « Psychanalyse et vie de foi », p. 132-141. Les épithètes sont de nous.
[3] Il serait possible de synthétiser et d’illustrer les distinctions qui viennent d’être faites dans une image de type politique (sans oublier que omnis comparatio claudicat !) :
* Position exclusive : c’est le conflit guerrier à type de conquête qui vise l’annexion d’un pays par un autre.
* Position dualiste : c’est la répartition pacifique d’une terre entre deux peuples : « Sépare-toi de moi. Si tu prends la gauche, j’irai à droite, si tu prends la droite, j’irai à gauche ». (Gn 13,9)
Les deux autres positions étant unitaires, les images seront intérieures à une même nation :
* Position homologue : c’est la répartition des belges en descendants d’espagnols et en non-descendants d’espagnols.
* Position moniste : c’est la répartition des belges en belges de pure souche et les autres. Or, il se trouve en fait qu’ultimement, si on remonte à l’origine, aucun belge n’est originaire de Belgique…
[4] « Selon cette position dualiste, l’on dira que la foi qui tombe par suite d’une analyse n’était que névrotique » (L’expérience du désir et la naissance du sujet, p. 46), de sorte que la psychanalyse peut purifier la foi mais ne l’atteint pas comme telle.
[5] Louis Beirnaert, Aux frontières de l’acte psychanalytique. La Bible, saint Ignace, Freud et Lacan, Seuil, Paris, 1987, p. 136.
[6] Aux frontières de l’acte psychanalytique, p. 138-141.
[7] Telle est aussi la position de Jean-Marie Pohier (Au nom du Père, coll. « Cogitatio Fidei » n° 66, Paris, Le Cerf, 1972), selon ce que dit Beirnaert (Aux frontières de l’acte psychanalytique, p. 137). En l’occurrence, c’est ici que la distinction entre les deux discours (analytique et religieux) s’efface le plus. C’est ainsi que Beirnaert se nommait jésuite psychanalyse et non pas jésuite et psychanalyse, en vue de marquer le factice ou le difficultueux de la distinction dénotée par la conjonction de coordination. Cela nous autorise à parler de monisme, quoiqu’en un sens tout relatif, car Beirnaert a bien conscience que la foi ne se réduit pas à une production psychique. Monisme doit s’entendre d’un point de vue épistémologique.
[8] Bien d’autres noms auraient pu être retenus : le dominicain Albert Plé, le jésuite Joseph de Tonquédec, les carmes de la Revue carmélitaine, des prêtres séculiers comme Marc Oraison ou Tony Anatrella, des laïcs comme Jacques Arènes, dont de nombreuses femmes comme Françoise Dolto, Nicole Jeammet, Geneviève de Taisne, Nicole Fabre, Macha Chmakoff, et tant d’autres. Leurs écrits, qui cherchent à établir des ponts entre psychanalyse et foi chrétienne, contiennent de nombreux développements et discernements d’importance, mais aussi ne sont souvent pas indemnes d’imprécision. Par exemple, dans son livre Le signe de la baleine, Nicole Fabre présente notamment une approche réductrice du péché : « Adam et Eve auraient-ils eu raison de se faire exclure du jardin d’Eden ? Le péché qui sépare n’aurait-il pas l’avantage dans une telle perspective (il est question du péché de nos premiers parents) d’assurer l’originalité en même temps que la prise de conscience de soi ? » (p. 106) Et, plus loin, elle a cette formule malheureuse : « Au terme de l’analyse, grâce à ce travail de décapage et d’affinement intérieur, j’espère qu’ils auront retrouvé une part de responsabilité et de liberté. Peut-être alors seront-ils devenus capables de pécher ! » (p. 131) Nicole Fabre critique la conception paulinienne de l’Eglise comme corps, car elle peut devenir « monstrueusement étouffante » (p. 108). Au fond, ses limites et ses erreurs tiennent à ce qu’elle prétend faire une relecture de l’agir chrétien à partir d’une perspective exclusivement psychanalytique, sans en critiquer certains concepts (ici, implicitement, celui de fusion et de différenciation), ce qui signifie implicitement qu’elle absolutise l’anthropologie analytique. On perçoit donc en creux combien il est important de confronter ce qui ne reste qu’un modèle à une saine philosophie de l’homme qui apporterait un discernement critique.
[9] Concernant la réception catholique de la psychanalyse, le point de vue le plus développé est sans doute celui de Michel David : Michel David, La psicoanalisi nella cultura italiana, Turin, Boringhieri, 1966. Un chapitre est consacré à l’Eglise catholique. Cf. aussi Agnès Desmazières, L’inconscient au paradis. Comment les catholiques ont reçu la psychanalyse, Paris, Payot, 2011.
[10] Abram Kardiner, Mon analyse avec Freud, 1977, trad. Andrée Lyotard-May, Paris, Belfond, 1978, p. 89.
[11] Élisabeth Roudinesco, Sigmund Freud…, p. 344.
[12] Élisabeth Roudinesco, Sigmund Freud…, p. 450.
[13] Cf., par exemple la lettre de Freud à Horace Frink, 17 novembre 1921, Library of Congress.
[14] Elias Canetti, Le flambeau dans l’oreille. Histoire d’une vie, 1980, trad. Michel-François Demet, Paris, Albin Michel, 1982, p. 134.
[15] Cf., par exemple, Le livre noir de la psychanalyse, Paris, Les Arènes, 2005. Sur l’antifreudisme de droite, cf. Alain de Benoist, Vue de droite, Paris, 1974, p. 184-196. Notamment : Pierre Debray-Ritzen, La scolastique freudienne, Paris, Fayard, 1973, p. 190-193.
[16] Cf. Michel Onfray, Le crépuscule d’une idole. L’affabulation freudienne, Paris, Grasset, 2010.
[17] Cf. Gérard Zwang, La statue de Freud, Paris, Robert Laffont, 1985.
[18] Cf. Jacques Bénesteau, Mensonges freudiens, Sprimont (Belgique), Mardaga, 2002, par exemple chap. 12 : « La substance clinique ».
[19] Cf., par exemple Eva Weissweiler, Les Freud. Une famille viennoise, trad. Frank et Martine Straschitz, Paris, Plon, 2006, p. 124-125. Mais l’auteur affirme qu’il s’agit d’une interprétation et non d’un fait documenté.
[20] Pour le détail, cf. l’ouvrage cité : Élisabeth Roudinesco, Mais pourquoi tant de haine ? Peut-on se fier à l’étude de la vie privée de Freud de Ronald W. Clark, Freud, the Man and the Cause. A Biography, New York, Random House, 1980 ?
[21] Entretien avec Kurt Eissler, 29 août 1953, Library of Congress, box 114, folder 4
[22] Cf. Élisabeth Roudinesco, Mais pourquoi tant de haine ?, Paris, Seuil, 2010.
[23] Certains ouvrages sont sur la frontière entre position moniste et position dualiste. Tel est le cas, par exemple de l’ouvrage de Jacques van Rillaer, Les illusions de la psychanalyse, Bruxelles, Margada, 1989. En effet, l’auteur distingue deux aspects chez Freud, et en cela, il est dualiste ; mais cette distinction ouvre à une polémique unilatérale qui fait sombrer l’étude dans le cadre du Freud-bashing : selon Rillaer, le plus intéressant aspect appartient aux prédécesseurs (philosophes, médecins, psychologues) et le plus spécifique qui ne résiste pas à l’examen scientifique. Sa critique est ici spéculative et pratique : les psychanalystes contemporains sont des artisans d’aliénation ; la cure analytique accomplit des méfaits, est truquée, ainsi que le montrent des statistiques récentes.
[24] Sur la réception catholique, longue et nuancée, de la psychanalyse, cf. la thèse tout récemment publiée de Agnès Desmazières, L’inconscient au paradis. Comment les catholiques ont reçu la psychanalyse, Paris, Payot, 2011. Auparavant, le développement le plus substantiel est sans doute celui de Michel David, La psicoanalisi nella cultura italiana, Turin, Boringhieri, 1966. Un chapitre est consacré à l’Église catholique. Cf. aussi les développements, moins riches, d’Élisabeth Roudinesco, La bataille de cent ans. Histoire de la psychanalyse en France 2. 1925-1985, Paris, Seuil, 1986, p. 206-218. Cf. Laurent Lemoine, Psychanalyse et relation pastorale. Études de théologie morale autour du frère Albert Plé, o.p., de 1950 à 1980, coll. « Recherches morales », Paris, Le Cerf, 2010 : avec l’œuvre du père dominicain Albert Plé, cet ouvrage parle des travaux d’autres chercheurs chrétiens, Louis Beirnaert, André Godin, Maurice Bellet, Charles-Henri Nodet.
[25] Par exemple en 1920, Freud soulignait les limites de la psychanalyse au sujet des pulsions : « Les lacunes de notre description s’effaceraient probablement si nous nous trouvions déjà dans la situation où nous pourrions remplacer les termes psychologiques par des termes physiologiques ou chimiques […]. La biologie est vraiment un domaine aux possibilités illimitées » (Sigmund Freud, « Au-delà du principe de plaisir », Essais de psychanalyse, trad. dir. Par André Bourguignon, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2001, p. 122).
[26] Paris, DDB, 1936, 2 tomes.
[27] Le scientisme est la doctrine philosophique qui réduit la vérité à ce que la science peut démontrer.
[28] Je parle ici d’un discernement entre la méthode et son interprétation. Aujourd’hui, l’efficacité de la psychanalyse est âprement discutée notamment par l’apport de nouveaux outils psychothérapeutiques particulièrement intéressants comme les TCC. Mais cette discussion est interne à la seule méthode. Elle est normale au vu de l’évolution des thérapies comme de la médecine. La visée première est le bien des patients, ainsi que le redira le chapitre 8.
[29] Roland Dalbiez, La méthode psychanalytique et la doctrine freudienne, Paris, DDB, 1936, 2 tomes, 21949, p. 56.
[30] Roland Dalbiez, La méthode psychanalytique et la doctrine freudienne, Paris, DDB, 1936, 2 tomes, 21949, tome 2, p. 513.
[31] Jacques Maritain, « Freudisme et psychanalyse », Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle, Paris, DDB, 1939, repris dans Jacques et Raïssa Maritain, Œuvres complètes, Fribourg Suisse, Ed. Universitaires, Paris, Saint-Paul, 17 volumes, 1982-2008, vol. VII (1939-1943), 1988, p. 61-96, ici p. 72. Souligné par l’auteur.
[32] Cf. Rudolf Allers, Das Werden der sittlichen Person, Fribourg, Herder, 1929 : trad. en anglais : The Psychology of Character, London, Sheed & Ward, 1939. Sur Allers, cf. l’ouvrage au titre trop polémique de Louis Jugnet, Un psychiatre philosophe. Rudolf Allers ou l’anti-Freud, Paris, Cèdre, 1950.
[33] Généalogie de la psychanalyse, Paris, p.u.f., 1985. Je cite selon le compte rendu de P. Masset, Nouvelle revue théologique, 108 (1986), p. 571-575, ici p. 571.
[34] Michel Henry, Généalogie de la psychanalyse, coll. « Épiméthée », Paris, p.u.f., 1985, 4e de couverture.
[35] Paul Toinet, Les profondeurs de l’homme, p. 111.
[36] Les profondeurs de l’homme, p. 125. Cf. beau texte de P. Emmanuel, p. 130.
[37] L’expérience du désir et la naissance du sujet , p. 46.
[38] Cf. Paul Ricœur, « Mon premier maître en philosophie », Marguerite Léna (éd.), Paris, Critérion, 1991, p. 221-225. Lisible sur http://www.fondsricoeur.fr
[39] Paul Ricœur parle d’archéologie et de téléologie : De l’interprétation, p. 444-475. Sur la continuité (et la rupture) entre Ricœur et Dalbiez, cf. p. 8 et note 1.
[40] Paul Ricœur, De l’interprétation, p. 8.
[41] Paul Ricœur, De l’interprétation, p. 337 à 529.
[42] Ibid., p. 161 à 165.
[43] Ibid., p. 165 à 169.
[44] Totem et Tabou, p. 176.
[45] Ibid., p. 168.
[46] Ibid., p. 169 et 170.
[47] « Une interprétation philosophique de Freud », p. 160-177, ici p. 171-173
[48] Cf. Ibid., p. 161.
[49] Ibid., p. 173-176.
[50] Ibid., p. 337-406.
[51] Ibid., p. 407-443.
[52] « Une interprétation philosophique de Freud », p. 173.
[53] Ibid., p. 444-475.
[54] « Une interprétation philosophique de Freud », p. 173-174.
[55] « L’athéisme de la psychanalyse freudienne », Concilium 16 (1966), p. 75.
[56] Ibid.
[57] De l’interprétation, p. 8.
[58] Ibid., p. 476-529.
[59] Roland Dalbiez fait aussi deux intéressantes critiques à la notion freudienne de symbole. En effet, Freud le réduit doublement. D’abord, il confond la causalité et l’association par ressemblance ou contiguïté ; il a donc « constitué en cause nécessaire et suffisante du fantasme ce qui n’était qu’un accessoire associé dans le polymorphisme du symbole » (Gilbert Durand, L’imagination symbolique, Paris, DDB, 1949, p. 46. Cf. le résumé des p. 43-49). La réduction de toute image au sexuel vient de là. Ensuite, Freud réduit le symbole à l’effet-signe, ce qui en diminue beaucoup la portée. Par exemple, Minerve n’est plus symbole de la sagesse, mais la sagesse est le symbole de Minerve par association ; de plus, la sortie du crâne de Jupiter devient l’analogue de la naissance par la vulve.
[60] Paul Ricœur, Phénoménologie de la volonté. II. Finitude et culpabilité. 2. La symbolique du mal, Paris, Aubier-Montaigne, 1960, p. 323-332.
[61] Ibid., p. 21-25.
[62] De l’interprétation, p. 486.
[63] Ibid., p. 478 à 487.
[64] Ibid., p. 487-504.
[65] Paul Ricœur, Phénoménologie de la volonté. II. Finitude et culpabilité. 1. L’homme faillible, Paris, Aubier-Montaigne, 1960, chap. 3.
[66] De l’interprétation, p. 487-491.
[67] Ibid., p. 491 et 494.
[68] Ibid., p. 495 à 504.
[69] Ibid., p. 501.
[70] Ibid., p. 504-510.
[71] « L’athéisme… », p. 76.
[72] Ibid., p. 82. Pour Freud, le premier engendrera la notion de péché et le second la figure du Père. Ces deux affects intéressant l’un l’irascible et l’autre le concupiscible, tous deux absolument centraux structurent tout l’exposé de l’ouvrage d’Aantoine Vergote, Dette et désir (Paris, Seuil, 1978) comme le titre le dit assez.
[73] De l’interprétation, p. 504.
[74] Ibid., p. 505.
[75] Ibid.
[76] Ibid., p. 510. Enfin, Ricœur fait une application à Moïse et le monothéisme (Ibid., p. 510 s. On y trouve là quelques réflexions auxquelles nous nous permettons de renvoyer.
[77] Ibid., p. 492.
[78] Ibid., p. 494.
[79] Ibid., p. 500.
[80] Paul Ricœur écrit en 1965 ; or, la première édition du Vocabulaire de psychanalyse de Laplanche et Pontalis qui a permis tant d’heureuses mises au point, lexicales et historiques, est paru en 1973 ; ce fait explique l’imprécision de la notion.
[81] Cf. Michel Labourdette, Théologie morale. La chasteté [Somme de théologie, IIa-IIae, q. 151 à 154], Polycopié non édité, Toulouse, Couvent des dominicains, 1, Impasse Lacordaire, 1959-1960, p. 139-140.
[82] De l’interprétation, p. 492.
[83] Cf. l’article suggestif de Laurent Lemoine, « Louis Beirnaert, s. j. (1906-1985) : la rencontre insolite et fructueuse entre éthique psycholotique et éthique chrétienne », RTEM. Le Supplément, n° 229 (juin 2004), p. 89-114. Cet et à reprendre en détail. Car la position de Beirnaert gagne à être connue, intégrée, dépassée.
[84] Louis Beinaert, Expérience chrétienne et psychologie, Paris, Éd. de l’Épi, 1964, éd. revue et corrigée en 1966, liminaire pour la deuxième éd., p. 15.
[85] Louis Beinaert, « Psychanalyse et vie de foi », Id., Aux frontières de l’acte analytique. La Bible, S. Ignace, Freud et Lacan, Paris, Seuil, 1987, p. 138. On ne peut opposer « homme du mystère et homme du monde profane » (« Psychanalyse et mystère de l’homme », Ibid., p. 282). Cf. Id., L’expérience du désir et la naissance du sujet (psychanalyse, éthique et mystique), Travaux et conférences du Centre Sèvres, n° 18, Paris, Médiasèvres, 1989.
[86] Louis Beinaert, « Psychanalyse et rapport moyen-fin », Aux frontières de l’acte analytique, p. 85.
[87] Denis Vasse, Le temps du désir. Essai sur le corps et la parole, Paris, Seuil, 1969, rééd. Coll. « Points Seuil » ; L’Ombilic et la voix. Deux enfants en analyse, coll. « Le champ freudien », Paris, Seuil, 1974 ; Un parmi d’autres, coll. « Le champ freudien », Paris, Seuil, 1978 ; Le Poids du réel, la souffrance, Paris, Seuil, 1983 ; La Chair envisagée. La génération symbolique, Paris, Seuil, 1988 ; L’Autre du désir et le Dieu de la foi. Lire aujourd’hui Thérèse d’Avila, Paris, Seuil, 1991 ; Inceste et jalousie. La question de l’homme, Paris, Seuil, 1995 ; La dérision ou la joie. La question de la jouissance, Paris, Seuil, 1999.
[88] Denis Vasse, La vie et les vivants, p. 90, 113, 142, 151.
[89] Denis Vasse, La vie et les vivants, p. 44.
[90] Denis Vasse, La vie et les vivants, p. 34.
[91] Denis Vasse, « Le temps du désir : du besoin de la prière à la prière de désir », Christus, 14 (avril 1967) n° 54, p. 164-183 : Christus, 210 Hors Série (mai 2006), p. 74-90, § 3 : « L’illusion du besoin ou la manifestation du manque ».
[92] Denis Vasse, Le poids du réel, la souffrance, Paris, Seuil, 1983, p. 32.
[93] Jacques Lacan, cité par Denis Vasse, La dérision ou la joie. La question de la jouissance, Paris, Seuil, 1999, p. 18.
[94] Une fois, Vasse semble tirer le désir du côté du transcendantal telle que l’a élaboré Karl Rahner (cf. la longue citation de celui-ci dans La souffrance sans jouissance ou le martyre de l’Amour, Paris, Seuil, 1998, note 1, p. 13-14).
[95] Denis Vasse, La dérision ou la joie. p. 210.
[96] Denis Vasse, La vie et les vivants, Paris, Seuil, 2001, p. 114.
[97] Denis Vasse, La vie et les vivants, p. 37. C’est moi qui souligne.
[98] Denis Vasse, L’Autre du désir et le Dieu de la foi. Lire aujourd’hui Thérèse d’Avila, Paris, Seuil, 1991, p. 79. Souligné dans le texte.
[99] « Foi et psychanalyse », in Revue Thomiste, 95 (1995), p. 284-312, ici p. 289.
[100] Denis Vasse, Le temps du désir. Essai sur le corps et la parole, Paris, Seuil, 1969, p. 86.
[101] Il est surtout connu pour son ouvrage original : Dette et désir. Deux axes chrétiens et leur dérive pathologique, Paris, Seuil, 1978. Cf. art. « Psychanalyse et interprétation biblique », in SDB, tome 9, col. 252-260.
[102] Antoine Vergote, La psychanalyse à l’épreuve de la sublimation, coll. « Passages », Paris, Le Cerf, 1997. Cf. le compte-rendu très élogieux de Bernard Pottier, « A. Vergote : La psychanalyse à l’épreuve de la sublimation », Nouvelle revue théologique, 122/2 (2000), p. 274-277.
[103] Antoine Vergote, La psychanalyse à l’épreuve de la sublimation, coll. « Passages », Paris, Le Cerf, 1997, p. 252.
[104] Antoine Vergote, La psychanalyse à l’épreuve de la sublimation, p. 255.
[105] Antoine Vergote, art. « Psychanalyse et interprétation biblique », Supplément au Dictionnaire de la Bible, tome 9, col. 252-260, ici col. 252.
[106] Ils sont tous publiés chez Paris, DDB : Foi et psychanalyse, 1973 ; Dire ou la vérité improvisée, 1990 ; Le lieu perdu. De la psychanalyse du côté où ça se fait, 1996 ; L’écoute, 1999.
[107] Il a produit plus de 200 publications dont la moitié de haut niveau scientifique.
[108] Sur Bellet et Lemieux, cf. Jean-Louis Souletie, « Sciences humaines et théologie chrétienne après Chauvet », Philippe Bordeyne et Bruce T. Morrill (éds.), Les sacrements révélations de l’humanité de Dieu. Volume offert à Louis-Marie Chauvet, trad. Jean-Pierre Bagot, coll. « Cogitatio Fidei » n° 263, Paris, Le Cerf, 2008, p. 211-229, ici p. 219 à 224.
[109] Raymond Lemieux, « Le loup dans la bergerie. Théologie et psychanalyse exposées au champ de l’Autre », Théologiques, 10 (2002) n° 2, p. 25-53, ici p. 52. Souligné dans le texte.
[110] Notre perspective sera philosophique. Nous remonterons le cas échéant à des déviations métaphysiques majeures comme l’oubli de la potentialité ; mais, par souci d’homogénéité et de proportionner la critique à l’exposé, nous nous cantonnerons en général en philosophie de l’homme. C’est donc volontairement que nous avons écarté les points de vue méthodologiques (la confusion des plans si bien mise en valeur par Dalbiez), épistémologiques (par exemple, l’empirisme positiviste d’où découle le matérialisme athée) ou éthiques, a fortiori théologiques.