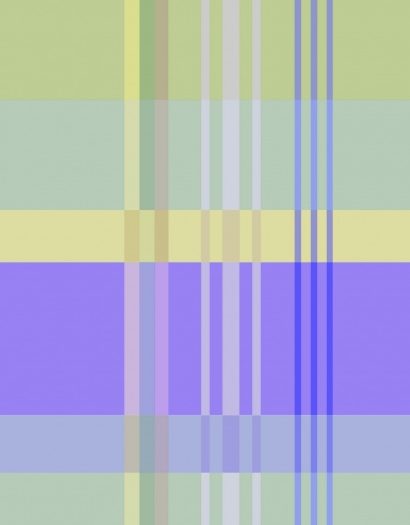A) La jeunesse de Freud et l’invention de la psychanalyse (1856-1905)
1) Naissance de Freud
Schlomo (Shelomoh), plus connu sous le prénom de Sigmund ou Sigismund Freud est né le mardi Rosch Hodesch Iyar 5616 du calendrier juif, soit le 6 mai 1856, à Freiberg (ou Vienne), 117, rue des Serruriers, premier des huit enfants de Jakob et de sa seconde épouse, Amalia.
Comme toujours, les naissances des hommes fameux sont entourées de légendes. Un jour, Amalia rencontra dans une pâtisserie une vieille femme qui lui prédisit que son fils serait un génie. Freud, qui était le préféré de sa mère, laquelle l’appelait « mon Sigi en or », a dû l’entendre. Plus tard, il ne manquera pas d’en faire l’herméneutique psychanalytique (!) : « Ces sortes de prophétie doivent être fréquentes, il y a tant de mères remplies d’espoir, tant de vieilles paysannes et de vieilles femmes qui, ne pouvant plus jouer de rôle dans le présent, s’en dédommagent en se tournant vers l’avenir [1] ». Que l’épisode soit légendaire importe peu ; en revanche, il permet de comprendre que Sigmund ait pu suivre un autre destin que celui qui lui était fixé par la lignée paternelle, à savoir négociant en laine. Amalia, femme séduisante et autoritaire, a pu faire valoir son point de vue à son mari.
2) Petite enfance de Freud et légendes freudiennes
Répétons-le une dernière fois : cette histoire au lance-pierre doit opérer des tris drastiques, pour faire comprendre quelques traits de la personnalité et de la doctrine freudiennes.
a) Freud abusé ?
Donnons un exemple de fausse rumeur, qui offrira aussi une première illustration de certains délires interprétatifs psychanalytiques. Le jeune Freud fut élevé par une bonne d’enfants engagée pour aider Amalia : Resi Wittek (ou Monika Zajic : il plane une incertitude sur le nom de la gouvernante [2]). Cette ardente catholique tchèque initia Freud à sa foi, de sorte que, pendant un bref temps, Sigmund glorifia le Dieu des chrétiens. Surtout, selon l’aveu même de Freud, « elle fut mon professeur de sexualité. Elle me lavait avec une eau rougeâtre dans laquelle elle s’était elle-même lavée auparavant [3] ». Or, en 1905, dans un essai fameux sur la sexualité dont on parlera, Freud affirmera que les nourrices peu consciencieuses endorment les enfants en leur caressant les organes génitaux [4]. Mettant en relation les deux faits, un certain nombre de commentateurs ont affirmé que Monika tripota le pénis du petit Sigmund, ce qui est l’origine de sa passion non seulement pour la sexualité, mais pour la sexualité infantile [5].
« La légende d’un Freud abusé par sa nourrice […] trouve donc sa source, comme toutes les autres légendes, dans l’œuvre freudienne elle-même, sans cesse réinterprétée au gré de spéculations ou de constructions infondées [6] ».
b) Relation aux amis
En revanche, un fait réel vaut d’être noté, car il conditionnera nombre d’événements futurs. Il est avéré avec certitude que Freud entretint avec son neveu John, plus âgé que lui, des relations ambivalentes : d’un côté, une relation de grande amitié, au point que les deux garçons étaient inséparables ; de l’autre, une relation de rivalité, accompagnée d’accusations et de disputes. Or, nous le verrons, Freud aura des relations très orageuses avec presque tous ses amis : il les aimera avec la même passion qui les fera se séparer d’eux, dans les larmes et les cris. Ainsi, faut-il s’en étonner ?, Freud comparera cette amitié à une amitié antique, celle de Brutus et de César, et y lira la matrice de toutes ses amitiés ultérieures (le déterminisme du passé) : « L’intimité d’une amitié, la haine pour un ennemi furent toujours essentielles à ma vie affective ; je n’ai jamais pu m’en passer, et la vie a souvent réalisé mon idéal d’enfant si parfaitement qu’une seule personne a pu être l’ami et l’ennemi [7] ». Enfin, on peut se demander si Freud en a fait la théorie, c’est-à-dire s’il a universalisé son expérience.
c) L’image du père
On ne saurait minimiser l’importance d’une autre donnée, plus traumatique, car il touche l’image du père. Jacob a d’abord donné à son fils Sigmund une image d’une forte autorité. Mais, en 1860, la famille Freud déménagea de Freiberg à la banlieue de Vienne, Leopoldstadt, peuplée de Juifs pauvres. Or, la mécanisation de la production des textiles mit en difficulté Jacob, négociant en textile. S’il réussit à assurer une vie décente à sa nombreuse famille, néanmoins, il ne prospéra jamais. Ainsi, « Jacob donna de lui l’image d’un homme faible et humilié ».
À ce fait s’ajoute un épisode ancien rapporté par le père lui-même à son fils pour lui dire que le temps présent était meilleur : « Un chrétien a jeté mon bonnet de fourrure dans la boue en criant : ‘Juif, descends du trottoir’ ». À Sigmund lui demandant ce qu’il avait fait, Jacob avait répondu : « J’ai ramassé mon bonnet ». Cet épisode dit plus que la défaillance du père face à cette réaction antisémite. Il est en effet significatif que, pour compenser cette scène qui lui déplaisait tant, Freud ait raconté qu’il lui a opposé une autre scène, elle, héroïque (et d’ailleurs historique) : Hamilcar faisant jurer à son fils Hannibal qu’il le vengerait des Romains et qu’il défendrait Carthage jusqu’à sa mort [8]. Ainsi, cette anecdote du bonnet de fourrure révèle l’attitude revancharde d’un Freud qui ne cessera pas seulement de venger son père de l’humiliation vécue et de demeurer fidèle à son identité juive (non sans paradoxe, on le redira), mais de valoriser le symbole du père. Sigmund, nouvel Hannibal (faut-il rappeler que ce général était sémite ?) !
d) Une autre amitié
À treize ans, Freud se lia d’amitié avec Eduard Silberstein, fils d’un banquier juif. Or, les deux garçons étaient tous deux férus de littérature et doués d’une forte imagination qui les conduisait à s’identifier à des héros de roman. Ils fondèrent une Academia castellana dont ils étaient les seuls membres, en hommage à leur écrivain favori, Cervantès. Particulièrement fascinés par une des Nouvelles exemplaires, « Colloque des chiens », ils s’attribuèrent chacun un nom de chien. Or, Freud choisit celui de Scipion, du nom du philosophe cynique, qui disserte à perte de vue sur les errances et les perversions humaines. Ainsi il prédisait déjà sa conviction à la fois que l’être humain ne peut maîtriser ses passions et que « l’homme qui pense […] est son propre législateur, son confesseur et son juge [9] ».
e) Le frère aîné
Disons un mot enfin de la fratrie :
« Ses cinq sœurs le vénéraient, elles le jugeaient tyrannique. Il surveillait leurs lectures, ne supportait pas le bruit du piano, qui le perturbait dans ses chères études, et il trouvait normal qu’elles fussent reléguées dans une chambre commune, éclairée à la bougie, alors que pour sa part il occupait une pièce à lui tout seul et jouissait d’une lampe à huile [10] ».
Qui a dit narcissique ? On ne saurait toutefois aller jusqu’à parler de personnalité narcissique, car Freud a toujours manifesté une véritable compassion et un souci pour ses proches, jusqu’au terme de sa vie. Il s’agit plutôt d’une mentalité patriarcale et machiste.
f) Conclusion
« Les commencements sont grands », disait Platon. Ces épisodes emblématiques permettent d’illustrer certaines constantes dans la personnalité et l’œuvre de Freud et de ses successeurs : l’importance et l’ambivalence de l’amitié ; l’hubris de l’interprétation ; l’importance de la loi du père ; la centralité de la judéité ; le goût pour la littérature ; l’ambition démesurée ; le pessimisme sur la nature humaine ; l’autoritarisme dominateur.
3) Les études à l’Université
Nous reviendrons sur les orientations de Freud en parlant de sa personnalité. Disons simplement ici qu’il opte pour les études scientifiques, précisément les sciences de la vie et la médecine. Il étudie à l’université de Vienne qui est l’une des meilleures d’Europe dans le domaine des sciences naturelles. À l’époque, la discipline reine est la physiologie, à laquelle Claude Bernard a donné ses lettres de noblesse en l’élevant au rang de science expérimentale. Or, la physiologie s’opposait au romantisme et au vitalisme en reconduisant les phénomènes biologiques à des processus physicochimiques. Autrement dit, avec militantisme, elle réduisait l’organisme, y compris humain, à la matière et aux forces la commandant. Si passionné soit-il par le psychisme, Freud fut irréversiblement marqué par cette prime perspective matérialiste et ne s’en départira jamais. En réalité, l’idéal scientiste anti-religieux l’imprégnait déjà.
Freud s’initia aussi avec beaucoup de rigueur et de patience aux exigences de l’expérimentation : il séjourna à deux reprises dans l’Institut de recherches sur les animaux marins fondé par Carl Claus à Trieste : il y examina sous microscope 400 spécimens d’anguilles pour démontrer l’hypothèse d’un chercheur polonais, Szymon Syrski, affirmant que les anguilles avaient des testicules. Freud poursuivit ses études à Vienne dans le laboratoire du grand maître viennois de la physiologie, Brücke, en observant les neurones des écrevisses et la moelle épinière de l’Amocoetes Petromyzon (un poisson très primitif), tout en élaborant une théorie neurologique, publiant de nombreux articles et suivant le cursus médical classique. Tout indiquait que Freud serait l’un des meilleurs chercheurs de sa génération en anatomie, en biologie et en physiologie [11].
Toutefois, malgré ses qualités et ces promesses, durant l’été 1882, Freud quitta le laboratoire et décida de s’orienter vers la médecine, donc d’approfondir sa connaissance de celle-ci par la pratique hospitalière.
4) La pratique hospitalière
Freud fut l’élève d’un grand maître de la psychiatrie viennoise, Theodor Meynert, chez qui il étudia pendant cinq mois. Puis, il devint ami de Josef Breuer (1842-1925), un clinicien juif assimilé dont il avait suivi les cours. D’une grande générosité envers ses amis, Breuer l’aida financièrement et surtout, percevant chez Freud son grand intérêt pour les expériences novatrices et transgressives, il lui conseilla de s’intéresser à l’hypnotisme, notamment pour traiter la maladie à la mode, l’hystérie. Or, à l’époque, on ne pouvait s’intéresser à cette pathologie, sans rencontre le plus grand spécialiste de l’hystérie dans le monde occidental : Jean-Martin Charcot, « le César de la Salpêtrière » [12].
a) La rencontre Freud-Charcot
Nous avons déjà évoqué cette personnalité fascinante et inquiétante. Imaginons-le, autoritaire, en habit noir, avec un monocle, glissant sa main pour se donner une pose impériale ou plutôt, osons-le dire, napoléonienne. Ce bel homme, taiseux, aux passions border-line pour les animaux (il vivait entouré de chiens et d’une petite guenon) et le cirque, attirait le tout-Paris intellectuel et médical à ses leçons du mardi et du vendredi, car il s’était d’abord fait connaître par sa description de la maladie portant son nom, la SLA, ensuite par sa réforme de l’institution asilaire en séparant les aliénées des épileptiques (qui ne sont pas aliénées) et les hystériques, et maintenant cette maladie si mystérieuse appelée hystérie. Cette pathologie désormais classée parmi les « névroses » (terme inventé en 1769 par le médecin écossais William Cullen pour définir les maladies nerveuses entraînant un trouble de la personnalité) intriguait par ses symptômes associant paralysies et gesticulations obscènes. Elle avait connu deux interprétations successives : pendant des siècles, on avait pensé le corps de la femme, singulièrement son utérus (d’où son nom), en proie à une possession démoniaque ; puis, avec Franz Anton Mesmer et sa théorie du magnétisme animal, on l’avait expliquée par un déséquilibre dans la diffusion d’un « fluide universel », qui conduisait les femmes à être simulatrice et se refuser à être mère et épouse. Charcot refusait ces deux théories, religieuse et savante, pour en proposer une troisième : l’origine traumatique ; autrement dit, ces femmes qui sont devenues célèbres, Rosalie Dubois, Justice Etchevery et bien d’autres, furent violées ou abusées dans leur enfance. Et ce génial clinicien qu’était Charcot le montrait en faisant apparaître ou disparaître les symptômes par transe hypnotique.
Par l’intercession de Brücke, Freud put quitter ses fonctions de praticien hospitalier et venir quatre mois et demi à Paris en juin 1885. Il s’installa en plein cœur du Quartier latin. Très vite, ce grand pratiquant des interprétations hâtives, juge autant les parisiennes qu’il trouve laides, la gastronomie française et les mœurs hexagonales :
« Ils ignorent pudeur et peur ; les femmes comme les hommes se pressent autour des nudités comme autour des cadavres de la Morgue ou des horribles affiches dans les rues, annonçant un nouveau roman dans tel ou tel journal et donnant en même temps un échantillon de son contenu. C’est le peuple des épidémies psychiques, des convulsions historiques de masse, et il n’a pas changé depuis Notre-Dame de Paris de Victor Hugo [13] ».
Bref, le Paris impudique et républicain choqua le Freud puritain et conservateur. En revanche, le Paris culturel, le Paris des grands boulevards, de Sarah Bernhardt et de Notre-Dame de Paris l’enchanta le Freud curieux de tout.
Un épisode vaut d’être rapporté. Le jeune Freud fut convié à une soirée à l’hôtel particulier de Charcot qui était sur le boulevard Saint-Germain. Il l’admirait tant qu’il fut attiré par sa fille, alors qu’il la trouvait laide. Bien entendu, il ne manqua pas de l’analyser dans sa Correspondance, voire d’en faire la théorie : « Rien n’est plus dangereux qu’une jeune fille qui a les traits d’un homme qu’on admire. On se moquerait alors de moi, on me chasserait et il ne me resterait plus que d’avoir vécu une belle aventure [14] »… Freud donna d’ailleurs à son premier fils le prénom Martin en souvenir de son « héros ».
Qu’est-ce que Charcot apporta à Freud ? [15] Certes, la personnalité et le rayonnement de cet homme mondialement connu l’ont fasciné. Ensuite, c’était un voyant à la grande puissance imaginative, comme Freud. Enfin, quant au contenu, Charcot a notamment apporté à Freud deux convictions : la causalité psychique et non pas organique de l’hystérie ; l’origine sexuelle.
En revanche, Freud a bientôt pris ses distances : celui de l’origine traumatique des hystéries.
b) La rencontre Freud-Bernheim
Comprendre ne suffit pas. Il faut aussi traiter. Charcot pratiquait l’hypnose. Mais un autre grand maître français la pratiquait dans un esprit différent, à Nancy : Hippolyte Bernheim. Or, celui-ci, s’arrachant définitivement à l’explication matérielle de Mesmer, faisait de l’hypnose une suggestion verbale. Freud se rendit à Nancy pour rencontrer Bernheim, discuter avec lui et assister à des séances de suggestion. À l’instar de ce qu’il avait fait avec Charcot, il traduira son livre [16]. De fait, se refusant d’entrer dans la polémique, Freud ne choisira pas entre les deux maîtres : du premier, il apprendra le diagnostic, c’est-à-dire l’étiologie psychique et sexuelle de l’hystérie ; du second, il apprendra que la cure peut opérer par la parole. D’ailleurs, bien vite, il abandonna l’hypnose pour ne garder que la catharsis et ce qui deviendra un sinon le concept clé de la psychanalyse, le transfert :
« Alors qu’une fois j’avais délivré de son mal l’une de mes patientes les plus dociles chez qui l’hypnose avait permis de réaliser les plus remarquables prodiges, en ramenant l’accès douloureux à sa cause, elle me passa à son réveil les bras autour du cou […]. Je gardais la tête assez froide pour ne pas porter ce hasard au compte d’un charme personnel irrésistible et pensais avoir désormais l’élément mystique qui était à l’œuvre derrière l’hypnose. Pour le mettre hors circuit, il fallait abandonner l’hypnose [17] ».
5) L’amitié décisive avec Wilhelm Fliess (1887-1900)
a) La rencontre et l’amitié
C’est à l’automne 1887 que se déroula l’une des rencontres les plus décisives, sinon la plus décisive, de la vie de Freud. Sur les conseils de Breuer, un oto-rhino-laryngologiste berlinois, Wilhelm Fliess, vint suivre les cours de Freud, alors Privat-docent (l’équivalent de maître-assistant), en même temps qu’il complétait sa formation à l’Hôpital général de Vienne. Ce juif sépharade était aussi un positiviste passionné de darwinisme, une intelligence prométhéenne brassant quantité de disciplines (mathématiques, histoire, littérature, art, etc.), et un esprit libre, aussi créatif que sûr de lui.
Faut-il le préciser, Freud qui était en manque d’interlocuteur et de relations intenses depuis plus d’un an, entra à nouveau dans une relation passionnelle, volcanique, un nouveau Sturm und Drang comme il les aimait. En témoignent les 287 lettres que Freud adressa à Fliess entre 1887 et 1904 : les mots se précipitent, en allemand ou en latin ; les idées encore davantage, multipliant les hypothèses sur la vie sexuelle. En revanche, nous ne possédons pas les lettres du médecin allemand. Nous verrons pourquoi. En tout cas, leur proximité était telle qu’ils devinrent jumeaux, jusqu’à se ressembler physiquement, se faisant photographier avec le même costume, la même barbe, le même regard. Surtout, ils convergeaient intellectuellement, échafaudant de concert les hypothèses les plus hardies. Entrons dans le détail.
b) La fécondité
Lorsqu’il rencontra Freud, Fliess était en train d’élaborer une doctrine où s’articulait une clinique de la névrose, une physiologie de la périodicité et une représentation médicale autant que cosmologique de la bisexualité humaine. Freud, quant à lui, construisait un modèle neurophysiologique cherchant à rendre compte de la totalité du fonctionnement psychique, normal et pathologique, et l’avait consigné dans un manuscrit d’une centaine de pages, Esquisse d’une psychologie scientifique [18]. Mais, grâce au contact avec Fliess, Freud se rendit rapidement compte qu’il tombait dans une sorte de « mythologie cérébrale » et qu’il neurologisait tout l’appareil psychique. Dès lors, il décida de construire une théorie non plus cérébrale ou neurologique, mais purement psychique de l’inconscient. Or, au centre de cette théorie, il affirmait que les symptômes névrotiques, notamment hystériques, avait pour cause un traumatisme sexuel subi dans l’enfance. Il retrouvait donc l’enseignement de Charcot.
c) La séparation
Au contact de Fliess, Freud ne se contenta pas de se séparer de l’interprétation neurologique (se coupant d’ailleurs d’avec Breuer), mais fit appel à la tragédie grecque et prépara le grand livre décisif dont nous allons bientôt parler. Cependant, il ne pouvait exister qu’un seul inventeur de la psychanalyse. Il fallait donc couper. La rupture, d’une grande violence, eut lieu en juillet 1900, au lac d’Achen : Fliess accusa Freud d’être agressif ; Freud accusa Fliess de ne pas reconnaître ses découvertes. Le thème des reproches est révélateur. Fliess ne pouvait se douter que Freud allait lui voler ses idées, comme il le dira en 1904 [19]. Freud à la fois projetait et anticipait l’accusation. En effet, en 1904, Fliess découvrit, dans le livre d’Otto Weininger, sa théorie de la bisexualité [20] ; or, Hermann Wodoba fut analysé par Freud qui lui parle de bisexualité, et en parle aussitôt à Weininger ; cette théorie provient de Freud. Mais comme Fliess lui en avait parlé, il accusa à juste titre le viennois de lui avoir volé l’idée. Après quinze années d’une si féconde amitié, ils se séparèrent pour ne plus jamais se revoir.
La suite est encore plus triste. Alors que, après une longue recherche infructueuse, Freud bénéficia ô combien de leur échange d’où germa la psychanalyse, Fliess acheva sa vie dans le désastre et l’absence totale de reconnaissance. Certes, Freud reconnut sa dette envers Fliess. Mais très parcimonieusement.
d) Une omertà pesante. Une ingratitude inquiétante
Jusqu’à quel point, Fliess est-il la véritable source de la psychanalyse ? Personne n’en saura jamais rien. Un fait est emblématique. On sait combien Freud avait souci d’assurer sa notoriété, voire de constituer des archives de sa propre histoire. Pourtant, il détruisit les lettres de Fliess, qu’on imagine nombreuses. Plus encore, lorsque Marie Bonaparte acheta les lettres de Freud à un marchand en 1936, il s’opposa à leur publication.
D’ailleurs, Freud a tenté de parer le coup en inventant le concept d’« auto-analyse [21] ». En effet, il déclara en août 1897 qu’il faisait une « auto-analyse ». C’est ainsi que Freud avait déclaré à Fliess qu’il était son principal patient. Or, s’auto-analyser, c’est tout découvrir à partir de soi et faire de la psychanalyse une totale création, donc prévenir toute critique de Fliess. D’ailleurs, la communauté freudienne crut en effet à ce qu’elle a elle-même appelé un « auto-engendrement ». Le premier à accepter ce mythe fondateur d’une création ex nihilo fut Ernest Jones en 1953 ; il en a tiré la conséquence que Freud souhaitait : Fliess joua le rôle du séducteur paranoïaque autant que du substitut paternel ; mais Freud a finalement su s’en débarrasser par son génie et devenir le « père fondateur » de la psychanalyse. Didier Anzieu, l’un des spécialistes français de la psychanalyse, a intitulé son ouvrage-phare : L’auto-analyse de Freud [22], où il évalue avec mesure cette auto-analyse [23].
Pourtant, Freud lui-même dut reconnaître :
« Mon auto-analyse reste interrompue. J’ai compris pourquoi. Je ne peux m’analyser moi-même qu’avec des connaissance objectivement acquises (comme un étranger). L’auto-analyse proprement dite est impossible, sinon il n’y aurait pas de maladie. Comme j’ai encore affaire à quelques énigmes dans mes cas, cela doit forcément m’arrêter dans mon auto-analyse aussi [24] ».
À sa suite, l’historiographie freudienne, Roudinesco en tête, tord le cou à cette nouvelle légende. Ainsi Octave Mannoni décida de substituer au terme d’« auto-analyse » celui d’« analyse originelle », intégrant la part apportée par les théories fliessiennes [25].
Enfin, Freud lui-même n’avoue-t-il pas plus qu’il ne le veut ? En effet, il écrit dans une lettre à Fliess datant du début de la rupture que, pour penser, il avait besoin d’un ami capable de lui révéler ce qu’il avait de « féminin » en lui. Or, ce faisant, non seulement il convoquait la théorie de la bisexualité élaborée par son ami, mais il faisait de celui-ci le principe masculin, donc fécondant… Il ajoute d’ailleurs un autre aveu des limites de la nouveauté de son invention :
« Aucun critique n’est, mieux que moi, capable de saisir clairement la disproportion qui existe entre les problèmes et la solution que je leur donne et, pour ma juste punition, aucune des régions inexplorées de la psyché, où, le premier parmi les mortels, je me suis aventuré, ne portera mon nom ou n’obéira à mes lois [26] »
Or, qui dit « punition », dit culpabilité et l’on sait que souvent le nom d’une nouveauté est celui du novateur, c’est-à-dire de l’inventeur ; c’est donc que Freud avoue implicitement être coupable de vol d’idées…
L’on comprend donc que, dans le cadre de la mythologie interprétative caractéristique de la psychanalyse, Peter Swales ait imaginé que, lors de cette rencontre au lac d’Achen, Freud aurait tenté d’assassiner Fliess [27]. Toutefois, il n’apporte aucune preuve à l’appui.
e) Freud, inventeur de la psychanalyse ?
Quoi qu’il en soit du rôle joué par Fliess, on ne peut nier l’originalité et la créativité de Freud. D’un mot, que l’on trouve les éléments de sa théorie chez ses contemporains et ses prédécesseurs, chez ses amis et rivaux, ne prouve pas qu’il n’est pas l’inventeur de la psychanalyse, mais simplement qu’inventer n’est pas créer. En effet, l’on doit toujours distinguer deux aspects dans la réalité : la matière et la forme ; les éléments et le tout (substantiel). Or, créer est faire surgir les deux aspects, alors qu’inventer porte sur le deuxième qui rapproche les parties du premier et les configure de manière neuve. Cette dualité d’aspect explique donc la double attitude possible face à la nouveauté : le misonéisme d’un côté, l’herméneutique de la révolution de l’autre.
Bien d’autres exemples pourraient l’attester, même chez les génies les plus incontestés comme Albert Einstein. Cela vaut même pour la plus grande des nouveautés, celle du Christ. Détaillons brièvement cette analogie. Le théologien suisse Hans Urs von Balthasar tient à un surgissement absolu, longuement attendu, mais totalement imprévisible. Tout à l’inverse, un Daniel Boyarin, professeur de Talmud à Berkeley, souligne fortement la continuité entre christianisme et judaïsme : partant de l’évangile selon S. Marc, il estime que la plupart des idées et des pratiques provenant de Jésus font partie du judaïsme dont il este contemporain – y compris la Trinité, l’Incarnation, la Rédemption. Par exemple, se fondant sur Dn 7, repris en Hénoch et en IV Esdras, Boyarin affirme qu’il y a eu un judaïsme qui cultive « l’idée d’une seconde personne divine venant sur terre sous forme humaine comme Messie [28] ». Il affirme donc que tout était déjà présent dans le milieu juif contemporain du Christ.
Appliquons cette grille à Freud lui-même : assurément, certaines briques ont été apportées par d’autres, et plus que Freud l’avoue ; cependant, celui-ci a apporté aussi des éléments ; surtout, la synthèse est incontestablement de lui, ainsi qu’elle émerge dans ce qui est probablement son plus grand livre, en tout cas le plus révolutionnaire : L’interprétation du rêve.
6) La naissance de la psychanalyse
La psychanalyse va apparaître au confluent de cinq grandes idées neuves. Et surtout d’une expérience (f). D’où découle la nouvelle théorie du psychisme humain (g).
a) L’approche narrative
La première nouveauté introduite par la psychanalyse est l’approche narrative. Nous peinons à nous imaginer cette fin de xixe siècle, avec son scientisme triomphant et une véritable manie de la classification. Michel Foucauld nous y a pourtant rendu sensible. La sexologie n’a pas échappé à cette toute-puissance taxonomique. C’est ainsi que les trois grands sexologues Kraft-Ebing, Albert Moll et Havelock Ellis se penchent avec passion et érudition sur les différentes pratiques, perversions et identités sexuelles : hystérie, homosexualité, bisexualité, transvestisme, transsexualisme, pédophilie, fétichisme, zoophilie, sans oublier l’onanisme – inversion et masturbation étant les deux figures majeures du « sexe non procréatif ». Deux conséquences : la description, classification et la compréhension (ici l’origine infantile de ces pathologies) priment la thérapeutique ; les exposés sont des descriptions froides, impersonnelles et hérissées de termes scientifiques.
Or, dans un ouvrage qui fit date et est daté de 1895, Études sur l’hystérie, Freud et son ami-bienfaiteur Breuer proposent une toute autre approche : narrative et, de surcroît, talentueuse (littéraire). Par exemple :
« Elle me raconte comment elle soignait son frère malade qui, à cause de la morphine, était sujet à de terribles crises pendant lesquelles il la terrorisait en la saisissant […]. Elle a fait des rêves affreux, les pieds des chaises et les dossiers des fauteuils étaient tous des serpents, un monstre à tête de vautour l’avait becquetée et mordue par tout le corps [29] ».
Plus encore, ils y racontent en détail des cas devenus célèbres, comme celui de Bertha Pappenheim, plus connue sous son pseudo « Anna O ». Précisément, ils décrivent les cas de huit patientes dont ils affirment qu’ils les ont guéries, sinon de leur pathologie, du moins de leur symptômes.
En passant de la géographie à l’histoire, Freud et Fliess introduisent une vie et une passion, mais aussi un drame. Ils rendent aussi sensible la souffrance de ces personnes. Ils sortent de même de la fausse lumière des classifications pour faire entrer dans le clair-obscur des secrets de famille. Par ailleurs, ils élargissent la perspective non seulement de l’histoire personnelle à l’histoire familiale, mais aussi à l’histoire de toute une génération et de toute une société bourgeoise dans l’empire austro-hongrois. Enfin, ils ouvrent des possibilités curatives, ici par le biais de cures hypnotiques et cathartiques. Ici, en l’occurrence, Bertha fut traitée par Breuer.
b) Le transfert
Autant Breuer et Freud convergent sur cette approche narrative nouvelle, autant ils divergent sur le moyen thérapeutique qui allait devenir central chez Freud : le transfert. Concrètement, dans l’écrit de 1895, Breuer se refuse à interpréter la séduction que la patiente exerce sur son thérapeute, alors que Freud y voit un rejeu de son traumatisme.
En fait, les divergences sont plus nombreuses et toutes fondamentales : Breuer doute beaucoup, Freud est catégorique ; Breuer privilégie la cause physiologique, Freud la cause psychique ; Breuer fait de la cause sexuelle (la séduction, faible mot, euphémisme pour dire abus) une étiologie parmi d’autres, Freud centre tout sur elle ; etc. Jones a mis de la paille sur le feu en inventant une opposition entre le « peureux » Breuer et le « courageux » Freud…
Aussi ne nous étonnerons-nous pas si, une nouvelle fois, Freud transforme cet ami, de surcroît bienfaiteur, en ennemi : certes, à cause des divergences ; mais aussi parce qu’il ne supporte pas d’être contredit (Roudinesco ose parler d’« orgueil [30] » : nous reviendrons sur ce point) ; sa passion exclusive pour Fliess devient de plus en plus envahissante ; faut-il ajouter une cause psychanalytique ? Freud n’en finit pas d’en découdre avec le père, et comment ce professeur qui fut aussi son protecteur n’évoquerait-il pas la figure paternelle ? On objectera que Freud reconnaîtra s’être trompé en 1925, à la mort de Breuer, dans une lettre à son fils Robert. Outre cet aveu seulement post mortem, faut-il ajouter qu’il ne le fait que conditionnellement, c’est-à-dire après avoir appris que, après la rupture, Breuer n’avait de cesse de s’intéresser à ses travaux… : « Ce que vous avez dit du rapport de votre père à mes travaux plus tardifs était nouveau pour moi et a agi comme un baume sur une blessure douloureuse qui ne s’était jamais fermée [31] ».
c) Du trauma réel au trauma fantasmé
En 1896, Freud tient toujours à sa théorie de la séduction, autrement dit à un « attentat précoce », c’est-à-dire à l’existence, en toute famille, d’une agression d’un adulte (parent, gouvernante, frère aîné) sur un enfant en général âgé de deux à cinq ans. Voire, il proposait à partir de là une classification des névroses en névrose obsessionnelle chez les hommes et névrose hystérique chez les femmes. En effet, les garçons participaient activement à l’agression subie et les filles acceptaient passivement l’abus [32].
Le 2 mai 1896, Freud, téméraire, proposa sa théorie à l’Association de psychiatrie et de neurologie de Vienne, notamment face à Kraft-Ebing ; celui-ci, glacial, qualifia sa communication de « conte de fées scientifiques » [33]. Freud ne manqua pas de réagir en se sentant non seulement exclu, mais persécuté par les mandarins de la Faculté. Pourtant, il n’allait pas tarder à lui-même s’opposer à sa propre théorie.
Pourquoi ? Je n’ai pas lu d’explication convaincante. En tout cas, deux faits vont jouer un rôle peut-être déterminant.
Tout d’abord, Jacob Freud, le père de Sigmund, meurt le 23 octobre 1896. Or, dans la souffrance qu’il éprouve, il réagit en psychanalyste : « à cette occasion se sont sans doute réveillées au fond de moi toutes les choses du passé [34] ». Plus, voire pire, trois mois plus tard, conformément à sa théorie de la séduction, Freud interprète cette souffrance en termes d’abus : Jacob « a été l’un de ces pervers et a été responsable de l’hystérie de mon frère (dont les états correspondent tous à une identification) et de celle de quelques-unes de mes plus jeunes sœurs ». Et il ajoute cette généralisation qui ressemble fort à une protection mentaliste : « La fréquence de cette relation me donne souvent à penser [35] ». Toutefois, une telle accusation ne peut que le conduire à s’interroger sur sa propre attitude. Or, il ne peut que constater qu’il n’est pas lui-même un abuseur d’enfants. Sa théorie est-elle donc juste ?
Ensuite, Freud va enfin pouvoir réaliser un de ses rêves, qui s’inscrit dans sa fièvre voyageuse : la visite de l’Italie. Il s’y rendra à plusieurs reprises : en septembre 1895, à Venise ; en 1896, en Toscane ; en 1897, de nouveau à Venise puis à Sienne, Orvieto, Pérouse, Arezzo, Florence ; puis, il se rendra toujours plus « vers le sud », à Rome, mais aussi à Pompéi, Naples, Palerme, etc. [36] Or, ces voyages, loin d’être seulement extérieurs, sont aussi et d’abord une plongée dans son intériorité et une source d’intense créativité : « On se délecte d’une beauté étrange et d’une énorme poussée créatrice, en même temps mon penchant pour le grotesque et le psychisme pervers y trouve son compte ». Autrement dit, sont stimulés autant, côté objet, le primat de l’intérieur et de l’intérieur sombre, irrationnel, que, côté sujet, cette intériorité inventive. Quoi qu’il en soit, de retour à Vienne, Freud avoue renoncer à sa théorie de la séduction qu’il appelle sa neurotica : « Je ne crois plus à ma neurotica [37] ». Conséquence : Jacob fut injustement soupçonné. Mais Freud s’en est-il excusé, au moins auprès de son confident correspondant de toutes ces découvertes, Fliess ? Il ne semble pas.
La conséquence en est que, en quittant la scène réelle pour entrer dans la scène fantasmée, l’explication des traumatismes sexuels et de l’hystérie cesse d’appartenir au discours scientifique de la physiologie et de la nosographie pour entrer dans celui de l’interprétation des discours du patient et de ses multiples temporalités. Le thérapeute devenait donc un herméneute appelé à démêler les différents fils : abus passé, fantasme présent et transfert tout aussi présent.
d) Une nouvelle théorie de la sexualité
En intériorisant le trauma qui était un trauma sexuel, Freud était inéluctablement voué à accorder à la sexualité une place nouvelle et surtout centrale. En effet, en réduisant le réalisme extérieur du traumatisme, il fallait accroître son impact intérieur, donc faire du fantasme sexuel une réalité totalement décisive. Précisément, le cœur de l’organisation pulsionnelle de l’être humain ; plus encore de l’enfant. Nous y reviendrons plus loin en développant la théorie freudienne de la sexualité.
e) L’introduction des figures mythiques : Œdipe et Hamlet
Freud est toujours demeuré un scientiste et un darwinien. Or, la science cherche des lois nécessaires et Darwin cherchait la loi biologique unifiant la totalité du monde vivant. De même Freud est en quête du grand mécanisme déterminant l’ensemble du fonctionnement du psychisme humain. D’ailleurs, Darwin imitait Newton, de sorte que l’on pourrait affirmer l’analogie suivante : Newton est au cosmos, ce que Darwin est à la vie et Freud au psychisme, des chercheurs de la logique unifiant la totalité.
- Nous avons enfin vu combien la correspondance est, pour Freud, la forme du dialogue, avec l’autre, mais peut-être plus encore avec soi, une manière de remuer des idées, d’évaluer quantité d’hypothèses. L’intuition révolutionnaire apparaît au détour d’une lettre à Fliess datée du 15 octobre 1897 : « Chaque auditeur fut un jour en germe, en imagination, un Œdipe qui s’épouvante devant la réalisation de son rêve transposé dans la réalité, il frémit suivant toute la mesure du refoulement qui sépare son état infantile de son état actuel [38]». Comme toujours, ainsi que nous l’avons vu, le coup de génie ne consiste pas à créer ex nihilo, mais à rapprocher parfois par-delà les champs épistémiques, les cultures, les siècles, à comparer, ici deux mondes qui n’avaient été jamais rapproché avec cette profondeur : celui de la névrose et celui de la tragédie grecque.
Qui ignore ce héros tragique – Sophocle a consacré une trilogie à la famille des Labdacides – qui fut peut-être le plus tragique des tragédies grecques ? Rappelons d’abord que, pendant des siècles, en fait jusqu’à Freud, l’héroïne tragique par excellence était Antigone ; on doit à Freud delui avoir substitué Œdipe. Rappelons ensuite qu’il s’agit d’un Œdipe reconstruit, voire d’une véritable refondation du mythe. En effet, Œdipe n’est en rien coupable d’avoir tué son père Laïos et d’avoir épousé sa mère Jocaste : d’une part, nulle haine ne l’animait, ni contre son père, ni contre l’étranger qui bloquait la route le conduisant à Thèbes ; d’autre part, nul désir ne l’attirait vers cette mère que, après avoir résolu l’énigme du Sphinx, ou plutôt de la Sphinge, la cité lui attribua comme épouse. Or, tout au contraire, dans la théorie analytique, le jeune enfant est coupable d’un double désir : parricide (tuer son père) et incestuel (posséder sexuellement le corps de sa mère).
Faut-il rappeler aussi la part biographique dans cette interprétation ? Nous venons de voir combien Freud accusa injustement ce père faible dont il avait honte et combien, jeune enfant, il fut fasciné par sa mère qu’il trouvait séduisante et, plus encore, fut ébloui par la vision de la nudité de sa mère, lors d’un voyage en train entre Freiberg et Leipzig. Et que dire du contexte sociohistorique ? Freud parle à partir d’un cadre particulier marqué d’une part par un système patriarcal et machiste, d’autre part par la puissance impériale du dernier Empire catholique d’Europe et du monde.
Quoi qu’il en soit, dans le « cas Dora » (Ida Bauer), la première cure psychanalytique que Freud estime avoir menée, la cause des symptômes hystériques qu’elle présente est interprété en termes œdipiens, à savoir un désir incestueux refoulé à l’égard de son père [39].
- Mais la figure d’Œdipe ne saurait suffire. Pour l’actualiser et y ajouter la culpabilité, Freud lui adjoint, dans le même texte, le personnage de Shakespeare, le prince danois et chrétien Hamlet. En effet, en tuant cette figure de substitution du père qu’est l’oncle devenu l’époux de sa mère, Hamlet est un Œdipe moderne, un Œdipe qui a intériorisé le fameux complexe par une « conscience coupable » : « Comment comprendre son hésitation à venger son père par le meurtre de son oncle […] ? Tout s’éclaire mieux lorsqu’on songe au tourment que provoque en lui le vague souvenir d’avoir souhaité, par passion pour sa mère, perpétrer envers son père le même forfait [40]». Pour être précis, le néologisme allemand Ödipuskomplex, « complexe d’Œdipe », apparaît non pas dans L’interprétation du rêve, comme Freud le dit faussement [41], mais plus tard, dans un article de 1910, de peu postérieur à l’essai sur Léonard de Vinci [42].
- On pourrait ajouter une influence souterraine de Faust ou plutôt du pacte faustien qui lie le Docteur avec le diable. Autrement dit, tout homme est ligoté, à son insu, par un déterminisme.
- Désormais, Freud est en possession de la loi d’airain, du déterminisme qui travaille chaque sujet à son insu, de sorte que tout homme ne peut que répéter le crime envers l’autre homme (en termes moins crus : entrer en rivalité et en rejet avec les hommes) et l’inceste envers la femme (en termes moins crus : épouser sa mère en croyant épouser sa femme). Ainsi toute personne est travaillée par une conscience coupable qui le conduit à s’inventer un « roman familial ». Cette expression inventée par Freud et Rank en 1909, peut se définir comme la reconfiguration que le sujet fait de son histoire familiale différente des liens généalogique réels [43].
f) Naissance d’une nouvelle discipline
La conséquence en est la naissance d’une nouvelle discipline. En effet, Freud propose une nouvelle théorie de la psyché qui se veut scientifique. Pourtant, il l’élabore à partir d’une étude ni des processus physiologiques ou pathologiques, comme en médecine, ni des comportements humains comme en sociologie ou en anthropologie, ni des phénomènes psychiques comme en psychologie, mais de la littérature et des mythes d’origine. Cette discipline inclassable, résistant à toutes les réductions, Freud lui donne un nom emprunté à Breuer même, ainsi qu’il l’a reconnu le 30 mars 1896 : « Psychoanalyse » [44]. Ce terme désigne une nouvelle méthode d’exploration de l’inconscient. Il demeure que le contenu, lui, est bien de Freud. Il s’agit d’une cure par la parole. La guérison venait d’une mise à jour de l’origine du mal, comme par un aveu. La proximité avec l’aveu des péchés, et donc avec la confession catholique, a été relevée par Michel Foucault et Michel de Certeau.
Et d’où vient cette nouvelle méthode ? à la suite de Didier Anzieu, relevons une différence riche de sens : la différence entre le Freud de 1895 et celui de 1902 [45]. En 1895, Freud est un homme de talent, plein d’énergie intellectuelle et physique, d’apparence calme et raisonnable. « Pourtant il portait en lui une souffrance. Il était la proie facile du ressentiment, du remords, du doute sur lui-même et de la dépendance envers autrui. Il ne se décourageait pas, mais se déprimait. […] En fait ce quadragénaire était en pleine crise d’entrée dans l’âge mûr ». Maintenant, « si nous considérons le même homme sept ans après, en 1902, nous sommes frappés par une série de transformations. Freud a conquis une plus grande sérénité intérieure. Il se sent sûr de sa vérité et de celle de son œuvre. À l’hostilité contre elle, il fait face avec une confiance résolue. Certes, sa phobie des voyages en chemin de fer ou de la traversée des rues, sa crainte de la mort, son ambivalence passionnelle dans les rapports humains se sont atténuées sans disparaître. Il est à peu près conscient de leurs mécanismes, assez libre à l’égard de leurs effets, et apte à traiter par l’auto-analyse et la discussion en commun ses difficultés intérieures. Le savant a par ailleurs libéré son imagination et les découvertes qu’il vient d’effectuer sont non plus des produits laborieux, mais des éclairs d’intuition. […] Sa culture a pris un tour nouveau ; la connaissances des civilisations disparues le passionne ; il collectionne les antiquités, voyage avec abondance, escalade les massifs alpins, visite les villes d’art du nord de l’Italie ».
Que s’est-il passé entre 1895 et 1902 ? L’autoanalyse de Freud. Et cette métamorphose intérieure s’est traduire par une grande créativité noétique, autrement dit, par la découverte de nombreux concepts [46]. Notamment, « il a admis la spécificité des processus psychiques et renoncé à les expliquer par leur dépendance au cerveau [47] ». Ceci est un grand apport de Freud, contre le réductionnisme matérialiste toujours renaissant. Et c’est le mérite de Dalbiez que de l’avoir relevé.
7) L’interprétation du rêve (1900)
Désormais, les éléments sont prêts à être agencés pour constituer la synthèse freudienne. Le point de départ sera l’étude de ce qui l’attire le plus depuis des années, l’analyse des rêves ; le point d’arrivée sera une toute nouvelle théorie du psychisme humain, rien moins que cela.
a) Le matériau préparatoire
Il est d’abord constitué des rêves mêmes de Freud. En effet, celui-ci a une riche activité onirique, entre rêves et rêveries, entretenue par sa consommation de drogues. De plus, il les relate dans un journal. Enfin, ces songes sont d’une extrême variété : dans ses langues, dans ses thèmes (sexualité, bien sûr, mais aussi famille, politique, antisémitisme, histoire, nourriture, mort, Dieu, amour), etc., dans sa richesse culturelle (il se met en scène dans des personnages littéraires, visite les musées européens, fait des voyages, etc.)
L’ouvrage rassemble d’autres rêves, ceux rapportés par ses proches (70), ceux contés par des personnes célèbres (comme Bismarck, etc.). Avec ses 50 rêves, nous aboutissons à un matériau total de 160 rêves.
Bien évidemment, ce livre est aussi révélateur de l’histoire de Freud, ainsi que lui-même le confiera dans la préface à la deuxième édition : l’ouvrage possède « une signification subjective que je n’ai saisie qu’une fois l’ouvrage terminé. J’ai compris qu’il était un morceau de mon auto-analyse, ma réaction à la mort de mon père, le drame le plus poignant d’une vie d’homme [48] ».
Enfin, comme toujours lorsqu’il est saisi par une passion, Freud a rassemblé un nombre colossal d’ouvrages sur l’onirisme ; de fait toutes les interprétations du rêve, depuis Aristote jusqu’à ses contemporains, surtout Alfred Maury, Karl Albert Scherner et Hervey de Saint-Denys, sont discutées dans la première partie de son livre [49].
b) Le titre
Tout indique que Freud veut écrire une œuvre marquante. Le titre de l’ouvrage d’abord : Die Traumdeutung, littéralement « Interprétation du rêve ». Deux faits qui frappent plus le germanophone que le francophone, d’autant que la traduction du titre fut longtemps fautive : « Interprétations des rêves », etc. D’abord, il ne parle pas des rêves, mais du rêve ; ensuite, il emploie non pas trois mots et deux concepts séparés (Deutung des Traums), mais un mot. Ainsi, Freud souligne-t-il le caractère synthétique, plus, définitif, de sa vision des rêves et, par delà, de la psyché humaine.
Ensuite, Freud choisit une épigraphe tirée de L’Énéide : « Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo : Si je ne puis fléchir les dieux d’en haut, je saurai mouvoir l’Achéron » (L. vii) [50]. Pour mémoire, Junon, femme de Jupiter, défend Didon, reine de Carthage. Elle cherche à convaincre Jupiter de laisser Énée épouser Didon, mais n’y parvient pas. Elle décide alors de faire appel à une furie bisexuelle nommée Alecto, pour qu’elle déchaîne les passions les plus instinctives et les plus guerrières dans le camp des alliés d’Énée. Or, Jupiter représente les dieux d’en haut et Alecto surgit de l’Achéron. La citation résume donc l’attitude de Junon : si elle ne peut fléchir Zeus, elle pliera Énée lui-même et directement, via l’Achéron, c’est-à-dire Alecto.
Freud en offre lui-même l’interprétation en 1927 dans une lettre à Werner Achelis où il dit qu’il découvrit cette citation dans un pamphlet publié par Ferdinand Lassalle en 1859, contre la monarchie des Habsbourg jugée obscurantiste. Il récuse l’interprétation politique pour lui substituer une interprétation psychologique :
« Vous traduisez Acheronta movebo par ‘remuer les fondements de la terre’, alors que les mots signifient plutôt ‘remuer le monde souterrain’. J’avais emprunté cette citation à Lasalle pour qui elle avait sûrement un sens personnel et se rapportait aux couches sociales et non à la psychologie ? Pour moi, je l’avais adoptée uniquement pour mettre l’accent sur une pièce maîtresse de la dynamique du rêve. La motion de désir repoussée par les instances psychiques supérieures (le désir refoulé du rêve) met en mouvement le monde psychique souterrain (l’inconscient) afin de se faire percevoir [51] ».
c) Le contenu
Notons quelques contenus parmi les plus importants. Il faut distinguer l’interprétation du rêve comme telle de la conception de l’appareil psychique.
1’) La théorie du rêve
- Nous avons déjà dit que Freud commence par une longue topique des opinions de ses prédécesseurs et contemporains.
- En deux chapitres, il expose ensuite sa méthode interprétative. Deux nouveautés : la libre association par laquelle le rêveur laisse libre cours à ses « pensées » ; le passage de la description figée à la narration. Tout cherche à dissoudre le plus possible les défenses, c’est-à-dire les censures de l’inconscient.
- Puis, il expose sa théorie du rêve.
- En premier lieu, sa structure. Elle est en quelque sorte épiphanique. En effet, le rêve est consitué d’un double contenu : manifeste (dont le rêveur est conscient et qu’il rapporte, raconte) et latent (dont le rêveur n’a pas conscience et qu’il découvrira par association et interprétation). Les deux contenus
« nous apparaissent comme deux présentations du même contenu en deux langues différentes, ou, pour mieux dire, le contenu du rêve nous apparaît comme un transfert des pensées du rêve dans un autre mode d’expression dont nous devons apprendre à connaître les signes et les lois de composition, par comparaison de l’original et de la traduction. Les pensées du rêve nous sont immédiatement compréhensibles dès que nous en prenons connaissance [52] ».
Illustrons à partir d’un exemple. Freud n’étant pas un grand pédagogue, je l’emprunterais à un autre auteur, inspiré par la psychanalyse freudienne. Voici un rêve de femme de 30 ans :
« J’étais une femme de ménage. Dans un vaste et luxueux salon, je frottais le parquet. J’avançais à quatre pattes. J’avais l’impression de me trouver depuis longtemps dans ce lieu. Des gens passaient. C’étaient une réception, je pense. J’aperçois une quantité de vaisselle à faire briller. C’était… comment vous dire ?… comme si j’étais à un point d’aboutissement de ma vie ; une sensation que je ne puis décrire… J’étais triste, en tout cas seule hors de tout… »
Le psychologue en propose l’explication suivante. Cette femme est maniaque. Nous en connaissons la cause : cette manie obsessionnelle de l’ordre s’origine dans le besoin d’être en règle devant une autorité (un surmoi). Ce perfectionnisme naît souvent d’un intense sentiment de culpabilité. « Dans ce rêve, nous trouvons également une notion de misérabilisme et d’échec (elle est devenue femme de ménage, elle travaille à quatre pattes). À ceci s’ajoute une sensation d’indignité (les gens ne la remarquent pas) ». Or, « ce rêve fut fort utile à cette jeune femme. Elle put prendre conscience qu’elle avait toujours caché, sous des compensations, le fait de se croire indigne d’exister. Ces compensations étaient ce qu’elles sont généralement : hauteur, mépris envers les autres, orgueil, besoin d’avoir raison, etc. »
À cela s’ajoute un » besoin d’échec ». En effet, « le fait de se croire inférieur et coupable d’exister, engendre automatiquement le besoin inconscient d’échouer [53] ». Car réussir c’est exister. Comment dès lors, la personne qui se ressent comme non-existante peut-elle réussir ?
- En second lieu, Freud expose les mécanismes du rêve, c’est-à-dire les processus qui permettent d’exprimer en contenu patent, manifeste, mais en les cachant, le contenu latent. Ils sont aussi au nombre de deux principaux : le déplacement qui procède par glissement des éléments primordiaux ; la condensation, qui procède par fusion de plusieurs contenus en une seule image (manifeste).
Nous aboutissons ainsi à la fameuse explication de Freud : le rêve est la réalisation d’un désir. Illustrons-la à partir d’un exemple de Freud lui-même :
« Une fillette de près de quatre ans avait été amenée de la compagne à la ville […] ; elle avait passé la nuit chez une tante sans enfants, dans un lit disproportionné à sa taille. Le lendemain matin, elle dit avoir rêvé que le lit était devenu beaucoup trop petit de sorte qu’elle n’y avait plus assez de place. L’énigme de ce rêve, en tant que réalisation d’un désir, est facile à éclaircir. Qui ne sait que pour les enfants, une chose entre toutes est désirable : devenir grand ! Les dimensions du lit avaient rappelé trop vivement à la fille son peu d’importance ; aussi s’empressa-t-elle de remédier en rêve à cette situation humiliante, et elle devint si grande que le grand lit même ne pouvait plus la contenir [54] ».
2’) L’objection classique du cauchemar
Voici comment Daniel Lagache répond : « Il est des rêves dont le contenu manifeste paraît en contradiction évidente avec la réalisation d’un désir : ce sont ceux où le rêveur subit un traitement pénible, par exemple un jugement, une condamnation à mort. L’explication en est généralement simple : le besoin dominant libéré par le sommeil est un besoin de punition (masochisme moral) [55] ». Bref, « le rêve est une tentative pour réduire des tensions dont l’élévation excessive entraîne l’angoisse, le cauchemar et le réveil [56] ».
On pourrait analyser le rêve à partir des quatre causes (cf. mon topo).
3’) La théorie psychique
« L’interprétation des rêves est […] la voie royale de la connaissance de l’inconscient ». La formule peut-être la plus célèbre de Freud ne provient pas de la Traumdeutung, mais d’un essai postérieur [57]. Aussi Freud est-il naturellement conduit à développer une théorie de l’inconscient, donc du psychisme. Elle est exposée dans le chapitre 7, le plus célèbre, le plus commenté et le plus original. Livre dans le livre, ce chapitre développe sa conception de l’appareil psychique, la première topique. Comme pour le rêve, Freud a étudié toutes les différentes théories de la psyché développées au xixe siècle, avant de proposer la sienne. Il distingue trois instances : le conscient, qui est équivalent à la conscience, et est donc actuellement conscient ; le préconscient, qui est potentiellement conscient, autrement dit est accessible au conscient ; l’inconscient, qui n’est pas accessible au conscient, car il lui résiste activement, plus encore, car le conscient l’a activement refoulé hors de son champ : il est donc, par définition, inaccessible et inconnu. Cette conception est profondément originale. Alors que les auteurs concevaient l’inconscient comme une supraconscience ou une sorte de réservoir de déraison, de démence, Freud propose de le définir par son mécanisme de création, le refoulement.
Pour reprendre l’image mythique ouvrant l’ouvrage, ou d’autres chères à Freud : « Le refoulement est à l’Achéron ce que l’inconscient est à Œdipe et le préconscient à Hamlet [58] ».
d) Conscience de l’importance
Freud a une vive conscience de l’originalité et de l’importance de son Traumbuch. Quand il écrit à Fliess, il se réfère au Docteur Faust (faisant de Fliess un double de Méphisto…) ou à Dante accomplissant le voyage total que l’on sait. Il faudrait aussi évoquer le périple d’Ulysse. Toutes ces images, dont on sait qu’elles sont, pour Freud, porteuses des vérités les plus intimes du psychisme, expriment ce que Freud veut réaliser : en visitant, voyageant dans le psychisme, Freud cherche à révéler ce qui était enfoui et qui n’avait jamais été révélé. Désormais l’exode, la rencontre n’est plus une terre cosmologiquement organisée (Homère) ni théologiquement agencée (Dante), c’est le psychisme humain (tournant anthropologique de la modernité) ; mais ce n’est pas le psychisme tout-puissant des Lumières (dont parle Gœthe), c’est le psychisme à la fois humilié par la découverte des sombres déterminismes inconscients et fasciné par ses profondeurs ténébreuses (romantisme jamais assagi de Freud). Tel est le sens de cet aveu de Freud à Jones :
« Je suis destiné, je crois à ne découvrir que ce qui est évident : que les enfants ont une sexualité – ce que toute nurse sait –, que nos rêves nocturnes sont, de la même façon que nos rêveries diurnes, des réalisations de désir [59] ».
Par ailleurs, confirmation est fournie par la date d’édition : non pas 1899, ce qui aurait été possible, mais 1900, l’ouverture d’un nouveau siècle, le xxe (du moins symboliquement, car, réellement, 1900 est la dernière année du xixe siècle…).
De plus, jusqu’en 1929, Freud ne cessa de remanier l’opus magnum qu’est l’ouvrage inaugural de la psychanalyse, y mettant à jour la bibliographie, y approfondissant son analyse, etc.
Enfin, Freud écrivit à Fliess le 12 juin 1900 : « Crois-tu vraiment qu’il y aura un jour sur cette maison une plaque de marbre où l’on pourra lire : ‘Ici se dévoila, le 24 juillet 1895, au Dr Sigmund Freud, le mystère du rêve’ [60] ? » Le rêve fut exaucé le 6 mai 1977.
e) La réception et le prolongement dans la trilogie [61]
Longtemps, l’opinion courut que ce livre fut mal reçu. Freud le premier accrédita cette nouvelle légende freudienne, lorsque, dans la préface à la deuxième édition, en 1908, il parle du « silence de mort ». De fait, son livre ne fut pas un best-seller : il se vendit une moyenne de 75 exemplaires par an pendant 8 ans. Les recensions n’ont pas parlé de Freud comme du Claude Bernard, du Charles Darwin ou du Louis Pasteur de la psychologie – ce à quoi le psychiatre viennois s’attendait.
Toutefois, ce constat est partiel. D’abord, l’ouvrage fut recensé par la quasi-totalité des grandes revues de médecine et de psychologie européennes ; ensuite, le livre suscita d’intenses polémiques, allant jusqu’à l’insulte. Surtout, Freud n’a pas pris le bon étalon pour mesurer la réception de sa pensée : plus que la médecine ou la psychologie, plus même que les articles et les ouvrages, ce sont les milieux artistiques, en particulier littéraires (notamment surréalistes), et philosophiques qui assurèrent à la psychanalyse le succès qu’on lui connaît en Occident. Enfin, en février 1902, Freud obtint la nomination tant désirée (Nothnagel et Krafft-Ebing avaient proposé cette candidature dès 1897) comme professeur extraordinaire à l’université de Vienne : le médecin de ville qu’il était jusqu’à maintenant devenait le Herr Professor qu’il demeurera jusqu’à la fin de sa vie – cela par une lettre signée de l’empereur très catholique François-Joseph, le 5 mars 1902, ce qui ne manque pas d’humour [62].
Comment expliquer le décalage entre la réalité et l’interprétation de Freud, suivie en chœur par ses disciples ? Là encore, par la tendance paranoïaque du Maître, par son autoconviction de Juif persécuté. On en trouve confirmation dans la perception qu’eut Freud de son deuxième ouvrage psychanalytique, La psychopathologie de la vie quotidienne, parue en deux parties dans une revue en 1901, avant d’être publiée, en 1905 [63]. Il traite des manifestations constantes autant qu’insues de l’inconscient dans les divers lapsus de la vie quotidienne – ces ratées multiples étant signalées en allemand par le préfixe ver- : versprechen (lapsus linguae), verhören (lapsus auditif), verlesen (lapsus lecturae), verschreiben (lapsus scriptae), vergriffen (geste manqué), vergessen (oubli de mots). Or, d’un côté, Freud se convainquit que l’accueil serait négatif : « L’ouvrage me déplaît terriblement et déplaira, je l’espère, encore plus aux autres [64] » ; de l’autre côté, ce livre fut accueilli : avec enthousiasme, de plus par un large public, durablement, avec fécondité comme une introduction pédagogique à l’inconscient, au point que écrivains, linguistes, structuralistes, Lacan et bien d’autres ont fait par lui leur entrée en psychanalyse. Adjoignons d’ailleurs le troisième livre de la trilogie que Freud a consacré aux formations de l’inconscient au tournant du xxe siècle : Le mot d’esprit dans sa relation avec l’inconscient [65].
8) Une nouvelle vision de la psychè
a) L’inconscient
1’) L’inconscient juste avant Freud
La décennie qui précède l’année 1900, d’intenses explorations sur l’inconscient eurent lieu. Tout a commencé par la publication, en 1889, de l’ouvrage décisif de Janet, L’automatisme psychologique. Un philosophe et psychologue, Théodore Flournoy (1854-1920), travaille de manière indépendante à Genève et exerce une grande influence par ses ouvrages. Notamment, il distingue quatre grandes fonctions de l’inconscient : créatrice, protectrice, compensateur et ludique [66]. Il a particulièrement développé l’activité créatrice, rapportant le cas d’une jeune mère qui, par moments, dicte des fragments philosophiques dépassant nettement et ses goûts et ses compétences [67].
Si bien qu’Ellenberger synthétise les apports de cette période si féconde en distinguant les quatre activités de l’inconscient : conservateur (l’hypnose montrant nombre de phénomènes d’hypermnésie, l’inconscient apparaissait de plus en plus comme un réservoir d’événements oubliés qu’il était possible de remémorer à certains moments) ; dissociatif (les habitudes, voire les fragments de la personne vivant à côté de la personnalité consciente, comme dissociés) ; créatrice (le romantisme avait particulièrement insisté sur ce point) ; mythopoïétique (la fabrication de romans intérieurs) [68].
Il faudrait ici rappeler ce que nous avons vu avec Pierre Janet, qui s’est approché de très près de la théorie freudienne et accorde une véritable puissance à l’inconscient.
2’) La nouveauté freudienne
On sait quelle place centrale la psychanalyse freudienne a accordée à l’inconscient. La conception de l’inconscient que nous développons rejoint la conception freudienne de l’inconscient (ce que l’on appelle parfois l’inconscient dynamique). Il vaut la peine de citer longuement un texte clair du psychiatre viennois.
« La division du psychique en un psychique conscient et un psychique inconscient constitue la prémisse fondamentale de la psychanalyse, sans laquelle elle serait incapable de comprendre les processus pathologiques, aussi fréquents que graves, de la vie psychique et de les faire rentrer dans le cadre de la science. […]
« ‘Être conscient’ est avant tout une expression purement descriptive et se rapporte à la perception la plus immédiate et la plus certaine. Mais l’expérience nous montre qu’un élément psychique, une représentation par exemple, n’est jamais conscient d’une façon permanente. Ce qui caractérise plutôt les éléments psychiques, c’est la disparition rapide de leur état conscient. Une représentation, consciente à un moment donné, ne l’est plus au moment suivant, mais peut le redevenir dans certaines conditions, faciles à réaliser. Dans l’intervalle, nous ignorons ce qu’elle est ; nous pouvons dire qu’elle est latente, entendant par là qu’elle est capable à tout instant de devenir consciente. En disant qu’une représentation est restée, dans l’intervalle, inconsciente, nous formulons encore une définition correcte, cet état inconscient coïncidant avec l’état latent et l’aptitude à revenir à la conscience. […]
« Mais nous avons obtenu le terme ou la notion de l’inconscient en suivant une autre voie, et notamment en utilisant des expériences dans lesquelles intervient le dynamisme psychique. […] Qu’il nous suffise de rappeler que c’est en ce point qu’intervient la théorie psychanalytique pour déclarer que si certaines représentations sont incapables de devenir conscientes, c’est à cause d’une certaine force qui s’y oppose ; que sans cette force elles pourraient bien devenir conscientes, ce qui nous permettrait de constater combien peu elles diffèrent d’autres éléments psychiques, officiellement reconnus comme tels. Ce qui rend cette théorie irréfutable, c’est qu’elle a trouvé dans la technique psychanalytique un moyen qui permet de vaincre la force d’opposition et d’amener à la conscience ces représentations inconscientes. À l’état dans lequel se trouvent ces représentations, avant qu’elles soient amenées à la conscience, nous avons donné le nom de refoulement ; et quant à la force qui produit et maintient le refoulement, nous disons que nous la ressentons, pendant le travail analytique, sous la forme d’une résistance. Cette notion de l’inconscient se trouve ainsi déduite de la théorie du refoulement [69] ».
L’inconscient est donc, pour Freud, identiquement le refoulé. En effet, explique-t-il, « un désir violent a été ressenti, qui s’est trouvé en complète opposition avec les autres désirs de l’individu, inconciliable avec les aspirations morales et esthétiques de l’individu ». Or « l’acceptation du désir inconciliable ou la prolongation du conflit auraient provoqué un malaise intense ». Seule solution pour sauvegarder la paix : « le refoulement épargne ce malaise, il apparaît ainsi comme un moyen de protéger la personne psychique [70] ». Le refoulement est donc l’opération par laquelle est repoussé dans l’inconscient des représentations (plus exactement des objets et des opérations de puissances de connaissance) liées à des pulsions, en vue de maintenir l’unité psychique. Il est le mécanisme qui crée et entretient l’inconscient, la censure servant de tourniquet unidirectionnel.
D’autres concepts freudiens trouvent leur place et leur explication dans notre perspective :
b) Le conflit psychique
Comme le dit Freud, « le processus […] : conflit, refoulement, substitution sous forme de formation de compromis, se renouvelle dans tous les symptômes de psychonévroses [71] », donc, pour le psychiatre viennois, dans toute la vie.
« Pour Freud – explique Maurice Corvez – le […] phénomène de refoulement est intimement connexe avec celui de conflit psychique. Un psychisme fragile s’est trouvé aux prises avec des forces, intérieures ou extérieures, contraires à certaines de ses tendances, instinctives ou acquises. […] L’être humain possède en effet à toutes les étapes de son développement psychique, une certaine lumière intérieure qui, dans les conflits inévitables de ses inclinations entre elles ou avec les réalités extérieures, l’invite et l’aide à se défendre contre toute menace de dissociation. Or, cet effort pour la sauvegarde de son intégrité psychique peut échouer ». « Le refoulement a donc pour caractéristique essentielle d’être privé de l’énergie de synthèse qui aurait dû s’employer à résoudre les conflits psychiques, selon les possibilités et les exigences particulières de chaque âge mental. […] Chaque fois, il y a eu malfaçon, réaction fausse, déviation et fonctionnement défectueux par rapport à ce qui eût été juste et sain [72] ».
En premier lieu, l’expérience montre qu’il accepte que notre gestion des affects ne soit souvent pas totalement maîtrisée et s’accommoder de la présence de plusieurs des processus psychologiques imparfaits présents ci-dessus. Par exemple, il y a fréquemment une part de peur, de formation réactionnelle, d’idéalisation dans notre douceur ou notre chasteté.
En second lieu, cette part de défense n’est en rien immorale ou coupable d’un point de vue éthique. Il faut en effet distinguer les processus psychiques qui sont moralement neutres et la régulation vertueuse qui seule confère sa qualification éthique à la gestion de nos passions. Un acte n’est humain (et donc humanisant) qu’à la mesure de la volonté qui l’investit. Or, la plupart des processus décrits ci-dessus se sont installés dans la prime enfance, alors que l’exercice de la volonté était minime ; et même établis plus tard, ils sont rarement conscientisés par le sujet ; or, l’exercice de la volonté requiert celui de la conscience.
c) Principe de plaisir et principe de réalité
« Dans Freud, c’est sous cette forme qu’apparaît le réel, à savoir l’obstacle au principe de plaisir. Le réel, c’est le heurt, c’est le fait que ça ne s’arrange pas tout de suite, comme le veut la main qui se tend vers les objets extérieurs [73] ».
Lacan a très bien vu que le principe de réalité n’est pas positif. L’homme blessé vit le réel comme ce qui contrarie son désir.
Voilà pourquoi la différence principale, au plan psychologique, n’est plus celle du sensible et de l’intelligible, mais celle du moi, c’est-à-dire mon plaisir, et de l’autre, le réel, qui me résiste.
Pascal Ide
[1] Sigmund Freud, L’interprétation du rêve, trad. Ignace Meyerson et Denise Berger, Paris, p.u.f., 1967, p. 171.
[2] Cf. Élisabeth Roudinesco, Sigmund Freud…, p. 25, note 1.
[3] Sigmund Freud, Lettre du 3 octobre 1897, Lettres à Wilhelm Fliess, 1887-1904, éd. complète Jeffrey Moussaieff Masson, trad. Françoise Khan et Robert, François Paris, p.u.f., 2006, p. 341. Sigmund Freud, Lettres à Wilhelm Fliess 1887-1904,
[4] Cf. Sigmund Freud, Trois essais sur la théorie sexuelle, 1905, trad. Philippe Koeppel, Paris, Gallimard, 1987.
[5] Un exemple parmi beaucoup, plus anciens : Marianne Krüll, Sigmund, fils de Jakob, 1979, trad. Marielène Weber, coll. « Connaissance de l’inconscient », Paris, Gallimard, 1983.
[6] Élisabeth Roudinesco, Sigmund Freud…, p. 27.
[7] Sigmund Freud, L’interprétation du rêve, p. 412.
[8] Cf. Sigmund Freud, L’interprétation du rêve, p. 175.
[9] Sigmund Freud, Lettres de jeunesse, 1989, trad. Cornélius Heim, Paris, Gallimard, 1990, p. 133-134.
[10] Élisabeth Roudinesco, Sigmund Freud…, p. 33.
[11] Cf. Frank J. Sulloway, Freud, biologiste de l’esprit, 1979, trad. Jean Lelaidier, Paris, Plon, 1998.
[12] Cf. Jean-Martin Charcot, Leçons du mardi à la Salpêtrière, Paris, Le Crosnier & Babé, 1892, 2 vol. Freud les traduira en allemand. Cf. aussi Marcel Gauchet et Gladys Swain, Le vrai Charcot. Les chemins imprévus de l’inconscient, Paris, Calmann-Lévy, 1997.
[13] Sigmund Freud, Correspondance, p. 186.
[14] Sigmund Freud, Correspondance, p. 209.
[15] Cf. Sigmund Freud, « Charcot », 1893, trad. Janine Altounian, Résultats, idées, problèmes, tome 1. 1890-1920, Paris, p.u.f., 1984, p. 61-73. Dans cette notice nécrologique, Freud dit aussi ce que lui a apporté le maître de la Salpêtrière.
[16] Cf. Hippolyte Bernheim, Hypnotisme, suggestion, psychothérapie, 1891, coll. « Corpus des œuvres de philosophie en langue française », Paris, Fayard, 1995.
[17] Sigmund Freud, Sigmund Freud présenté par lui-même, 1925, trad. Françoise Cambon, Paris, Gallimard, 1984, p. 47.
[18] Publié une première fois sous ce titre dans La naissance de la psychanalyse, il a été retraduit sous le titre Projet d’une psychologie, dans Sigmund Freud, Lettres à Wilhelm Fliess 1887-1904, p. 593-693.
[19] Outre l’ouvrage de Max Schur (La mort dans la vie de Freud, 1972, trad. Brigitte Bost, coll. « Connaissance de l’inconscient », Paris, Gallimard, 1975, coll. « Tel », 1982) et celui déjà cité de Frank J. Sulloway, cf. Erik Porge, Vol d’idées ? Wilhelm Fliess, son plagiat et Freud, suivi de Wilhelm Fliess, Pour ma propre cause, Paris, Denoël, 1994.
[20] Otto Weininger, Sexe et caractère, 1903, trad. Daniel Renaud, Lausanne, L’Âge d’homme, 1975. Cf. Jacques Le Rider, Le cas Otto Weininger. Racines de l’antiféminisme et de l’antisémitisme, Paris, p.u.f., 1982.
[21] Cf. Sigmund Freud, Lettres à Wilhelm Fliess, p. 331, 339, 351.
[22] Didier Anzieu, L’auto-analyse de Freud et la découverte de la psychanalyse, coll. « Bibliothèque de psychanalyse », Paris, p.u.f., 21975, 2 tomes. Remarquablement clair, cet ouvrage montre comment la psychanalyse freudienne est née, notamment à travers l’auto-analyse de Freud. C’est une excellente introduction à Freud.
[23] Il est vrai qu’une des trois sources de la doctrine psychanalytique est l’auto-analyse de Freud (les deux autres, selon Anzieu, étant l’analyse de ses patients et la culture). Mais l’homme ne peut jamais se connaître ni connaître quoi que ce soit seul : « Il n’y a pas d’auto-analyse sérieuse si elle n’est parlée à quelqu’un ». C’est ainsi que « l’auto-analyse de Freud a été un dialogue constant avec Fliess auquel le liaient une grande connivence fantasmatique et une homosexualité latente » (L’auto-analyse de Freud…, p. 732). « Resituée dans » son « contexte interrelationnel, l’auto-analyse devient possible. Elle est même nécessaire pour » les psychanalystes. D’ailleurs, « chaque psychanalyste a en effet à réinventer d’une certaine façon la psychanalyse pour lui-même ». Elle est, pour Freud, comme pour les autres, « l’acte permanent d’appropriation personnelle de la psychanalyse » (Ibid., p. 733).
[24] Ibid., p. 357. Cf. aussi p. 430.
[25] Cf. Octave Mannoni, Clefs pour l’imaginaire, Paris, Seuil, 1979, p. 115-131.
[26] Sigmund Freud, Lettres à Wilhelm Fliess, p. 521. Retraduit par Élisabeth Roudinesco, Sigmund Freud…, p. 84.
[27] Peter Swales, « Freud, Fliess and Fratricide. The Role of Fliess in Freud’s Conception of Paranoïa », Laurence Spurling (éd.), Sigmund Freud. Critical Assessments, London & New York, Routledge, 1982, vol. 1.
[28] Daniel Boyarin, Le Christ juif. À la recherche des origines, trad. Marc Rastoin, coll. « Initiations bibliques », Paris, Le Cerf, 2013, p. 128.
[29] Josef Breuer et Sigmund Freud, Études sur l’hystérie, 1895, trad. Anne Berman, Paris, p.u.f., 1967, p. 41-47.
[30] Élisabeth Roudinesco, Sigmund Freud…, p. 94.
[31] Sigmund Freud, Lettre à Robert Breuer, 26 juin 1925, citée par Albrecht Hirschmüller, Josef Breuer, 1978, trad. Marielène Weber, Paris, p.u.f., 1991, p. 268.
[32] Sigmund Freud, « L’hérédité et l’étiologie des névroses », 1896, in Œuvres complètes de Freud. Psychanalyse, Jean Laplanche, Pierre Cotet, André Bourguignon, François Robert et al. (éds.), Paris, p.u.f., 1988-2014 (désormais cité par son acrostiche : OCF.P), 21 volumes, tome 3, p. 105-120, ici p. 120.
[33] Sigmund Freud, « Sur l’étiologie de l’hystérie », 1896, in OCF.P, tome 3, p. 147-180.
[34] Sigmund Freud, Lettres à Wilhelm Fliess, p. 258.
[35] Ibid., p. 294.
[36] Cf. Sigmund Freud, « Notre cœur tend vers le sud ». Correspondance de voyage, 1895-1923, trad. Jean-Claude Capèle, Paris, Fayard, 2005.
[37] Sigmund Freud, Lettres à Wilhelm Fliess, p. 333.
[38] Sigmund Freud, La naissance de la psychanalyse, p. 198 ; cf. Id., Lettre du 15 octobre 1897, Lettres à Wilhelm Fliess, p. 344. Souligné par moi.
[39] Sigmund Freud, « Fragment d’une analyse d’hystérie (Dora) », 1905, in Cinq psychanalyses, trad. Marie Bonaparte, Paris, p.u.f., 1954, p. 1-91 : OCF.P, tome 6, p. 183-291. La meilleure reconstitution de ce cas, qui a bénéficié de dizaines d’études, est celle de Patrick Mahony, Dora s’en va. Violence dans la psychanalyse, 1996, trad. Aline Weil, coll. « Les Empêcheurs de penser en rond », Paris, Synthélabo, 2001.
[40] Ibid., p. 198-199 et p. 344-345.
[41] Sigmund Freud, L’interprétation du rêve, p. 229, note 1.
[42] Sigmund Freud, « D’un type particulier de choix d’objet chez l’homme », in OCF.P, tome 10, p. 197.
[43] Cf. Otto Rank, Le mythe de la naissance du héros, suivi de La légende de Lohengrin, trad. Elliot Klein, Paris, Payot, 1983.
[44] Cf. Sigmund Freud, « L’hérédité et l’étiologie des névroses », 1896, in OCF.P, tome 3, p. 105-120. Article rédigé en français.
[45] Didier Anzieu, L’auto-analyse de Freud…, p. 723 à 727.
[46] Ibid., p. 724 et 725. Ces concepts sont classés par ordre alphabétique.
[47] Ibid., p. 727.
[48] Sigmund Freud, L’interprétation du rêve, p. 4.
[49] Cf. Jacqueline Carroy, Nuits savantes. Une histoire des rêves (1800-1945), Paris, EHESS, 2012.
[50] Cf., par exemple, Jacques Le Rider, « Je mettrai en branle l’Achéron. Fortune et signification d’une citation de Virgile », Europe, 954 (octobre 2008), p. 113-122.
[51] Sigmund Freud, Correspondance, p. 408.
[52] L’interprétation des rêves, trad., Paris, p.u.f., nouvelle éd., 1967, p. 207.
[53] Pierre Daco, L’interprétation des rêves. Pour la valorisation de votre domaine profond, coll. « Marabout Service » n° 341, Viviers, Marabout, 1979, p. 76-78.
[54] Le rêve et son interprétation, p. 33.
[55] Daniel Lagache, La psychanalyse, coll. « Que sais-je ? » n° 660, Paris, p.u.f., 101971, p. 54-55.
[56] Daniel Lagache, La psychanalyse, coll. « Que sais-je ? » n° 660, Paris, p.u.f., 101971, p. 57.
[57] Sigmund Freud, Cinq leçons sur la psychanalyse, trad. Yves Le Lay et Suzanne Jankélévitch, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2010, p. 63.
[58] Élisabeth Roudinesco, Sigmund Freud…, p. 120.
[59] Ernest Jones, La vie et l’œuvre de Sigmund Freud, tome 1, p. 384.
[60] Sigmund Freud, Lettres à Wilhelm Fliess, p. 527.
[61] Cf. Norman Kiell, Freud Without Hindsght. Reviews of His Work, 1893-1939, Madison, International Universities Press, 1988.
[62] Cf. Henri F. Ellenberger, Histoire de la découverte de l’inconscient, p. 476-478.
[63] Sigmund Freud, La psychopathologie de la vie quotidienne, 1905, trad. Denis Messier, Paris, Gallimard, 1997.
[64] Sigmund Freud, La naissance de la psychanalyse, p. 293-294 ; Lettres à Wilhelm Fliess, p. 556.
[65] Cf. Sigmund Freud, Le mot d’esprit dans sa relation avec l’inconscient, 1905, trad. Cornélius Heim, Paris, Gallimard, 1988.
[66] Henri F. Ellenberger, À la découverte de l’inconscient, p. 268.
[67] Théodore Flournoy, Congrès international de psychologie, Munich, 1896, p. 417-420.
[68] Henri F. Ellenberger, À la découverte de l’inconscient, p. 269. Avec de multiples références.
[69] Sigmund Freud, Essais de psychanalyse, trad. Samuel Jankélévitch, coll. « Petite Bibliothèque Payot » n° 44, Paris, Payot, 1977, p. 179-181.
[70] Sigmund Freud, Cinq leçons sur la psychanalyse, trad. Yves le Lay, coll. « Petite Bibliothèque Payot » n° 84, Paris, Payot, 1977, p. 25.
[71] Sigmund Freud cité par Jean Laplanche et Jean-Baptiste Pontalis, Art. « Instinct », Vocabulaire de la psychanalyse, Daniel Lagache (éd.), Paris, p.u.f., 41973, p. 91.
[72] Maurice Corvez, L’être et la conscience morale, Louvain, Nauwelaerts, Paris, Béatrice-Nauwelaerts, s. d., p. 349 et 350.
[73] Jacques Lacan, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Séminaire XI, Paris, Seuil, 1973, p. 152.