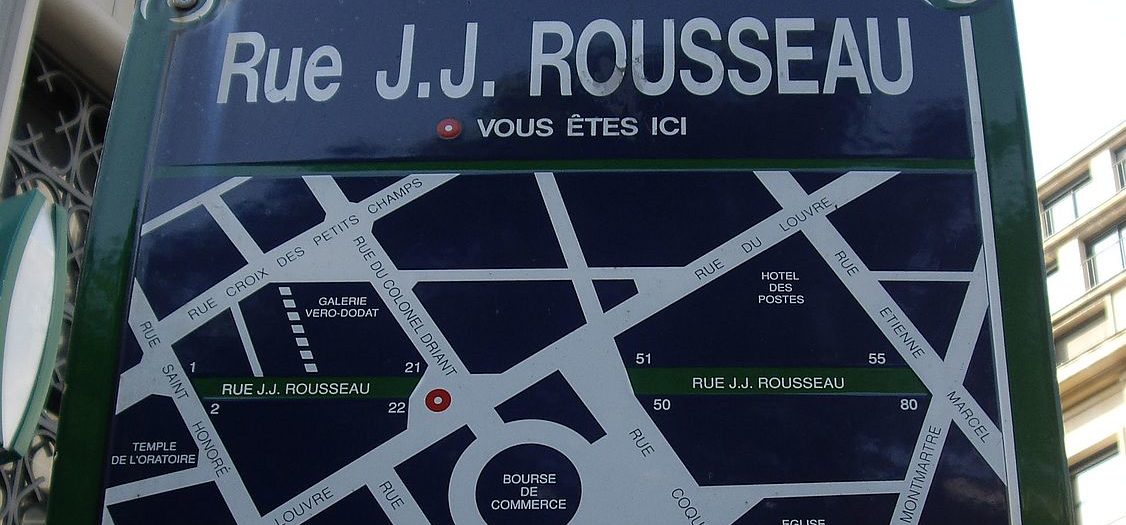« Qu’il serait doux de vivre parmi nous, si la contenance extérieure était toujours l’image des dispositions du cœur [1] ».
1) Jean-Jacques Rousseau ou le mythe de la transparence
a) Thèse
Il est on ne peut plus classique de présenter la pensée de Rousseau [2] (et sa vie qui en est indissociable) comme une fermeture à l’autre et une complaisance en soi, ces deux aspects constituant le recto et le verso d’une unique réalité.
Il serait erroné de croire qu’un tel diagnostic est unilatéralement négatif. En positif, Rousseau est aussi, notamment, l’inventeur d’un nouveau style qui marque encore notre siècle.
b) Exposé
1’) Diagnostic
Plus originale est l’explication qu’en donne Jean Starobinski dans son grand livre : Jean-Jacques Rousseau : la transparence et l’obstacle [3]. Rousseau est fermé à l’autre et, par compensation, a surdéveloppé son ego et son ego sensible. Voilà la thèse commune. L’explication ou plutôt l’explicitation qu’en donne Starobinski est la suivante : le couple premier structurant la pensée de Rousseau est celui de l’être et de l’apparaître (ou de l’apparence). Exposons-le.
L’incommunication entre les hommes est d’abord l’effet d’un cloisonnement intérieur. L’homme, tout homme, est seul, parce que la division d’avec l’autre se redouble d’une division interne qui la fonde : il est traversé par le clivage être-apparaître (ou apparence). Et tous les hommes se dérobent sous le masque de l’apparaître : « Tous mettent leur être dans le paraître [4] ». Ce couple conceptuel se traduit dans d’autres couples, plus imagés : profondeur-surface, ou intérieur-extérieur. Mais Starobinski privilégiera un couple dont il faudra se demander s’il est seulement métaphorique : la transparence et l’obstacle. La surface, dit Rousseau est mensongère ; la profondeur, le cœur, est vérité. A ce couple métaphysique se joint bientôt un couple éthique, car c’est la vie qui intéresse l’auteur des Confessions : la profondeur est bonne, le paraître est le mal.
Certes, ce thème de l’identité du mensonge et de l’apparence est courant au xviiie siècle et l’était déjà au siècle de Molière qui avait immortalisé le Tartuffe, multiplié les Caractères et dénoncé le péril des hypocrisies par l’entremise de La Bruyère et de Vauvenargue. Ce qu’ajoute Rousseau et qui sera sa spécificité est l’expérience : ce que les auteurs s’étaient jusqu’à maintenant contenté de décrire avec parfois la finesse d’un psychologue comportementaliste ou d’un entomologiste est vécu par Rousseau comme un déchirement intime, comme la souffrance de l’existence. Et cette division va prendre l’ampleur d’une distinction affectant la métaphysique (vrai-faux ou être-paraître), la théologie (les dieux-les hommes), l’éthique (bien-mal), le politique (individu-société), l’histoire (avant la citoyenneté-après l’avènement de l’état)
Cette division intérieure est le fruit d’expériences fondatrices que viendront renforcer des décisions ultérieures.
Rousseau en a fait l’expérience dans un épisode qui, par bien des côtés, fait office d’Urszene, mais dans un tout autre sens que chez Freud. Ecoutons Rousseau nous le dire dans les Confessions près d’un demi-siècle plus tard :
« J’étudiais un jour seul ma leçon dans la chambre contiguë à la cuisine. La servante avait mis sécher à la plaque les peignes de mademoiselle Lambercier. Quand elle revint les prendre, il s’en trouva un dont tout un côté de dents était brisé. A qui s’en prendre de ce dégât ? personne autre que moi n’était entré dans la chambre. On m’interroge ; je nie d’avoir touché le peigne. M. et mademoiselle Lambercier se réunissent ; m’exhortent, me pressent, me menacent ; je persiste avec opiniâtreté ; mais la conviction était trop forte, elle l’emporta sur toutes mes protestations, quoique ce fût la première fois qu’on m’eût trouvé tant d’audace à mentir. La chose fut prise au sérieux ; elle méritait de l’être. La méchanceté, le mensonge, l’obstination parurent également dignes de punition […]. Il y a maintenant près de cinquante ans de cette aventure, et je n’ai pas peur d’être aujourd’hui puni derechef pour le même fait. Hé bien ! je déclare à la face du Ciel que j’en était innocent ».
Conclusion générale :
« Je n’avais pas encore assez de raison pour sentir combien les apparences me condamnaient, et pour me mettre à la place des autres. Je me tenais à la mienne, et tout ce que je sentais, c’était la rigueur d’un châtiment effroyable pour un crime que je n’avais pas commis [5] ».
Rousseau n’hésite pas à décrire cette expérience comme « traumatisante », comme la perte d’une sorte de « bonheur pur [6] », bref, comme une chute, comme la disparition du paradis perdu. Or, en quoi consiste cette expérience fondatrice, archétypale ? En l’opposition expérimentée, subie, comme la plus grave des injustices, entre l’être profond innocent et le paraître coupable. L’être lui apparaît non seulement comme déchiré, mais déchiré entre un bien qui est la vérité profonde de l’innocence et le mal qui est l’apparence de la faute. Donc, la vie de Rousseau sera comme vouée à rejouer cette perte de la transparence originelle. La conséquence immédiate fut en effet la perte de confiance dans les autres. L’expérience de l’erreur de l’adulte les fait déchoir de leur position divine, ce qui est une conséquence à laquelle la psychanalyse nous a habitués, mais fait aussi entrer dans une défiance systématique.
Il y avait plusieurs manières de réagir, de rejouer ce traumatisme fondateur. Rousseau aurait pu partir en guerre contre la société. Il le fera un moment, un moment seulement. Il aurait pu en faire une théorie ; il abandonnera le projet, car il discrédite le travail discursif de la raison. Il va donc choisir la fusion, mais avec soi. Aussi toute sa vie, Rousseau ne cherchera qu’une chose : la transparence avec soi, et il sera convaincu qu’il y est arrivé.
« Moi, qui ne sais me déguiser avec personne, comment me déguiserais-je avec mes amis ? Non, dussent-ils m’en estimer moins, je veux qu’ils me voient toujours tel que je suis, afin qu’ils m’aident à devenir tel que je dois être [7] ».
Son seul idéal sera de concrétiser l’identité fichtéenne Moi = Moi.
2’) Cause
La cause est politique : « On n’ose plus paraître ce qu’on est » à cause de la « contrainte perpétuelle » qu’est « ce troupeau qu’on appelle société [8] ». Le manque de transparence, l’obstacle ne peut être dû à l’homme en son essence, tellement il aspire à cette vérité sur soi, tant il aspire à trouver son cœur. Il ne peut être que l’effet de la société.
Ici se pose une question capitale : cette transparence originelle est-elle définitivement disparue ? Deux réponses sont possibles : soit l’essence humaine bonne a dégénéré, s’est défigurée au point que l’altération l’a définitivement perdue ; soit la nature primitive persiste, inviolée mais cachée. Dans le premier cas, notre essence s’identifie à notre condition historique ; dans le second, l’état historique ne compromet pas, n’entame pas l’essence de l’homme. Rousseau semble défendre les deux hypothèses, parfois même simultanément. Mais au fond, c’est la seconde qui l’agrée. En ce sens, il n’adhère pas à une conception dialectique qui introduit le mouvement jusque dans la structure ; la conception rousseauiste est essentialiste et cet essentialisme fonde son optimisme. On peut le dire autrement : la continuité de l’histoire assure de la pérennité d’une essence qui demeure en sa bonté.
3’) Le remède
On le sait, pour Rousseau, il n’y a qu’un remède : être vrai, c’est-à-dire résorber en son être cette distance entre l’être et le paraître. « Je me suis montré tel que je fus », dit Rousseau au premier livre des Confessions [9].
Malheureusement, il va faire la cuisante expérience que cette vérité n’est pas reçue. Se donner en toute transparence aux autres ne suffit pas à rétablir la communication, à être reçu.
Dès lors, pour Rousseau, le seul lieu de la transparence est la relation à soi : « Passant ma vie avec moi, je dois me connaître [10] ». Il ne fait aucun doute qu’il accédera à cette connaissance de soi. Cette conviction n’est pas le fruit d’une réflexion anthropologique sur le statut de la conscience, mais une assurance morale : il ne peut pas dissimuler.
Certes, la connaissance de soi est ardue, elle doit passer par la longue médiation de l’écriture, ce qui explique l’étendue de l’œuvre autobiographique, des Dialogues aux Rêveries, en passant par les Confessions. Il demeure qu’elle est possible. Et si un élément échappe à sa mémoire, c’est qu’il est inessentiel.
Or, cette transparence à soi se fait par le seul sentiment authentique. L’autre et plus encore la réflexion, qui médiatise la présence à soi, devient un obstacle à la transparence [11]. Certes, par la réflexion, l’homme émerge de l’animalité, mais il s’éloigne aussi de la présence immédiate du monde naturel et de la plénitude qui lui est liée. La réflexion est un malheur puisqu’elle détruit l’unité originelle de la conscience et du monde naturel. Autrement dit, la réflexion pense la certitude, mais elle ne l’éprouve pas, elle ne la vit pas : « La conscience ne nous dit point la vérité des choses, mais la règle de nos devoirs [12] ». Comment donc concilier la nécessité d’arracher l’homme à l’animalité et au matérialisme et le refus de la réflexion ? Le développement de l’homme passe par trois phases : une phase enfantine, dénuée de toute réflexion, où prime la sensation immédiate ; le stade de l’activité discursive ; la découverte du sentiment moral transcende donc la seule sensibilité et ne contredit pas la raison puisque celle-ci y incite d’obéir à l’impératif pratique du sentiment. « Ainsi ma règle de me livrer au sentiment plus qu’à la raison est confirmée par la raison même [13] ». En fait, la pensée de Rousseau évolue : dans les Dialogues, la raison, la réflexion cesse d’être une étape de croissance pour devenir la source du mal : elle fait dévier, « défléchir » l’homme de son « vrai but », sa « première destination [14] », l’empêche de s’abandonner à l’immédiateté de la sensation ; or, c’est elle qui est source de son innocence.
c) Approche médicale et psychologique
1’) Approche neuropsychiatrique
Il est difficile et sans doute impossible de décider du normal et du pathologique dans sa vie. « La fuite dans la solitude, les élans d’imagination idyllique, le refuge cherché dans les occupations machinales, les grands plaidoyers pathétiques, tout cela peut passer à la fois pour l’expression du mal, et pour une thérapeutique spontanément improvisée [15] ».
Au plan neuropsychiatrique, il est clair toutefois que Rousseau est malade et même gravement malade. Les meilleurs critères sont sans doute : la revendication de singularité absolue avec la double conséquence d’isolement et de refus de l’universel (à la limite de l’amentalisme).
On voit chez Rousseau une mise en œuvre progressive de la dépossession, de la rupture avec l’autre et même avec toute extériorité. On peut lui donner un sens autre que moral : mystique. Mais on ne peut s’empêcher de demander : quelle est la part de la liberté ? Starobinski n’hésite pas à parler d’un choix de Rousseau, même si celui-ci s’estime victime et le répète à satiété. « Rousseau ne veut pas reconnaître qu’il a choisi cette situation où le choix est prévenu par le destin [16] ». Peut-on distinguer deux phases : au début de sa réforme personnelle, le dénuement est clairement voulu ; puis, lors de la persécution, il devient subi ? En fait, en se laissant retirer tout ami, tout appui, toute défense [17], Rousseau sait aussi qu’il échappe à toute prise et donc qu’il devient invulnérable. Cette attitude est aussi une protection :
« Toute la puissance humaine est sans force désormais contre moi… Maître et Roi sur la terre, tous ceux qui m’entourent sont à ma merci, je peux tout sur eux et ils ne peuvent plus rien sur moi [18] ».
2’) Le type Quatre
Et si la question d’un discernement entre la maladie et la résistance à la maladie, voire sa part créative, comme le dirait l’antipsychiatrie, était mal posée ? Il y va de toute une vision de l’homme.
Selon la typologie de l’ennéagramme, Rousseau serait un type quatre (qui, selon les précisions apportées par Don Riso [19], s’avère de plus en plus désintégré au fur et à mesure où il évolue) : il en a l’individualisme, la recherche farouche de son originalité, la fuite décidée de toute banalité, le besoin permanent de souligner son unicité et la crainte de son engloutissement dans la multitude, le souci de créer un style, dans tous les sens du terme ; il en a aussi l’hypersensibilité, l’imagination débordante, la créativité artistique (surtout poétique), la complaisance dans la tristesse, la dépression alternant avec des phases d’exaltation (de plus en plus rare), le besoin romantique de trouver la vérité ultime dans le sentiment et la défiance à l’égard non de l’intelligence mais de la raison, la capacité à souffrir ; il en a enfin la jalousie, la paranoïa et l’orgueil démesuré dans l’affirmation de l’auto-suffisance de soi, le désir de se couper de tout autre et de s’inventer une religion et un Dieu à sa mesure. Néanmoins, et c’est un autre enseignement de l’ennéagramme, même désintégré, le type (quel qu’il soit, ici le type quatre) demeure ouvert ; la pathologie ne dévore pas toute capacité créative ; plus encore, il la surdéveloppe. Précisément, le type Quatre est sans doute celui qui est le plus tourné vers la vie intérieure, la belle individualité, donc le moins ouvert aux autres, mais le plus introduit aux richesses de l’imaginaire et de l’affectivité.
D’ailleurs, le type Quatre est un des grands fournisseurs de journal : que l’on songe au premier Kierkegaard, du stade esthétique, ou à En route de Huysmans.
3’) La maladie créatrice
Il est clair que, pour Rousseau, la délimitation de cet espace intérieur a d’abord une cause extrinsèque : l’échec d’une communication satisfaisante avec l’extérieur. Rousseau a voulu une transparence totale ; déçu, il se replie sur lui et trouve, dans le sentiment moral, le lieu de cette transparence. Pour autant, son intériorité est-elle purement réactive ?
Rousseau demeure un exemple unique de l’impossibilité pour la pathologie d’épuiser, de détériorer totalement le terreau sur lequel elle s’est élaborée. Plus encore, son métier d’écrivain est sans doute ce qui lui a permis, de manière créative, de ne pas se laisser totalement engloutir dans sa maladie. Jean-Jacques s’arrache à son obsession, pire, à son délire, en tentant de conquérir, face à l’hostilité du monde, une innocence, une transparence intérieure qu’il veut lui voler. Jean Starobinski a bien souligné cette ambivalence de Rousseau enfermé dans sa maladie qui ne parvient néanmoins pas à dévorer toute créativité, son être : « Dans les Rêveries, nous trouvons tout ensemble la répétition monotone d’une conviction folle, et le chant mélodieux d’une voix qui défend l’âme contre sa destruction [20] ». Dans le paradoxe le plus étrange et le plus riche d’espérance, répétition rime avec création.
d) Approche philosophique
Selon la perspective philosophique, plus précisément du point de vue de la philosophie anthropologique de la blessure, l’histoire de Rousseau, indissociable de son œuvre, me parle toute entière de la relation à l’autre. Rousseau s’est fermé à l’autre. Et cette fermeture est à la fois subie (cf. l’épisode de Bossey) et voulue : la volonté a pris en charge cette fermeture et l’a accru, voire rendu définitive. Presque. Car l’histoire de Rousseau aurait pu être tragique si elle ne montrait aussi que cette obturation ne saurait jamais être totale. N’est-ce pas le sens de la question essentielle que Diderot pose à Rousseau : « Je sais bien que, quoi que vous fassiez, vous aurez pour vous le témoignage de votre conscience : mais ce témoignage suffit-il seul, et est-il permis de négliger jusqu’à certain point celui des autres hommes [21] ? »
Ainsi que le montre l’analyse détaillée des Rêveries d’un promeneur solitaire, le raisonnement de Rousseau est infalsifiable et victimaire : je veux bien m’ouvrir à l’autre, mais c’est l’autre qui m’a exclu.
D’ailleurs, ce besoin d’écriture contredit dans l’exécution (in actu exercito) ce qu’il déclare en intention (in actu signato) : le langage n’est-il pas un prédonné universel ? Il n’y a pas d’écriture neutre, indifférente à l’autre.
Enfin, dans les Confessions, Rousseau s’est attaché à transformer son histoire en fatalisme déterministe : tout surgit avec nécessité des événements les plus anciens. Néanmoins, la liberté demeure dans le sentiment intérieur et son incarnation, qui est la créativité langagière. S’abandonnant à la liberté du sentiment, Rousseau lui donne la parole : « Je prends donc mon parti sur le style comme sur les choses. Je ne m’attacherai point à le rendre uniforme ; j’aurai toujours celui qui me viendra, j’en changerai selon mon humeur sans scrupule, je dirai chaque chose comme je la sens, comme je la vois, sans recherche, sans gêne, sans m’embarrasser de la bigarrure [22] ». Toutefois, il s’est délesté de sa vie et de son fondement : la raison.
e) Approche expérimentale : une expérience mystique du soi
Les différentes approches qui précèdent n’épuisent pas, à mon sens, la fécondité de la pensée rousseauiste.
Jean-Jacques n’est pas qu’un homme authentique, comme il y en aura tant d’autres (que l’on songe au Sartre des Mots). Il est un homme d’expérience, un homme qui a vécu une expérience engageant, outre son esprit, mais tout son être. Autrement dit, cet homme « vrai » décrit une expérience unique qu’il a cherchée toute sa vie et qu’il semble avoir vécue, même si ce n’est que par éclipses. Et il tente de la communiquer à son lecteur.
Comment mieux caractériser cette expérience ?
1’) Une expérience mystique
Aussi étonnant que cela paraisse, j’émettrais l’hypothèse que Rousseau a vécu une expérience mystique. Louis Gardet définissait la mystique comme « l’expérience fruitive (fruitive, c’est-à-dire trouvant en soi sa complétude) d’un absolu [23] ». Or, on retrouve chez notre auteur, me semble-t-il, les signes d’une recherche d’un absolu et la recherche d’une paix intérieure, d’une expérience fruitive.
2’) Une expérience mystique du soi
Mais je précise aussitôt que cette expérience mystique relève de la la mystique du soi ou mystique d’immanence. En effet, sans entrer dans le détail [24], je distinguerai avec Maritain (et tant d’autres à sa suite), deux formes de mystique : de transcendance et d’immanence. Si toutes deux cherchent l’absolu, la première la cherche au-dessus d’elle, dans la foi en un Dieu créateur, la seconde au plus intime d’elle dans un moi qui, en son fond ultime, s’identifie à la divinité. La première fut développée en Occident, la seconde surtout en Orient.
Rousseau, qui est donc une exception, vit une expérience qui l’apparente aux mystiques orientales du soi. La créativité que cette personne malade déploie pour sortir de sa pathologie et de sa souffrance le conduit aux confins d’une mystique du soi. Ne serait-ce pas l’une des raisons cachées mais réelles de l’attirance qu’il ne cesse d’exercer et ne cessera jamais d’exercer ?
Donnons-en quelques signes. Rousseau consent, voire cherche à couper tous les liens, toute relation à autrui. Plus encore, il cherche la parfaite sérénité dans le calme des passions, il refroidit en quelque sorte son cœur, loin des sentiments brûlants. « Il faut que le cœur soit en paix et qu’aucune passion n’en vienne troubler le calme [25] ». « Il ne me reste plus rien à espérer ni à craindre en ce monde, et m’y voilà tranquille au fond de l’âme, pauvre mortel infortuné, mais impassible comme Dieu même [26] ». Or, cette sérénité se conquiert dans l’absence d’actes. Rousseau, on le sait, se défie au plus haut point non pas de l’intelligence mais de l’exercice discursif de la raison [27]. Pour lui, il y a à choisir non pas entre raison et sentiment mais entre deux usages de l’intelligence : médiat et immédiat. Or, seul l’usage immédiat garantit la certitude, alors que la raison instrumentale, la raison raisonnante fuit l’évidence et introduit dans le trouble de l’opinion. Même la sensation est encore trop agitée. Aussi Jean-Jacques veut-il appauvrir le sensible. Qu’il est naïf celui qui fait du rousseauisme un sensualisme, une réduction au sentiment. Enfin, c’est tout objet distinct du moi, de la conscience que Rousseau veut abolir pour ne garder que l’état d’âme correspondant à cette possession du monde réel. Il veut le moi sans l’être : « Il n’y a rien de beau que ce qui n’est pas [28] ». Cette expérience est une réduction au soi pur, d’avant toute énergéia, toute action, hors toute extériorisation de soi. Voilà pourquoi Rousseau désire une action sans antécédents ni conséquences :
« Je me suis souvent abstenu d’une bonne œuvre que j’avais le désir et le pouvoir de faire, effrayé de l’assujettissement auquel dans la suite je m’allais soumettre si je m’y livrais inconsidérément [29] ».
L’auteur des Confessions n’a jamais poursuivi que des buts immédiats, sans répercussions involontaires ; or, s’il accepte le sentiment immédiat avec Thérèse, dans le plaisir de l’instant sans passé ni avenir, il refuse cette aliénation de la nature qui est l’apparition d’enfant ; ainsi s’éclaire l’attitude de Rousseau : son refus de la paternité « semble n’être que l’expression, en une circonstance particulière, de la crainte plus générale de vivre dans un monde où les actes ont des suites involontaires [30] ».
Toute médiation, toute extériorité s’identifie à l’opacité, à l’obstacle, à la résistance à cette transparence si chèrement conquise. Plus encore, le monde des hommes est par nature divisé. Le monde rousseauiste a transposé dans l’humanité ce que le bouddhisme et même l’hindouisme dit de l’être en général : qu’il est impermanence, division donc illusion (maia).
D’autre part, ce que Rousseau recherche au-delà de tout mouvement, ce n’est pas le nihil, l’abolition stoïcienne des sentiments ou je ne sais quel consentement à la fatalité, mais l’existence pure : « Le sentiment de l’existence dépouillé de toute autre affection est par lui-même un sentiment précieux de contentement et de paix qui suffirait seul pour rendre cette existence chère et douce à qui saurait écarter de soi toutes les impressions sensuelles et terrestres qui viennent sans cesse nous en distraire et en troubler ici-bas la douceur [31] ».
Enfin, Rousseau jouit de cette transparence à soi, de cette existence qui n’est que présence à soi.
Ne pourrait-on dire que cette mystique du soi est la grande tentation du tragico-romantique individualiste ? J’ai l’impression que Rousseau est un être tellement blessé, tellement à vif que la moindre vague intérieure, le moindre contact dysharmonieux avec l’autre et avec la nature suscitent des raz de marée intérieurs, réactivent de telles rancœurs qu’il s’est comme insensibilité, protégé.
3’) Une expérience mystique du soi inédite
Précisons enfin que cette mystique du soi présente chez Rousseau plusieurs traits originaux : outre son lien avec la pathologie, la médiation de la nature et la prédominance de l’affectivité.
Rousseau propose à ses lecteurs une « mystique naturelle [32] ». En effet, à l’instar de la relation à soi, la relation à la nature est toute d’immédiateté :
« J’allais encore d’un pas plus tranquille chercher quelque lieu sauvage dans la forêt, quelque lieu désert où rien ne montrant la main des hommes n’annonçât la servitude et la domination, quelque asile où je pusse croire avoir pénétré le premier et où nul tiers importun ne vînt s’interposer entre la nature et moi [33] ».
Cette immédiateté possède un sens négatif, d’absence de présence humaine : « Je m’écriais parfois avec attendrissement : Ô nature ! ô ma mère, me voici sous ta seule garde ; il n’y a point ici d’homme adroit et fourbe qui s’interpose entre toi et moi [34] ». Et la nature est, on le redira, une nature toute de transparence et de fluidité.
La nature est à la fois l’image et comme la médiatrice (mais immédiate) de l’état ataraxique, de l’absence de toute pensée et de tout mouvement intérieur. « De temps à autre naissait quelque faible et courte réflexion sur l’instabilité des choses de ce monde et dont la surface des eaux m’offrait l’image [35] ». La parfaite transparence des éléments, des choses (et non leur réflexion) est symbole et aide à cette pure transparence à soi, sans extérieur. « L’existence est purement présente à elle-même, mais il lui faut, autour d’elle, le murmure de l’eau, la pulsation des vagues, le grand ciel étoilé [36] ». L’originalité de Rousseau est d’avoir joint l’atténuation de tout mouvement intérieur et le murmure tranquille des choses de la nature.
Le psychanalyste ne manquera pas d’identifier ce besoin, cette présence nécessaire de la nature-mère, cette indifférenciation, voire cette dépersonnalisation [37], à une régression fusionnelle, extrêmement archaïque. Mais, pour dire quelque chose de l’enracinement de l’expérience, une telle interprétation manque le spécifique qu’est le caractère fruitif. Pour employer le discernement proposé par Ricœur, la généalogie freudienne vise l’archè et manque l’esprit.
Pascal Ide
[1] Discours sur les sciences et les arts, OC, III, p. 7.
[2] Les citations sont empruntées avant tout à l’édition critique : Jean-Jacques Rousseau, Œuvres complètes, Bernard Gagnebin et Marcel Raymond éds., coll. « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, Gallimard, 4 volumes. Tome 1. Les Confessions – Autres textes autobiographiques, n° 11, 1959 ; tome 2. La Nouvelle Héloïse – Théâtre – Poésies – Essais littéraires, n° 153, 1961 ; tome 3. Du Contrat social – Écrits politiques, n° 169, 1964 ; tome 4. Émile – Éducation – Morale – Botanique, n° 208, 1969 ; tome 5. Écrits sur la musique, la langue et le théâtre, n° 416, 1995.. Les citations se feront en faisant suivre OC du numéro du volume puis de celui de la page. Correspondance générale de Jean-Jacques Rousseau, Théophile Dufour éd., Paris, Armand Colin, 1924-1934, 20 vol. parus et tables.
[3] Jean Starobinski, Jean-Jacques Rousseau la transparence et l’obstacle, suivi de Sept essais sur Rousseau, coll. « Bibliothèque des idées », Paris, Gallimard, 1971, repris dans la coll. « tel » n° 6. Sur la transparence chez Rousseau, cf. Pierre Burgelin, La philosophie de l’existence de J.-J. Rousseau, coll. « Bibliothèque de philosophie contemporaine », Paris, p.u.f., 1952, p. 293-295.
[4] Dialogues, L. III, OC, I, p. 936.
[5] Confessions, L. I, OC, I, p. 18-20.
[6] Ibid., p. 20.
[7] A Mme d’Houdetot, 15 janvier 1758, Correspondance générale, vol. III, p. 266.
[8] Discours sur les sciences et les arts, OC, III, p. 8.
[9] Confessions, L. I, OC, I, p. 5.
[10] Première lettre à Malesherbes, OC, I, p. 1133.
[11] Cf. Jean Starobinski, « Jean-Jacques Rousseau et le péril de la réflexion », L’œil vivant, Paris, Gallimard, 21968, p. 94-188.
[12] La Nouvelle Héloïse, VIe partie, lettre viii, OC, II, p. 698.
[13] Émile, IVe partie, OC, I, p. 573. « Je sais seulement que la vérité est dans les choses et non pas dans mon esprit qui les juge, et que moins je mets du mien dans les jugements que j’en porte, plus je suis sûr d’approcher de la vérité. » (Ibid.)
[14] Dialogues, I, OC, I, p. 668-669.
[15] Jean Starobinski, Jean-Jacques Rousseau, p. 241. Cf. le chap. viii sur « La maladie » et le septième essai « Sur la maladie de Rousseau », p. 430-444.
[16] Ibid., p. 294.
[17] « Seul, sans appui, sans défense, abandonné à la témérité des jugements publics. » (Correspondance générale, vol. XV, p. 171)
[18] Texte écrit sur des cartes à jouer. Rêveries, éd. Marcel Raymond, p. 173-174. Cf. OC, I, p. 1171.
[19] Cf. Don Richard Riso et Russ Hudson, La sagesse de l’Ennéagramme. Le guide complet de développement psychologique et spirituel pour les neuf Types de Personnalité, trad. Thierry Grandjean, Eudes Riblier, Dorothée Nicolas, Paris, Dunod, 2018.
[20] Jean Starobinski, Jean-Jacques Rousseau, p. 316.
[21] Correspondance générale, vol. III, p. 133.
[22] Annales Jean-Jacques Rousseau, IV (1908), p. 10-11.
[23] Louis Gardet, La mystique, coll. « Que sais-je ? » n° 694, Paris, p.u.f., 21981, p. 5.
[24] Sur la mystique d’immanence, cf. Jacques Maritain, « L’expérience mystique et le vide », in Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle [1939], dans Jacques et Raïssa Maritain, Œuvres complètes, Fribourg Suisse, Éd. Universitaires, Paris, Saint-Paul, 17 volumes, 1982-2008, vol. VII [1939-1943], 1988 p. 159-195). Dans l’ordre chronologique : Louis Gardet, « À propos de Heidegger. Valeur d’expérience de la question du sens de l’être », Revue thomiste, 68 (1968) n° 3, p. 381-418 ; Ernst-R. Korn (alias Heinz R. Schmidt), « La question de l’être chez Martin Heidegger », Revue thomiste, 70 (1970), I. « La question de l’être telle que la présente Heidegger », n° 2, p. 227-263 : II. « Essai d’explicitation », n° 3, p. 560-603 ; Revue thomiste, 71 (1971) n° 1, III. « Observations critiques concernant l’entreprise de Heidegger », p. 33-58 ; « Le Sacré dans l’œuvre de Martin Heidegger », Nova et Vetera, 45 (1970) n° 1, p. 36-57 ; Louis Gardet et Olivier Lacombe, L’expérience du Soi, Paris, Desclée, 1981, p. 319-369 ; Denis Bilhat, De l’être ou rien. Heidegger et philosophie de l’être, coll. « Croire et savoir » n° 10, Paris, Téqui, 1988 ; Yves Floucat, « La critique heideggérienne de l’onto-théologie et la métaphysique de saint Thomas d’Aquin », Appendice de L’être et la mystique des saints. Conditions d’une métaphysique thomiste, coll. « Croire et savoir » n° 21, Paris, Téqui, 1995, p. 159-182.
[25] Rêveries, promenade V, OC, I, p. 1047.
[26] Rêveries, promenade I, OC, I, p. 999.
[27] Cf. Robert Derathé, Le rationalisme de Rousseau, Paris, p.u.f., 1948 : réimpression Slatkine, Genève, 2010.
[28] La Nouvelle Héloïse, VIe partie, lettre viii, OC, II, p. 693.
[29] Rêveries, Promenade VI, OC, I, p. 1054.
[30] Jean Starobinski, Jean-Jacques Rousseau, p. 275.
[31] Rêveries, promenade V, OC, I, p. 1047.
[32] L’expression est de Jean Starobinski (Jean-Jacques Rousseau, p. 311) qui place lui-même l’expression entre guillemets.
[33] Troisième lettre à Monsieur de Malesherbes, OC, I, p. 1139-1140.
[34] Confessions, L. XII, OC, I, p. 644.
[35] Rêveries, promenade V, OC, I, p. 1045.
[36] Jean Starobinski, Jean-Jacques Rousseau, p. 306.
[37] Cf. Marcel Raymond, Jean-Jacques Rousseau. La quête de soi et la rêverie, Paris Marcel Corti, 1962, p. 179.