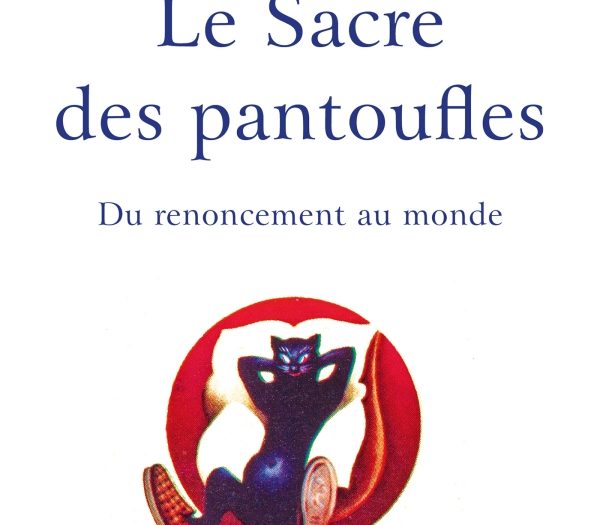« Ce pouvoir immense et tutélaire » de nos démocraties « aime que les citoyens se réjouissent pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. […] Il pourvoit à leur sécurité […] ; que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre [1] ? »
Le dernier essai de Pascal Bruckner, Le sacre des pantoufles, est un énième regard porté sur l’acédie de notre temps [2] – l’incarnation symbolique dans la pantoufle, ou plutôt, dans la chambre connectée en plus [3]. Il propose d’abord différents signes à partir de la figure emblématique d’Oblomov, l’antihéros du roman de Gontcharov [4] (prologue et chap. 1). Il en décline différents signes, affectif (« La banqueroute d’Éros » : chap. 2), actif (« Le voyage interdit » : chap. 3), en relation avec l’environnement – la banalité quotidienne (chap. 4) – et ses artefacts – l’illusion du téléphone intelligent (« Le bovarysme du portable » : chap. 5) –, et finalement, ce qui est sa thèse centrale : le repli sur le chez soi (« Les trois C : la Caverne, la Cellule, la Chambre » : chap. 6), lui-même centré sur la pantoufle et la robe de chambre (chap. 11).
De ces signes, notre auteur montre alors l’ambivalence essentielle et, au fond, la malice, opposant les « beautés du chez-soi » (chap. 7) aux « supplices de la vie entravée » (chap. 8), les délices du sommeil et sa proximité avec la mort (chap. 9), la « féerie digitale » et la « victoire de l’avachissement » (chap. 10).
Puis, le philosophe écrivain passe des faits et de leur évaluation à la cause qui est l’acédie : en quelques auteurs représentatifs, d’autrefois comme Amiel (« Les déserteurs de la modernité », c’est-à-dire de l’existence : chap. 12) ou d’aujourd’hui comme Houllebecq (« Les extrémistes de la routine » : chap. 15), en sa tonalité affective qui est dépendante du climat (« Le chagrin météo » : chap. 13) et s’identifie à l’ennui (« Le défaitisme existentiel » : chap. 14).
Enfin, se pose la question du remède, d’abord en creux, dans le constat que les déclinistes actuels se contentent de renchérir dans la fadeur (chap. 15), puis, en plein, dans les cinq pages de la conclusion (« Chute ou transfiguration »).
Comme toujours chez Pascal Bruckner, la langue est agréable, les formules heureuses, les exemples piquants, le regard aiguisé. Comme toujours aussi chez lui, l’organisation est un peu lâche, même si nous avons cherché à en rendre compte de manière systématique. Comme toujours enfin, le jugement diagnostique (symptomatique et étiologique) est aussi fin que le remède est succinct. Comme tant d’analystes de notre temps (au premier rang desquels, Bernanos), il a compris que le mal dont souffrent nos contemporains est spirituel et porte ce nom trop oublié d’acédie ; moins que beaucoup d’auteurs (là encore comme Bernanos), il a compris que le traitement doit lui aussi être radicalement spirituel – même si son texte est parsemé d’allusions au Dieu chrétien.
Surtout, et c’est là que je prends du recul vis-à-vis de ce livre : si Bruckner a raison de nommer le syndrome de la pantoufle et de la chambre connectée (illusion d’être en lien avec le monde) comme caractéristique de l’acédie du xxie siècle, il n’en a pas noté le paradoxe fondamental. Pourtant, il rappelle le mot fameux de Pascal : « Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre [5] ».
Où se trouve donc ce malheur : demeurer dans sa chambre ou ne pas y demeurer ? Pour pouvoir y répondre, il faudrait convoquer une anthropologie qui manque à notre philosophe et, plus encore, une anthropologie du don. Nous le savons, celui-ci est réception, appropriation et donation. Plus précisément, la réception est pour l’appropriation et celle-ci pour la donation. Autrement dit, je suis aimé pour m’aimer, et je m’aime pour aimer l’autre (me donner à lui). Or, le lieu est plus que le symbole de l’amour-don, il en est un des moyens de réalisation [6]. En l’occurrence, si l’on se focalise sur les deux derniers temps, le chez-soi est au sortir de chez-soi ce que l’estime de soi est au don de soi. Pour le dire en creux, si je ne sais pas habiter mon espace intérieur [7], je suis vide de moi et donc ne peux qu’offrir cette vacuité en prétendant me donner à autrui. Le problème ne vient donc pas des pantoufles, mais de leur sacre, c’est-à-dire de leur absolutisation : nous ne sommes donnés nous-mêmes à nous-mêmes que pour nous donner à Dieu et aux autres.
Pascal Ide
[1] Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 4e partie, coll. « Folio Histoire », Paris, Gallimard, 1986, 2 vol., tome 2, p. 434..
[2] Cf., par exemple, Alain Ehrenfeld, La fatigue d’être soi, Paris, Odile Jacob, 1998 ; Emil Cioran, La tentation d’exister, coll. « Tel », Paris, Gallimard, 1956.
[3] Cf. Pascal Bruckner, Le sacre des pantoufles, Paris, Grasset, 2022.
[4] Cf. Ivan Gontcharov, Oblomov, 1859, éd. Robert Cahné, trad. Arthur Adamov, coll. « Folio Classique », Paris, Gallimard, 2007.
[5] Blaise Pascal, Pensées, éd. Brunschvicg 139, éd. Lafuma 136.
[6] Cf. Pascal Ide, « 1. Être enveloppé d’amour », Feu et lumière, 237 (mars 2005), p. 50-53 ; « 2. Habiter son espace intérieur », Feu et lumière, 241 (juillet-août 2005), p. 54-57 ; « 3. Donner à l’autre un espace en soi », Feu et lumière, 244 (novembre 2005), p. 50-53.
[7] Cf. Jean-Louis Chrétien, L’espace intérieur, coll. « Paradoxe », Paris, Minuit, 2014.