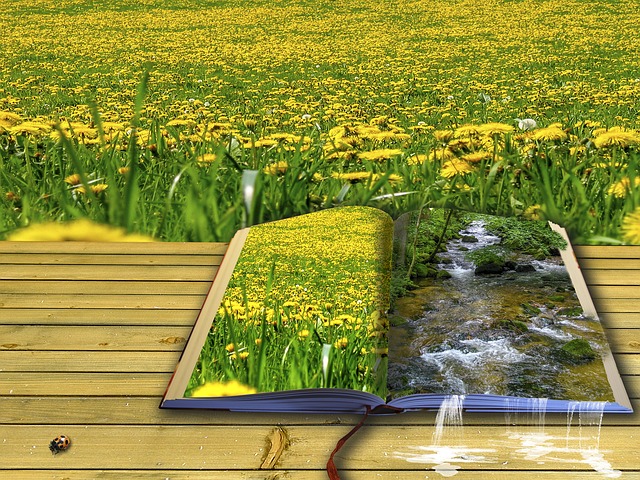2) Dans les beaux-arts
a) Dans les arts plastiques
À l’instar des techniciens, les artistes se méprennent aussi sur l’interprétation du principe selon lequel l’art imite la nature.
1’) L’interprétation erronée
Leonardo da Vinci lui-même n’avait pas honte de faire l’apologie de la peinture avec des arguments comme celui-ci : « Il est arrivé pour une peinture représentant un père de famille que les petits-fils se mirent à le caresser, quoiqu’ils fussent encore au maillot, et aussi le chien et le chat de la maison firent de même ; et c’était chose merveilleuse qu’un tel spectacle [1] ». Et ailleurs :
« Ainsi se trompent les animaux : j’ai vu autrefois une peinture qui trompait le chien par sa ressemblance avec son maître, et l’animal faisait grande fête à ce tableau. J’ai vu aussi les chiens aboyer et vouloir mordre des chiens en peinture ; et un singe faire mille folies à un singe peint ; et aussi des hirondelles voler et se poser sur les fers peints qui étaient figurés sur les fenêtres des édifices [2] ».
Or, note toujours Maritain, « il est parfaitement clair que l’imitation au sens d’une simple copie des apparences naturelles réalisée de telle manière que l’image trompe l’œil et soit prise pour la chose est une notion détestable, directement opposée à la nature de l’art [3] ». Au contraire, de ce point de vue, « l’art s’efforce de se libérer de la nature et des formes naturelles », comme le note le même auteur [4].
2’) L’interprétation adéquate
Il faut déjà reprendre ce que nous avons dit de la technique – puisque tout art comporte une dimension technique –, mais il faut aller plus loin, car les beaux-arts présentent une spécificité : « Pour créer son œuvre de lignes et de couleurs, le peintre imite la nature comme il imiterait un autre peintre. Il ne copie pas la nature comme un objet, il dérobe à la nature, il extrait de son observation de la nature et de sa connivence avec elle, les moyens opératifs grâce auxquels la nature dispose ses propres matériaux bruts de forme, couleur et lumière, pour imprimer dans notre œil et notre esprit une émotion de beauté [5] ». Ici, on le constate, c’est le processus même d’orientation vers le beau qui est « imité ».
Par exemple, l’artiste va imiter l’irrégularité qui est un des secrets de la nature et l’une de ses lois les plus profondes (s’originant dans la contingence de la matière et s’opposant au déterminisme automatique qui fonde méthodologiquement la science classique).
« En examinant à ce point de vue les productions plastiques ou architecturales les plus renommées, on s’aperçoit aisément que les grands artistes qui les ont créées, soucieux de procéder comme cette nature dont ils ne cessaient d’être les respectueux élèves, se son bien gardés de transgresser sa loi fondamentale d’irrégularité. On constate même que des œuvres vasées sur des principes géométriques comme Saint-Marc, la petite maison François 1er Cours la Reine… [ainsi] que toutes les églises dites gothiques, etc., ne présentent aucune ligne d’une rectitude parfaite et que les figures rondes, carrées ou ovales qui s’y trouvent et qu’il eût été bien facile d’obtenir exactes, ne le sont jamais [6] ».
Or, « ce concept véritable de l’imitation, correctement entendu, exprime une nécessité à laquelle l’art humain est soumis [7] ».
b) Dans la poésie. L’exemple des ‘correspondances’ baudelairiennes
L’analogie réelle est bien illustrée par le thème littéraire des correspondances qui apparaît chez Baudelaire et sera développé par les poètes ultérieurs, à commencer par Rimbaud.
1’) Un exemple privilégié
Montrons-le à partir d’un exemple privilégié, le poème Correspondances (dans le recueil Les Fleurs du mal) est on ne peut plus évocateur. Lisez-le en détail et tentez de répondre aux questions suivantes (cela fait un peu bac de français !). Relevez les correspondances établies dans le premier quatrain ; pourquoi leur interprétation est-elle difficile ? Puis montrez que les correspondances du second quatrain sont d’un autre ordre et tentez de le caractériser.
Le premier quatrain montre une correspondance de type vertical entre le ciel et la terre. Baudelaire notait dans ses Notes nouvelles sur Edgar Poe (en 1857) :
« C’est cet admirable, cet immortel instinct du Beau qui nous fait considérer la Terre et se spectacles comme un aperçu, comme une correspondance du ciel. La soif insatiable de tout ce qui est au-delà, et que révèle la vie, est la preuve la plus évidente de notre immortalité. C’est à la fois par la poésie et à travers la poésie, par et à travers la musique que l’âme entrevoit les splendeurs situées derrière le tombeau ».
On retrouve la même tendance à la correspondance verticale et réelle dans un autre poème des Fleurs du mal : « Élévation » :
« Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées,
Des montagnes, des bois, des nuages, des mers,
Par delà le soleil, par delà les éthers,
Par delà les confins des sphères étoilées,
Mon esprit, tu te meus avec agilité,
Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l’onde,
Tu sillonnes gaiement l’immensité profonde
Avec une indicible et mâle volupté ».
Le second quatrain expose les correspondances existant entre les réalités sensibles, donc des similitudes horizontales. On sait combien un Rimbaud exploitera ces correspondances notamment dans son poème « Voyelles ». Les réalités sensibles, odorantes, colorées et sonores communient dans une « profonde unité » qui ne nie pas leur diversité ; or, unité dans la diversité, voilà la définition de l’analogie. Le Lagarde et Michard cite dans une note le passage suivant de Baudelaire qui est éclairant et confirmatif :
« Ce qui serait vraiment surprenant, c’est que le son ne pût suggérer la couleur, que les couleurs ne pussent pas donner l’idée d’une mélodie, et que le son et la couleur fussent impropres à traduie des idées ; les choses s’étant toujours exprimées par une analogie réciproque, depuis le jour où Dieu a proféré le monde comme une complexe et indivisible totalité [8] ».
Les deux tercets développent l’analogie, la correspondance horizontale, sensible dans le registre des odeurs qui occupent une grande place dans l’univers baudelairien [9].
La correspondance est donc une analogie et plus précisément cette analogie est-elle réelle ou seulement intramentale ? A la lecture des différents passages de Baudelaire qui viennent d’être cités, il semblerait que les deux analogies, mondaine et supramondaine, soient toutes deux réelles, davantage encore, fondées dans le dessin du Créateur. Au premier vers du poème Correspondances, il est dit que « La Nature est un temple », et non pas qu’elle est comme un temple. En effet,
« la nature est un temple parce qu’elle préserve au sein de ses forêts la familiarité originelle qui produit des analogies entre différentes choses. […] Aussi, quand Baudelaire déclare que la Nature est un temple, il ne regarde pas la nature avec le yeux d’un poète qui forge de simples comparaisons. Il regarde la nature avec de yeux imaginaires qui voient des yeux familiers le regarder à eur tour, dans un lointain étrange et indéterminé ».
Pourquoi ? « Car les forêts symboliques, quelles qu’elles soient, sont les gardiennes de relations originelles, aussi éloignées, aussi oubliées soient-elles [10] ».
2’) Exposé général
De manière plus générale, toute l’œuvre baudelairienne est marquée par l’ambivalence des choses (et donc par leur foncière analogie réelle). C’est particulièrement frappant dans le poème fameux, « L’albatros », cet oiseau symbolisant la dualité de l’homme cloué au sol et aspirant pourtant à l’infini :
« Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l’archer ;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher [11] ».
Contrairement à Rimbaud qui est un poète de la finitude et de la désespérance, Baudelaire chante l’attrait de l’infini, son angoisse. Il est en effet fortement conscient non seulement de la blessure d’infini affectant tout homme, mais de la tentation, de l’ivresse exercée par les créatures (qu’il ne confond pas avec la blessure d’infini, erreur funeste !). Aussi le sens du péché, tragique, court dans toute l’œuvre du poète des Fleurs du mal, tandis qu’il a disparu chez l’auteur du Bateau ivre. Enfermé dans notre monde, Rimbaud a perdu le sens du mal (et c’est là, peut-être, son plus grand malheur) ; alors, il troque le péché contre l’hubris et le chaos, la rédemption contre la pseudo-libération des contraintes rationnelles. Pourrait-on dire que Baudelaire est à Rimbaud ce que Hegel (ou au moins Fichte) est à Nietzsche ?
Tel est le sens du spleen baudelairien qui n’est pas d’abord je ne sais quelle maladie d’amour ou détresse liée aux ennuis matériels de l’auteur, même si ceux-ci furent bien réels ; ce spleen « est essentiellement métaphysique [12] ». En effet, « devant les maux qui l’opressent, le poète tente désespérément de s’évader vers les sphères de l’idéal ; mais sans cesse le réel vient arrêter ces élans, et les rechutes rendent sa détresse plus intolérable. Cet échec de l’infini dans le fini humain aboutit au découragement, à la nostalgie de l’âme exilée ». On le voit, Baudelaire est marqué par un sens aigu du péché originel ; son œuvre est comme une longue glose du thème pascalien de la misère de l’homme sans Dieu, autrement dit du mystère du péché originel. Peut-on dire qu’elle est d’essence mystique (ce qui est le cas de Pascal) ? Sans doute, le moteur premier des élévations, des correspondances est sans doute un véritable instinctus divinus. Mais celui-ci est souvent occulté par la séduction des réalités terrestres et secrètement, aussi par leur capacité d’attirer vers l’in(dé)fini négatif de l’enfer ou l’infini positif du ciel. C’est ce que confesse avec lucidité le poète dans la dernière strophe du dernier poème des Fleurs du mal :
« Ô mort, […],
Verse-nous ton poison pour qu’il nous réconforte !
Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau,
Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe ?
Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau [13] ! »
Baudelaire connaît la douloureuse ambiguïté de la beauté dont le « regard infernal et divin / Verse confusément le bienfait et le crime [14] ». Et souvent il ne tranche pas. Le poème ci-dessus se termine dans l’attente : beauté qui dit l’infini, « de Satan ou de Dieu, qu’importe ? » Le spleen est porteur de désespérance. Baudelaire pleure autant le temps qui fuit que l’ennui de ne pas vivre de l’éternité (les doubles larmes dont parle sainte Catherine de Sienne ; la double blessure intérieure dont traite saint Jean de la Croix). En tout cas, un signe de la vitalité évangélique qui n’a cessé d’habiter Charles Baudelaire est son sens du pauvre (que l’on relise le si beau poème écrit en souvenir de sa mère, « La servante au grand cœur » [15]). Et si la mort lui semble parfois la seule solution, elle ne s’identifie jamais au chaos, à l’absurde, et demeure mystérieusement ce « portique ouvert sur les Cieux inconnus [16] ».
3) Conclusion
Pour Charles Baudelaire, une même réalité mondaine est à la fois charnelle et spirituelle. Charnelle, elle peut entraîner aux pires corruptions. Symbole du spirituel, elle correspond avec l’infinité céleste. Mais le péché obscurcit notre esprit et interprète comme une béance ou appel du vide ce qui est ouverture vers le mystère invisible. De même, il déchiffre comme une angoisse irrémédiable ce qui est notre inquiétude innée en quête du seul repos divin. Arthur Rimbaud est le témoin de ce tropisme charnel, immanent ou horizontal qui s’épanouira dans notre siècle rongé par la détresse de la finitude [17]. Verlaine des dix sonnets composés à la prison de Mons en 1874, lui, est le témoin de l’inclination spirituelle, trascendante ou verticale. Si le premier n’a gardé que le sens horizontal des correspondances, le second a fini par en retrouver le sens vertical.
Si les trois poètes français ont oublié l’époque bénie où le visible exprimait l’invisible, leur œuvre atteste toujours une attente de cette création théophanique et réconciliée.
Pascal Ide
[1] Léonard de Vinci, Textes choisis. Pensées, théories, préceptes, fables et facéties, trad. et éd. Joséphin Péladan, Paris, Société du Mercure de France, 1907, § 357, p. 175.
[2] Ibid., § 362, p. 180.
[3] Jacques Maritain, L’intuition créatrice dans l’art et dans la poésie, p. 211 ; cf. p. 211-215.
[4] Ibid., p. 66.
[5] Ibid., p. 212.
[6] Auguste Renoir, « Projet d’un manifeste », 1884, cité dans Lionello Venturi, Les archives de l’impressionnisme. Lettres de Renoir, Monet, Pissarro, Sisley et les autres : Mémoires de Paul Durand-Ruel : documents, Paris et New York, Durand-Ruel éd., 1939, p. 128. On pourrait en dire de même de la découverte de la forme de flamme mise en valeur par Michel-Ange (cf. Jacques Maritain, L’intuition créatrice dans l’art et dans la poésie, p. 20, note 13).
[7] Jacques Maritain, L’intuition créatrice dans l’art et dans la poésie p. 212 ; et il applique cette question au cas délicat du statut de la peinture actuelle qui, selon son diagnostic, se trouve dans une relative impasse (Ibid., p. 213-215).
[8] Charles Baudelaire, Richard Wagner et Tannhäuser à Paris, 1861, dans Œuvres complètes, éd. Claude Pichoix, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, Gallimard, 2 vol., 107 et 1976, tome 1, p. 779.
[9] Cf., par exemple, Id., « Parfum exotique », Les fleurs du mal, tome 1, p. 25-26.
[10] Robert Harrison, Forêts. Essai sur l’imaginaire occidental, trad. Florence Naugrette, Paris, Flammarion, 1992, p. 259 et 260.
[11] Charles Baudelaire, « L’albatros », Les fleurs du mal, p. 10.
[12] André Lagarde et Laurent Michard, xixe siècle. Les grands auteurs français du programme, Paris-Montréal, Bordas, 1969, p. 442.
[13] Charles Baudelaire, « Le voyage », Les fleurs du mal, p. 134.
[14] Id., « Hymne à la beauté », Les fleurs du mal, p. 24.
[15] Id., « La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse, Les fleurs du mal, p. 100.
[16] Id., « La mort des Pauvres », Les fleurs du mal, p. 126.
[17] Sur ce sujet, cf. les fines analyses de George Steiner, dans Le Sens du sens. Présences réelles, trad. française de Monique Philonenko et trad. allemande de Heinz Wismann, coll. « Problèmes et controverses », Paris, Vrin, 1988. Avec une préface de Raymond Polin et une post-face d’Alexis Philonenko. Cf. site pascalide.fr : « La crise de la postmodernité selon George Steiner ».