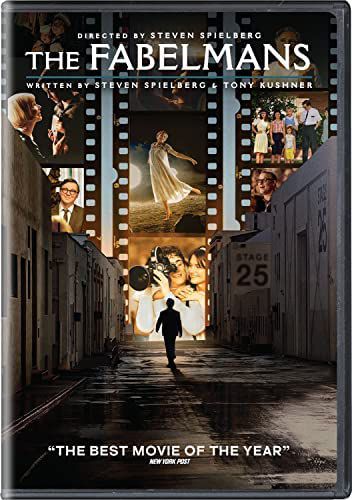
(Français) The Fabelmans
Country:
Américain
Release date:
22 février 2023
Duration:
2 hours 31 minutes
Évaluation:
Director:
Steven Spielberg
Actors:
Michelle Williams, Paul Dano, Mateo Zoryon Francis-DeFord, Gabriel LaBelle
Age restriction:
Adolescents et adultes
Official sites: