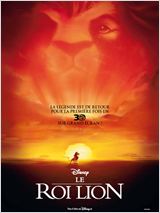Le Roi-Lion (The Lion-King), dessin animé et drame américain de Roger Allers et Bob Minkoff, 1994.
Thèmes principaux
Relations père-fils, culpabilité, enfant prodigue, héros, jalousie, nature, sacré.
À sa sortie, Le Roi-Lion est devenu l’un des six succès majeurs cinématographiques américains de tous les temps [1], le plus grand de l’année 1994 et peut-être le film le plus rentable de l’histoire du cinéma (815 millions de dollars de recettes pour un coût initial de 40 millions de dollars). Depuis, on le sait, il y a eu Titanic et Avatar du même Jim Cameron. Or, ce succès a dérangé. Le critique de Télérama qui boude le dessin animé va jusqu’à estimer « papa Walt définitivement éteint” ; et même celui qui s’enthousiasme (modérément) estime « encombrante » « la tradition Disney », portant des jugements tels que : « la gentillesse mièvre de Bambi a disparu [2] ». Les spectateurs, en tout cas, ont fait leur choix. Cela suffit pour que je m’interroge sur les raisons du succès phénoménal du trente-deuxième long métrage animé produit par les Walt Dysney Pictures.
On s’est extasié à juste titre devant les prouesses techniques : par exemple, la mort du roi Mufasa, due à la fuite de milliers de gnous affolés, fut entièrement réalisée en images de synthèse (la multiplication des mêmes images, dessinées en 3D, autorise une grande variété de trajectoire). Elle ne dure que deux minutes trente, mais a demandé à cinq infographistes du Computer Animated Production Systems un travail de deux ans, exploit unique, quoique depuis lors bien dépassé, dans le domaine de l’animation [3]. Mais la raison du plaisir éprouvé à la vision du Roi-lion – plaisir que les adultes sont loin d’avoir boudé – ne réside jamais dans la seule raison technique et doit être cherché dans une raison éthique, voire religieuse.
Pascal Ide
[1] Après les films, tous américains, et dont les trois premiers sont des histoires de science-fiction : E.T., Jurassic Park, La Guerre des étoiles, Maman j’ai raté l’avion et Forrest Gump.
[2] Télérama, 2341 (23 novembre 1994), p. 50-51. Le critique qui est « pour » est Bernard Génin et le critique qui se prononce « contre » est Marie-Elisabeth Rouchy.
[3] Toutefois, il y a eu deux précédents : la séquence du bal de La Belle et la Bête et la caverne d’Aladdin.
À sa sortie, Le Roi-Lion est devenu l’un des six succès majeurs cinématographiques américains de tous les temps [1], le plus grand de l’année 1994 et peut-être le film le plus rentable de l’histoire du cinéma (815 millions de dollars de recettes pour un coût initial de 40 millions de dollars). Depuis, on le sait, il y a eu Titanic et Avatar du même Jim Cameron. Or, ce succès a dérangé. Le critique de Télérama qui boude le dessin animé va jusqu’à estimer « papa Walt définitivement éteint” ; et même celui qui s’enthousiasme (modérément) estime « encombrante » « la tradition Disney », portant des jugements tels que : « la gentillesse mièvre de Bambi a disparu [2] ». Les spectateurs, en tout cas, ont fait leur choix. Cela suffit pour que je m’interroge sur les raisons du succès phénoménal du trente-deuxième long métrage animé produit par les Walt Dysney Pictures.
On s’est extasié à juste titre devant les prouesses techniques : par exemple, la mort du roi Mufasa, due à la fuite de milliers de gnous affolés, fut entièrement réalisée en images de synthèse (la multiplication des mêmes images, dessinées en 3D, autorise une grande variété de trajectoire). Elle ne dure que deux minutes trente, mais a demandé à cinq infographistes du Computer Animated Production Systems un travail de deux ans, exploit unique, quoique depuis lors bien dépassé, dans le domaine de l’animation [3]. Mais la raison du plaisir éprouvé à la vision du Roi-lion – plaisir que les adultes sont loin d’avoir boudé – ne réside jamais dans la seule raison technique et doit être cherché dans une raison éthique, voire religieuse.
Montrons-le en analysant le déroulement de l’intrigue de manière systématique, même si la structure ainsi mise en évidence est à la poésie et au charme du dessin animé, ce que le squelette est à un homme vivant dans la force de l’âge.
1) Un fils heureux
Le film commence au moment où Simba qui vient de naître est en quelque sorte « sacré », voire « oint » successeur du roi Mufasa, par Rafiki, le babouin (et non pas le ouistiti, comme dit le français) : le soleil qui, à l’instar de la vie, se lève sur une scène de parade splendide, salue le roi-soleil de l’empire des Hautes Terres.
Mais Simba n’est encore qu’un lionceau insouciant et irresponsable qui trouve sa joie à suivre ses caprices. Son père lui désigne-t-il un lieu tabou, la Colline du Nord, que le plaisir de la découverte se double de celui de la transgression des interdits parentaux. La curiosité avivée, Simba entraîne son amie Nala braver inconsidérément le danger. D’autant qu’un lâche tentateur, son oncle Scar, lui apprend qu’il s’y trouve un cimetière d’éléphants. Voilà pour la curiosité. Mais ce n’est qu’une partie de la vérité : le cimetière est aussi le repère des trois hyènes, Shenzy (à qui Whoopi Goldberg ne fait pas que prêter sa voix) et ses deux compagnes, Banzai et Ed. Néanmoins, si le lionceau est imprudent, il ne manque pas de courage : il est prêt à donner sa vie pour celle qu’il aime et qu’il a imprudemment entraînée. Les hyènes vont-elles se repaître de l’héritier ? Heureusement, le père veille.
Mais d’où Simba l’imprudent tire-t-il son courage ? De Mufasa. Il admire ce père grandiose, le plus courageux des animaux, devant qui tout genou fléchit, ce vrai roi qui gouverne son pays avec un sens aigu de ses responsabilités. D’ailleurs, à côté de sa colère, Mufasa doit éprouver une secrète fierté de voir son fils affronter les hyènes pour sauver Nala. Surtout, le fils aime son père plus que tout au monde. Il veut en suivre les traces. Certes, sa petite patte semble perdue dans l’empreinte géante de Mufasa ; mais comment ne pas désirer un jour s’égaler à elle ?
Car le Roi-lion est d’abord un père. De celui-ci, il a l’autorité. Il apprend à son fils à reconnaître ses torts et sa responsabilité : « Tu m’as désobéi délibérément ». « Je voulais être brave comme toi, explique naïvement Simba ». Du père, il a le sens du réel, donc le prix de la vie : « Être brave ce n’est pas risquer sa vie pour n’importe quoi ». Du père, il a aussi la vulnérabilité, qui conjure la tout-puissance : « Alors, même les rois ont peur ?, demande Simba qui va de découverte en découverte ». Il existe une crainte qui n’est pas lâcheté, dont il n’y a pas à avoir honte. En effet, la crainte qui naît de l’amour a peur non pas pour soi, mais pour l’autre. Du père, il a aussi la capacité à dépasser sa déception d’avoir été trahi dans sa confiance et à pardonner. Enfin, prophétique, le roi-lion est le vrai père qui ne garde rien pour lui et prépare son fils à la succession : se refusant au narcissisme de la prétention à l’immortalité comme à la demande fusionnelle d’être le « super-copain », Mufasa dispose Simba à sa possible mort. Celle-ci acceptée, le « rien ne nous séparera » qui suivra apporte une sécurité qui n’est pas une illusoire anesthésie : « Chaque fois que tu te sentiras seul, n’oublie pas que du haut du ciel, les autres rois te contemplent et t’aident ».
Un tel père ne peut pas ne pas graver profondément son image au fond du cœur de son fils. Le départ sera d’autant plus douloureux, mais le rebond d’autant plus haut.
Face à Mufasa, l’oncle constitue l’antitype du père et souligne, en contrepoint, ce que celle-ci est appelée à être. Mû par la jalousie encore plus que par l’ambition, il se caractérise notamment par trois propriétés qui sont autant de notes contre-paternelles : l’absence de fiabilité, l’absence de responsabilité (« La génétique n’a pas joué en sa faveur », s’excuse-t-il : mais l’humour ne doit pas dissimuler le report de responsabilité sur autre que sa liberté), l’absence d’amour pour ceux qu’il gouverne (dans quel état laissera-t-il le royaume ? avec qui gouvernera-t-il ?)
2) Le fils perdu
L’abominable trahison de l’oncle (« Tu vas aimer ma surprise à en mourir ! ») laisse Simba prématurément seul. Mais cette solitude extérieure, loin de son royaume et de la présence sécurisante de ceux qui l’aiment, n’est rien face à l’esseulement intérieur. En effet, par jalousie autant que pour écarter définitivement Simba du trône, Scar s’est s’ingénié pour culpabiliser le lionceau : « Je ne voulais pas le tuer, balbutie Simba. – Personne ne peut vouloir une telle chose. Mais sans toi, le roi serait vivant. Pars très loin et ne reviens pas ». Plus sûrement que les hyènes, la honte va assassiner le cœur de Simba. Bien symboliques de son état intérieur sont la forêt de buissons épineux infranchissables, et le désert inhospitalier grâce auxquels Simba échappe aux hyènes chargées de le tuer.
Comment, sans père, loin de sa mère, intensément angoissé et surtout en haine de lui, Simba va-t-il pouvoir survivre ? Une seule solution, bien connue des psychologues : refouler le passé, faire table rase de sa trop douloureuse histoire. L’occasion lui est offerte, au-delà de ses espérances, par la rencontre de deux nouveaux amis qui feront, au moins pour instant, figures de sauveurs : Timon le suricate (le suricate est une espèce de mangouste) et Pumbaa le phacochère.
De prime abord, Timon et Pumbaa se contentent de lui présenter une vie faite de plaisirs et dénuée d’entraves. La seule loi se résume dans le mot magique qui aplanit toute difficulté : « Hakuna-matata » (avec l’accent, s’il vous plaît), expression swahili qui signifie à peu près : « pas de problème », « vivre sa vie sans souci », et qui n’est pas sans évoquer la chanson de Baloo « il en faut peu pour être heureux ». Simba accepte joyeusement et sans difficulté cette nouvelle vie, faite d’insouciance et dénuée d’engagements où tout est occasion de calembours et de bons gueuletons : le seul mal que l’on connaisse est « le mâle qui ronge ». Surtout une vie sans les remords du passé et les craintes de l’avenir.
Pourtant cette tranquillité sans prix coûte en fait très cher. Simba se coupe d’abord de ses racines : « On ne revient jamais en arrière », expliquent ses deux amis qui lui proposent leur vision New age d’un monde délié de toute attache, de tout enracinement historique et culturel, et finalement de toute altérité (« Quand le monde entier te persécute, persécute-le »). Plus encore, il en perd son identité. Un changement très symbolique d’attitude le signale : le lion Simba se met, comme ses amis, à manger des larves (« un peu gluant, mais appétissant »). Certes, il y a de la régression orale dans cette identification hédoniste du bonheur avec la satisfaction d’un ventre repu. Mais surtout l’identité de l’animal passe par son régime alimentaire. Bref, en abandonnant la nourriture carnivore pour l’insectivore, Simba abandonne son être même.
Conséquence de cette double rupture à l’égard de son origine passée et de son identité présente : Simba perd sa destinée à venir, le sens de sa vie, sa vocation. Peut-on vivre longtemps heureux sans finalité ? Si ses compagnons ne simulent pas un personnage, lui, Simba, a dû renoncer à sa personne : il ne sait ni ce qu’il est, ni ce qu’il ressent, ni ce qu’il désire. Contrairement à Baloo, nulle Baghera, certes stressée et un rien sentencieuse, mais non dénuée de sagesse, ne veille sur lui pour l’inviter à changer…
3) Le fils retrouvé
Un jour, attirée par la faim et la nécessité de sauver son peuple, surgit Nala. En un instant, toutes les angoisses soigneusement enfouies réapparaissent avec la même soudaineté que son amie d’enfance et admiratrice, compagne et complice de ses incartades.
N’est-ce pas juger trop négativement ce temps de fraternité sans attache, ni faille ni souffrance ? Régression fusionnelle sans doute ; mais période nécessaire pour permettre la survie à un Simba profondément traumatisé : « J’ai essayé de vivre ma propre vie, explique-t-il à Nala ». Cette existence ne lui a-t-elle pas au moins permis de grandir et se fortifier sans heurt ? Nous aurons bientôt la réponse.
Nala va droit au fait en rappelant à Simba qui il est et ce à quoi il est destiné : désormais, son père mort, il est roi. Son ancien ami refuse en se réfugiant dans l’individualisme qui est sa nouvelle vie. Mais Nala souffre trop pour être dupe : « Tu dois être roi ». Simba, lui, est trop accablé par son inavouable culpabilité et, à l’instar de Scar, s’excuse en faisant appel au jeu impersonnel des causes : « Il y a une fatalité ». Convoquant un autre argument, Nala repart à la charge : « Tu es notre seule chance. Tu as des responsabilités ». Sans le savoir, elle éveille maintenant l’image trop douloureuse de Mufasa. D’ailleurs, l’intense remords de Simba lui interdit de s’identifier à ce père tant chéri : « Tu parles comme mon père, rétorque-t-il, plus douloureux que méprisant ».
Ayant épuisé tout argument, Nala ne peux plus rien pour Simba et son pays et s’en va. Seul, il est impuissant à affronter son oncle indigne. Toutefois, l’intervention de Nala fut loin d’être inutile. Elle a donné l’orientation (l’oméga) ; Simba a maintenant besoin de l’impulsion (l’alpha). Ce sera le rôle de Rafiki. Aussitôt qu’il comprend que, par la merveilleuse connexion des éléments (« tout est lié »), Simba est vivant, le singe se met en route : « Tu es le fils de Mufasa, lui déclare-t-il, dès qu’il l’aperçoit ». Réponse immédiate qui traduit la mentalité de Simba : « Mon père est mort », autrement dit : moi aussi, puisque je l’ai tué. « Erreur, reprend Rafiki, il est vivant ». Alors se déroule ce qui constitue pour moi la scène décisive du film – qui est aussi la plus belle. Rafiki conduit Simba jusqu’à un étang pour lui donner une merveilleuse leçon de vie. Il demande à l’actuel Roi-lion de regarder.
Tout d’abord, replié sur sa souffrance, Simba ne voit que son reflet : « Regarde mieux, insiste le vieux sage. Ton père vit en toi ». Soudain, son portrait se brouille et, au-delà, Simba voit alors lui apparaître les traits du visage tant aimé. En effet, l’eau réfléchit le ciel qu’un jour Mufasa lui avait montré. Son père résume alors tout le mal commis par Simba en une phrase : « Tu m’as oublié en oubliant qui tu étais ». En quittant son pays, en quittant son identité, Simba a oublié la parole d’espérance que son père a un jour prononcé : « Chaque fois que tu te sentiras seul, n’oublie pas que du haut du ciel, les autres rois te contemplent et t’aident ». Alors Simba comprend d’un coup que tout ce qu’il est n’est pas enfui, mais seulement enfoui.
Mais, une fois mieux compris qui il était, comment affronter la culpabilité ? La guérison suppose que Simba accepte trois points : 1. non plus refuser, mais accepter le passé (« il te faut affronter le passé ») ; 2. s’ouvrir à l’avenir en reprenant sa place dans le grand cycle de la vie ; 3. adhérer au présent, c’est-à-dire à son propre être qui n’est pas insectivore : « N’oublie pas qui tu es ». Il est celui que son père appelle : « Tu es mon fils ».
Certes, le lion s’est amolli en lui – telle est la première leçon du combat contre Rafiki. Mais Simba apprend vite, à la mesure de son désir. Surtout, cette éducation à la hâte aurait-elle suffi à décider Simba de se préparer à revenir en son royaume si son père – sans oublier la présence de sa mère protectrice, la douce Sarabi – n’avait durablement gravé une empreinte tout à la fois suave et forte ?
Le décor accompagne et exprime le chemin de Simba. Le royaume de Mufasa était une féerie multicolore, une danse de la vie où chaque être occupait sa place. L’anti-royaume de Scar est un gouffre de ténèbres, d’aridité, « chaos de hurlements sauvages » – ceux des charognards que sont les hyènes. À l’image de l’âme de l’oncle dévoyé, qui est assassinée par la jalousie et la haine vengeresse, le pays n’est plus que mort et désolation. La nature désertifiée ne joue pas qu’un rôle symbolique. Elle pâtit de ce roi de la nuit qui, en s’alliant avec les hyènes – situées « au bout-bas de la chaîne alimentaire » ! –, s’est dérobé au respect des lois de la vie et a bouleversé l’harmonie des différents maillons constituant la nature en sa dynamique et systémique totalité.
4) « Le retour du roi »
Simba revient par le cimetière des éléphants, trace de sa désobéissance, mais aussi du salut et du pardon gratuitement offerts par son père. Maintenant il doit, lui et lui seul, reconquérir le pouvoir. Pour cela, il doit affronter pire que Scar, la mauvaise conscience qu’il incarne et suscite : « Tu te soumets ou tu te bats ». À son oncle qui lui rappelle le passé honteux, Simba répond : « Je ne me sens pas coupable ». C’est un premier pas. Mais la parole peut-elle ainsi changer d’un coup son affectivité ? D’ailleurs, le roi félon est d’une duplicité infinie : il somme Simba de reconnaître devant tous qu’il est l’assassin de son père : « C’est moi qui suis le coupable ». Cet aveu à la face de tous atterre Simba et révèle combien la blessure est encore vive. Symboliquement acculé par Scar sur le rocher royal, il s’apprête à tomber dans le feu. Scar le rattrape, en enfonçant sauvagement ses griffes dans les pattes antérieures. Ce faisant, il renouvelle le geste abominable par lequel il a consommé le régicide de Mufasa. Plus encore, Scar ne peut s’empêcher de révéler tout le plan machiavélique qu’il a monté : il a besoin d’être reconnu par son rival, pour que son triomphe soit complet. Mais cet orgueil lui sera fatal : la haine qu’il suscite en Simba suscite l’énergie du désespoir. D’un bond, le prétendant légitime se rétablit, dans tous les sens du terme, sur l’enjeu qu’est le rocher royal, et renverse Scar. Plus encore, toute l’amertume accumulée par la culpabilité se retourne contre son perfide auteur. En même temps qu’il bannit tout remords stérile et recouvre son identité plénière, Simba venge la mémoire de son père. Mais en digne fils du magnanime Mufasa, il renonce à toute vindicte sanguinaire : « Je ne vais pas te tuer. Pars très loin et ne reviens jamais ». L’exil de Scar ne durera pas : les hyènes qu’il a trahies n’auront pas la même clémence.
Selon Freud, deux critères signent l’accès à la guérison et l’arrêt de l’analyse : aimer et travailler. Une fois réintégré sa fonction royale, Simba se doit donc de découvrir la valeur de l’amour. « On ne peut pas se marier », expliquait le lionceau Simba à Zazu, « c’est ma copine ». Il sait maintenant que l’amour ne s’oppose pas à l’amitié, mais se fonde sur elle.
Après le vent prophétique et le feu purificateur, la pluie apaisante vient laver le mal, emportant symboliquement un squelette. Alors, Simba peut prendre possession du rocher royal, dernier des quatre éléments fondamentaux (air, feu, eau, terre) et y pousser son seigneurial rugissement.
En une heureuse inclusion, la dernière scène présente le successeur de Simba. Sommes-nous pour autant revenus au point de départ ? Si le sage babouin manifeste la continuité, la présence des deux amis, Pumbaa et Timon, introduit cette altérité et cette nouveauté constantes que chante Elton John dans un hymne à la responsabilité et à la solidarité des créatures au sein du monde : Le cercle de la vie (The Circle of life). En se refusant au cycle sans fin de la violence, le nouveau Roi-lion a opté pour le cycle vraiment innovant de la vie. Se dit aussi une des plus belles lois de la vie : la crise assumée agrandit et introduit de l’inédit ; la blessure entretenue rétrécit et met au rouet. Alors que la cicatrice de Scar barre son âme, amère et jalouse, comme elle zèbre son visage, le stress post-traumatique vécu par Simba s’est transformé en fécondité, l’injustice subie en puissance et en miséricorde. C’est d’ailleurs dans cette blessure traversée que le roi légitime puise l’énergie pour surmonter la mort prochaine, sortir de la fatalité de la répétition et renverser l’usurpateur.
5) Le triangle homme-nature-sacré
Passons de la perspective diachronique (narrative) à la perspective synchronique qui est tout aussi intégrative. Ce film nous touche à cause du parcours humain de Simba et de la belle image de père incarnée par Mufasa. Jusque maintenant, les productions Dysney fondait leurs intrigues dramatiques sur des histoires d’amour. Pour la première fois, un de leurs films met en scène la relation de filiation : « Le ressort émotionnel du Roi-Lion est la relation père-fils », explique l’un des deux réalisateurs, Roger Allers. Voilà pourquoi, et c’est encore une première étroitement corrélée, le scénario très travaillé du film est entièrement inédit. D’ailleurs cet intérêt porté à la paternité n’est-il pas révélateur d’un besoin typique de l’Amérique actuelle [4], besoin plus urgent que le seul rêve auquel convie l’histoire d’amour.
Le dessin animé nous rejoint aussi en nous réconciliant avec la nature. Nous avons déjà vu le jeu cosmique des quatre éléments. Autre exemple : dans son chemin de réconciliation intérieure avec lui-même, Simba ne fut-il pas aussi porté par l’aide, subtile, du vent (et de quelques humbles feuilles mortes), ce vecteur du grand cycle de la vie, de l’amour et de la sagesse ? Zazu, digne majordome, secrétaire et bouffon de sa majesté Mufasa, n’est-il pas un un Calas, un oiseau, donc un être qui habite les airs ? Ici surtout se vérifie la grande loi : l’extérieur reflète l’intérieur : le royaume de Mufasa est à son image, profus, vivant, paisible, harmonieux, quasi-paradisiaque ; celui de Scar à sa ressemblance, pauvre, mort (la jalousie est une mort de l’âme), inquiétant, dysharmonieux, quasi-infernal.
Enfin, Le Roi-lion ne dédaigne pas la dimension du sacré. Certains s’offusquèrent du geste par lequel Simba est oint roi. Loin d’être une parodie de sacrement, il s’agit d’un rite d’institution universellement pratiqué dans les religions archaïques. D’ailleurs, le geste sacramentel présente une part d’enracinement naturel, ainsi que l’a montré le théologien Louis-Marie Chauvet [5]. De manière plus générale, du propre aveu des réalisateurs, « Le Roi-Lion est une fable généreuse qui remet à l’honneur les grands archétypes du récit initiatique : le cycle de la vie, l’action, l’aventure, le rapport père-fils, le premier amour [6] ».
6) Conclusion
Allons plus loin. Plus que ternaire (homme-nature-Dieu), la structure implicite du film ne serait-elle pas quaternaire ? Ne rappelle-t-elle pas le fameux Quadriparti de Heidegger : la terre et le ciel, les dieux et les mortels [7] ? Voire, davantage qu’un croisement incertain d’Hamlet et du Livre de la jungle, Le Roi-lion ne reprend-il pas la plus belle et la plus fameuse des paraboles de l’Évangile : celle du fils prodigue, ou, mieux, du père miséricordieux [8]. Les parallèles sont nombreux, qui ne doivent pas effacer les différences. Le fils cadet et Simba ont reçu beaucoup d’amour de la part d’un père que les récits montrent si attentionné. Tous deux, un jour, s’en vont, loin de la maison paternelle : certes, Simba subit cet éloignement alors que le fils prodigue le choisit ; mais on ne saurait totalement annuler la part de responsabilité de Simba : son infidélité à soi et son désespoir ne sont que partiellement excusé par l’amnésie liée au refoulement. Dans les deux cas, l’éloignement du père, plus, sa perte, cause une perte d’identité ; et cette perte se traduit par un changement radical et humiliant d’alimentation. Enfin, dans les deux récits-paraboles, le salut opère en deux temps : le retour en soi-même et la découverte qu’il y a en soi plus grand que soi, en l’occurrence, le père. Rappelons-nous la si belle parole de Mufasa, soulignée par l’admirable symbolique de l’étang miroir : « Tu m’as oublié en oubliant qui tu étais ». De même, c’est « en entrant en lui-même » (Lc 15,17), que le fils prodigue fait mémoire de la maison de son père.
Cette bijection qui entrelace si étroitement les deux récits alarmera certains qui crieront à la confusion des genres. Bien au contraire, elle manifeste l’inépuisable puissance symbolique de la parole du Christ. L’inspiration est sans doute religieuse et le résultat profane. Mais justement, Dieu n’est pas venu seulement pour sauver le monde, mais aussi pour le récapituler et le parfaire [9].
Pascal Ide
[1] Après les films, tous américains, et dont les trois premiers sont des histoires de science-fiction : E.T., Jurassic Park, La Guerre des étoiles, Maman j’ai raté l’avion et Forrest Gump.
[2] Télérama, 2341 (23 novembre 1994), p. 50-51. Le critique qui est « pour » est Bernard Génin et le critique qui se prononce « contre » est Marie-Elisabeth Rouchy.
[3] Toutefois, il y a eu deux précédents : la séquence du bal de La Belle et la Bête et la caverne d’Aladdin.
[4] Cf., par exemple, l’activiste du mouvement masculin américain Robert Bly, Iron John, 1990 : L’homme sauvage et l’enfant, trad. Christian Cler et Maxime Loiseau, Paris, Seuil, 1992 Plus généralement, Elisabeth Badinter, XY. De l’identité masculine, Paris, Odile Jacob, 1992.
[5] Cf. Louis-Marie Chauvet, Symbole et sacrement. Une relecture sacramentelle de l’existence chrétienne, coll. « Cogitatio Fidei » n° 144, Paris, Le Cerf, 1987.
[6] Michèle Darmon, Notes de production, Communication et Relations Presse, 4 rue de Penthièvre 75008, Paris, 1994, p. 9.
[7] Cf. Jean-François Mattéi, Heidegger et Hölderlin. Le Quadriparti, coll. « Épiméthée », Paris, p.u.f., 2001.
[8] Cf. Lc 15,11-32.
[9] On sait combien le christianisme a fécondé l’art. Jacques Maritain ne l’a-t-il pas montré pour l’art en général (cf. L’intuition créatrice dans l’art et la poésie, Paris, DDB, 1966, chap. 9) et Erich Auerbach pour le roman réaliste (cf. Mimésis. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale, trad. Cornelius Heim, Paris, Gallimard, 1968, rééd. coll. « Tel », 1977. Cf. site pascalide.fr : « L’origine biblique du roman réaliste ») ?
Mufasa (doublé en français par Jean Réno), le roi lion qui gouverne la terre éclairée par le soleil, vient d’avoir un fils, Simba. Scar (admirablement campé, sous les traits et la voix de Jeremy Irons que double en français Jean Piat), le frère du roi, lâche et jaloux, voit s’envoler son rêve de lui succéder sur le trône. Il décide alors d’assassiner le légitime successeur avec la complicité de ces ennemis héréditaires des lions que sont les hyènes. Ce plan ayant échoué, un autre, bien plus diabolique le remplace. Scar tue Mufasa lui-même et accuse Simba de cette mort. Intensément culpabilisé, le lionceau fuit. Survivant grâce à la complicité d’un suricate, Timon, et d’un phacochère, Pumbaa, il apprend d’eux une nouvelle vie faite d’insouciance et d’oubli. Pendant ce temps, le gouvernement calamiteux de l’oncle indigne qui délègue tout aux hyènes, conduit le pays de Mufasa à la ruine. Mais comment Simba pourrait-il affronter et détrôner le roi félon, sans affronter ses démons intérieurs ?