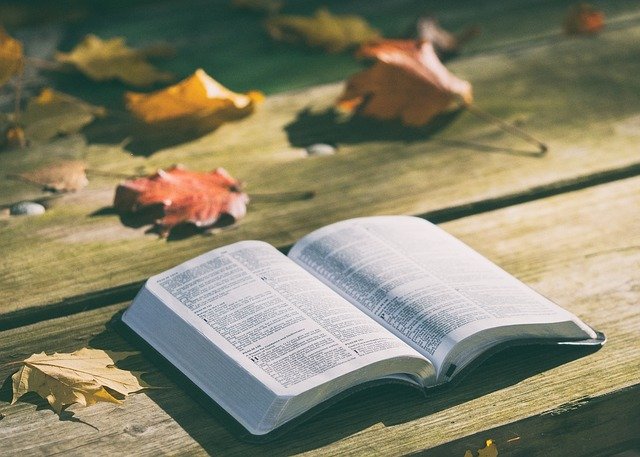1) La beauté comme épiphanie de la gratuité
Multiples sont les définitions de la beauté [1]. Platon disait que le beau est « ce qui, étant vu, plaît ». Dans une approche moins subjective, les médiévaux affirmaient que la beauté est « la splendeur de la forme ». Plus profondément encore, le penseur suisse Balthasar affirme que la beauté est l’être en tant qu’il se montre. Il veut dire par là que la raison la plus profonde de la beauté est la gratuité. C’est elle qui nous fait nous exclamer face à un acte héroïquement généreux, non pas seulement « C’est bien », mais « C’est beau ». Voilà pourquoi au terme de chacun des jours de la création, Dieu s’écrie dans un regard émerveillé que c’est « tov », terme hébreu qui embrasse le bien et le beau.
Or, notre relation à la nature commence avec l’étonnement, plus encore, l’enthousiasme face à la nature qui se donne à voir, qui se montre gratuitement. Actuellement, je vois par la fenêtre un ciel bleu comme il n’en brille qu’en février. Hier, un merle chantait avec virtuosité, au point que j’ai arrêté mon travail pour répondre à son chant par la gratitude de mon écoute émerveillée.
2) La vérité comme dévoilement
Qu’est-ce que la vérité ? Cette question sentencieuse (de gros traités de philosophie lui ont été consacrés) ou inquiétante (n’est-ce pas celle qui a conduit le sceptique et compromis Pilate à condamner Jésus ?) cache une expérience très simple. Si vous affirmez que, en ce moment, vous êtes en train de lire un livre, vous dites vrai ; si, en revanche, vous dites que, toujours maintenant, vous êtes en train de prendre une douche, vous dites faux (qu’il s’agisse d’une ignorance, d’une erreur ou d’un mensonge, peu importe). Le premier énoncé (« Je lis un livre ») est donc vrai parce qu’il correspond à la réalité, et le deuxième faux parce qu’il est en décalage à l’égard de cette même réalité.
La scolastique médiévale a condensé cette approche de la vérité dans une heureuse formule : la vérité est l’adéquation entre l’esprit et la chose [2]. Le terme adéquation qui est construit sur deux racines latines, ad, « vers », et aequum, « égal », signifie simplement égalité ou identité, au moins approchées, en l’occurrence entre celui qui connaît et celui qui est connu.
Implicitement ou explicitement, notre compréhension et notre pratique de la vérité est spontanément celle-ci. Elle est pratiquée par les petit enfants dès le plus jeune âge (« Je mange une orange. – C’est faux, tu manges une pomme »), autant que par les chercheurs expérimentés (affirmer que les corps tombent à vitesse accélérée est vrai et à vitesse uniforme est faux).
Pourtant, cette première définition ne dit pas tout de la vérité. Le philosophe allemand Martin Heidegger nous a rendus sensibles à une autre approche : est vrai l’être qui se montre, se dévoile [3]. Le langage courant ne l’ignore pas. C’est ainsi que l’on dira d’une personne qu’elle est vraie lorsqu’elle cesse de cacher ce qu’elle ressent ou ce qu’elle veut derrière une façade ou un personnage, et qu’elle se montre telle qu’elle est. Ainsi, le terme vérité retrouve son sens originaire. En effet, en grec, aléthéia, « vérité », est composé du préfixe privatif a et de la racine léthé. Or, dans la mythologie grecque, Léthé, « oubli », est la personnification de l’oubli, autant que l’un des cinq fleuves des Enfers, qui les séparait du monde extérieur côté Vie, auquel les âmes des justes et des méchants ayant expié leurs fautes buvaient pour oublier leur vie antérieure et, ainsi devenues amnésiques, pouvoir revenir sur la terre. Littéralement, aléthéia s’identifie donc à « non-oublié ». Ainsi, une nouvelle fois, la vérité est un chemin qui conduit de l’apparence dans les profondeurs de l’être que nous ne cessons d’oublier et de perdre [4]. « Le secret de l’être n’a donc rien de jaloux ni de maléfique […]. Si tout était dévoilé sans réserve, il n’y aurait plus de dévoilement. Le dévoilement absolu et total est le voilement absolu et total [5] ».
Le premier sens de la nature, le sens théorétique, en restait à la première définition de la vérité (l’adéquation de l’intelligence aux choses), qui est la moins décisive. Voilà pourquoi nous avons centré le sens théorétique et historique sur la beauté et non pas sur la vérité. En revanche, le deuxième sens, le sens allégorique, lui, entre dans le mystère de la nature, y déchiffre son attente de l’homme et de l’harmonie entre l’homme et la nature. De même que la vérité va de ce qui apparaît au fond qui demeure toujours en excès, donc secret, de même découvrir les sens de la nature, c’est peu à peu arpenter le rude et riche chemin conduisant dans les profondeurs scellées de la nature, sans jamais en épuiser la surabondance.
Dans un fragment fameux, Héraclite affirme : « La nature aime se cacher [6] ». Mais il ne dit que la moitié de la vérité : la nature aime aussi et d’abord à se révéler [7]. C’est ce qu’atteste l’œuvre du grand naturaliste suisse encore trop peu connu Adolf Portmann (1897-1982) [8].
Il s’agit donc ni de trembler devant les espaces infinis de la nature, ni de la torturer pour mettre à nu ses arcanes [9]. Autrement dit, il ne s’agit ni de la voiler (la réduire à l’invisible qui s’y cache) ni de la violer (la réduire au visible qui s’y manifeste). Ne jouant pas à « Fais-moi peur » ou à cache-cache, le cosmos s’avance vers nous pour nous révéler plus grand qu’elle : la venue de l’homme et, avec lui, de Dieu lui-même. Si les phénomènes visibles sont cause les uns des autres, ils sont signes de réalités invisibles, présentes et à venir, qui en détiennent la clé. Telle est l’expérience que j’ai faite, à la « Fenêtre de Dieu ».
Osons prophétiser. Les disciplines scientifiques ne sortiront de la crise qui n’épargne aucun domaine (pas de grande théorie physique validée depuis les théories de la relativité et la mécanique quantique ; pas de modèle unificateur du vivant depuis Darwin ; etc.) que si elles conjuguent audace de la vérité et humble non-violence dans son interrogation : « Nature, que me donnes-tu à connaître de toi ? »
3) La bonté comme achèvement de l’être
Le bien ou la bonté présente souvent pour nous une connotation morale : est bon ce qui humanise notre action ; un homme bon est un homme éthiquement bon. Le bien transcendantal est autrement plus large puisqu’il s’applique à tout être. En ce sens, est bon tout ce qui apparaît désirable. Complémentaire de cette définition subjective qui nous vient d’Aristote, est la définition de saint Thomas pour qui la bonté est la perfection ou l’accomplissement d’un être. C’est ainsi que l’on distingue le médecin bon du bon médecin : dans le premier cas, bon présente un sens moral ; dans le second, il renvoie au sens transcendantal : le bon médecin est le médecin accompli dans son art.
Le sens écologique de la nature est souvent compris au sens étroitement moral du terme bon : l’homme doit cesser de violenter la nature et la respecter. Cela est juste. Mais l’homme est appelé à beaucoup plus : vouloir le bien de la nature, c’est-à-dire à lui permettre de déployer ses ressources et d’ainsi, de concert avec elle, produire tout son fruit. Autrement dit, l’accomplir au-delà même de ce qu’elle peut par elle-même. Tel est le sens transcendantal de la bonté.
4) L’unité comme communion
Les chapitres précédents nous ont invité à revisiter les transcendantaux beau, vrai et bien, et, à chaque fois, à élargir le sens spontané que nous leur octroyons. Faisons de même pour le dernier d’entre eux, qui est associé au sens eschatologique.
Spontanément, nous identifions l’unité d’un être à son indivision : cette orange est une tant que je ne l’ai pas découpée en quartiers. Nous associons aussi parfois l’unité à l’unicité : est un non plus seulement ce qui est indivis en soi, mais ce ce qui est distinct de tout autre, autrement dit ce qui est singulier. Ainsi, chaque orange dans ce panier est unique en ses caractéristiques, et ne serait-ce que par sa position.
Véridique, mais trop pauvre, cette définition de l’unité exclut tout ce qui est multiple ; elle risque de sombrer dans la tentation illusoire de l’uniformité (« Ah, si nous pouvions penser la même chose, ainsi il n’y aurait plus de violence ») et le culte individualiste de l’unicité. Elle ne prend pas en compte l’histoire qui peu à peu rassemble et fait d’une diversité un tout. Au point de départ, Roméo Montagu et Juliette Capulet sont différents, voire opposés par leurs familles de naissance. Mais par leur amour, ils se rapprochent, ne font plus qu’un cœur et bientôt une seule chair ; ils promettent que, au-delà des dissensions parfois prolongées et violentes, une unité est possible et éminemment désirable. Cette unité transcendantale n’est plus initiale, c’est-à-dire donnée, mais terminale, c’est-à-dire à construire. Elle porte un nom : en Occident, communion ou communauté ; en Orient, harmonie.
Pris dans le premier sens (l’indivision ou l’unicité), l’unité dépeint davantage le sens fondamental de la nature, notre première approche de celle-ci. Mais nous avons vu que le sens eschatologique se caractérise par sa capacité à faire converger et réconcilier ce qui avait tendance à diverger : nature, homme, œuvres de la technique, et même Dieu. Ainsi entendue, l’unité est bien l’œuvre excellente que recueille le sens eschatologique de la nature. C’est elle qu’attend l’espérance écologique. Non pas un retour à une nature sans homme (paradigme écocentriste), non pas une nature absorbée par la technique (paradigme transhumaniste), mais une nature pleinement unie à l’homme, les deux étant harmonisés ultimement en et par Dieu. C’est ce que signale l’image apocalyptique du jardin dans la Jérusalem céleste développée au chap. 9.
Pascal Ide
[1] Pour le détail et les citations, cf. Pascal Ide, Introduction à la métaphysique. I. Vers les sommets, coll. « Les cahiers de l’École cathédrale » n° 8, Paris, Mame, 1994, p. ; L’épiphanie de la beauté, Paris, Le Centurion, 2021.
[2] Cf., par exemple, saint Thomas d’Aquin, Q. D. De veritate, q. 1, a. 1. Pour le détail, cf. Pascal Ide, Introduction à la métaphysique. I. Vers les sommets, p. .
[3] Cf., par exemple, Martin Heidegger, « De l’essence de la vérité », 1930, trad. Walter Biemel et Alphonse de Waelhens, Questions I, Paris, Gallimard, 1968, p. 159-194.
[4] Pour une approche métaphysique de cette conception mystérique de la vérité, cf. Pascal Ide, Être et mystère. La philosophie de Hans Urs von Balthasar, coll. « Présences » n° 13, Namur, Culture et vérité, 1995, chap. 1.
[5] Jean-Louis Chrétien, « La réserve de l’être », Michel Haar (éd.), Martin Heidegger, coll. « Cahier de L’Herne », Paris, L’Herne, 1983, p. 233-260, ici p. 248.
[6] Héraclite, Fragment B cxxiii, de Thémistius, in Les présocratiques, éd. Jean-Paul Dumont, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, Gallimard, 1988, p. 173. Il attribue même ce mystère au divin (Fragment, B lxxxvi, p. 166). Cf. Giorgio Colli, Nature aime se cacher. Physis kryptesthai philei, trad. Patricia Farazzi, coll. « Polemos », Paris, Éd. de l’Éclat, 1994 ; Pierre Hadot dans Le voile d’Isis. L’histoire de l’idée de nature, Paris, Gallimard, 2004.
[7] « le déploiement de l’être, c’est de se déclore, de s’épanouir, de ressortir dans l’ouvert du non-retrait », ce qui est justement la phusis (Martin Heidegger, « Ce qu’est et comment se détermine la phusis », trad. François Fédier, in Questions II, Paris, Gallimard, 1968, p. 165-276, ici p. 276)
[8] Cf. Pascal Ide, « La forme (animale) comme gratuite automanifestation. Adolf Portmann, Jacques Dewitte et quelques autres », Revue des questions scientifiques, 190 (2019) n° 3-4, p. 349-383.
[9] Nous verrons que Bacon a fait de la torture le modèle même de l’investigation scientifique.