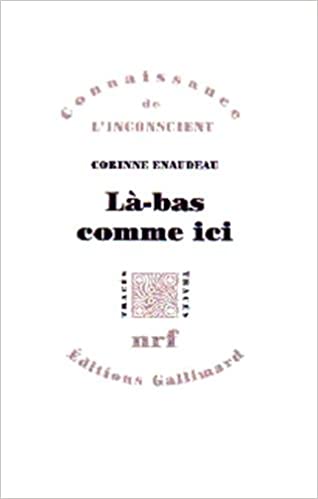Le chapitre ultime de l’essai de la professeur de philosophie Corinne Enaudeau sur le paradoxe de la représentation [1] (à commencer par celui de Diderot) se présente, à bien des égards, comme la conclusion, le résumé ou le point d’orgue de l’ouvrage.
Il est un bon condensé de l’actuel scepticisme, sur fond de déconstruction freudolacanienne. Sa thèse est synthétisée dans le titre : « Hiatus ». L’auteur l’établit en multipliant les sauts. Le plus fondamental réside dans « l’abîme entre la chose et soi », autrement dit entre l’objet et le sujet, la nature et l’esprit. Il se fonde, du côté de l’objet, sur la déhiscence kantienne entre le noumène (qui n’est pas exactement la chose en soi) et le phénomène, ou, dans le lexique actuel, entre la chose et sa représentation. Du côté du sujet, il « se répète en un autre écart » : celui résidant « entre voir et parler ». Autrement dit, entre le sensible et l’intelligible, « le senti et le conçu », ici nommé par sa médiation qu’est le dit. Or, si « l’écart du dit au vu » est « infranchissable », alors « le savoir [est] impossible [2] ». Et de citer un passage du maître-livre de Foucault : « On a beau dire ce qu’on voit, ce qu’on voit ne loge jamais dans ce qu’on dit, et on a beau faire voir, par des images, des métaphores, des comparaisons, ce qu’on est en train de dire, le lieu où elles resplendissent n’est pas celui que déploient les yeux, mais celui que définissent les successions de la syntaxe [3] ». Cette disjonction de la chose et du soi se prolonge en une « bataille » topologique entre l’ici et le là-bas, qui donne son titre au livre, c’est-à-dire « entre ce que je vois là-bas, mais ne peux dire, et ce qu’ici je dis sans le faire voir [4] ».
Que penser de cette dissidence multipliée usque ad nauseam ?
En négatif, cette cascade de ruptures engendrant des césures infranchissables est triplement criticable : en amont, parce qu’elle se fonde sur le postulat kantien que récuse l’expérience d’humble donation des choses en leur beauté et d’émerveillement suscitée par leur gratuite automonstration ; en lui-même, par rétorsion au moins pratique, parce que l’auteur de cete conclusion prétend, lui, tenir un discours transmissible, intelligible, qui nous parvient à travers des signes sensibles ; en aval, parce qu’elle fait naître une profonde désespérance dans le sens et interdit toute éthique, toute communication, tout amour…
En positif, deux points méritent d’être soulignés, voire d’être sauvés. Du côté du sujet, un refus d’abdiquer la représentation : celle-ci ne donne pas à voir « l’essence immatérielle et vraie des choses », c’est entendu ; du moins, vise-t-elle « un invisible à construire, un aspect à produire [5] ». Du côté de l’objet, et c’est la raison de la première résistance, un refus de la mainmise, de cette raison opératoire et dominatrice, qui est l’ennemi intime autant de la déconstruction française (Foucault, Deleuze, Derrida, etc.) que de la Théorie critique allemande (Horkheimer, Adorno, Habermas, etc.). Tel est le sens de la phrase : « Parce que c’est non le vrai, mais le réel qu’on cherche ». En effet, du premier, on fait « une seule copie conforme » qui engendre « l’évidence muette » de Descartes. Alors que le second qui « naît, lui, des visages qu’on lui crée [6] », est porteur d’une profondeur à jamais immaîtrisable. Ainsi, ce scepticisme peut être interprété à partir de la philosophie ontophanique du mystère. Certes, il a dissocié le fond de la manifestation, pour congédier définitivement le sens dans l’indicible. Mais elle continue à multiplier les représentations (qui, redisons-le, ne peuvent se substituer à la manifestation), donc à construire, comme pour attester la présence de cet inaccessible, voire l’espérance d’un quelque chose, ainsi qu’ose le dire la dernière phrase de l’essai : « l’aptitude au rien nous accorde quelque chose [7] ». Le discours du hiatus ou de la déconstruction devient alors une des formes contemporaines de l’apophatisme.
En constructif, enfin, j’ébaucherais un mouvement en quatre temps : le réalisme naïf ou plutôt natif qui croit à l’adéquation spontanée de l’esprit à la chose, mais sait aussi, sans l’expliciter, que cette adéquation n’épuise pas la profondeur ni de la chose ni de l’esprit, ni même du lien les unissant ; l’idéalisme triomphant qui inverse la relation la vérité en rendant la chose adéquate à l’esprit, et conduit à la catastrophe du paradigme technoscientifique omnicontrôlant ; le scepticisme déconstructeur qui, en multipliant les barrières, croit abattre la raison et la vérité, alors qu’il n’atteint que leur défiguration moderne ; enfin, après les crises antérieures peut-être nécessaires, un réalisme supérieur nullement nostalgique ou antimoderne qui, en s’émerveillant de l’autodonation réenchantée des choses, de la spontanéité intériorisante de l’esprit et enfin de leur admirabile commercium (l’harmonie orientale présentant ici une ressource inespérée), intègre tant le monisme univociste de l’idéalisme que le pluralisme équivoque du scepticisme. Si, après avoir vécu dans l’unité édénique de l’enfance, puis l’unification-domination toute-puissante de nos rêves d’adulte, nous sommes « divisé[s] de toute part [8] » lors des révoltes de milieu de vie, c’est en vue d’une synthèse inédite de la maturité sapientielle qui n’abandonne rien des membra disjecta, parce que la Vérité qui n’est qu’Amour « espère tout » et « supporte tout » et que l’Amour, en retour, « se réjouit de la Vérité » (1 Co 13,4-7).
Pascal Ide
[1] Corinne Enaudeau, Là-bas comme ici. Le paradoxe de la représentation, coll. « Connaissance de l’Inconscient. Série : Tracés », Paris, Gallimard, 1998, p. 228-234.
[2] Ibid., p. 228.
[3] Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 25. Cité Ibid., p. 229.
[4] Corinne Enaudeau, Là-bas comme ici, p. 230.
[5] Ibid., p. 231.
[6] Ibid., p. 232.
[7] Ibid., p. 234.
[8] Ibid., p. 232 et 233.