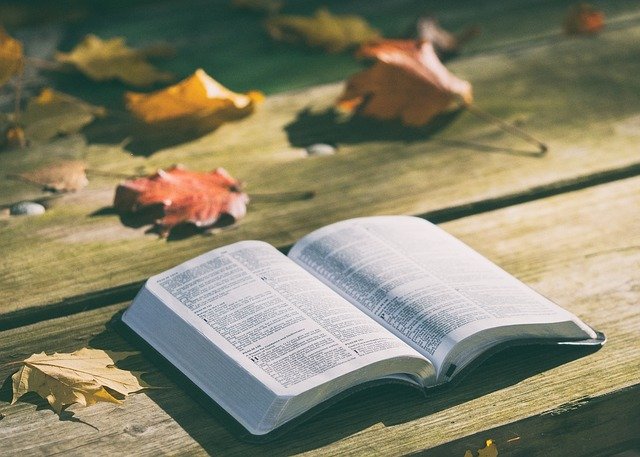Les quatre sens ne se trouvent que dans certains passages privilégiés, qui font appel à des réalités, des paroles ou des événements de grande portée. Un exemple classique est Jérusalem [1]. Celle-ci est, au sens littéral, la cité historique des Juifs ; au sens allégorique, l’Église sur Terre ; au sens moral, l’âme chrétienne ; au sens anagogique, l’Église du Ciel (la Jérusalem céleste). D’ailleurs, c’est parce que l’on a voulu appliquer cette doctrine des quatre sens à tous les passages de l’Écriture que l’on est tombé dans un allégorisme et un systématisme qui l’a discréditée.
Nous répondrons d’abord que, il est vrai, chaque passage ne renvoie pas à l’ensemble des quatre sens. Les étendre à chaque événement et chaque parole de l’Ancien Testament serait lassant, arbitraire et probablement erroné. Ensuite, en revanche, les quatre sens se retrouvent ensemble dans la totalité de l’Écriture. Enfin, certains événements, certaines paroles les contiennent. Tel est par exemple le cas de la traversée de la Mer Rouge : l’événement historique (sens littéral) préfigure la victoire du Christ sur la mort (sens allégorique), symbolise la conversion et le baptême (cf. 1 Co 10,2) (sens tropologique) et annonce l’entrée dans la vie éternelle (sens anagogique).
D’ailleurs, les Pères de l’Église et les docteurs médiévaux ont depuis longtemps fait justice de cette difficulté. Par exemple, saint Augustin qui dit de l’Écriture qu’elle est pleine du Christ, propose l’image de la lyre : tout, dans la lyre concourt au son, mais tout ne résonne pas [2]. Saint Bonaventure affine la métaphore : « Toute l’Écriture est comme une cithare : la corde inférieure ne rend pas l’harmonie [harmoniam] par elle-même, mais avec les autres ; un texte scripturaire, de même dépend d’un autre, et plus encore mille autres renvoient à un seul [3] ». Le concile Vatican II l’affirme de manière solennelle :
« comme l’Écriture Sainte doit être lue et interprétée avec le même Esprit qui l’a faite écrire, pour découvrir correctement le sens des textes sacrés, il ne faut pas donner une moindre attention au contenu et à l’unité de l’Écriture tout entière [4] ».
Henri de Lubac ajoute une précision éclairante : « L’historien […] considère chaque texte l’un après l’autre », mais le « croyant […] reçoit l’Écriture de la Tradition et la lit dans l’Église, car c’est à l’Église qu’elle fut donnée, c’est dans son sein qu’elle fut écrite, sous la dictée de l’Esprit. Il la considère donc dès l’abord comme un tout [5] ». Ainsi, c’est la totalité de l’Ancien Testament qui possède cette portée christologique et la totalité de la lettre qui renvoie à l’Esprit.
Pascal Ide
[1] Henri de Lubac donne un certain nombre d’illustrations : « Sur un vieux distique », p. 124, note 29 ; Exégèse médiévale, I-II, p. 644-645.
[2] Cf. Augustin, Contra Faustum, L. 22, chap. 94, PL 42, 463. Pour d’autres citations, cf. Henri de Lubac, « Sur un vieux distique », p. 129-132.
[3] Saint Bonaventure, In Hexaemeron, coll. XIX, 7, Opera omnia, éd. Quaracchi, 1891, tome V, p. 421, trad. Marc Ozilou, Les six jours de la création, Paris, Desclée-Le Cerf, 1991, p. 413.
[4] Concile Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique Dei verbum sur la Révélation divine, 18 novembre 1965, n. 12.
[5] Henri de Lubac, « Sur un vieux distique », p. 131.