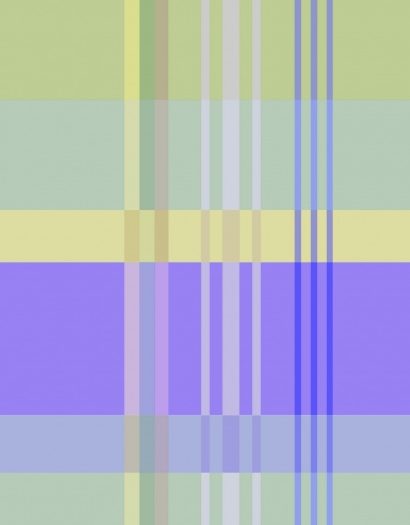4) La nature en général
La crise du fondement de la morale est donc le résultat autant que l’un des symptômes de la rupture entre liberté et nature (et, au-delà, entre liberté et vérité). Comment rétablir la jonction ? Différents chemins de réconciliation sont envisageables [1]. Je partirai des ressources inexploitées du concept de nature dont Georges Cottier disait : « Pour Saint Thomas lui-même, il s’agit d’un concept de portée analogique. Et c’est au niveau de la Physique qu’il est d’abord analysé, dans la considération des êtres matériels soumis au changement [2] ». En effet, la nature est non seulement externe mais interne à l’homme – et pas seulement au titre du corps. Après une approche plus descriptive (la nature est universelle), je proposerai une approche plus ontologique (en différentes étapes) que confirmera une analyse d’Éric Weil.
a) La nature comme donnée universelle
La nature est régulière. On ne s’en étonne pas assez. En effet, l’extraordinaire constance des phénomènes physiques n’a rien d’une évidence. Déjà James Clark Maxwell constatait cette régularité dans le monde particulaire : « les molécules sont conformes à un type constant avec une précision qui ne se trouve pas dans les propriétés sensibles des corps qu’elles constituent. En premier lieu, la masse de chaque molécule individuelle et toutes les autres propriétés sont absolument inaltérables. Deuxièmement, les propriétés de toutes les molécules de la même sorte sont absolument identiques [3] ». Même conclusion chez un chercheur actuel : « L’un des traits saillants du monde des particules élémentaires, totalement absent de notre monde habituel, est le fait qu’elles se présentent sous forme de populations d’individus universellement identiques [4] ». Or, la régularité ne peut être liée à l’individualité : un individu n’est en rien cause des traits caractéristiques d’un autre individu, surtout pour des populations immenses ; mais les atomes et les particules sont au nombre de plus de 1080 dans l’univers. Par conséquent, la nature n’est pas seulement une collection d’individus ; elle présente une cohérence. Celle-ci doit d’ailleurs s’entendre dans un sens autant synchronique (la régularité) que diachronique (l’immutabilité, la pérennité). L’observation de l’état de l’univers à des moments de plus reculés, de plus en plus proches de son commencement (le big bang) montre qu’il obéit à des lois identiques à celles qui le régissent aujourd’hui : les constantes universelles sont non seulement isotropes mais isochrones.
Si la nature est régulière, elle est intelligible. On sait combien Einstein s’en émerveillait. « La nature ne ment pas », disait Théodore Monod, le naturaliste qui s’est éteint le 22 novembre 2000 [5]. Le monde présente un sens [6]. Un jardinier me disait : « Les choses émettent : elles nous parlent. Chaque plante d’un jardin potager parle une langue différente ». C’est une manière de dire le sens immanent aux choses, leur lisibilité, leur intelligibilité non-construite. Enfin, cette intelligibilité est bonté : la nature est « bonne ». Là encore, on oublie trop combien la nature « réussit ». En effet, le plus souvent, les événements naturels se produisent et aboutissent à leurs effets au lieu de défaillir. Un signe de cette bonté, soulignée par le rédacteur du premier chapitre de la Genèse, est la beauté de l’univers [7].
Or, ces trois traits – régularité et immuabilité, intelligibilité, bonté – connotent tous l’idée d’universalité, mais différemment : la régularité dit l’extension, plus formelle ou plus extérieure, de l’universel dans l’espace et le temps ; en revanche, l’intelligibilité et la bonté disent la profondeur de l’universalité : la nature n’est pas seulement ce qui regroupe les êtres physique en fonction de certaines similitudes et régularités (que les lois expriment) ; elle exprime aussi que cette communauté se commun-ique, sous le double mode de l’intelligibilité et de la bonté, c’est-à-dire à la raison et à la volonté.
Mais en quoi consiste cette profondeur de la nature ? L’approche ontologique, proprement philosophique, va permettre de répondre à cette question. Nous allons désormais nous aider de la remarquable analyse proposée par Aristote au début du Livre II des Physiques.
b) La nature comme principe interne de mouvement
1’) La nature est une donnée première
Il existe des réalités naturelles. En effet, quelle que soit la distance séparant le monde grec du monde actuel, on rencontre chez chacun d’eux des disciplines dites naturelles (qu’il s’agisse de philosophie de la nature ou de sciences de la nature). Or, dans l’épistémologie d’Aristote, une science (par définition, démonstrative) a pour principe la définition de son objet. Voilà pourquoi le Stagirite s’interroge sur la définition de la nature. Pour autant, cela ne signifie nullement que cette définition ou que cette discipline procèdent par voie a priori, comme le demande Kant. Tout au contraire. La nature est une donnée d’expérience première, irréfutable. C’est un fait qu’il y a des êtres naturels. Le démontrer serait absurde et déraisonnable : en effet, l’existence de réalités naturelles est une évidence manifeste, sensible ; or, toute connaissance part des sens. De plus, l’argumentation devrait faire appel à des réalités moins manifestes ; or, vouloir démontrer le plus manifeste par le moins manifeste, c’est marcher sur la tête. Pour autant, précise saint Thomas dans son commentaire d’Aristote, la connaissance manifeste de la nature comme donnée première ne signifie pas un savoir de la nature de chaque chose particulière : en effet, le premier type d’approche est général et confus – quoique très certain –, alors que le second est précis et distinct. Or, la connaissance procède du commun au particulier, du confus au distinct. Par conséquent, que l’on ignore les principes animant chaque réalité naturelle n’interdit nullement d’affirmer de manière très certaine l’existence de la nature comme un fait connu par soi-même (per se notum) [8].
Mais ce que l’on ne peut déduire, on peut l’induire. Aussi cette définition de la nature s’obtient-elle par voie inductive, à partir de l’observation.
2’) La nature est liée au mouvement
Justement, qu’est-ce que l’expérience m’apprend de la nature ? Spontanément, aujourd’hui, nous identifions naturel à matériel ou sensible : un être naturel est un être perçu par nos sens. Plus profondément, l’être naturel est doué de mouvement. La caractéristique première de l’être physique est sa mobilité, celle-ci devant s’entendre au sens très général de changement, qu’il soit seulement local ou entraîne une modification intrinsèque. De fait, les sciences actuelles l’attestent : à quelque échelle que ce soit, de la particule jusqu’aux amas de galaxie, tous les êtres naturels sont en mouvement ; à quelque moment du temps que l’on se situe, depuis le Big bang, jusqu’à l’hypothétique Big crunch, qui dit nature dit mouvement ; enfin, quel que soit l’entité naturelle, depuis l’être inerte le plus apparemment passif ou stabilisé (comme un neutron) jusqu’à l’être le plus infiniment complexe, natura est in motu. La thermodynamique n’a-t-elle pas démontré la corrélation existant entre agitation, c’est-à-dire mouvement local, et chaleur ? Or, le zéro absolu (moins 273,15 degrés Celsius) n’est qu’une limite asymptotique : nul être naturel ne peut l’atteindre ; par conséquent, les enta naturalia sont toujours en agitation, au moins au plan particulaire : même le plus stable des cristaux est composé d’atomes dont les particules ne sont pas en repos.
Trois témoignages, venant de trois époques et de trois horizons différents, l’attestent. Le premier est celui d’Aristote. Pour celui-ci, la physique se distingue de la métaphysique en ce que celle-là étudie l’être en tant que mobile et celle-ci, l’être en tant qu’être.
Kant fait aussi de la mobilité la caratéristique empirique propre de la nature corporelle. En effet, la métaphysique de la nature est, pour Kant, une connaissance rationnelle des objets d’expérience que sont les êtres de la nature. Or, cette construction, pour être a priori, demande que leur objet soit déterminé et cette détermination relève d’un jugement se fondant sur ce que l’expérience donne. Mais, et voilà le point de convergence, Kant identifie cette détermination à la mobilité : « La détermination fondamentale d’un quelque chose qui doit être un objet des sens externes, devrait être le mouvement, car celui-ci seul peut affecter ces sens [9] ». En effet, Kant veut construire le concept métaphysique de matière ; or, pour lui, la matière, c’est le mobile en tant qu’il remplit l’espace, en tant qu’il se meut dans l’espace, etc. [10]
Enfin, le concept clef de la conception spéculative de la nature d’Alfred North Whitehead est « l’événement », c’est-à-dire le mouvement porteur de nouveauté. En effet, le philosophe américain contemporain définit la nature comme « ce que nous observons dans la perception à travers nos sens [11] ». Or, la nature forme un tout systématique fermé, autoconsistant à l’égard de la pensée : « La nature, en tant qu’elle se manifeste dans la perception sensible, est autoconsistante par rapport à la conscience sensible, tout en étant aussi autoconsistante par rapport à la pensée [12] ». La nature est donc constituée par un ensemble complexe « d’entités naturelles [13] », « sans référence à la conscience sensible ou à la pensée [14] ». Ces réalités sont des faits. Or, Whitehead regroupe ces faits sous le nom d’événement : « le fait ultime pour la conscience perceptive est un événement » qui est « global et total », même si nous le décomposons « en événements partiels [15] ». Autrement dit, la nature est une « occurrence totale »qui se trouve « en train de passer [16] » ; d’où le nom d’événement.
3’) La nature est principe (de mouvement)
Si déjà un Aristote faisait de l’être naturel un être mobile, combien plus aujourd’hui où notre connaissance nous assure que le mouvement règne dans les deux mondes de l’infiniment petit et de l’infiniment grand qui étaient pour eux, inertes, quoique pour des raisons différentes. Ainsi tout est en mouvement ; pour autant, tout n’est pas mouvement. Or, celui-ci requiert une origine, une source. Et c’est ce que l’on appelle la nature. Celle-ci est donc principe de mouvement.
En effet, que signifie principe ? « Le caractère commun de tous les principes, conclut Aristote au terme d’une analyse célèbre des différentes significations du terme, c’est d’être la source d’où l’être, ou la généraion, ou la connaissance dérive [17] ». Or, étymologiquement, le mot « nature », en grec (phusis) comme en latin (natura) désigne la naissance (natura est proche de nasci : naître). De là, il en est venu à exprimer la cause de la naissance. Enfin, la signification s’est élargie et, puisque la naissance est un mouvement, « nature » signifie la cause ou le principe de tout mouvement. Et, on va le voir, le principe interne de mouvement. Donc, la nature est principe de mouvement, principe s’entendant de la cause efficiente. Contrairement à l’apparence, cette définition n’a rien de nominal : elle part de la constatation universelle (qui n’est pas à démontrer, car, répétons-le, on ne démontre pas ce qui est évident) selon laquelle tout être se meut, et remonte à sa cause : il faut bien une source à son mouvement [18].
4’) La nature est (principe) intrinsèque
La nature est principe de mouvement. Mais il faut encore préciser. En effet, d’autres causes sont à l’origine de changement : la technique humaine ou le hasard. Autrement dit, certains êtres sont produits par la nature, d’autres par des causes différentes, les deux qui viennent d’être nommées. Comment se distinguent ces différents types de causalité, en particulier la nature et l’industrie humaine ?
Partons d’un exemple. Quelle raison fait que, face à une coquille trouvée sur une plage, on la dise naturelle, alors qu’on refusera cet épithète à l’écrou qui la jouxte ? [19] La réponse spontanée est la suivante : le premier n’est pas fabriqué par l’homme alors que le second l’est. Une telle réponse pose trois problèmes. D’abord, la définition est seulement négative. Ensuite, la réponse est extrinsèque : considérant la relation à la cause efficiente, elle ne dit pas ce qu’est la nature ni ce qu’est l’objet technique en lui-même. Quand j’ai dit que je possède un Van Gogh, je donne la cause du tableau non ce qu’il représente. Enfin, le critère apparaît incertain dans son application : face à un galet dépoli roulé par la vague, comment savoir s’il s’est détaché de la falaise ou s’il vient d’une tuile jetée sur la plage et usée par le frottement ?
Partons d’un autre exemple. Il est naturel à un oiseau de voler, non à un fer à repasser ou même à un avion. Pourquoi n’est-il pas naturel à l’avion de voler ? Parce que les éléments qui composent l’avion ne présentent pas cette propriété interne. C’est de l’intime même de la paramécie que lui vient son mouvement de nutrition ; il appartient à la nature même de l’oiseau de voler. Inversement, c’est par une conjonction toute accidentelle et hétérogène à la nature des éléments, plastiques, métalliques, le composant que l’avion est capable de s’arracher à la pesanteur.
L’efficience d’un corps naturel se distingue donc de celle de la technique en ce que son principe est intérieur. En regard, l’activité artisane et industrieuse n’intervient que de l’extérieur : l’artisan ne peut intervenir que de l’extérieur non pas dans un sens local – il est bien certain que le chirurgien atteint l’intérieur du corps –, mais dans un sens ontologique, dans la mesure où il ne fait que modifier un arrangement de réalités sans en rien agir sur le dynamisme qui les habite. Non seulement la pierre tombe toujours sur la terre, mais elle le fait avec une nécessité qui ne souffre nulle exception. Jamais on n’a empêché ni on ne pourra empêcher que les corps s’attirent l’un l’autre. Cette certitude est indépendante de l’état d’avancement de notre connaissance sur la nature de la force gravitationnelle qui, aujourd’hui, demeure encore mystérieuse. Même un bouclier antigravifique n’inverserait pas la loi d’attraction mutuelle des corps, il ne ferait qu’empêcher son exercice.
Que l’on se comprenne bien. Que la nature soit un principe immanent aux entia naturalia ne fait pas d’elle une réalité hypostasiée, séparée des êtres singuliers ; au contraire, elle est insérée en eux comme leur principe de mouvement. Dans le même ordre d’idées, la nature n’est pas quelque chose d’absolu, ainsi que Thomas l’affirme de manière très précise dans son commentaire (natura non est quid absolutum). Il recourt, pour le montrer, à l’étymologie de nature (et cela est vrai autant du latin que du grec) : natura vient de nasci, comme phusis de phusein ; or, naître se dit d’un être qui est engendré en étant conjoint au principe l’engendrant ; voilà pourquoi la nature est dit principe de la génération. Inversement, l’on sait combien le stoïcisme au temps des Grecs, Spinoza dans les temps modernes, la deep ecology à l’époque contemporaine, ont fait de la nature un principe autonome, intouchable, qui, dans sa version extrême, est panthéiste. Ainsi donc, pour Aristote comme pour Thomas, la nature est principe en un sens dérivé.
De manière plus générale, il convient donc d’éviter les deux conceptions symétriques dont traitait la topique : la première tend à dissoudre la nature, niant tout principe intime aux réalités matérielles, au nom par exemple de leur passivité, de leur inintelligibilité ou de leur inconnaissabilité (Kant) ; la seconde, tout au contraire, tend à absolutiser la nature, faisant de celle-ci le Principe, voire la Norme et la Référence ultime.
Le penseur danois Sören Kierkegaard disait que la nature se distingue de l’homme par son obéissance inconditionnée [20]. En regard, l’esprit humain lui donne de pouvoir se déterminer contre son Créateur. Il s’y ajoute une autre raison : « La nature, toute la création est l’œuvre de Dieu, et pourtant Dieu ne s’y trouve pas ; mais dans l’homme particulier (qui est virtuellement esprit), il y a une possibilité latente qui dans l’intériorité s’éveille au rapport avec Dieu qu’il est possible de voir partout [21] ».
Aristote l’établit à partir d’une vaste induction qui couvre les différents types de changement : « Chaque être naturel a en soi-même un principe de mouvement et de fixité, les uns quant au lieu, les autres quant à l’accroissement et au décroissement, d’autres quant à l’atération. Au contraire un lit, un manteau et tout autre objet de ce genre, en tant que chacun a droit à ce nom, c’est-à-dire dans la mesure où il est le produit de la technique, ne possèdent aucune tendance naturelle au changement, mais seulement en tant qu’ils ont cet accident d’être en pierre ou en bois ou en quelque mixte et sous ce rapport ; car la nature est un principe et une cause de mouvement et de repos pour la chose en laquelle elle réside immédiatement, par essence et non par accident [22] ». Cette dernière phrase constitue la définition – fort célèbre – de la nature.
c) La nature comme paradigme de la technique
On objectera d’abord à cette définition que nombre d’êtres naturels présentent un mouvement dont la cause est extérieure. Cela se vérifie particulièrement dans le monde inorganique : la pomme ne chute que parce qu’elle est attirée par la terre ; or, celle-ci lui est extérieure.
Il faut en fait distinguer deux sortes de principe interne (donc naturel) de mouvement. Le premier est actif et cause totale du mouvement : c’est le cas chez tous les êtres vivants. Le second est passif et donc seulement susceptible d’être mis en mouvement par un autre être : c’est le cas de tous les êtres inertes, inanimés. Reste qu’il est bien intime au fer d’être mû par la force gravitationnelle ; et cette capacité est interne à la réalité matérielle [23].
Une autre difficulté argumentera dans l’autre sens : certains objets fabriqués par l’homme présentent un principe intrinsèque d’opération. Et cela apparaît par exemple dans les plastiques synthétiques (qui présentent des propriétés nouvelles [24]) et plus encore dans les vivants réalisés par clônage ou modifiés par mutation.
En fait, l’industrie humaine intervient à titre bien réel, mais seulement dispositif : elle rassemble, ordonne les éléments qu’elle veut synthétiser ; or, cette mise en ordre obéit à des lois très précises. Loin de les créer ou simplement de les modifier, il les suppose à chaque instant et toute la difficulté (et parfois la virtuosité) de l’expérimentation gît dans ce continuel respect des multiples paramètres et des contraintes en œuvre. Par conséquent, le dynamisme des éléments constituant l’objet à construire préexiste à l’acte technique. Comme la nature est ce principe intime de mouvement, elle précède donc et fonde la poïésis humaine.
C’est ce qu’énonce le principe d’Aristote souvent villipendé car incompris : l’art imite la nature [25]. Il suffit d’en définir les trois termes pour que la juste signification en soit manifestée. Nous nous sommes déjà longuement penché sur le sens du terme « nature » ; l’ »art » s’entend ici au sens grec très général de faire ou de technique ; enfin, le verbe « imiter » exprime une parenté intime. Précisons ce dernier point, si souvent mal compris. L’imitation est souvent réduite à un mimétisme tout extérieur, donc connotée négativement. En fait, il existe deux sortes d’imitation : l’une formelle, extérieure ; l’autre en profondeur, intérieure. Or, il n’est que trop certain que la technique épouse non pas les figures dessinées par la nature mais les processus qui les ont produit. Commentant le fameuse formule d’Aristote : « L’art imite la nature », le philosophe Gilbert Romeyer Dherbey précise : « imiter, ce n’est pas copier un résultat, c’est entrer dans l’identité d’une genèse ; l’artisan retrouve dans le mouvement de sa fabrication le secret de la production des choses naturelles [26] ». Faisant appel à une distinction plus phénoménologique, Jacques Maritain précise : « Ce qui est «imité» […], écrit , ce ne sont pas les apparences naturelles mais la secrète ou transapparente réalité à travers les apparences naturelles [27] ».
L’invention de l’avion est exemplaire à cet égard. On le sait, ce sont les frères Wright et non Clément Ader qui ont découvert l’avion. Pourquoi Ader a-t-il échoué ? Son prototype, comme les engins qu’il construisit par la suite n’étaient pas viables, parce que ses schémas mentaux collaient trop à la nature : son « image de départ » était celle d’un oiseau. « Son avion s’appelait Éole, ce qui nous dit déjà le contexte mythologique ». Or, « il s’agissait de la reproduction en bambou et en toile d’un volatile, d’une chauve-souris, semble-t-il ». Clément Ader a étudié la chauve-souris dans les moindres détails du pliage, de la couture, etc. pour construire son avion III : par exemple son squelette alaire est arqué comme les os du mammifère volant. Bref, « la combinaison oiseau-moteur à vapeur n’avait pas d’avenir, c’était une recomposition sans originalité ». En regard, qu’ont fait les frères Wright ? « Ils travaillaient en mécaniciens, les mains dans le cambouis, à quelque chose de tout à fait nouveau. L’oiseau ne les intéressait pas. Ils firent beaucoup plus lourd qu’Adler, mais ils ajoutèrent un moteur à essence, dont la puissance était importante pour l’époque. […] Le 17 décembre 1903, Wilbur et Orville Wright ne réalisaient pas un «saut de puce» de quelques secondes, mais quatre vols successifs, quittant la terre, montant à une certaine altitude, atterrissant. Il sont considérés, à juste raison, comme les inventeurs de l’aviation [28] ». Or, cette invention a demandé une obéissance très précise aux lois de la pesanteur, de l’énergie chimique, etc. La démarche d’Ader illustre l’imitation comprise dans son sens extrinsèque donc infécond, celle des Wright, l’imitation au sens intérieur donc fructueux.
Le principe selon lequel la technique imite la nature – redécouvert par une discipline déjà ancienne mais encore trop marginale, la bionique [29] – est apte à fonder toute la philosophie de la technique. En effet, un juste sens de la nature permet d’éviter le prométhéisme technolâtrique tout en sauvant, en la situant, la créativité propre à l’agir ouvrier, contre la tentation symétrique, technophobe [30]. Et notre connaissance actuelle de la structure de la matière comme des possibilités de la technique, loin de contrevenir au principe d’Aristote, « ouvre » à celui-ci « une ampleur quant à ses modalités d’application, insoupçonnée des Anciens [31] ».
La mise en œuvre d’un tel principe changerait grandement le regard du médecin sur sa pratique. Elle permet de tenir le juste équilibre entre un certain exercice, violent, de la médecine allopathique – où la technique oublie le dynamisme naturel qui, pourtant, demeure la cause première de la guérison – et un certain exercice, exclusif, des médecines douces – qui ont tellement accusé la présomption technicienne qu’elles en arrivent à nier sa créativité et sa fécondité propre
À mon sens, la crise que traverse la pratique médicale – dont les problèmes considérables posés par les dépenses démesurées de santé constituent l’indice le plus criant – ne trouvera pas sa solution dans la seule humanisation, nécessaire mais symptômatique, des relations soignant-soigné, mais dans ce qu’on pourrait appeler un réenchantement de la nature et dans une guérison en profondeur du regard porté par le personnel soignant, notamment médical, sur les relations existant entre le donné originaire qu’est la personne du patient comme cause principale de santé et la technique professionnelle comme cause adjuvante [32].
d) Confirmation : le diagnostic d’Éric Weil
Le philosophe contemporain Éric Weil propose une lecture de la nature qui confirme d’autant mieux notre propos qu’elle part de la perspective actuelle – qui tend à confondre technique et nature – et qu’il est un spécialiste de l’idéalisme allemand [33].
Il prend pour point de départ la distinction entre deux sortes de nature : la nature « vécue [34] »et la nature « abstraite » des sciences [35], la première étant la nature « qui nous arrive et que nous ne faisons pas [36] »et la seconde la nature que nous transformons – autrement dit, ce que nous avons appelé ci-dessus la nature (au sens strict du terme) et l’art. Spontanément, si l’on demandait à un de nos contemporains ce qu’est pour lui la nature, il penserait à celle dont traitent et que révèlent le physicien, le chimiste, le biologiste ; or, c’est une nature caractérisée par « l’artifice », par « l’artificiel [37] » et que non seulement nous connaissons, mais que nous « dominerons chaque jour un peu plus [38] ». La technique est consubstantielle à la science : « les grands physiciens fondateurs de notre science, un Galilée ou un Descartes, furent le premier ingénieur, le second obsédé par le rêve d’une domination humaine sur la nature [39] ». Aussi considère-t-on la nature comme ce qui « doit recevoir de l’homme sa forme » ; elle n’est bonne « qu’à être employée à des fins qui ne découlent pas d’un donné qui a bien une structure de fait, mais nulle structure sensée [40] ». Notre regard sur les êtres naturels est donc mêlé au faire, à la technique.
Or, cette conception de la nature est somme toute très récente : depuis le xviie siècle « en ce qui concerne les idées » et depuis le xixe siècle « quand on songe aux faits [41] », c’est-à-dire à la mise en œuvre par la médiation de la technique. En regard, « l’idée de transformer le donné pour le dominer n’est jamais venue auc Grecs, et même leur médecine cherchait avant tout à libérer la nature des entraves, gênes, conditions contre nature que la folie des hommes avait créées [42] ». Pour le Grec, la nature est la « belle ordonnance compréhensible en elle-même, spectacle bienfaisant et bienheureux [43] ». Elle est un cosmos ; pour le moderne, elle est un univers, selon la distinction célèbre opérée par Alexandre Koyré.
Mais quelle relation précise existe-t-il entre la nature vécue et la nature abstraite ? D’abord, la différence est irréductible : nous « agissons » la nature scientifique, alors que nous « réagissons » face à la nature [44]. En effet, « la nature se trouve en face de nous, – la nature est ce qui nous englobe et soutient ; la nature est ce qui porte en soi tout ce qui vit, tout le spontané, toute notre vie et toute notre spontanéité [45] ».
Ensuite, la nature vécue comme donnée précède la nature dont parle la physique. Quelques signes parmi beaucoup : « Nous posons des questions à la nature, nous la soumettons à la torture – et elle répond. Ni le physicien, ni nous autres, nous ne nous en étonnons : nous avons tort [46] ». Un autre indice est l’uniformité des phénomènes naturels, dont il fut traité plus haut : « la nature est ce qui agit le plus souvent », aimait dire Aristote. Or « la régularité de la nature, pour reprendre la formule de la vieille métaphysique pour désigner cette bonne volonté de la nature, n’est pas de notre mérite, elle n’est pas notre œuvre, elle n’est pas due à notre technique ; au contraire, rien de tout cela ne serait possible en l’absence de son consentement tacite. Nous ne pouvons pas prouver que la nature soit ordonnée et cohérente [47] ».
Enfin, l’omniprésence, la prégnance de la nature maîtrisée rend extrêmement difficile « à concevoir notre rapport à la nature » spontanée qui est considérée comme « l’autre de l’homme ». Notre connaissance actuelle de la nature est donc aveuglée, blessée. Aussi Éric Weil n’hésite-t-il pas à dire que nous avons « refoulé » la nature au sens grec du terme, « avec les conséquences ordinaires » et gênantes « du refoulement [48] ».
À la lumière de ce constat, le philosophe français éclaire la question des rapports de l’homme à la nature. Il vaut la peine de suivre un moment son développement car il permet de comprendre l’attitude de la médecine vis-à-vis du corps humain. La relation de l’homme à la nature est sujette à la même ambivalence que celle qui vient d’être décrite à propos de la nature en général. En effet, l’homme est « l’animal qui » à la fois « n’a rien reçu de la nature » et qui « a tout reçu de la nature ». Cette situation paradoxale qui fait de l’homme « un animal distinct de tous les autres [49] » engendre une dualité d’attitudes possibles face à la nature dont on retrouve des illustrations tout au long de l’histoire : on peut « opposer la foi en le progrès de ceux qu’on appelle les philosophes du xviiie siècle français au désespoir d’un Rousseau, le progressisme des révolutionnaires et des techniciens de notre temps au pessimisme d’un Nietzsche et de ses nombreux héritiers, à moins que l’on ne préfère les observations faites à un niveau moins élevé, allant des protestations contre la société de consommation au naturisme de ceux qui sont convaincus du danger mortel des produits de l’agriculture moderne [50] ». L’optimisme technolâtre domine-t-il encore aujourd’hui le pessimisme technophobe ?
Or, la nature est à la technique ce que le corps est à la médecine
À nouveau, nous nous trouvons aujourd’hui en face de deux conceptions antinomiques et incompatibles du corps : la première, dominante, maximise l’importance de la technique et réduit l’organisme à une matière passive ; la seconde, de moins en moins minoritaire, valorise la part de la nature spontanée et suspecte la technique. Médecine allopathique versus médecines dites « douces » [51]. Dans le premier cas, l’homme se définit « comme essentiellement être de projets [52] » et se libère de toute amarre, de toute origine, de tout don qui la précède. Dans le second cas, l’homme retourne aux origines, au « lien immédiat à la Nature [53] », parfois avec culpabilité. Mais la victoire de Protagoras sur les Cyniques engendre une désespérance profonde. En effet, chaque jour, l’homme perçoit combien le projet prométhéen a échoué : « nous ne sommes toujours pas devenus immortels sur cette terre [54] » ; « je ne suis pas le maître, je suis un être d’angoisse, être fini qui ne s’est pas donné l’existence [55] ». Tous les projets buttent sur l’échec de tout projet qu’est la mort. D’où naît la tentation du « retour à la nature » qui anima le hippie, génère les grandes communautés New Age et conduit à une gnose aussi vague que prégnante. La seconde solution constitue-t-elle une redécouverte de la conception grecque ? Non. D’une part, ce retour à la nature est réactif, avec tous les risques de ressentiment si finement analysés par Nietzsche : « L’homme révolté se trouve rejeté sur la nature, il n’y est pas retourné ». D’autre part, « la nature dont parle le révolté moderne, est sa propre nature déterminée, nature de pulsions, d’instincts, de forces intérieures subies, librement subies, si l’on veut, mais aveugles : la sexualité, la violence, la jouissance immédiate au contact des choses, des êtres, des humains [56] ». Autrement dit, cette nature n’est libérée des liens tissés par l’histoire et l’institution que de l’extérieur (c’est l’immunitas a vinculo), non de l’intérieur. Or, cette position autodestructrice est « irréfutable ».
La véritable solution n’est ni une technique hors nature, ni une nature chimiquement pure de toute intervention humaine, mais la juste articulation des deux [57].
5) La nature humaine comme fondement de la morale
Même si, avec Éric Weil, nous avons commencé à traiter de l’homme, jusqu’ici, nous avons surtout considéré la nature en général. Ce substantif peut-il se prédiquer de l’homme ? Est-il possible de parler de nature humaine ? Je reprendrai les deux approches de la nature, la première plus extensive et aussi plus descriptive – la nature humaine comme référence universelle –, la seconde plus « intensive » et plus ontologique – la nature comme principe interne de mouvement. Nous serons alors à pied d’œuvre pour envisager une fondation de la morale dans la nature humaine.
a) La nature humaine comme donnée universelle
La sociologie, la littérature, les mille visages de l’esprit humain, l’expérience attestent l’existence de traits humains transcendant la diversité des lieux et des temps [58]. « Entendu, la sociologie est partie de l’anthropologie et postule l’unité (relative) de l’espèce humaine. Mais, comme la psychologie, elle voit autre chose : des psychologies différentielles de peuples et de races. Seulement, dans toutes ces psychologies collectives différentes, elle voit d’immenses ressemblances. Les musiques, les danses varient avec les peuples, les familles de peuple […]. Notre musique n’est qu’une musique. Et, cependant, il existe quelque chose qui mérite le nom de ‘la musique’. Ce n’est pas celle de notre ‘grammaire musicale’, mais celle-ci y rentre. Il en est de même de tous les grands ordres de faits sociaux ». Au-delà de pratiques comme les arts, les techniques, les sciences, il existe l’art, la technique, la science qui ne sont donc pas que des dénominations purement équivoques. Ce commun, l’auteur de ces lignes le nomme « fond humain ». Au fait, qui parle ? Le sociologue Marcel Mauss [59].
Analysant les différentes métamorphoses subies par la figure d’Antigone, George Steiner constatait un invariant : la leçon éternelle d’Antigone est qu’il existera toujours une distance entre les lois non écrites, qui sont celles de la conscience, et les décrets de Créon qui peuvent être les lois écrites et votées, et dont on sait combien elles peuvent parfois être iniques. [60] Par conséquent, la loi civile n’est pas la loi inscrite dans les cœurs ; or, le cœur est universel et la loi civile particulière.
Jeanne Hersch a dirigé un volume où sont rassemblés plus de mille fragments, provenant des cultures de tous les lieux et de tous les temps (depuis le troisième millénaire avant notre ère jusqu’à 1948) et regroupant des genres littéraires aussi variés que des écrits moraux, juridiques ou spéculatifs, des œuvres d’art (tragédie, conte, chanson) ou la sagesse populaire (les proverbes, les inscriptions funéraires) [61] ; or, elles attestent ce que Ricœur appelle « une exigence plus vieille que toute formulation philosophique », à savoir : « quelque chose est dû à l’être humain du seul fait qu’il est humain [62] ».
Contre l’opposition nature universelle et pluralité des cultures concrètes, je retiendrai, parmi beaucoup (d’autres seront développés plus bas), un argument qui joint à la démonstration – par définition universelle et abstraite – l’expérience – par définition singulière et concrète –, celle de la jonction vécue entre la culture française et la culture chinoise [63]. L’académicien François Cheng s’oppose à « cette opinion répandue », selon laquelle « toute culture forme un bloc si irréductible qu’elle serait réfractaire à la transmission par rapport à une autre culture ». Il argumente à partir du passage de la singularité de la personne à la particularité de la culture pour extrapoler – dans un a fortiori – au passage, selon lui beaucoup plus aisé, de la particularité culturelle à l’universalité humaine : « J’adhère pleinement à l’idée que toute personne est singulière, intrinsèquement unique ». Or, « paradoxalement, cette unicité de chacun ne peut prendre sens, n’est à même de se révéler et de s’épanouir que dans l’échange avec d’autres unicités, et la langue de la culture, valables pour une collectivité, ont précisément pour fonction de fixer des règles et des croyances communes, afin de favoriser cet échange et cette circulation ». Conclusion : « Puisque échange et circulation il y a au niveau d’un groupe d’hommes, pourquoi ceux-ci ne marcheraient-ils pas entre les cultures, surtout lorsque celles-ci cherchent à tendre vers une forme de vie vraiment ouverte [64] ? »
D’une commune nature humaine à une éthique universelle, il n’y a qu’un pas. C’est à elle que, pour une part, fait référence la notion de loi naturelle ou de morale naturelle. « Sans fondements universels, il n’y a pas de morale possible, disait Soljénytsine [65] ! » La nature humaine est la meilleure garantie spéculative contre le racisme. C’est ce qu’a démontré Pierre-André Taguieff dans un ouvrage remarquable qui fit parler de lui lors de sa parution [66]. « Le raciste nie qu’il existe une humanité, écrit l’une des principales figures de la philosophie anglaise contemporaine. Il entend traiter certains individus comme s’ils étaient moins que des êtres humains. Cela est contraire à la raison, qui suppose une universalité de l’idée d’humanité [67] ».
Cette éthique universelle constitue le thème d’un ouvrage de Clive Staples Lewis au titre évocateur : L’abolition de l’homme [68]. Le polémiste anglais part du constat [69] que l’homme actuel est atteint d’une maladie mortelle que l’on peut indifféremment appeler relativisme éthique, scepticisme culturaliste, subjectivisme moral. Et il en donne différents exemples (sur toile de fond à la Aldous Huxley) comme le behaviorisme de Skinner. La conséquence de ce scepticisme, dit-il, est la désespérance ; pire : l’abolition de l’homme – ce que l’on appellera la « mort du sujet ».
En réalité, continue Lewis, ce relativisme éthique est d’abord un relativisme anthropologique : l’idée d’un homme « conditionnable à merci », telle est « la racine de tous nos maux » : en effet, « elle nie l’homme dans son humanité en le niant comme sujet libre [70] ». Une autre racine est la subjectivisation du réel. Enfin, sans s’attaquer à la science comme telle, Lewis en dénonce le mésusage : « il est bien difficile de distinguer dans la démarche de la science actuelle désir de vérité et désir de pouvoir [71] ».
Pour répondre à cette vision délétère et décourageante, Lewis s’est proposé le chemin difficilior : montrer que l’humanité a toujours reconnu une Voie unique pour atteindre le bonheur, l’humanisation de l’homme [72]. Cette morale unique, de facto, il la nomme Tao [73]. En effet, « contre toute ‘évidence’ ordinaire, contre tout ce que nous avons tous répété sans y penser, […] il n’y a pas tant de relativisme que ça dans les vrais jugements moraux des hommes, et qu’on a beaucoup exagéré les différences [74] ». Depuis Descartes, le jugement de fait est le lieu de la convergence et le jugement de valeur celui du dissensus ; le fait, qui est du domaine de l’universel, assemble et la morale, qui est du domaine de l’opinion individuelle, divise. En regard, Lewis oppose tranquillement « la massive unanimité d’une raison pratique dans l’humanité ». Et l’appendice de l’ouvrage égrènera, avec bonheur, émanant des livres saints des grandes religions, des préceptes de contenu identique se rapportant aux différents grands commandements (ceux du Décalogue). On retrouve dans des écrits aussi divers que le Livre des morts ou les Préceptes de Ptahhotep en Egypte, l’hymne babylonien à Shamash, les Lois de Manou en Inde, les Entretiens de Confucius, la Bible, l’Iliade d’Homère, le De Officiis de Cicéron, les traditions des Indiens d’Amérique un équivalent de chacun des commandements du Décalogue ou de la Règle d’or (Mt 7,12). J’en relève une, presque au hasard : « On ne doit jamais frapper une femme, même avec une fleur ». Qui parlent ? Les Lois de Manou [75].
Un dernier témoignage. Un moraliste aussi attentif à la culture que Xavier Thévenot demandait « d’entendre le mot ‘naturel’ dans son sens philosophique premier qui désigne la réalité de l’homme comme homme et non pas seulement le biologique en lui ». Il défend donc clairement l’existence d’une nature humaine. Mais quel est le contenu de cette expression ? En quoi consiste, pour lui, cette « réalité de l’homme » ? « Tout homme, quelle que soit son ethnie ou sa culture, partage avec tout autre être humain quelque chose de commun, c’est ce qu’on appelle la nature humaine [76] ». La nature humaine s’entend donc ici au sens d’universel attribué à tout individu.
Cette définition de la nature par l’extension a le mérite de souligner que, au-delà de l’éclatement culturel demeure une unité. Mais cette approche ne risque-t-il pas de réduire l’universel à un invariant transculturel ? N’encourt-elle pas le risque de formalisme dont on a vu qu’il constituait le point faible des théories de Beauchamp et Childress ? Afin de ne pas sombrer dans le nominalisme, ne faut-il pas la doubler d’une définition par l’intention, la compréhension, c’est-à-dire la profondeur ? Par ailleurs, on se demandera si l’on peut affirmer un tel sens de l’universel sans référence à un principe transcendant. il faut « vivre comme si Dieu fondait le sens de notre existence », dit Taguieff cité ci-dessus [77]. Ce point laissant intacte la question, différente, d’une fondation théologique des Droits de l’homme issus d’une tradition laïque.
b) La nature humaine comme inclination originaire
En quoi consiste cette nature identique en chaque individu humain ? Nous avons vu ci-dessus que la nature se disait d’un principe interne, inné et ineffaçable, de dynamisme. Or, qui dit dynamisme dit mouvement orienté vers une fin. Voilà pourquoi Thomas d’Aquin affirme (au nom de la raison et non de la foi) : « La fin est déterminée, pour l’homme, par la nature [78] ». D’où la question : l’être humain hérite-t-il d’un certain nombre de grandes orientations ? et si oui, quelles sont ces finalités ?
Dans son traité De officiis [79], le philosophe romain Cicéron distingue trois grands types de tendance naturelle : a) les premières sont communes à tous les êtres vivants : protéger sa vie, éviter ce qui est nuisible, se nourrir, se loger, etc. ; b) les secondes sont communes aux seuls animaux : l’union sexuelle en vue de la génération et le soin des enfants ; c) les troisièmes sont propre à l’hommes : l’inclination à la vie en société, nécessaire pour mieux subvenir aux besoins humains et assurée notamment par la communication langagière [80] ; l’inclination à la recherche de la vérité, sans laquelle il n’y a pas de vie heureuse ; l’inclination à l’ordre, au convenable, au beau, en un mot à la vertu morale, l’honestas, qui elle-même se répartit en quatre vertus principales ou cardinales.
Dans une perspective chrétienne, S. Thomas d’Aquin a lui aussi proposé une systématisation riche de suggestion [81]
À la question : « Quels sont les préceptes de la loi naturelle ? », sa réponse fonde ces préceptes sur les grandes inclinations présentes dans l’homme. Lisons le passage central de sa réponse. L’Aquinate montre d’abord que le tout premier principe de la morale, autrement dit le premier précepte de la loi naturelle, est de rechercher le bien (et son corollaire : éviter le mal). En effet, l’action humaine se caractérise par son orientation vers une fin : personne n’agit jamais que vers un but ; or, la fin a raison de bien, car celui-ci est ce que toutes choses désirent ; voilà pourquoi l’inclination première, fondatrice, de l’homme est la propension au bien, celui-ci devant s’entendre au sens le plus général du terme.
Thomas différencie ensuite les biens à poursuivre, donc les préceptes à accomplir, en fonction des différentes finalités principales de l’être humain : « Parce que le bien a raison de fin et le mal raison du contraire, il s’ensuite que l’esprit humain saisit comme des biens, et par la suite comme digne d’être réalisées toutes les choses pour lesquelles l’homme a une inclination naturelle ; en revanche, il envisage comme des maux à éviter les choses opposées aux précédentes. C’est donc selon l’ordre même des inclinations naturelles que se prend l’ordre des préceptes de la loi naturelle.
- En premier lieu, en effet, se trouve dans l’homme une inclination à rechercher le bien correspondant à sa nature, en quoi il est semblable à toutes autres autres substances, en ce sens que toute substance recherche la conversation de son être, selon sa nature propre. Selon cette inclination, ce qui assure la conservation humaine et tout ce qui empêche le contraire, relèvent de la loi naturelle.
- En second lieu, se trouve dans l’homme une inclination à rechercher certains biens plus spéciaux, conformes à la nature qui lui est commune avec les autres animaux. Ainsi appartient à la loi naturelle ce que la nature enseigne à tous les animaux, par exemple l’union du mâle et de la femelle, le soin des petits, et les choses semblables.
- En troisième lieu, se trouve dans l’homme une inclination vers le bien conforme à sa nature d’être raisonnable, nature qui lui est propre ; ainsi l’homme présente une inclination naturelle à connaître la vérité sur Dieu et à vivre en société. En ce sens, appartient à la loi naturelle tout ce qui relève de cette inclination : par exemple que l’homme évite l’ignorance, qu’il n’offense pas ceux avec il doit vivre, et toutes les autres qui concernent cette inclination [82] ».
La ressemblance entre les classifications thomasienne et cicéronienne est frappante ; on s’étonne d’ailleurs que le Docteur angélique, toujours prompt à indiquer ses sources, ne cite pas le moraliste romain. Mais, quelle que soit la continuité et donc l’enracinement dans le texte suscité, on ne peut nier l’originalité de la typologie thomasienne.
Systématisant l’enseignement de Thomas, le père dominicain Servais Pinckaers estime que celui-ci distingue cinq grandes inclinations : 1. l’inclination au bien ; 2. l’inclination à la conservation de l’existence ; 3. l’inclination à l’union sexuelle et à l’éducation des enfants ; 4. l’inclination à la connaissance de la vérité ; 5. l’inclination à la vie en société [83].
En fait, la lecture attentive du texte de l’Aquinate montre que l’interprétation du moraliste fribourgeois, pour être attentive à l’essentiel de l’intention thomasienne, à la fois systématise trop et n’honore pas assez la richesse du texte. Précisément, cette herméneutique est critiquable à au moins quatre titres :
- La seule distinction clairement énoncée par Thomas est tripartite : les inclinations communes à tous les êtres, commune aux animaux et propres à l’homme ; d’ailleurs, ce principe de distinction porte en lui-même sa propre critique : en effet, se fondant sur le principe selon lequel l’homme est un microcosme portant l’univers et plus que lui (puisqu’il le dépasse par son esprit), on aurait très bien pu répartir les inclinations selon les différents degrés d’être, ajoutant aux trois précédents ce qui est commun aux vivants (les biens et fins des puissances végétatives). Or, ces inclinations physiologiques ne sont pas de peu d’importance – on les range usuellement parmi les besoins comme celui de se nourrir.
- Ensuite, Thomas manque de cohérence. Il place l’union du mâle et de la femme dans les inclinations animales. Or, chez les êtres infrarationnels, cette union a pour finalité la procréation qui est un bien physiologique, quoiqu’il présente une originalité animale (cela est aussi vrai d’autres propensions proprement végétatives et qui adoptent une modalité proprement animale comme le besoin de sommeil).
- Par ailleurs, Thomas ne place pas l’orientation vers le bien dans ces trois distinctions, mais à part dans le précepte clé gouvernant tout l’ordre de la raison pratique.
- Enfin, au sein de chacun de ces genres d’inclination, les listes, loin d’être exhaustives, sont suivies d’un « etc ».. C’est ainsi que les biens propres à la vie animale ne sauraient se résumer à la seule union et procréation ; chaque sens, interne et externe, présente une inclination vers son bien propre ; de même les affectivités concupiscible et irascible. Il est donc regrettable que le moraliste de Fribourg clôture une liste que l’auteur de la Somme de théologie garde expressément ouverte. Si l’on épouse le principe de la distinction et non pas la vétusté de la lettre, on pourrait par exemple se demander s’il ne faudrait pas ajouter une inclination à la sécurité, au beau, à la créativité (l’imagination), à la fécondité, au don de soi, etc. [84] Dans le même ordre d’idées, on notera que Thomas d’Aquin parle explicitement d’une orientation vers Dieu (par la médiation de la recherche de la vérité), ce que le Père Pinckaers met entre parenthèses. Mais ce desiderium Dei déborde largement la seule recherche du vrai (videndi Deum) ; elle est présente dans tout désir conséquent et non vain ; on est donc en droit de se demander s’il ne faudrait pas ajouter à la liste une orientation de l’être humain vers Dieu (desiderium naturale).
Quoi qu’il en soit des précisions, des prolongements, des perfectionnements que cet article de Thomas d’Aquin non seulement permet mais semble encourager – et je pense ici à un certain nombre de riches acquis en ethnologie, sociologie, psychologie, etc. [85] –, il souligne en tout cas quatre points essentiels pour notre sujet : 1. l’existence d’inclinations naturelles en l’homme ; 2. la raison de leur existence et de leur distinction dans la structure de l’être humain [86] ; 3. le fondement de toute l’éthique dans ces inclinations premières, donc l’enracinement de la morale dans l’anthropologie, c’est-à-dire une vision adéquate de la nature de l’homme ; 4. enfin, de même que la nature est un art divin, de même les inclinations naturelles renvoient à un fondement méta-physique dont on a vu qu’il faisait défaut à l’approche seulement extensive de la nature humaine.
c) Réponse à une difficulté
Nous avons tenté de montrer que la notion de nature humaine présentait encore une validité. Le prochain paragraphe permettra d’affronter les deux principales objections qui lui furent opposés : anhistoricité et monolithisme violent. Disons ici un mot de la troisième difficulté, la polysémie à la limite de l’ambiguïté du mot « nature ».
Dans l’expression « nature humaine », celui-ci ne s’entend pas du seul esprit, des seules inclinations spirituelles ; la « nature » comme source de prescription ne se réduit pas à la seule conscience et à la seule raison. Qu’elle englobe la totalité somatopsychique de l’homme se déduit de la notion d’inclination naturelle. En effet, nous avons vu que celle-ci s’enracinait dans les finalités inscrites dans l’être humain ; or, celui-ci est un univers en raccourci, sans qu’il soit cependant possible de l’y réduire [87] ; par conséquent, le moraliste est appelé à déchiffrer les grandes propensions humaines autant dans l’ordre proprement rationnel que dans l’ordre corporel (par exemple, la connexion entre union et procréation, inscrite dans la structure de la sexualité). L’enseignement de l’Église ne laisse nul doute sur ce point : « La loi morale naturelle exprime et prescrit les finalités, les droits et les devoirs qui se fondent sur la nature corporelle et spirituelle de la personne humaine. Aussi ne peut-elle pas être conçue comme normativité simplement biologique, mais elle doit être définie comme l’ordre rationnel selon lequel l’homme est appelé par le Créateur à diriger et à règler sa vie et ses actes et, en particulier, à user et disposer de son propre corps [88] ». Il est d’ailleurs significatif que Richard Gula dénomme les deux interprétations de « la nature », « selon la nature » et « selon la raison droite », cette opposition réintroduisant un dualisme dont on espérait qu’il fût congédié et que l’auteur se permet de déchiffrer jusqu’à l’intérieur des documents magistériels, au risque d’oublier la continuité de leur enseignement.
6) L’assomption de la nature humaine dans la personne
Les grandes inclinations naturelles constituent la première pile du pont joignant l’être humain et l’agir moral ; mais elles ne sauraient suffire à fonder le discours et la pratique éthique. Une seconde pile doit honorer la dimension proprement historique, libre, spirituelle de l’homme. Si nous avons – brièvement – pris nos distances à l’égard d’un constructivisme intégral, nous ne sacrifions pourtant pas aux mânes naturalistes. En effet, l’homme est habité par un dynamisme naturel, mais il n’atteint sa dignité plénière qu’au titre de personne assumant ces données originaires. Voilà pourquoi Jean-Paul II dans le passage déjà cité où il traite des inclinations naturelles, affirme aussi que celles-ci « ne prennent une qualité morale qu’en tant qu’elles se rapportent à la personne humaine et à sa réalisation authentique qui, d’autre part, ne peut jamais exister que dans la nature humaine [89] ». Comment penser cette assomption ?
Je ferai appel à deux types d’approche, parmi d’autres. La première se fondera sur les catégories de la métaphysique traditionnelle, puissance et acte, mais revisitées de manière inattendue par un biologiste darwinien, afin de répondre de manière homogène aux objections des naturalistes ; la seconde, plus actuelle, puisera dans les ressources d’une métaphysique du don encore à l’état d’ébauche.
a) Dans la perspective de la puissance et de l’acte. Approche philosophique
Dans la perspective thomasienne adoptée ci-dessus, l’inclination naturelle ne constitue qu’un point de départ. En effet, elle demeure très indéterminée, vague, confuse : elle désigne une ouverture, en termes techniques, un objet formel ; mais l’objet formel spécifie l’objet matériel, il ne le détermine pas. Que l’œil soit fait pour le visible ne dit rien des réalités colorées qu’il verra. De plus, l’inclination oriente la personne vers une finalité, mais elle n’indique pas les chemins pour s’y rendre. Que la personne, par son intelligence, soit ordonnée au vrai, ne dit rien des différents champs de connaissance à explorer. Or, la puissance est à l’acte ce que l’imparfait est à l’achevé, donc ce que l’indéterminé est au déterminé, ce que le point de départ est au terme finalisateur. Voilà pourquoi la relation des inclinations naturelles à la culture et à l’histoire élaborée par la liberté se comprend en termes de puissance et d’acte – ou, dans un registre plus personnaliste : promesse et accomplissement. Or, l’éthique est la discipline qui étudie l’agir humain. Celui-ci se déploie dans la distance séparant l’homme de l’humanisé, ce qu’il est de ce qu’il veut et doit être. Par conséquent, la loi éthique trouve sa source dans ces potentialités, ces ouvertures que sont les inclinations naturelles, à charge pour elle d’indiquer à l’esprit comment les orienter vers leur achèvement.
Pour autant, cette relation ne doit en rien se concevoir de manière déductive ou déterministe, autrement dit naturaliste. Il y va non seulement de notre liberté, donc de notre dignité d’être responsable, mais de notre créativité, de notre capacité d’engendrer du sens nouveau. En effet, l’actualisation de nos inclinations fait appel à nos facultés spirituelles : l’intelligence, notamment la conscience (pour les discerner et les explorer) et la volonté (pour y consentir et les éduquer). Par exemple, il relève de notre intelligence et de notre volonté d’accueillir, de déchiffrer et d’apprivoiser nos tendances sexuelles [90]
À noter que la philosophie thomasienne possède d’autres ressources pour préciser la relation entre inclinations naturelles et reprise personnelle par la raison et la liberté, donc la fondation de l’éthique dans la nature humaine : la distinction de l’ordre d’exercice et de l’ordre de spécification [91]. On comprendra mieux le jeu des puissances spirituelles avec le second type de relation exposé plus bas. Pour l’instant je vais faire appel à une confirmation inattendue de notre thèse, sous la plume d’un célèbre biologiste, historien des sciences et vulgarisateur : Stephen Jay Gould.
b) Dans la perspective de la puissance et de l’acte. Confirmation actuelle
Le fameux biologiste et historien des sciences Stephen Jay Gould se prononce en faveur du fondement biologique d’une nature humaine. Certes, explique-t-il, nous « faisons inextricablement partie de la nature » : « L’unité entre les humains et tous les autres organismes dans l’évolution est le principal message laissé par la pensée darwinienne à la plus arrogante des espèces de notre globe ». Il demeure qu’affirmer cela « ne nie pas pour autant le caractère unique des humains [92] ». Mais qu’est-ce qui fonde la spécificité de notre espèce ? Pour répondre à cette question, Gould va prendre position dans le difficile et polémique débat entre innéistes (pour lui représentés par les défenseurs de la sociobiologie) et environnementalistes.
L’inventeur de la théorie gradualiste de l’évolution prend d’abord ses distances à l’égard de la sociobiologie et de son déterminisme. Les partisans de celle-ci ont tenté de découvrir un fondement génétique à l’agressivité, la xénophobie, le conformisme, l’homosexualité, voire à l’ascension sociale. Pourtant, estime Gould, la plupart de nos comportements s’expliquent par des raisons non pas génétiques, mais culturelles. Il cite le propos d’un anthropologue américain de l’université Cornell montrant que les stratégies optimales de chasse et de cueillette chez le peuple Cree du nord de l’Ontario, certes, suit pour une part les modèles biologiques, mais « une fois que la décision d’aller chasser a été prise [93] ». Or, la décision est un acte de liberté irréductible aux conditionnements biologiques.
Mais Gould n’est pas plus en accord avec un spiritualisme qui affirmerait « que la biologie n’a rien à nous proposer pour nous guider dans notre quête d’une meilleure connaissance de nous-mêmes [94] ». Il est par exemple évident que le cerveau est le fondement biologique de nos activités intellectuelles et donc de la culture. « Les hommes sont des animaux et tous nos actes sont accomplis, en un certain sens, sous la férule de notre biologie. Certaines contraintes font tellement partie intégrante de notre être que nous nous en rendons rarement compte, car jamais il ne nous viendrait à l’idée que la vie puisse se dérouler autrement. Prenons par exemple l’étroite variabilité des tailles moyennes des adultes et les conséquences qu’entraîne le fait de vivre dans le monde gravitationnel des organismes de grandes dimensions et non dans celui des forces superficielles habité par les insectes ». De même, notre incapacité à la photosynthèse, notre mode de digestion, etc., toutes « ces caractéristiques sont dues à notre édifice génétique et toutes exercent une forte influence sur la nature humaine et sur la société [95] ».
Comment dirimer le débat ? Gould propose de distinguer le déterminisme de la potentialité. Wilson lui-même constate que les personnes et les peuples sont parfois violents et parfois non. Or, une conception innéiste et génétique est déterministe ; autrement dit, un gène de la violence devrait systématiquement engendrer la guerre. « Ce n’est donc pas l’agression elle-même qui est codée dans nos gènes [96] ». Mais ce qui parfois est et parfois n’est pas mais peut être, en un mot, ce qui est contingent, s’enracine dans une potentialité. Par conséquent, à côté d’un principe de détermination (génétique), il existe en l’homme un principe de potentialité. De manière plus générale, « la variété des comportements » humains qui « est impressionnante […] apporte un bon témoignage de cette flexibilité qui est la caractéristique spécifique du comportement humain ».
Aussi Gould note-t-il que la différence entre sa thèse et celle la sociobiologie n’est pas seulement de degré, mais de nature. Dans la théorie sociobiologique, les actes dépendent étroitement – c’est-à-dire en leur essence – du substrat biologique ; leurs caractères spécifiques sont commandés par les gènes. Selon cette conception, « la sélection établit bien des lois constitutives à un niveau très profond mais […] les comportements spécifiques sont des épiphénomènes de ces lois et non des objets dignes de l’attention darwinienne [97] ». Gould se fonde donc implicitement sur une vision anthropologique non pas moniste, mais duelle : de l’aspect naturel, corporel, biologique, il faut distinguer un autre aspect, irréductible et régi par des lois différentes : on le qualifiera de culturel.
Pour être deux, ces aspects ne sont pas moins coordonnés et constituent un être unifié. Comment concevoir leur corrélation ? On l’a vu : Gould renoue avec la conception aristotélicienne de puissance, jusque dans la terminologie. La notion de potentialité lui permet d’articuler, voire de réconcilier le naturel et le culturel – et, pour nous, l’éthique. En effet, la flexibilité humaine vient du cerveau : « Qu’est-ce que l’intelligence sinon l’aptitude à résoudre les problèmes de façon non programmée (ou comme nous disons souvent, créatrice) ? » Or, le cerveau est ouvert à tous les possibles : contrairement aux autres organes (le système immunitaire mis à part), sa spécialité est la généralité. Gould précise encore cette notion de flexibilité et de potentialité en rappelant combien l’homme est un animal néoténique [98] : « c’est à perpétuité que nous sommes des enfants, et cela en un sens qui n’est pas seulement métaphorique [99] ». Voilà pourquoi il qualifie de larmarckienne l’évolution culturelle (puisqu’il y a hérédité des caractères acquis), l’évolution biologique étant davantage de nature darwinienne.
Par conséquent, la différence entre les trois positions – celle de la sociobiologie, celle du culturalisme et celle de Gould – recouvre la distinction métaphysique existant entre acte (déterminisme), privation (absence) et puissance [100]. Dès lors, inné ne signifie plus actuellement déterminé, mais potentiellement déterminé, ce qui change tout : « si inné ne signifie que possible, ou même probable dans certains environnements, alors tout ce que nous faisons est inné et le mot n’a plus de signification [101] ».
c) Dans la perspective du don
Les explications ci-dessus font appel aux catégories de la métaphysique traditionnelle : entre autres, puissance, acte, nature. J’aimerais la compléter par une autre perspective, prenant en compte une sensibilité plus actuelle : celle du don [102]. Dans son sens courant, mais aussi dès sa première attestation vers 980 [103], celui-ci – par exemple, dans la locution usuelle « faire don » – désigne l’action d’abandonner gratuitement quelque chose à quelqu’un. Par métonymie, il s’applique à ce qui est donné. Le don présente donc deux significations : une active, l’acte de donner ; l’autre passive, le don reçu, le cadeau. Le latin possède d’ailleurs deux termes différents pour exprimer cette dualité de sens : donum (actif) et datum (passif).
Or, si le premier principe (le Bien en soi) n’est que diffusion de soi, autocommunication, en revanche l’étant fini reçoit son être avant de le transmettre. Par conséquent, du point de vue de l’Absolu, le donum précède le datum, mais du point de vue de l’être créé, le recevoir fonde le se-donner.
Tel est, très brièvement résumé, le fondement métaphysique de la nature comme principe intime de mouvement. Si la créature en général et l’homme en particulier, sont doués d’une nature, c’est parce qu’ils ne se sont pas donnés l’existence ; par ailleurs, celle-ci, loin d’être pure relation à sa source, est douée d’une consistance ; mais cette autonomie se vérifie, se manifeste dans l’ordre de l’agir ; plus encore, l’étant atteste son origine transcendante par le dynamisme qui le soulève et le fait participer à son principe, non seulement dans son être mais dans son rayonnement. Voilà pourquoi, dans une formule justement célèbre, Thomas affirme que « la nature est un art divin inscrit dans les choses [104] ». Les inclinations naturelles sont comme des traces (pour parler comme Levinas) ou des vestiges (pour parler comme saint Augustin) de leur origine supraphysique.
Par ailleurs, ce dynamisme naturel, loin de faire violence à la créature jaillit de son cœur intime ; il est reçu à la mesure de l’être qui l’accueille, selon le mode propre de l’étant qu’il meut. Cela est tout particulièrement vrai de l’homme qui est appelé à s’approprier, c’est-à-dire à faire sien, tout ce qui lui est donné par son intelligence et sa volonté.
Par conséquent, entre l’être et la nature passivement reçu et l’activité exercée par l’étant, entre datum et donum, se trouve un moment intermédiaire qui témoigne de son autonomie. Toute créature est donc portée par un rythme à trois temps : réception, appropriation et donation. Par exemple, avant d’engendrer, l’homme doit être conçu puis assimiler et croître, autrement dit s’approprier, faire sienne la vie reçue. Or, chacun de ces moments porte l’empreinte du don. Ainsi celui-ci obéit à une dynamique à trois moments : 1) le don reçu, 2) le don approprié, 3) le don offert – le moment postérieur se greffant sur le moment antérieur.
Appliquons la dynamique du don à la question du fondement naturel de la morale. La vérité et l’erreur, symétrique, unilatérale, des positions constructiviste et naturaliste apparaissent sous un jour nouveau : le constructivisme honore le dynamisme du second moment mais manque le moment du don originaire ; tout à l’inverse, le naturalisme souligne l’enracinement dans le premier moment mais efface trop l’appropriation. Voilà pourquoi ces deux regards peinent à comprendre le troisième moment qu’est le don désintéressé de soi. Dès lors, on doit affirmer que la nature (humaine) fonde la morale si et seulement si elle est appropriée, humanisée, orientée par l’esprit de l’homme, en conformité avec les orientations inscrites en elle.
Une dernière question pourrait se poser : comment s’opère ce travail d’humanisation, de moralisation ? Ce point fut évoqué plus haut à propos de la médiation de l’esprit et de l’ordre d’exercice. La morale antique et médiévale, mais aussi, tout récemment, certains moralistes contemporains répondent : par le travail de la vertu [105]. Celui-ci fait passer de l’inclination naturelle à l’acte pleinement moral qui l’assume et l’accomplit.
d) Réponse à deux difficultés
Que la liberté, loin de s’opposer aux inclinations naturelles, universelles et immuables, présentes en l’homme, mais les assument, les approprient et les actualisent suffit à réfuter la coupure entre nature et esprit dont il était question dans le premier paragraphe, ce conflit se présentant sous la double figure universalité-diversité, immuabilité-historicité.
Nous avons montré que, quelle que soit la situation particulière et historique des normes et des habitudes, celles-ci ne sauraient nier l’existence d’inclinations universelles objectivées dans des règles elles-mêmes communes. Ni en droit – il fut rappelé que l’existence d’une loi naturelle permet de relier les hommes entre eux –, ni en fait – la loi naturelle, avant d’être un énoncé objectif est une réalité subjective, la « lumière de l’intelligence mise en nous par Dieu », « donnée à la création », donc à tout homme, pour que « nous connaissions ce qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter [106] ».
En revanche, une fois affirmée le fait de la coexistence de la particularité culturelle et de l’universalité d’une éthique fondée sur les inclinations naturelles et pensée leur relation en termes de puissance et d’acte ou d’appropriation, il demeure au moins deux questions portant sur la mise en œuvre de cette articulation théorique et donc de l’effectivité d’une morale en situation. La première est celle de l’évitement de la violence secrète d’un discours et d’une pratique prétendument communs alors qu’ils ne sont que l’universalisation d’une particularité ethnocentrique, par exemple européocentrée. Répondre à cette question requiert un discernement toujours à reprendre et sera grandement aidé par une véritable expérience interculturelle, autrement dit par un chemin intérieur d’arrachement à son particularisme sans renoncement à sa particularité vers un universel prégnant de cette richesse régionale [107]. On sait que l’ouverture à l’universel qui ne s’opère pas sur les décombres des particularités gît le défi de la mondialisation-globalisation. La seconde est celle de la concrétisation de cette ouverture à l’Autre qu’implique la morale naturelle. Autre, en effet, l’universel prescriptif dont il a jusque ici été question, autre chose l’universel vécu qu’est l’amour de tout homme, surtout celui qui présente une réelle différence avec soi (culturelle, religieuse, etc.). Or, voici plus de soixante-dix ans, Henri Bergson nous donnait une leçon, que l’inflation d’un discours sur les Droits de l’homme, nécessaire mais tenté par l’utopie et régulièrement violé par les faits, gagnerait à relire : « On se plaît à dire que […] notre sympathie s’élargirait […] par un progrès continu », allant de la famille à notre culture, « grandirait en restant la même, et finirait par embrasser l’humanité entière. C’est là un raisonnement a priori, issu d’une conception purement intellectualiste de l’âme. […] Mais entre la société où nous vivons et l’humanité en général, il y a […] le même contraste qu’entre le clos et l’ouvert ; la différence entre les deux objets est de nature, et non plus simplement de degré [108] ».
7) Conclusion
Fonder la morale – partiellement – sur la nature (humaine) fait aujourd’hui craindre le pire. Outre les objections relevées au début de l’article, on soulignera à juste titre que le terme est des plus polysémiques ; pire, sa signification change d’un auteur à l’autre. Et si cette diversité présentait un sens ? « S’il en est ainsi – explique le cardinal Cottier – c’est que la nature appartient au champ des expériences premières de l’homme [109] ». Le philosophe français contemporain Michel Henry notait que le concept de nature demeure toujours imparable, incontournable, malgré la sécularisation du monde et de la métaphysique, la disqualification de la nature objective et l’innovation considérable que constitue l’art abstrait, engendrant la conception d’un art comme libre produit et expression de la subjectivité déliée de toute attache hétéronomique [110] – il faudrait ajouter la confusion entre nature et technique : « L’ethos prométhéen qui a accompagné son prodigieux essor a empêché la perception exacte de l’essence de la technique moderne. On a vu dans la technique un moyen et une preuve de l’affirmation du pouvoir de l’homme, ce pouvoir étant censé se manifester contre la nature [111] ».
Dès lors, la question véritable est celle-ci : si nous ne pouvons nous passer du signifiant « nature », à quel signifié renvoie-t-il ? Nous ne parlerions pas de la nature si nous n’en avions pas tous une conception, ou plutôt une expérience au moins implicite. Quand le lecteur de ces lignes pense au terme « nature », à quel vécu est-il renvoyé ?
Le premier enjeu de l’article était de revisiter, voire de corriger, avec l’aide d’Aristote, le contenu de la nature : celle-ci est un principe interne de dynamisme qui précède et fonde toute activité humaine ; plus largement et plus profondément, elle est le témoignage caché mais très assuré de l’enracinement de toute créature dans une source transcendante qu’on a osé appeler art divin.
Ayant ainsi conjuré les risques du constructivisme, nous avons ensuite tenté d’en honorer les requisit, et là s’inscrit le second enjeu : les grandes inclinations, ouvertures naturelles de l’homme ne peuvent fonder l’éthique que si, selon les différents registres sémantiques déployés ci-dessus, elles sont actualisées, exercées et appropriées.
Mais le plus urgent demeure aujourd’hui de retrouver le sens originel et originaire de la « nature ». On ne pourra guérir de notre vision gravement erronée de la phusis, dit le philosophe Martin Heidegger, que si l’on sait lire les « traces de l’ouverture » du sens de la phusis « dans les fragments des paroles des penseurs initiaux [112] ». Notre article commençait par une parole d’Héraclite. J’aimerais le conclure par un autre fragment du penseur présocratique que cite justement Heidegger au terme de son passionnant commentaire du chapitre consacré par Aristote à la phusis : « La nature aime se cacher [113] ».
Pascal Ide
[1] Pour Robert Spaemann, la réponse est la vie. En effet, le propre de la vie est de conjuguer l’extériorité et l’intériorité. A Thomas d’Aquin qui affirme : « Qui non intelligit, non perfecte vivit » (In X Ethicorum ad Nicomachem, L. IX, l. 11, n. 1902), Robert Spaemann ajoute : « Qui non vivit, non perfecte existit », joignant ainsi penser, vie et être (Personen. Versuch über den Unterschied zwischen « etwas » und « jemand », Stuttgart, Klett-Cotta, 1996, p. 80). Mais il manque cruellement aujourd’hui une philosophie de la vie : « Je crois, explique Robert Spaemann dans une interview qu’il a donnée à un étudiant faisant une thèse sur sa pensée et que celui-ci reproduit en fin de son travail, que […] le problème de notre civilisation consiste en une dialectique du naturalisme et du spiritualisme. D’un côté on conçoit le monde, toutes les choses y compris les hommes comme des objets, des objets purement matériels qu’on peut manipuler, qu’on peut comprendre comme des objets. De l’autre côté il y a l’intériorité : l’expérience, le sentiment, la pensée, la manière que l’homme a de se comprendre lui-même comme intériorité. Il n’y a pas moyen, dans la pensée moderne, d’intégrer ces deux perspectives. […] Ce qu’on a perdu à partir de Descartes c’est la notion de vie. La vie est intériorité et extériorité en même temps. Chez Platon déjà, et après chez Plotin aussi, vous trouvez toujours ces trois étapes de la réalité : être, vivre et penser. Chez Descartes vous ne trouvez plus que la pensée et l’extériorité ; mais la notion de vie […]. Il faut bien comprendre le mot d’Aristote : vivere viventibus esse (cf. De l’âme, L. II, ch. 4, 415 b 13). L’être de la personne n’est pas d’abord pensée mais vie. Si vous me demandez ce que je considère comme thème prioritaire de la recherche philosophique, je dirais qu’au fond c’est la notion de vie ». (Paulin Sabuy Sabangu, Nature, raison et personne. Une approche anthropologique d’après Robert Spaemann, Thèse pour le Doctorat de Philosophie, Faculté de philosophie de l’Université Pontificale de la Sainte Croix, Rome, 1998, p. 272-273)
[2] Georges Cottier, « Le concept de nature chez saint Thomas », Coll. édité par Marcello Sanchez Sorondo, Physica, cosmologia, Naturphilosophie. Nuovi Approcci, coll. « Dialogo di Filosofia » n° 10, Rome, Herder, Università Lateranense, 1993, p. 37-64, ici p. 37. Même propos à la fin : « C’est au niveau de la Physique d’Aristote que saint Thomas rencontre l’idée de nature, dont il saisit aussitôt la portée métaphysique et la richesse analogique ». (p. 63-64)
[3] Cité dans Les atomes. Une anthologie historique, textes choisis, présentés et annotés par Bernadette Bensaude-Vincent et Catherine Konnelis, coll. « Agora. Les Classiques », Paris, Presses Pocket, 1991, p. 199-200.
[4] John Barrow, La grande théorie. Les limites d’une explication globale en physique, trad. Michel Cassé, Loïc Cohen et Guy Paulus, Paris, Flammarion, 1996, p. 246.
[5] Propos entendus au journal de 20 heures, le même jour, sur France 2.
[6] M. Espinoza, Essai sur l’intelligibilité de la nature, Toulouse, Ed. Universitaires du Sud, 1987.
[7] Que l’on songe au succès de l’ouvrage de Yann Arthus-Bertrand, La Terre vue du ciel, Paris, Ed. de la Martinière, 1999.
[8] Cf. S. Thomas d’Aquin, In octo libros Physicorum Aristotelis expositio, L. II, l. 1, n. 148, Turin-Rome, Marietti, 1965, p. 75.
[9] Premiers principes métaphysiques de la science de la nature, trad. Gibelin, Paris, Vrin, 1952, p. 20.
[10] Kant n’explicite pas ce choix du mouvement. On peut toutefois émettre l’hypothèse suivante. Pour le philosophe allemand, le mouvement s’identifie à la translation. Or, l’on doit à la physique de Newton d’avoir découvert les lois de la mécanique, autrement dit du mouvement local.
[11] The Concept of Nature, Cambridge, University Press, 1971 (11920), p. 3.
[12] Ibid., p. 4.
[13] Ibid., p. 13.
[14] Ibid., p. 5.
[15] Ibid., p. 15.
[16] Ibid., p. 14.
[17] Aristote, Métaphysique, L. V, ch. 1, 1013 a 17-18, trad. Jean Tricot, coll. « Bibliothèque des textes philosophiques », Paris, Vrin, 21970, 2 tomes, vol. 1, p. 247.
[18] Voici ce que dit saint Thomas dans son commentaire sur la définition des Physiques : « Dans la définition de la nature, on pose le terme «principe» à la façon d’un genre. Ce terme n’est donc pas pris dans son acception absolue. Il est choisi, ici, parce que le nom de nature inclut la signification de principe. Car le terme «naissance» s’emploie pour les êtres qui sont engendrés en étant unis au générateur, comme cela arrive chez les plantes et les animaux, c’est pourquoi le principe de la génération et du mouvement est dénommé «nature». D’où il faut voir le ridicule de ceux qui, voulant corriger la définition d’Aristote, s’efforcent de définir la nature par quelque chose d’absolu et disent que la nature est une puissance inscrite dans les choses, ou quelque chose du même genre. Mais il dit «principe et cause», pour désigner que la nature n’est pas principe de tous les mouvements de la même manière dans tout ce qui est mû. Au contraire, la nature opère de façon différente, comme il a été dit au numéro précédent ». (S. Thomas d’Aquin, In octo libros Physicorum Aristotelis expositio, L. II, l. 1, n. 145, Ibid., p. 74-75)
[19] Cf. la méditation de Paul Valéry dans « L’homme et la coquille », in Œuvres, éd. Jean Hytier, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, Gallimard, 1957, p. 886-907.
[20] « Tout y est obéissance inconditionnée ». (Sören Kierkegaard, Le Lis des Champs et l’oiseau du ciel, trad. Paul-Henry Tisseau revue par Else-Marie Jacquet-Tisseau, in Œuvres complètes, Paris, Ed. de l’Orante, tome 16, 1971, p. 313).
[21] Sören Kierkegaard, Post-scriptum aux miettes philosophiques, in Œuvres complètes, tome 10, 1977, p. 227.
[22] Aristote, Physiques, II, 1, 192 b 8-32, trad. Henri Carteron, coll. des Universités de France, Paris, Les Belles Lettres, 1990, p. 59 et 60. « L’art (la technique) est un principe de mouvement résidant dans une autre chose, tandis que la nature est un principe résidant dans la chose même, car l’homme engendre l’homme ». (Aristote, Métaphysique, L. XII, ch. 3, 1070 a 7-8, vol. 2, p. 649).
[23] S. Thomas d’Aquin objecte : « Il semble qu’il n’est pas vrai que, selon n’importe quel changement affectant les choses naturelles, le principe du mouvement soit dans ce qui est mû. En effet, dans l’altération et la génération des corps simples, tout le principe du mouvement semble provenir d’un agent extrinsèque. Par exemple : quand l’eau se réchauffe ou quand l’air est changé en feu, le principe de ces changements vient d’un agent extérieur ». (In octo libros Physicorum Aristotelis expositio, L. II, l. 1, n. 143, Ibid., p. 74) Après avoir écarté une réponse insuffisante, Thomas résout ainsi l’objection : « C’est pourquoi il faut dire que dans les choses naturelles le principe du mouvement est en elles selon le mode du mouvement qui leur convient. Les choses auxquelles il convient de mouvoir ont en elles le principe actif de ce mouvement. Les choses auxquelles il convient d’être mues, ont en elles le principe passif de ce changement. Ce principe est la matière. C’est évidemment ce principe, en tant qu’il a la puissance naturelle à telle forme et à tel mouvement, qui fait que le mouvement est naturel. Ce que produisent les choses artificielles n’est donc pas naturel, car bien que le principe matériel soit dans ces choses, ce principe n’a pas une puissance naturelle à une telle forme. Par contre, même le mouvement local des corps célestes est naturel, bien qu’il soit causé par un moteur séparé. Car dans ces corps célestes, il y a une puissance naturelle à un tel mouvement. En ce qui concerne les corps lourds et légers, ils ont en eux le principe formel de leur mouvement. Mais cette sorte de principe formel ne peut être appelé une puissance active à laquelle se rapporterait le mouvement, il appartient beaucoup plus à la puissance passive : la pesanteur de la terre, en effet, n’est pas tellement un principe actif de mouvement qui lui permettrait de mouvoir autre chose, c’est beaucoup plus un principe passif qui lui donne la possibilité d’être mue : parce que le lieu est comme tout autre accident consécutif à la forme substantielle. Ainsi être mû vers un lieu, comme c’est le cas des corps lourds et légers, est consécutif de la forme substantielle. Cependant, la forme naturelle (des corps lourds et légers) n’est pas le moteur. Le moteur est le générateur qui donne telle espèce de forme, de laquelle suit telle sorte de mouvement ». (Ibid., n. 144, Ibid., p. 74)
[24] Cf. le travail voire l’art des « néo-plasticiens » que célèbre François Dagognet dans (Rematérialiser. Matières et matérialismes, coll. « Problèmes et controverses », Paris, Vrin, 21989, chap. 2).
[25] Physique, L. II, ch. 1, 199 b 28.
[26] Les choses mêmes. La pensée du réel chez Aristote, coll. « Dialectica », Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983, p. 179. « Cette opposition de la technique et de la nature ne doit pas dissimuler leur identité essentielle. Dans l’identité de la technique et de la nature s’enracine l’unité profonde du systèmes des causes, puisque toute production, qu’elle soit naturelle ou artificielle, apparaît comme une transformation de la matière en tant qu’activité mécanique réglée en considération de la fin. Dans la production humaine en revanche, l’idée se distingue de la matière et la fin s’oppose aux moyens ou aux mécanismes producteurs. Pour autant que l’idée et la fin y prennent ainsi une existence distincte, la production humaine est la production naturelle devenus consciente. Cette distinction supérieure, cette prise de conscience réfléchie de l’idée et de la finalité, constituent la supériorité de l’activité humaine sur la production simplement naturelle. L’unité de la production humaine et de la production naturelle en ceci, que l’art imite la nature. Cette imitation ne désigne pas seulement la copie servile des formes et des mécanismes déjà réalisés par la nature, mais plutôt l’identité profonde des processus téléologiquement réglés dans la nature comme dans l’art. Mais le côté conscient et intentionnel de l’activité humaine a pour résultat qu’ »elle achève » ce que la nature est incapable d’accomplir. […] Pour autant que l’activité technique utilise les lois de la nature, elle n’a rien de contre nature : elle constitue plutôt un achèvement conscient de la nature ». (Michel Gourinat, De la philosophie, Paris, Hachette, 1969, p. 580-581)
[27] L’intuition créatrice dans l’art et dans la poésie, Paris, DDB, 1966, p. 211 à 215. Et Maritain applique cette conception à l’art au sens actuel, esthétique du terme : « Il est parfaitement clair que l’imitation au sens d’une simple copie des apparences naturelles réalisée de telle manière que l’image trompe l’oeil et soit prise pour la chose est une notion détestable, directement opposée à la nature de l’art. Mais Aristote n’a jamais eu dans l’esprit une telle notion. […] Pour créer son œuvre de lignes et de couleurs, le peintre imite la nature comme il imiterait un autre peintre. Il ne copie pas la nature comme un objet, il dérobe à la nature, il extrait de son observation de la nature et de sa connivence avec elle, les moyens opératifs grâce auxquelles la nature dispose ses propres matériaux bruts de fortune, couleur et lumière, pour imprimer dans notre oeil et notre esprit une émotion de beauté. Voilà à vrai dire un type d’imitation tout à fait particulier, qui consiste à se faire soi-même instruire par un maître réticent et jaloux : larcin plutôt qu’imitation ».
[28] Guy Bechtel, Gutenberg et l’invention de l’imprimerie. Une enquête, Paris, Fayard, 1992, p. 113-114.
[29] Cf. Lucien Gérardin, La bionique, coll. « L’univers des connaissances », Paris, Hachette, 1968.
[30] « Nous devons observer que, parmi les effets dérivant d’un principe extérieur, il y en a qui dérivent seulement de ce principe : ainsi la forme d’une maison est produite dans la matière uniquement par l’art de l’architecte; mais il y a un effet qui dépend tantôt d’un principe extérieur, tantôt d’un principe intérieur : ainsi la santé est causée dans le malade tantôt par un principe extérieur, qui est l’art médical, tantôt par un principe intérieur, comme lorsque quelqu’un est guéri par la force de la nature. Dans de pareils effets il faut tenir compte de deux choses : d’abord que l’art imite la nature dans sa manière d’agir : en effet de même que la nature guérit le malade en l’altérant, ou en digérant, ou en expulsant la matière qui est cause de la maladie, ainsi opère l’art médical. Ensuite, il faut observer que le principe extérieur, c’est à dire l’art, n’agit pas de la même manière que l’agent principal, mais comme un facteur qui aide cet agent principal, c’est à dire le principe intérieur, en le fortifiant, et en lui procurant les instruments et les secours dont la nature se sert pour produire ses effets : comme le médecin fortifie la nature et lui procure les aliments et les médicaments que la nature emploie pour atteindre sa fin ». (S. Thomas d’Aquin, Somme de théologie, Ia, q. 117, a. 1)
[31] Georges Cottier, « Le concept de nature chez saint Thomas », p. 45.
[32] Cf. Pascal Ide, « Health : Two Idolatries », Paulina Taboada, Kateryna Fedoryka Cuddeback and Patricia Donohue-White (éd.), Person, Society and Value : Towards a Personalist Concept of Health, coll. « Philosophy and Medicine » n° 72, Lancaster, Kluwer Academic Publishers, 2002, p. 55-85.
[33] Éric Weil, « De la nature », Philosophie et réalité. Derniers essais et conférences, coll. « Bibliothèque d’Archives de Philosophie » n° 37, Paris, Beauchesne, 1982, p. 343-363. Ce texte est le seul inédit du recueil.
[34] Ibid., p. 347.
[35] Ibid., p. 346.
[36] Ibid., p. 345.
[37] Ibid., p. 345.
[38] Ibid., p. 344.
[39] Ibid., p. 346.
[40] Ibid., p. 357.
[41] Ibid., p. 357.
[42] Ibid., p. 349.
[43] Ibid., p. 357.
[44] Ibid., p. 345.
[45] Ibid., p. 351. C’est moi qui souligne.
[46] Ibid., p. 348.
[47] Ibid., p. 348.
[48] Ibid., p. 352.
[49] Ibid., p. 353.
[50] Ibid., p. 354 et 355.
[51] Sur cette double conception antagoniste, cf. Pascal Ide, Le corps à cœur, 1ère partie et « Health : Two Idolatries », art. cité.
[52] Éric Weil, « De la nature », p. 359.
[53] Ibid., p. 355.
[54] Ibid., p. 357.
[55] Ibid., p. 358.
[56] Ibid., p. 360.
[57] Ibid., p. 361. Éric Weil propose à l’homme d’ »accepter sans amertume » « ce qu’il y a d’irréductiblement animal et de naturel » en lui (Ibid., p. 361). Et cette acceptation s’identifie, pour le philosophe non croyant, en un consentement stoïcien à la finitude, voire à une abstention : puisque la nature révoltée est l’envers de la violence technique, il s’agit de renoncer au « projet des projets, celui de la domination absolue », de nous rappeler que « la nature ne prescrit rien » (Ibid., p. 362) et ainsi libérés « de l’obsession des projets, des promesses et de l’éternel, nous serons heureux demain ». (Ibid., p. 363) Si le diagnostic d’Eric Weil vise juste, le remède proposé laisse à désirer. La perspective biblique, et même simplement réaliste, est autrement dynamique. Loin de se réfugier dans l’abstention, elle se met à l’écoute du commandement de domestication de la terre (cf. Gn 1,28), qui évite la double erreur technophobe et technolâtre, cette relation humanisée à la technique requerrant une réconciliation du corps et de l’âme, des qualités primaires et des qualités secondaires.
[58] Volontairement, je n’ai pas fait appel aux Droits de l’homme, car il n’est que trop clair que la Déclaration de 1948, par opposition à la déclaration française de 1789, n’est plus sous-tendue par l’idée de nature mais requiert seulement un pragmatique choix de vivre-avec-les-autres.
[59] Marcel Mauss, « Catégories collectives et catégories pures » (1934), repris dans Œuvres. 2. Représentations collectives et diversité des civilisations, Paris, Minuit, 1974, p. 152.
[60] Les Antigone, Paris, Gallimard, 1986.
[61] Paul Ricœur, « Pour l’être humain du seul fait qu’il est humain », Jean-François de Raymond (dir.), Les enjeux des droits de l’homme, Paris, Larousse, 1988, p. 236-237.
[62] Jeanne Hersch (dir.), Le droit d’être un homme. Anthologie mondiale de la liberté, Recueil de textes, Paris, Unesco et Robert Laffont, 1968, réédité Paris, Jean-Claude Lattès et Unesco, 1984 et 1990.
[63] François Cheng dit avoir effectué « le plus grand écart que constitue le passage d’une écriture idéographique de type isolant à une écriture phonétique de type réflexif ». (Le Dialogue. Une passion pour la langue française, Shangaï, Presses artistiques et littéraires de Shangaï, Paris, DDB, 2002, p. 78-79)
[64] Ibid., p. 13-14.
[65] Alexandre Soljénytsine, Nos pluralistes, trad., Paris, Seuil, 1993.
[66] Pierre-André Taguieff, La force du préjugé. Essai sur le racisme et ses doubles. coll. « Armillaire », Paris, La Découverte, 1988.
[67] Michael Dummett, Le Monde du mardi 11 octobre 1994, p. 2.
[68] Clive Staples Lewis, L’abolition de l’homme. Réflexions sur l’éducation (1943), trad. et préface Irène Fernandez, Paris, Criterion, 1986. Je me référerai notamment à la remarquable et longue préface (p. 5-55).
[69] Pour le montrer, Lewis propose une méthode de prime abord déroutante. Il s’attaque à deux malheureux manuels scolaires. L’universitaire ne manquera pas de se gausser. Notre polémiste ne se trompe-t-il pas d’adversaire ? En fait, s’il paraît utile à Lewis d’analyser les manuels et non les œuvres plus fondamentales, c’est en vue de vérifier l’impact de ces dernières et s’assurer qu’elles sont véritablement sources. De plus, les œuvres populaires donnent à voir de manière claire, voire naïve des énoncés formulés de manière souvent plus voilés, plus abstraite, dans les ouvrages de fond. En outre, ce sont ces manuels qui servent d’intermédiaire entre la culture universitaire et la culture scolaire, donc qui rejoignent la grande majorité de la population. Enfin, notre auteur est convaincu, et cela n’était pas si fréquent de son temps, que les manuels scolaires, loin d’être innocents, sont porteurs d’une idéologie implicite.
[70] Ibid., p. 10.
[71] Ibid., p. 14.
[72] Lewis est-il kantien ? Oui, en tant qu’il croit à l’existence de maximes universelles. Non, dans le sens où cette universalité n’est pas seulement formelle, mais de contenu ; dans le sens aussi où le critère éthique est le bien de l’homme. L’unicité du contenu découle en dernière instance d’une vision rationnelle du bien.
[73] Le terme choquera certains à cause de ses connotations religieuses chinoises. Ce nom est-il opportun ? En tout cas, il a l’avantage de la nouveauté. Du temps de Lewis, le Nouvel Age, l’orientalisme n’existaient pas. Il demeure que ce terme peut semble insuffisamment universel et neutre, à cause de l’intérêt actuel pour l’orientalisme, souvent considéré comme route alternative aux sagesse occidentales.
[74] Ibid., p. 25.
[75] Cité p. 196. La Manusmrti – aussi appelée Manava-Dharmasastra et connue en français sous le titre « Lois de Manu » – est un dharmasastra, un traité de loi hindou en vers, précisément le plus important et le plus ancien de la tradition hindoue du Dharma. Patrick Olivelle (éd.), Manu’s Code of Law: A Critical Edition and Translation of the Manava-Dharmasastra, Oxford, Oxford University Press, 2005.
[76] Xavier Thévenot, interviewé par Monique Hébrard, Panorama, décembre 1993, p. 95.
[77] Pierre-André Taguieff, La force du préjugé, p. 491. Dans le même sens : « La geste des Droits de l’homme, affirme Jean-François Collange, pourrait bien ne pas renvoyer à moins qu’à la genèse fondamentale de toute humanité, comme à la prévenance de l’Autre qui la suscite et à sa Parole qui la génère ». (Théologie des droits de l’homme, coll. « Recherches morales », Paris, Le Cerf, 1989, p. 13) « Le christianisme, estime Chantal Delsol, a pour mission de maintenir le socle de l’unité de l’espèce humaine ». En effet, argumente-t-elle, cette unité fut brisée par les deux grandes idéologies du vingtième siècle : le communisme en séparant l’humanité en classes, le nazisme en races. Aujourd’hui, deux pensées agressives menacent cette unité : l’islam qui sépare le genre humain en deux espèces distinctes, cette fois selon le sexe ; et cette branche de la bioéthique, issue des pays anglosaxons, qui partage le genre humain en personnes et en ‘impersonnes’, ici selon le critère de leur état de santé ». (Le Figaro, samedi 23 et dimanche 24 août 2003, p. 8) J’ajouterai une troisième idéologie – le libéralisme qui secrète tout autant d’exclusion.
[78] S. Thomas d’Aquin, In decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum expositio, Turin-Rome, 31964, L. VI, l. 2, n. 1131 : « Finis autem determinatus est homini a natura ». Cf. L. III, l. 13, n. 525.
[79] L. I, ch. 4.
[80] Cf. aussi le beau texte du De finibus bonorum et malorum, L. III, ch. 19 : « Ainsi sommes-nous disposés par nature à former des groupes, des assemblées, des cités ».
[81] Somme de théologie, Ia-IIæ, q. 94, a. 2. Les commentaires techniques de ce texte sont rares. Cf. surtout Germain G. Grisez, « The First Principle of Practical Reason. A Commentary on the Summa theologiæ, 1-2, Question 94, Article 2 », in Aquinas : A Collection of Critical Essays, Ed. Anthony Kenny, London, Macmillan, 1970, p. 340-383. Cf. aussi l’article plus classique de J. B. Schuster, « Von den ethischen Prinzipien. Eine Thomasstudie zu S. Th., I-II, 94, 2 », Zeitschrift für katholische Theologie, 57 (1933), p. 44-65.
[82] Ibid., c.
[83] Thomas-Servais Pinckaers, Les sources de la morale chrétienne. Sa méthode, son contenu, son histoire, coll. « Etudes d’éthique chrétienne », Paris, Le Cerf, Fribourg-Suisse, Ed. universitaires, 21990, p. 404 à 460 ; cf. le résumé très clair dans La morale catholique, coll. « Bref », Paris, Le Cerf, 1992, p. 107 à 119.
[84] Il est d’ailleurs significatif que, citant expressément Somme de théologie, Ia-IIæ, q. 94, a. 2, le pape donne comme exemple : « contempler la beauté » (Encyclique Veritatis splendor, 6 août 1993, n. 51).
[85] Par exemple les cinq grands types de besoins universels distingués et hiérarchisés par la pyramide d’Abraham Maslow (cf. références et remarques dans Pascal Ide, Mieux se connaître pour mieux s’aimer, Paris, Fayard, 1998, Annexe 2) ou les besoins fondant la passionnante méthode élaborée par Marshall B. Rosenberg (Les mots sont des fenêtres (ou bien ils sont des murs). Introduction à la Communication non violente, trad. Annette Cesotti et Christiane Secretan, Paris, La Découverte et Syros, 1999 ; cf. la présentation selon un style plus français qu’en donne Thomas d’Ansembourg, Cessez d’être gentil soyez vrai ! Être avec les autres en restant soi-même, Québec, Les Éd. de l’homme, 2001).
[86] A cette raison, on peut joindre une argumentation par rétorsion (réduction à l’absurde) : par exemple qui refuserait que l’homme soit incliné au bien ou au vrai nierait in actu exercito ce qu’il prétend défendre in actu signato.
[87] Sur ce thème classique, cf. par exemple Henri de Lubac, « Petit monde et grand monde », Pic de la Mirandole. Études et discussion, Paris, Aubier-Montaigne, 1974, p. 160-169.
[88] Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction Donum Vitæ, 22 février 1987, n. 3, Acta Apostolicæ Sedis 80 (1988), p. 74. Je rappelle que ce document, parfois relativisé, est édité dans les Acta Apostolicæ Sedis et donc présente une véritable autorité magistérielle. De plus, le passage ci-dessus est cité par Jean-Paul II dans l’encyclique Veritatis spendor (au n. 50).
[89] Encyclique Veritatis splendor, 6 août 1993, n. 50 ; cf. n. 51. « Cette loi est dite naturelle non pas en référence à la nature des êtres irrationnels, mais parce que la raison qui l’édicte appartient en propre à la nature humaine ». (Catéchisme de l’Église catholique, 8 décembre 1992, n. 1955)
[90] Pour le détail de ce point, clairement souligné dans la tradition thomiste, cf. par exemple Jacques Maritain, « Quelques remarques sur la loi naturelle », Nova et Vetera, 1978/1, p. 1 à 12 ; Neuf leçons sur les notions premières de la philosophie morale, Paris, Téqui, 1951, p. 49s ; L’homme et l’État, Paris, PUF, 1953, p. 77s ; La loi naturelle ou loi non écrite, éd. Georges Brazzola, coll. « Prémices », Fribourg (Suisse), Ed. Universitaires, 1986, leçons 5 à 9 ; cf. la bibliographie exhaustive des écrits de Maritain portant sur la loi naturelle, p. 249-252. Cf. aussi Georges Cottier, « Nature et nature humaine », Nova et Vetera, 74/4, octobre-décembre 1999, p. 57-74.
[91] Cf. les suggestives remarques de Jean-Miguel Garrigues, « La personne humaine dans sa réalité intégrale selon saint Thomas », in Coll., Thomistes ou de l’actualité de saint Thomas d’Aquin, coll. « Sagesse et cultures, Paris, Parole et Silence, 2003, p. 99-111. En un mot, la personne est à la nature ce que l’ordre d’exercice est à l’ordre de spécification. En effet, dans une étude essentielle sur la liberté, Thomas distingue ces deux ordres de la manière suivante : « Une puissance est mue de deux manières : d’une première manière du point de vue du sujet, d’une autre manière du point de vue de l’objet. […] Le premier changement appartient à l’exercice même de l’acte, c’est-à-dire qu’il soit accompli ou non, et qu’il soit accompli mieux ou moins bien. Le second changement concerne la spécification de l’acte, car l’acte est spécifié par son objet ». (De malo, q. 6, c.) Or, l’ordre de spécification concerne la nature, l’orientation naturelle de l’acte : en effet, la détermination donnée par la spécification est double, matérielle et formelle ; mais, si la détermination matérielle est acquise, la seconde est innée, donc naturelle. En revanche, l’ordre d’exercice, lui, concerne la personne : en effet, selon un axiome de Thomas, c’est non pas la faculté mais la personne (le suppôt) qui agit, c’est-à-dire se trouve au principe de son action : « Il revient en propre à la personne d’agir ». (cf. par exemple Somme de théologie, IIIa, q. 3, a. 1 ; q. 20, a. 1, ad 2um. Cf. aussi Ibid., Ia-IIæ, q. 83, a. 2, ad 2um ; Ia, q. 39, a. 5, ad 1um) Il faut donc toujours reconduire l’action non pas seulement à son principe immédiat qu’est la puissance, mais à son principe ultime qu’est l’être agissant, en l’occurrence la personne. Par conséquent, la personne et l’ordre de l’agir moral sont à la nature ce que l’ordre d’exercice est à l’ordre de spécification. Or, si l’ordre d’exercice est déterminé par la spécification, il est à la fois le principe et le terme : la fin est spécifiée par l’objet et la forme n’est véritablement possédée que par celui qui pose l’acte. Voilà pourquoi Thomas dit : « Agir en vue d’une fin ne relève pas de la nature mais de la personne ». (Super Ep. ad Romanos, ch. 1, l. 3, n° 51) En soulignant la connexion étroite entre principe et fin, Thomas considère donc la personne non pas seulement comme source (ainsi que les modernes l’ont bien vu), mais aussi parce qu’elle est fin : « La personne qui agit est cause de l’acte en tant qu’elle est mue par la fin ; et c’est en cela principalement qu’elle est ordonnée à l’acte ». (Somme de théologie, Ia-IIæ, q. 7, a. 4, ad 3um) Ces brèves remarques montrent, soit dit en passant, le tournant personnaliste de la pensée chrétienne ne remonte donc pas au nominalisme franciscain et ne s’oppose par conséquent pas à une fondation métaphysique.
[92] Stephen Jay Gould, La mal-mesure de l’homme. L’intelligence sous la toise des savants, trad. Jacques Chabert, « Biblio-essais », Paris, Ramsay, 1983, p. 411.
[93] Ibid., p. 417. Souligné par l’auteur.
[94] Ibid., p. 411.
[95] Ibid., p. 418.
[96] Ibid., p. 420.
[97] Ibid., p. 419.
[98] La néoténie est la biopersistance des caractères larvaires (ou immatures). Stephen Jay Gould a déjà développé cette idée dans un autre ouvrage (Darwin et les grandes énigmes de la vie, trad. D. Lemoine, Paris, Pygmalion-Gérard Watelet, 1979, p. 352 à 404). A noter que l’on préfère de plus en plus parler d’hétérochronie (c’est-à-dire de différentiel de vitesse dans la maturation des programmes au sein d’un même organisme).
[99] Stephen Jay Gould, La mal-mesure de l’homme, p. 423.
[100] Un autre biologiste, François Jacob, avait exprimé cette idée de manière similaire. Il constate en effet que « tout enfant normal possède à la naissance la capacité de grandir dans n’importe quelle communauté, de parler n’importe quelle langue, d’adopter n’importe quelle religion, n’importe quelle convention sociale ». Il est donc vraisemblable que « le programme génétique met en place ce qu’on pourrait appeler des structures d’accueil ». Donc sur la relation inné-acquis, il faut dire : « l’être humain est génétiquement programmé, mais il est programmé pour apprendre. Tout un éventail de possibilités est offert par la nature au moment de la naissance. Ce qui est actualisé se construit peu à peu pendant la vie par l’interaction avec le milieu ». (Le jeu des possibles. Essai sur la diversité du vivant, Paris, Fayard, 1981, réédité dans Le Livre de poche. Biblio-essais, n° 4045, p. 115. C’est moi qui souligne)
[101] Ibid., p. 420. Certes, Gould estime nihiliste la position selon laquelle l’homme serait table rase, cire vierge (cf. Ibid., p. 411), mais il s’agit là d’une question de mots.
La prise de position de Gould, on l’a noté, est d’autant plus intéressante qu’il est darwinien. Elle rejoint des développements plus classiques évoqués ci-dessus. Je n’adresserai qu’une réserve à cette passionnante interprétation : selon Gould, c’est la sélection naturelle qui a travaillé dans le sens d’une plus grande flexibilité de la nature humaine. Par exemple : « Qu’est-ce qui aidera le plus à l’adaptation d’un animal qui pense et apprend : des gènes choisis pour l’agression, la rancune, la xénophobie, ou la sélection de lois d’apprentissage qui engendreront une attitude agressive dans certaines circonstances appropriées ou une conduite pacifique dans d’autres ? » (Ibid., p. 422 ; cf. p. 421-422) Si on interprète ce mécanisme dans le sens du déterminisme, ce qui fut chassé par la porte rentre par la fenêtre : comment expliquer que le processus fondateur ne soit pas déterminant dans le développement ? Des notions comme « épiphénomène » ne restent que des mots sans explicitation philosophique. Par contre, si l’on entend la notion d’évolution et de sélection dans un sens résolument finaliste, le biologique ne menace plus de réduire le culturel à l’état d’expression ou d’émergence.
[102] J’ai développé ce thème notamment dans mon ouvrage Eh bien dites : don ! Petit éloge du don, Paris, L’Emmanuel, 1997. Et dans deux articles : « Une éthique de l’homme comme être-de-don », Liberté politique, n° 5. Sortir de l’école unique, été 1998, p. 29-48 ; « Une théologie du don. Les occurrences de Gaudium et spes, n. 24, § 3 chez Jean-Paul II », Anthropotes, 17/1 (2001), p. 151-180 et 17/2 (2001), p. 129-163. Je prépare une thèse de théologie sur le thème du don.
[103] Cf. Le Robert. Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction d’Alain Rey, Paris, Le Robert, 1998, 3 tomes, vol. 1, p. 1120.
[104] L. II, l. 14, n. 8, p. 131. Précisément, il est dit : « la nature n’est rien d’autre que la raison d’un certain art, à savoir divin, inscrit dans les choses, par lequel les choses sont mues en vue d’une fin déterminée ». (« Natura nihil est aliud quam ratio cuiusdam artis, scilicet divinæ, indita rebus, qua ipsæ res moventur ad finem determinatum ».) On peut en rapprocher un autre principe célèbre : « l’œuvre de la nature est œuvre de l’intelligence ». (L. II, l. 4, n. 6, p. 87) Précisément le passage dit : « Les choses naturelles sont imitables par l’art, parce que toute la nature est ordonnée à sa fin par quelque principe intellectif, de telle manière que l’œuvre de la nature semble être une œuvre de l’intelligence » (« opus naturae videatur esse opus intelligentiae »). En effet, la nature est principe de mouvement ; or, le mouvement est ordonné à une fin ; mais seule l’intelligence peut ordonner une réalité à sa finalité, permet de poursuivre une fin par des moyens déterminés ; par conséquence l’œuvre de la nature se présente comme l’œuvre d’une intelligence. Et c’est une autre raison pour laquelle l’art est dit imiter la nature.
[105] Pour un développement concret de cette question, cf. Thomas-Servais Pinckaers, Les sources de la morale chrétienne, p. 361-366 ; Pascal Ide, Construire sa personnalité, Paris, Fayard, 1991, chap. 1.
[106] S. Thomas d’Aquin, Collationes in decem præceptis, I, n. 2, Rome-Turin, Marietti, Opuscula theologica, tome 2, p. 250. Cité par le Catéchisme de l’Église catholique, n. 1955.
[107] Il faudrait d’ailleurs ajouter à ces deux dimensions, universelle et particulière, la troisième dimension, singulière.
[108] Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, I, in Œuvres, éd. du Centenaire par André Robinet, Paris, PUF, 1959, p. 1001-1002. « Le groupe traditionnel ne connaît pas d’obligation envers ceux qui lui sont extérieurs, les ennemis naturels, les étrangers, les sous-hommes, ces êtres qu’on a le droit, souvent l’obligation, de soumettre, de réduire en esclavage, d’offrir en sacrifice à ses divinités : c’est dans l’histoire que l’idée «ethnocentrique» de l’universalité est devenue elle-même universelle en ce sens qu’elle n’est plus l’apanage d’un groupe ». (Éric Weil, « Du droit naturel », Essais et conférences, Paris, Vrin, 1971, 2 vol. tome 1, p. 191-192) A noter que François Cheng, dans l’exemple ci-dessus, ne parle d’une facilité à passer de sa sphère culturelle à l’universel que parce qu’il a lui-même fait l’expérience d’une circulation entre deux cultures exceptionnellement différentes.
[109] Georges Cottier, « Nature et nature humaine », p. 57.
[110] Cf. l’intéressant article de Michel Henry, « Nature (esth.) », in Encyclopédie philosophique universelle. II. Les notions philosophiques. Dictionnaire, Paris, PUF, 1990, tome II, p. 1731 à 1733.
[111] Georges Cottier, « Le concept de nature chez saint Thomas », p. 56. Souligné dans le texte.
[112] « Ce qu’est et comment se détermine la phusis », trad. François Fédier, Questions II, Paris, Gallimard, 1968, p. 165 à 276, ici p. 276.
[113] Héraclite, Fragment B cxxiii, de Thémistius, in Les présocratiques, p. 173 (« Phusis kruptesthai philéi ». Cf., dans le même sens, Fragment, B liv, Les présocratiques, p. 158) A noter qu’Héraclite attribue ce mystère au divin (Fragment, B lxxxvi, p. 166).