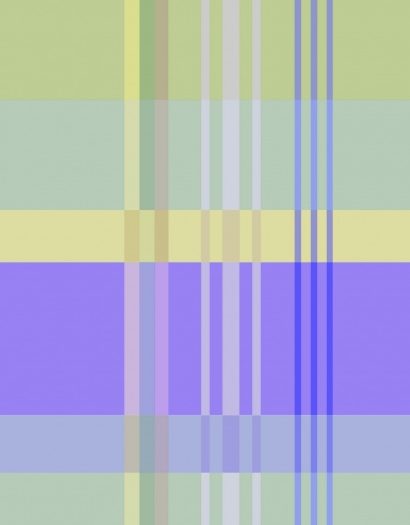B) La diffusion de la psychanalyse (1905-1914)
On pourrait sous-titre : Ou la psychanalyse à la conquête du monde. Je suivrai maintenant de plus loin l’évolution de Freud, pour ne m’attarder qu’à quelques faits révélateurs et quelques publications marquantes.
1) La théorie de la sexualité (détaillée au chap. 5)
2) La prime notoriété de Freud. Les disciples de la première heure
a) Le premier cercle
Ayant acquis une réelle notoriété dans le monde de la psychologie et de la psychiatrie dynamique, Freud entreprit de réunir autour de lui un cercle de disciples, médecins, juifs, non universitaires, comme Rudolf Reitler et Max Kahane, Alfred Adler et Wilhelm Stekel, mais bientôt des sectataires pro-freudiens d’autres compétences, comme le musicologue Max Graf ou l’éditeur libraire Hugo Heller, et même d’autres nationalités. À l’automne 1902, ils constituèrent la PMG, Psychologische Mittwochs-Gesellschaft, la « société psychologique du mercredi », car ils se réunissaient chez Freud, le mercredi soir après dîner. Entre octobre 1902 et septembre 1907, la PMG compta 23 membres. Entre 1902 et 1906, il n’y eut aucune transcription des débats. Mais ce ne sera plus le cas par la suite, de sorte qu’on compte la transcription de 250 réunions qui eurent lieu jusqu’à 1918 [1].
Notons quelques traits communs à tous ces premiers disciples du cénacle freudien : profondément viennois dans l’esprit, presque tous juifs, d’une trentaine d’années, tous masculins (la première femme apparut en 1910), machistes (nulle femme ne devait troubler leur aréopage), paladins militants de la psychanalyse naissante et… névrosés. En effet, en parlant de leurs cas cliniques, ils parlaient d’eux-mêmes, de leurs angoisses et de leurs rêves, leur vie tumultueuse, leurs révolte contre leurs pères et la société de l’époque, leur identité juive et leur mélancolie profonde… Ajoutons un dernier trait, et pas des moins troublants : beaucoup furent traités par Freud ; leurs épouses, leurs sœurs, leurs amantes, puis leurs enfants expérimentèrent aussi ce qui, à partir de 1904, devint la cure psychanalytique, voire, de patientes, devinrent aussi thérapeutes. Vous avez dit fusion ? Vous avez dit narcissisme, voire manipulation ?
Même si Freud lui-même nourrissait un certain mépris pour ses premiers disciples de la Société du mercredi – il confia en effet à Ludwig Binswanger : « Alors, vous avez vu maintenant cette bande [2] ? » –, il reçut beaucoup de cette première génération de disciples qui lui vouaient une dévotion sans borne : « Sans le dialogue qu’il entretint alors avec cette première génération de disciples, jamais Freud n’aurait pu nourrir son œuvre, comme il le fit, en la remaniant sans cesse à la lumière de ce que chacun lui apportait [3] ».
b) Le second cercle
En 1907, Freud prononça la dissolution de la PMG par souci de créer une société plus institutionnelle, d’en écarter certains membres trop turbulents ou trop dissidents et d’adjoindre des membres plus respectables. Il créa alors en 1907 une association véritable, avec des règles, la Wiener Psychoanalytische Vereinigung (WPV) ou Verein, que l’on peut considérer comme la première institution psychanalytique de l’histoire du freudisme. Si on tentait de la définir à partir d’un équivalent des quatre causes (et comparativement), on pourrait dire qu’elle se caractérisait :
- par l’entrée de disciples extérieurs au cénacle d’origine. C’est ainsi que s’adjoignirent les premiers grands disciples de Freud : Max Eitington, Sandor Ferenczi, Karl Abraham, Carl Gustav Jung et Ernest Jones ;
- par une forme institutionnelle ressemblant à une Académie (versus le caractère intentionnellement informel, socratique, de la PMG) ;
- par une réglementation établissant une hiérarchie entre maître et disciples,
- par une finalité ouvertement prosélyte : il s’agissait d’internationaliser le mouvement, de diffuser la psychanalyse hors Vienne et bientôt hors Europe, donc de transformer chaque membre de la Verein en militant destiné à divulguer la bonne doctrine : chacun était profondément convaincu que la psychanalyse était la plus grande révolution du xxe siècle et qu’il participait donc à l’œuvre la plus importante de leur époque. Une médiation privilégiée fut le lancement de ce trois revues fondées par Freud et ses disciples, en 1909, 1910 et 1912 (Imago).
c) Une relation « exemplaire » : Carl Gustav Jung (1875-1961)
Il y aurait beaucoup à dire maintenant en particulier des relations de Freud avec les membres de la Verein, mais aussi de la PMG, par exemple avec Alfred Adler, disciple doué qui fut aussi le premier grand dissident dans l’histoire du mouvement psychanalytique (il se sépara de Freud en 1911). Toutes ces relations étaient régies selon la loi déjà plusieurs fois illustrée du « je t’aime, je te hais », qui régissait les amitiés avec le Herr Professor.
Nous nous concentrerons sur celui qui fut peut-être le plus brillant et le plus doué des disciples de Freud : Carl Gustav Jung [4]. Jung, alors psychiatre assistant de Bleuler, prit contact avec Freud en octobre 1905.
1’) Les raisons multiples d’une attirance
D’emblée, Freud sut que la rencontre serait d’une importance exceptionnelle pour la psychanalyse. Pour quatre raisons principales : d’une intelligence exceptionnelle et d’une grande érudition (il lisait autant Kant que Hegel ou Nietzsche), Jung était déjà reconnu pour ses travaux sur la psychogenèse des maladies mentales, et donc n’était pas suspect de venir par besoin de reconnaissance ; Jung était suisse (d’un pays où les cliniques étaient les plus prospères), et donc ouvrait une nouvelle « terre d’apostolat », hors Vienne et Berlin ; Jung se passionnait pour la psychose et « le monde des fous », alors que la psychanalyse ne s’était tournée que vers la névrose ; fils de pasteur, Jung était de culture chrétienne, et donc découplait ainsi la psychanalyse de son lien avec des sectataires, des analystes et des analysants juifs à ce point étroit qu’on pouvait le croire nécessaire, conjurant ainsi la qualification redoutée de « science juive ». Une confidence à Karl Abraham l’atteste :
« Il vous est plus facile qu’à Jung de suivre mes pensées car […] de par notre parenté raciale, vous êtes plus proche de ma constitution intellectuelle, tandis que lui, en tant que chrétien et fils de pasteur, ne trouve le chemin qui mène jusqu’à moi qu’au prix de grandes résistances intérieures. Son ralliement n’en a que plus de valeur. Je dirais presque que seule son entrée en scène a soustrait la psychanalyse au danger de venir une affaire nationale juive [5] ».
2’) Les raisons tout aussi évidentes et tout aussi multiples d’une répulsion (à moins qu’il ne s’agisse d’une attirance encore plus forte)
Ne nous cachons pas, pour autant, les multiples oppositions (outre la différence d’âge de 11 ans qui prédispose Freud à jouer le rôle du père). Outre celles déjà notées (de fait, la relation de Jung à la question juive est pour le moins ambiguë [6]) et qui sont plus extrinsèques, en voici au moins trois, intrinsèques : Freud rationaliste matérialiste et scientiste versus Jung mêlant hermétisme, voire occultisme, antimatérialisme, attirance pour le spirituel ; Freud passionné par l’individualité et l’inconscient individuel versus Jung passionné pour la psychologie des peuples et l’inconscient collectif ; Freud rejetant le lexique des aliénistes de l’époque (aliénation, état mental, personnalité, dédoublement, etc.) et les classifications en vigueur dans la psychiatrie versus Jung formé à cette école ; côté thérapeutique, Freud qui ne prescrit pas, ne s’intéresse pas à l’aménagement des asiles versus Jung formé aux remèdes et la gestion de la vie collective des malades mentaux ; Freud partisan d’une libido sexuelle versus Jung partisan d’une libido entendue comme énergie vitale ; Freud cultivant l’abstinence sexuelle versus Jung polygame, multipliant les aventures amoureuses même avec ses patientes (dont il fera des disciples : nouvel exemple de confusion, voire de névrose et de manipulation…).
Faut-il ajouter que Jung était lui aussi névrosé. Brièvement, les symptômes : hanté par des souvenirs terrifiants et haineux contre les Jésuites et l’Église catholique ; sujet à de nombreuses syncopes ; envahi par la conviction de son indignité. Tout aussi brièvement : comparaisons avec un autre Carl Gustav dit « l’Aîné », recteur de l’université de Bâle et dont une légende tenace disait qu’il était le fils naturel de Gœthe ; sa mère s’adonnant devant lui au spiritisme avec son propre père, un pasteur illuminé ; surtout, horresco referens, abus commis par un prêtre catholique ami de son père [7].
Bref, tout est déjà en place pour que se déploie autant une relation particulièrement passionnelle qu’une rupture particulièrement conflictuelle…
3’) La première rencontre
Le dimanche 3 mars 1907, Emma Rauschenbach, épouse belle, riche, intelligente, élégante et distinguée de Jung, l’accompagna à Vienne pour sa première rencontre avec Freud, dans son domicile de la Berggasse [8].
« Impressionné par Emma, si différente des femmes de son entourage et surtout issue d’une tout autre classe sociale que la sienne, Freud se montra d’une exquise amabilité. Invités à partager le repas de la famille réunie au grand complet, les convives comprirent très vite combien les deux hommes étaient pressés de se retrouver seuls pour entamer un dialogue qui s’acheva au milieu de la nuit. Jung parla sans s’arrêter pendant trois heures, et Freud finit par l’interrompre pour lui proposer de converser de façon ordonnée. L’échange se poursuivit alors pendant dix heures, et chacun eut le sentiment de partager avec l’autre des opinions convergentes. Pourtant, Jung fut frappé par l’absence ‘totale de conscience philosophique’ de son interlocuteur, par son ‘positivisme’ et par l’importance extravagante qu’il accordait à sa théorie sexuelle.
« Tandis qu’ils devisaient, un bruit retentissant provenant de la bibliothèque les fit sursauter. Convaincu qu’il s’agissait d’un phénomène d’ ‘extériorisation cataleptique’ [phénomène qui, dans le spiritisme, est dû à l’émanation d’un fluide venant d’un sujet en catalepsie et provoquant des phénomènes psychokinétiques comme le craquement d’un meuble], Jung, toujours à l’affût des voix de l’au-delà, annonça qu’un deuxième bruit ne tarderait pas à se faire entendre. Freud qualifia de ‘pure sottise’ les superstitions de son hôte, qui crut déceler sur son visage une marque de terreur quand un deuxième craquement se produisit [9] ».
Le lendemain de cette rencontre mémorable, Freud se livra à son exercice favori en demandant à Jung de lui raconter ses rêves. Ludwig Binswanger, qui était aussi présent à la demande de Jung, intimidé, commente : « Je ne me rappelle plus le rêve de Jung, mais je me souviens de l’interprétation qu’en donna Freud. Elle tendait à montrer que Jung voulait le détrôner pour prendre sa place ». Ajoutons, pour confirmation de l’excès de ces interprétations, celle que Freud proposa du rêve de Binswanger :
« Moi-même je rêvais de l’entrée de la maison du 19 Berggasse, qui se trouvait justement en reconstruction, et du vieux lustre recouvert à la hâte, en raison de la réfection. L’interprétation de Freud qui ne me parut pas précisément convaincante […] était que le rêve contenait le souhait d’épouser sa fille [aînée], en même temps que le refus de ce souhait [10] » !
4’) Une relation ambiguë
Très tôt, se mit en place une relation ambivalente. Freud voyait en Jung le Josué dont il aurait été le Moïse : « Vous serez celui qui, comme Josué, si je suis Moïse, prendrez possession de la terre promise de la psychiatrie, que je ne peux apercevoir que de loin [11] ». De fait, si Jung était psychiatre, Freud était neurologue et médecin généraliste.
De l’autre, Jung voyait en Freud un génie, mais aussi son libérateur, un père autant qu’un messie. Comme l’atteste une lettre de Jung :
« En fait – ce que je dois vous avouer avec réticence –, je vous admire sans bornes en tant qu’homme et chercheur et, consciemment, je ne vous jalouse pas. Ce n’est donc pas de là que vient mon complexe d’autoconservation, mais de ce que ma vénération pour vous a le caractère d’un engouement passionné, religieux qui, quoi qu’il ne me cause aucun autre désagrément, est toutefois répugnant et ridicule pour moi à cause de son irréfutable consonance érotique. Ce sentiment abominable provient de ce qu’étant petit garçon, j’ai succombé à l’attentat homosexuel d’un homme que j’avais auparavant vénéré [12] ».
Bref, « Freud croyait avoir trouvé un hériter susceptible d’adhérer à sa doctrine et Jung pensait avoir rencontré un père capable de l’aimer [13] ». Un épisode qui eut lieu la veille du départ pour le Nouveau Monde, le 10 août 1909, à Brême, résume bien l’attitude de Freud et l’extrême tension existant entre les deux hommes, malgré la fascination tout aussi excessive. Jung invite Freud à son hôtel (Sandor Ferenczi, du voyage, est aussi présent, mais peu importe) et il se met à parler d’une légende des corps momifiés d’hommes préhistoriques que l’on a retrouvés dans des tourbières allemandes, sans savoir comment ils ont péri. Freud fut alors saisi d’angoisse et eut une syncope ; puis, après avoir repris connaissance, il expliqua que sa réaction venait de ce que le récit de Jung traduisait un désir symbolique de mort du père. Furieux, Jung récusa cette interprétation et accusa Freud de délire projectif. Il est d’ailleurs significatif que Freud ne relate pas l’événement dans son journal de voyage et parle seulement d’un accès de fatigue.
Quoi qu’il en soit, Freud fit tout de suite entrer Jung dans la PMG qui, il est vrai, n’était pas encore la Verein ; mais, sans étonnement non plus, le jeune helvète jugea négativement et sévèrement les membres comme un « ramassis d’artistes, de décadents et de médiocres [14] » !
5’) La rupture
Entre 1906 et 1914, Freud et Jung ont échangé pas moins de 359 lettres [15]. Mais, latente dès la première rencontre, la rupture était inéluctable [16]. Elle eut lieu en 1913. D’un côté, Freud accusa Jung de céder à la « boue noire de l’occultisme ». De l’autre, Jung avait besoin de se libérer de ce qu’il vivait comme une emprise. Derrière, il se cache aussi des motifs moins avouables. Nous avons vu la difficulté presque insurmontable de Freud à demeurer dans une relation pacifiée avec une personnalité attirante qui ne l’admirait pas inconditionnellement. Jung, de son côté, se considérait comme socialement supérieur à Freud, a toujours eu une vive conscience de la supériorité de la doctrine freudienne sur la psychanalyse qu’il fonda.
Au fond, la divergence était d’abord doctrinale, mais surdéterminée par une divergence psychologique qui ligotait et bâillonnait les deux hommes. Un aveu de Jung résume bien cette double opposition :
« Je n’aurais pu donner à Freud mes propres associations pour interpréter le rêve sans me heurter à son incompréhension et à de violentes résistances. Je ne me sentais pas à la hauteur pour leur tenir tête. Je craignais aussi de perdre son amitié si je maintenais mon point de vue [17] ».
3) L’élargissement décisif de la célébrité : le voyage aux États-Unis (1909) [18]
Nous avons vu, avec le cas emblématique de Jung, mais aussi, plus globalement de la Verein, combien la psychanalyse s’est ouverte à l’Europe. Mais l’Occident était de plus en plus tourné vers le nouveau continent, riche en potentialité et passionné par les questions psychologiques et psychiatriques. Tôt ou tard, se poserait la question de l’attitude à avoir vis-à-vis des États-Unis. En fait, Freud était trop assuré de sa mission universelle (il est fils des Lumières, si sombres soient-elles) pour ne pas rêver de se rendre aux États-Unis, d’autant qu’il se sentait-croyait rejeté en Europe.
a) Le contexte
Il faut prendre la mesure de la différence entre Ancien Monde et Nouveau Monde. Si l’expression forgée par Alvin Toffler – le choc du futur – et, plus encore, par Samuel Huntington, le choc des civilisations [19] – a un sens, c’est bien ici. Résumons les oppositions en un tableau binaire :
Juif / chrétien
Matérialiste athée / structurellement religieux
Libertaire / puritain
Polygame / monogame, c’est-à-dire fidèle
Machiste / intégrant la femme
Art et sublimation comme réponse à la libido / mariage comme contrôle morale de la sexualité
Sexualisation / désexualisation de la libido au service de l’efficacité de la société industrialisée
De telles oppositions devraient normalement conduire à un affrontement, voire à un rejet de la psychanalyse. D’ailleurs, la conviction intime de Freud, pourtant ascétique, était que la morale religieuse ne pouvait conduire à une abstinence sexuelle [20].
Mais l’on doit prendre en compte un autre facteur, et c’est une différence notable avec les Américains d’aujourd’hui. Ceux-ci sont en effet beaucoup plus autocentrés et convaincus que, s’il existe une fabrique de la culture et de la pensée, elle a lieu chez eux. Mais, à l’époque, tous les grands spécialistes américains des psychopathologies, comme Morton Prince, Adolf Meyer, William James, Granville Stanley Hall, parlaient plusieurs langues, avaient voyagé, se passionnaient pour les publications de Janet, Bleuler, Jung et Freud, donc étaient aussi eurocentrés.
De plus, la psychologie du Nouveau Monde est traversée par deux courants. D’un côté, les somaticiens affirment que les troubles psychiques ont toujours un substrat cérébral, donc somatique, le traitement devant donc d’abord être physique, chirurgical ou médicamenteux. De l’autre, les psychothérapeutes, en revanche, affirment que l’origine des troubles mentaux est psychique, le traitement devant donc d’abord être psychologique.
b) L’accueil
C’est dans ce contexte particulier et incertain que le psychologue Granville Stanley Hall se décida à inviter Freud à prononcer plusieurs conférences à la Clark University de Worcester qui fêtait le vingtième anniversaire de sa fondation. Freud n’hésita pas, pour les raisons susdites, outre son amour des voyages et son admiration pour Abraham Lincoln. Jung ayant aussi été invité, ils décidèrent de venir ensemble.
Nous avons déjà parlé de l’épisode inaugural, la veille de l’embarquement. L’analyse psychologique mutuelle et sauvage de Freud et Jung, sous le regard de Ferenczi, se poursuivit sur le superbe paquebot de ligne, le George-Washington [21] – et après, lors des promenades dans Central-Park –, Freud interprétant les rêves de Jung comme autant de meurtres du père et Jung déchiffrant dans ceux de Freud autant de mystères féminins enfouis dans une grotte archaïque… La traversée dura du 21 au 29 août. Lorsque Freud qui avait tant rêvé de l’Amérique, aperçut les rives du Nouveau Monde symbolisée par la statue de la Liberté, il fut pris d’une intense émotion et, se tournant vers Jung, il prononça ces mots célèbres : « Si seulement ils savaient ce que nous leur apportons… » [22]
En fait, nous avons en mémoire une autre phrase, beaucoup plus sulfureuse : « Ils ne savent pas que nous leur apportons la peste ». Rapportée par Lacan, cette phrase jouit donc de son autorité. Toutefois, il s’agit purement et simplement d’une invention, donc d’une nouvelle légende freudienne, dénuée de tout fondement et contraire aux faits [23]. C’est d’ailleurs ce que confirme la parole de Freud à Ferenczi écrite quelques mois auparavant : « Nous devrions très vite être mis à l’index là-bas, aussitôt qu’ils tomberont sur les soubassements sexuels de notre psychologie [24] ». Elle dénote une crainte projective, pas une volonté d’intoxication anticipée.
Pendant cinq jours, négligeant leur fatigue, ils visitèrent New York, autant les musées que la ville et son melting pot si typiquement américain ; voire, Freud découvrit le cinéma, pardon le cinématographe !
Avec courage, Freud prit trois décisions d’importance, d’ailleurs contre l’avis de Jones, mais non sans avoir longuement parlé avec Ferenczi : parler sans papier, donc ne pas rédiger ses conférences ; parler en allemand, l’auditoire étant parfaitement germanophone ; affronter la question de la sexualité. Ce faisant, il ne fut pas seulement d’un brio étourdissant, mais il fut « Américain chez les Américains », c’est-à-dire pragmatique, concret, multipliant des exemples pour illustrer chacun des concepts centraux de la psychanalyse : la méthode d’interprétation par association libre, le refoulement, la technique de la cure, l’hystérie, la sexualité infantile (évoquant par exemple ici le cas du « petit Hans »). Il trouva aussi des images heureuses, comme celle, fameuse, du gêneur pour expliquer ce qu’est le refoulement.
Le 7 septembre, Freud entama sa série de cinq conférences. Elles proposaient une sorte de synthèse de la théorie psychanalytique [25] – pour être plus précis, de la doctrine du « premier Freud », ce que l’on pourrait qualifier le Freud optimiste, celui de la Belle Époque. Le public, prestigieux, rassemblait non seulement le gratin en matière psychologique et psychiatrique de cette région des États-Unis, comme William James, mais aussi deux Prix Nobel de physique, Albert Michelon et Ernest Rutherford.
c) Le triomphe
L’accueil fut triomphal, non seulement dans la salle, non seulement dans la presse locale, mais aussi dans la presse nationale et dans les milieux académiques. Le lendemain, le 10 septembre 1909, Freud, de concert avec Jung, reçut le titre de docteur honoris causa de l’université Clark : seule distinction universitaire que reçut jamais Freud, première d’une longue liste pour Jung.
Pour une fois, Freud ne bouda pas son plaisir, ainsi qu’il le rapporte en 1925 :
« Je n’avais à l’époque que cinquante-trois ans, je me sentais juvénile et bien portant, ce bref séjour dans le Nouveau Monde fut d’une manière générale bénéfique pour mon amour-propre ; en Europe, je me sentais en quelque sorte proscrit, ici je me voyais accueilli par les meilleurs comme un de leurs pairs. Ce fut comme l’accomplissement d’un rêve diurne invraisemblable, lorsque je montai à la chaire de Worcester afin d’y donner les Cinq leçons sur la psychanalyse. La psychanalyse n’était donc plus une formation délirante, elle était devenue une part précieuse de la réalité [26] ».
Il est intéressant de comparer ce commentaire, notamment vis-à-vis de l’âge, à celui consécutif à la réception de sa Traumdeutung : alors qu’il a 44 ans, il se trouve un « vieux juif » épuisé.
De fait, Freud a réellement conquis le sous-continent américain : son interprétation psychologique des « maladies de l’âme » balaya l’interprétation somatique, et la psychanalyse devint la « cure mentale » la plus populaire. On ne saurait d’ailleurs négliger dans cette opération de conquête-séduction, le rôle joué par le cinéma, notamment à travers les films d’un des réalisateurs les plus prisés, Alfred Hitchcock.
Toutefois, il faut ajouter deux faits importants. Primo, la réception outre-Atlantique ne s’est pas opérée sans une déformation notable : si les Américains ont reçu aussi triomphalement la psychanalyse, c’est pour ce qu’elle n’était pas, à savoir une thérapie du bonheur. Aussi, la raison pour laquelle ils l’accueillirent fut-elle aussi celle pour laquelle « ils la rejetèrent soixante ans plus tard ». Secundo, j’ajouterai, contre l’avis de la trop psychanalytique Roudinesco, que ce fut déjà quelques décennies, voire quelques années plus tard, ainsi que nous le verrons avec un autre géant de la psychologie et de la psychiatrie, Milton Erickson. Et les raisons sont autres : le manque d’efficacité de la psychanalyse ; le manque de fondement expérimental, voire l’impossibilité de discuter sa vérité, sa non-réfutabilité. D’ailleurs, Freud fut, pour une fois, lucide. Se fondant sur une caractéristique de la mentalité juvénile des Américains qu’il n’avait pas manqué d’observer, il écrivit : « Mon succès sera court, les Américains me traitent comme un enfant qui s’amuse avec sa nouvelle poupée, laquelle sera sous peu remplacée par un nouveau jouet [27] ».
Ne serait-il pas intéressant de passer un extrait, par exemple, de Psychose ou, mieux, La maison du Dr Edwards ?
4) L’élargissement de la première théorie psychanalytique
Convaincu d’avoir élaboré une théorie de la psyché révolutionnaire, Freud ne cessera de l’étendre (et donc de l’approfondir) aux différents domaines proprement humains : l’histoire (individuelle, c’est-à-dire biographique, et universelle, du moins en tant qu’elle est archaïque), l’art et la littérature, la culture, l’anthropologie, la morale, la religion. Toujours avec le même principe : révéler le patent derrière le latent, déchiffrer, tel un Sherlock Holmes, l’inconscient qui gît sous et régit le conscient.
a) L’étude sur Léonard de Vinci (1910)
Le premier domaine d’extension fut l’histoire individuelle : « Le domaine de la biographie doit également devenir nôtre. Depuis mon retour [d’Amérique], j’ai eu une seule idée. L’énigme du caractère de Léonard de Vinci est tout à coup devenue transparente pour moi [28] ». Léonard a toujours fasciné Freud : parce qu’il est italien, parce qu’il est génial, parce qu’il est affligé d’un certain nombre de symptômes (homosexuel, végétarien, fasciné par les « têtes bizarres et grotesques », gaucher) et de traumatismes (enfant illégitime de Piero da Vinci, riche notable, et d’une humble paysanne). Surtout parce qu’il va illustrer les hypothèses freudiennes sur la sexualité infantile, en même temps qu’il va se projeter en lui. D’un mot, Léonard était « sexuellement inactif ou homosexuel » et « avait converti sa sexualité en pulsion de savoir », tout en demeurant insatisfait.
Après avoir veillé, comme toujours, à s’informer sur les meilleures sources (sa bibliothèque en comporte les exemplaires annotés, en italien, français ou allemand), il va donc composer un essai entre janvier et mars 1910 puis le publier en mai [29]. Dans ce petit livre écrit comme un roman policier ou un roman à énigme, il part d’un souvenir rapporté par Leonardo :
« Il semble qu’il m’était déjà assigné auparavant de m’intéresser aussi fondamentalement au vautour car il me vient à l’esprit comme tout premier souvenir qu’étant encore au berceau, un vautour est descendu jusqu’à moi, m’a ouvert la bouche de sa queue et, à plusieurs reprises, a heurté mes lèvres de cette même queue [30] ».
Or, le génie de la Renaissance interprète cette donnée comme l’explication de son amour des oiseaux et surtout de ses projets de machines volantes. Freud, lui, cherche l’origine de l’homosexualité du florentin dans ce souvenir. D’abord, dans la civilisation égyptienne, le mot « mère » est représenté par un pictogramme représentant un vautour autant qu’une divinité maternelle du nom de Mout ; de plus, une légende chrétienne fait du vautour une image de la vierge immaculée, car il s’agit d’un oiseau femelle qui ouvre son vagin pour être fécondée par le vent (l’esprit). Freud émet donc l’hypothèse que le peintre du Quattrocento fut influencé par ces récits mythiques, païens et chrétiens. Dès lors, le toucher des lèvres correspond à un souvenir plus ancien, celui du nourrisson prenant le sein maternel. Or, l’on sait combien l’enfant fut le soin d’un amour exclusif de sa mère, alors que son père l’ignorait. Donc, Léonard se souvient dans son rêve de cet amour comblant, mais désormais inaccessible. Or, Freud avait déjà proposé différentes interprétations contradictoires de l’homosexualité masculine. Ici, il proposa une théorie cohérente : fixation exclusive à la mère ; refoulement de l’amour pour la mère ; refus de l’identification au père (absent) ; fixation sur un choix narcissique et repli sur une phase auto-érotique, tout objet amoureux étant un substitut de sa propre personne.
Freud trouva évidemment une confirmation de son herméneutique dans le trop fameux sourire de Mona Lisa del Giocondo, dit La Joconde : il s’agissait du sourire de sa mère, idéalisée par l’enfant (à l’instar des têtes d’anges ou Sainte Anne en tierce).
Pour le détail, nous renvoyons aux commentaires, par exemple, sur l’erreur de Freud qui s’est fié à la version allemande. Celle-ci parle d’un « vautour [Geier] ». Or, dans le texte italien (original), Léonard écrit nibbio, « milan », et l’allemand dispose d’un mot spécifique pour désigner cette autre espèce d’oiseau de proie : Hühnergeier ou Gabelweihe.
Pourtant, si fantaisiste nous paraisse cette reconstruction, elle fut saluée comme un véritable tour de force.
b) Le complexe d’Œdipe (1910)
Freud invente l’expression « complexe d’Œdipe » dans un article de 1910 [31]. Développons et élargissons.
1’) Définition
L’enfant « commence à désirer la mère elle-même, au sens nouvellement acquis, et à haïr de nouveau le père comme rival qui fait obstacle à ce souhait. Il tombe comme nous disons sous la domination du complexe d’Œdipe [Ödipuskomplex]. Il ne pardonne pas à sa mère et considère sous le jour d’une infidélité le fait qu’elle ait accordé la faveur du commerce sexuel non pas à lui, mais au père [32] ».
2’) Importance
Dans un dessin de Voutch, on voit un homme attablé dans un restaurant dire à une femme en tendant la main vers sa poitrine : « Je vais maintenant toucher vos seins, Edwige. Il le faut : j’ai promis à maman que je le ferai [33] ». Jules Renard dit un jour à son enfant, âgé de cinq ans : « Fantex, tu es trop grand, maintenant, pour coucher avec ta mère. – Mais je suis moins grand que toi, papa [34] ! »
Ces deux exemples humoristiques – qui parlent de complexe d’Œdipe de manière transparente – montrent une nouvelle fois l’impact de la psychanalyse sur les idées reçus d’aujourd’hui. Ce complexe est une excellente attestation de l’impact de la psychanalyse sur la culture contemporaine. Qui a lu Freud ? Presque personne. Qui n’a jamais entendu parler de « complexe d’Œdipe », de « tuer son père », etc. ? Là encore, presque personne. Quel parent n’a pas entendu d’un parent ou d’un psy ou un pédagogue, de défusionner avec ses enfants, de le laisser dormir dans une autre chambre, de lui interdire le lit conjugal ? C’est dire l’influence massive du freudisme sur les idées de notre temps – ce qui, sur ce point, ne peut que nous réagir.
3’) Origine
Certes, le mythe d’Œdipe ne raconte pas une histoire de blessure, mais une histoire de responsabilité, donc, ici de faute. En effet, il décrit de la manière la plus frappante l’aveuglement du double péché de la fusion incestueuse et de la violence contre l’autre. « Œdipe ne sait pas qu’il est le tueur de son père et l’époux de sa propre mère ». Ou plutôt, il ne veut pas savoir, il s’aveugle sciemment. En effet, si Œdipe se fait ainsi payer, c’est qu’
« il n’a pas été assez attentif aux nombreux indices, dont certains au niveau subliminal, qui se trouvent dans son environnement. Il n’aurait sûrement pas fait ce qu’il a fait, s’il l’avait su. Mais il ne lui est pas venu à l’esprit de se servir de son ignorance comme d’un alibi. […] On pourrait conjecturer qu’Œdipe n’a peut-être pas vu parce qu’il ne voulait pas voir. Le châtiment qu’Œdipe s’inflige à lui-même est aussi un acte concret qui prend une portée symbolique : il se crève les yeux. Puisqu’il ne voulait pas ‘voir’ d’une manière plus abstraite, il a le sentiment qu’il ne mérite pas de voir ». En regard (si je puis dire !), « la seule personne qui a vraiment ‘vu’ et su est le prophète aveugle, Tirésias [35] ».
Autrement dit, il n’y va pas que d’une dynamique du salut, mais aussi d’une dynamique de la lumière sur le péché, ce qui est identique.
4’) Un contenu universel
Dans sa préface à Vingt ans après [36], Dominique Fernandez ne ménage pas son enthousiasme et ses éloges à l’égard de la finesse psychologique d’un auteur dont on méprise les écrits autant que leur genre littéraire, le roman d’aventures – et en vient à défendre celui-ci de la plus belle manière, comme roman intérieur par excellence, comme roman d’imagination au service de l’intériorité. Il montre d’abord que Dumas a anticipé le désir mimétique. En effet, dans La Dame de Monsoreau, nous trouvons le triangle amoureux du duc d’Anjou, de l’autre prétendant, Bussy d’Amboise, et de Diane de Méridor dont les deux hommes semblent très épris ; or, lorsque, dans les dernières des 800 pages, Bussy meurt dans l’embuscade tendue par le duc, celui-ci ne regarde plus Diane et explique à qui s’en étonne : « Ma foi, je ne suis plus amoureux ». Dumas a aussi pressenti le complexe d’Œdipe. En effet, dans Vingt ans après, Raoul, vicomte de Bragelonne, est le fils d’Athos et de la duchesse de Chevreuse, fruit d’une rencontre anonyme et d’une nuit, racontée au chapitre xxii ; le jeune homme ne sait rien de ses origines ; or, alors qu’Athos et la duchesse se demande ce qu’ils vont faire de Raoul, qui a désormais quinze ans et est fort beau, la duchesse étant elle-même des plus séduisantes, l’ancienne Marie Michon dit au mousquetaire : « Laissez-le-moi » et s’entend répondre : « Non pas, Madame ; si vous avez oublié l’histoire d’Œdipe, moi, je m’en souviens » (chap. xcvi. Freud n’était pas né) [37]. Et Dominique Fernandez ajoute le sens profond de ce roman d’aventure : non pas les coups de rapière ou les évasions, mais la « quadripartition » des mousquetaires : « le projection de l’auteur en quatre doubles différents ». Comme dans « les plus grands romans d’aventures du xixe siècle », par exemple, les romans de Stendhal, « au lieu de se raconter lui-même, de se livrer à une confession forcément étriquée, comme tant de jeunes romanciers aujourd’hui, l’auteur de romans d’aventure est celui qui se demande : qu’aurais-je fait si au lieu d’être né dans tel pays, à telle époque, de telle famille, j’étais né sous un autre ciel, avec des coordonnées différentes [38] ? » Appliquons à nos mousquetaires : « Voyons, a pu se dire Dumas, il y a en moi un bravache impénitent, un libertin de l’ancien régime, un capitaliste du nouveau, plus un nostalgique du mystère [39] ». Précisons : le roman d’aventures vaut parce qu’il a multiplié les possibles dans des personnages inventés et des situations que l’auteur n’aurait jamais pu vivre mais où il pourrait se projeter, donc dire ce qu’il porte. Telle est en effet la fonction de l’imagination : inventer des possibles qui révèlent les potentialités latentes et ainsi actualisent ce qui se contenterait de demeurer virtuel.
Le « fameux mythe d’Œdipe est devenu, à travers les écrits psychanalytiques, la métaphore qui sert de référence à un certain nombre de relations émotionnelles au sein de la famille ; celles-ci peuvent être à l’origine des perturbations les plus sérieuses dans la croissance vers une personnalité mature bien intégrée et peuvent par ailleurs être la source potentielle du développement le plus riche de la personnalité [40] ».
« Tout lecteur des écrits de Freud est frappé par la manière décisive dont le complexe d’Œdipe fut découvert ; dans le même mouvement, il apparut à la fois comme un drame individuel et comme le destin collectif de l’humanité, comme un fait psychologique et comme la source de la moralité, comme l’origine de la névrose et comme l’origine de la civilisation [41] ».
b’) Remarque. Son équivalent féminin, le complexe d’Électre
1’) Exposé d’un problème
Concept théorique rattaché à la première topique de Freud, destiné à expliquer le développement psychique de la petite fille, et faisant pendant au concept de complexe d’Œdipe expliquant le développement psychique du petit garçon.
Selon Freud, le développement psychique de l’enfant se déroule selon trois stades successifs. Au cours du premier stade, dit « oral », l’enfant prend son plaisir par l’acte de manger. Le sein de la mère est alors perçu par l’enfant comme objet de plaisir. Lors du deuxième stade, dit « sadique-anal », l’enfant prend conscience de sa puissance sur le monde. Enfin, lors du troisième stade, dit « œdipien » ou « génital », se développe, chez le garçon, le complexe d’Œdipe : les pulsions d’attirance à l’égard de la mère se renforcent, l’enfant devient de plus en plus exigeant et envahissant, ce qui provoque l’opposition du père, lequel cristallise ensuite sur lui des pulsions hostiles de la part du garçon. À l’adolescence, ce complexe provoque l’attirance du garçon pour les filles, et son rejet des autres garçons, ce qui conditionne une sexualité « normale ».
La difficulté saute cependant aux yeux : s’il en allait exactement de la même manière chez la petite fille, alors l’adolescente devrait ressentir une attirance sexuelle pour les autres filles et un rejet des garçons ; or, ce n’est pas ce qu’on observe ; aussi Freud fut-il amené à aménager le concept de complexe d’Œdipe pour l’adapter au cas de la fille et résoudre l’asymétrie constatée entre le développement psychique des garçons et celui des filles.
2’) Description
Ce « complexe d’Œdipe version filles » est nommé « complexe d’Électre » en référence à l’héroïne grecque qui vengea son père Agamemnon en assassinant sa propre mère, Clytemnestre.
Pour Freud, il est clair que la mère « nourricière » est le premier objet d’amour chez la fille comme chez le garçon ; il est clair également que la fille, comme le garçon, découvre vers trois ans que les parents entretiennent des relations sexuelles d’où l’enfant se sent exclu ; il est enfin tout aussi clair que la fille, comme le garçon, cherche alors à s’interposer entre ses parents.
Toutefois, à ce moment, le processus chez la fille se dissocie nécessairement du processus chez le garçon. En effet, lors de cette première phase, dite « phallique » du complexe d’Œdipe, le garçon peut s’interposer entre ses parents en entrant ouvertement en conflit avec son père, ce qu’il réalise en exhibant son pénis ; le père, qui sanctionne ce comportement, se présente alors comme une figure de l’autorité liée à la peur de la castration.
De son côté, la fille, privée de pénis, ne peut entrer ouvertement en conflit avec le père. Aussi chez elle la castration n’est-elle pas ressentie comme la peur de perdre son pénis, mais comme la frustration de ne pas en avoir. Elle peut alors, selon Freud, réagir de trois façons : rejet pur et simple de la sexualité ; rejet de la castration et donc de son destin de future femme ; choix du père comme objet.
Plus précisément, dans ce dernier cas, la fille commencerait à ressentir une attirance pour son père – attirance toute calculée, s’entend, puisqu’il s’agit de lui soutirer un pénis pour se procurer celui qui lui manque. Cette attirance pour le père peut donc s’élaborer sans entamer la pulsion sexuelle pour la mère « nourricière », même si celle-ci prend, temporairement du moins, figure de rivale dans la quête du pénis paternel.
L’explication proposée par Freud permet ainsi de comprendre comment la fille, malgré le même « point de départ » que le garçon (les pulsions sexuelles envers la mère), en vient à ressentir des pulsions sexuelles pour son père et des pulsions hostiles pour sa mère (situation contraire à celle du garçon).
S’il y a même point de départ dans le désir de la mère, la castration divise garçon et fille quant au début du complexe. La castration est, pour le garçon, la sortie du complexe d’Œdipe : le père pose pour le petit d’homme cette menace par excellence, et cet enfant doit abandonner la convoitise de la mère. La castration met fin au complexe d’Œdipe. Tandis que le complexe d’Électre, à proprement parler, débute par la castration – c’est la castration qui, comme on l’a vu, introduit le désir du père. Cette fonction opposée de la castration quant au complexe chez le garçon et la fille n’est pas sans conséquences sur le développement psychique ultérieur.
Comme le complexe d’Œdipe pour le garçon, le complexe d’Électre trouve à se résoudre au moment de l’adolescence, lorsque la fille surmonte la castration, qu’elle commence à élaborer une personnalité propre empruntant à la fois à son père et à sa mère, et qu’elle se met à rechercher d’autres partenaires sexuels que ses parents. Le désir d’enfant, à l’âge adulte, ne serait alors chez la femme qu’une simple sublimation du désir de pénis ressenti dans l’enfance.
Cependant, si le complexe d’Œdipe permet l’expression radicale de l’attirance à l’égard de la mère et d’hostilité à l’égard du père, au contraire, dans le complexe d’Électre, cette expression se teinte toujours d’ambivalence. La fille est attirée par son père, mais seulement dans la mesure où elle cherche à lui soutirer un pénis ; elle ressent une rivalité à l’égard de sa mère, mais continue par ailleurs à s’identifier à elle. Aussi Freud pensait-il que le complexe d’Electre ne se résolvait jamais complètement chez la fille et que ses effets s’en ressentaient dans sa vie mentale de femme.
3’) Critiques
Outre les critiques communes adressées contre le complexe d’Œdipe, voici trois critiques propres.
En outre, le complexe d’Electre autorise trois critiques autonomes. D’abord, Freud prête aux petites filles de son époque une connaissance de l’anatomie humaine qu’elles n’avaient probablement pas. Nombre de jeunes femmes de son époque arrivaient au mariage dans la plus grande ignorance des choses du sexe. Beaucoup ignoraient ce qu’était un pénis, n’ayant jamais vu d’homme nu, surtout pas leur père ou leur frère. On ne comprend donc guère comment une « envie de pénis » peut se développer chez quelqu’un qui ignore jusqu’à l’existence même du pénis. De nos jours, cette explication de Freud reste donc teintée de mystère.
Ensuite, la notion de complexe d’Electre a entraîné de vives critiques de la part du mouvement féministe. L’explication de Freud s’élabore, en effet, à partir d’un « calque » établi à partir du développement psychique du garçon, exactement comme si la fille était une sorte de garçon « bizarre », « anormal ». Freud, d’ailleurs, ne dissimule nullement son point de vue puisque, à l’en croire, la fille se considérerait elle-même comme un « garçon privé de pénis ». À aucun moment Freud ne s’aperçoit que la féminité pourrait s’analyser comme une réalité positive, plutôt que comme une négativité, un défaut par rapport à un garçon supposé meilleur (puisque lui ne « manque » de rien). La conclusion freudienne selon laquelle le complexe d’Electre ne se résoudrait jamais complètement chez la femme adulte confirme la forte misogynie de l’auteur : la femme serait en effet, dans cette perspective, beaucoup moins stable psychologiquement que l’homme. Freud confirme ainsi les préjugés tenaces selon lesquels les femmes seraient naturellement des hystériques ou des caractérielles.
Enfin, le mouvement gay et lesbien conteste fortement les positions de Freud. À l’en croire, en effet, la pérennité du complexe d’Electre chez la femme laisserait entendre que l’homosexualité féminine serait « normale », tandis que l’homosexualité masculine constituerait un symptôme de trouble psychique dû à un complexe d’Œdipe « inversé » non résolu.
c) L’élargissement de la psychanalyse à l’ethnologie : Totem et Tabou (1911-1913)
Ce complexe d’Œdipe était, pour Freud, non seulement une loi individuelle, mais une loi universelle, l’équivalent psychique de la loi d’adaptation que Darwin invente (au sens étymologique : « trouve ») et applique pour faire surgir tout vivant, toute nouvelle espèce. Aussi Freud est-il hanté par le désir de l’appliquer à l’origine de l’humanité. Il le fit dans quatre brefs essais écrits entre 1911 et 1913 et réunis dans un ouvrage au titre célèbre : Totem et Tabou [42].
1’) Contenu
Faut-il s’étonner, après cette introduction, que Totem et Tabou ressemble à une fable darwinienne, tout en reprenant les thèmes centraux de l’Ödipuskomplex, mais appliqués à l’échelle de l’humanité ? Résumons-en le contenu.
Au commencement, les hommes étaient réunis en plusieurs hordes, donc chacune était soumise au pouvoir despotique d’un mâle dominant possédant toutes les femelles. Un jour, les fils de la tribu se révoltèrent contre la domination du père. Non seulement, ils le tuèrent, mais ils dévorèrent son cadavre. Or, après ce parricide, ils éprouvèrent une culpabilité. Ne pouvant supporter ce souvenir traumatique, ils le refoulèrent. Mais ne pouvant non plus s’en débarrasser (les cadavre de la mémoire ne se décomposent pas !), ils inventèrent un nouvel ordre social fondé sur l’instauration de l’exogamie (autrement dit l’interdit de la possession des femmes appartenant au clan, c’est-à-dire l’interdit de l’inceste) et du totémisme, c’est-à-dire du substitut du père qu’est le totem (autrement dit, l’interdit du meurtre du père).
Ainsi, par cette fable, Freud expliquait les interdits fondateurs de la société et de la morale : interdit de l’inceste, interdit du meurtre du père. En même temps, il les fondait en convoquant non pas l’éthique traditionnelle, mais la psychologie, plus précisément, son complexe d’Œdipe qui consistait justement dans l’expression des deux désirs (épouser la mère et tuer le père) et la transgression de ces deux interdits.
Bien évidemment, Freud n’était pas créateur. En effet, nombre des matériaux composant le livre provenaient d’autres origines : le thème de la horde sauvage était emprunté à Charles Darwin [43] ; celui de la récapitulation de la phylogenèse dans l’ontogenèse à Ernst Haeckel [44] ; celui d’un roi meurtrier de son prédécesseur et devenu à son tour la victime du monarque successeur, à James Georg Frazer [45] ; celui du repas totémique et de la substitution du clan à la horde à William Robertson Smith [46] ; celui de l’effondrement du système patriarcal par la rébellion des fils dévorant leur père à James Jasper Atkinson [47] ; celui de l’horreur de l’inceste et des mariages consanguins à Edward Westermack [48].
Néanmoins, une nouvelle fois, l’inédit ne tenait pas tant à la matière ou plutôt au matériau ou au contenu, qu’à la configuration, l’arrangement des éléments.
2’) Exposé systématique par Ricœur
Comme point de départ [49], Freud reprend la grille historique établie par Auguste Comte (la loi des trois états), mais en la réinterprétant complètement par le biais de la psychanalyse. La correspondance est la suivante :
|
Évolution de l’humanité selon Comte |
Évolution de l’humanité selon Freud |
Évolution de l’individu humain selon Freud |
|
Ère religieuse |
État mythologique ou pré-animiste |
Le narcissisme |
|
Ère métaphysique |
État religieux |
Le choix d’objet |
|
Ère positiviste ou scientifique |
État scientifique |
Le principe de réalité |
Freud, dit Ricœur, analyse les mécanismes en jeu dans la genèse des deux premières étapes.
a’) Premier temps : la magie et le pré-animisme [50]
Ici, le processus psychique en cause est la toute-puissance des idées. C’est ce que la magie montre à l’évidence. Mais celle-ci constitue la phase la plus primitive de l’animisme, car elle n’implique pas encore la croyance en l’existence des esprits. Or, il y a peu de fondements ethnologiques à une telle hypothèse. Aussi, note Ricœur, « l’intervention de la psychanalyse, dès la sélection des matériaux […] est […] manifeste ».
Ricœur critique cette analyse en estimant peu convaincant la relation mise entre narcissisme et toute-puissance des idées. Reste qu’il est très juste que « la première problématique religieuse est une problématique de la toute-puissance ».
b’) Deuxième temps : la religion animiste [51]
Le premier mécanisme en jeu est la projection. En effet, la toute-puissance du désir va se déplacer ; et l’on devrait assister à un renoncement au narcissisme comme on le voit dans le devenir de l’individu humain. Pourquoi ? La raison en est un processus économique : la projection dans la réalité de nos dynamismes psychiques. Et voilà ce qui explique l’animisme.
Le second mécanisme (plus secondaire) est le remaniement ou l’élaboration secondaire. En effet, ce processus emprunté à la théorie du rêve rend compte du caractère systématique de l’animisme, ce que ne fait pas la seule projection.
c’) Troisième temps : le meurtre du père primitif [52]
Il s’agit maintenant d’expliquer l’apparition de la religion. Aux deux autres mécanisme analysés (toute-puissance de la pensée et projection de cette puissance dans la réalité) vient s’adjoindre le complexe d’Œdipe et sa puissance de réconciliation.
Totem et Tabou établit qu’aux origines, il a existé le meurtre du père primitif prolongé par le repas totémique [53]. Or cet évènement est à l’origine :
– de l’organisation sociale : par le pacte des frères.
– de l’institution morale : par l’obéissance rétrospective qui en résulte.
– de la religion, par un double mécanisme psychique : d’une part, la culpabilité causée par le souvenir refoulé mais bien présent du meurtre ; cette culpabilité invite à trouver une conduite obtenant une réconciliation. Mais d’autre part, l’image du père est toujours investie par des attitudes ambivalentes et la révolte à son égard n’est jamais éteinte. Aussi trouve-t-on de même une tendance à commémorer ce triomphe sur le père de manière déguisée. Tel est le sens profond du repas totémique qui resurgit dans l’eucharistie chrétienne.
Ricœur finit en commentant : « Ce qui est frappant dans cette histoire, c’est qu’elle ne constitue pas une avance […], mais la sempiternelle répétition de ses propres origines […] le lieu du piétinement émotionnel. C’est pourquoi les lacunes de cette histoire sont par principe inessentielles [54] ». Cette thématique de l’archaïsme que relève ici Ricœur est fondamentale pour saisir son interprétation.
3’) Réception
Un constat. Ici, la majeure partie d’entre vous, vous n’avez pas lu l’ouvrage. Pourtant, qui, lorsque j’ai résumé l’ouvrage, n’a eu l’impression d’entendre une histoire déjà connue. Preuve, une nouvelle fois, que les principales thèses de la psychanalyse sont passées dans la culture, voire l’air du temps. Donc, de l’influence considérable du freudisme.
Une nouvelle fois aussi, Freud va à contre-courant : alors que l’anthropologie de son époque avait renoncé à chercher les fameux « mythes d’origine », le penseur viennois propose un nouveau mythe d’origine ; alors que les tendances nouvelles en ethnologie étaient à l’étude sur le terrain, aux expéditions et à la plongée dans la langue et les mœurs des peuples que l’on appelle aujourd’hui « premiers » et que l’on qualifiait à l’époque de « sauvages », Freud écrit à partir de son appartement de la Berggasse, certes, en réunissant, comme toujours, une documentation considérable [55], mais sans nulle étude de terrain.
d) La transition : l’étude sur le narcissisme (1914)
Un article important de 1914 servira de transition avec ce que l’on peut appeler le « second Freud » : « Pour introduire le narcissisme » [56]. Pour cette approche nouvelle, Freud se fonde sur l’un des proches, Karl Abraham, clinicien des psychoses. Jusqu’à maintenant, la libido était la manifestation de la pulsion sexuelle ; désormais, elle pouvait se reporter sur le moi. Ce dédoublement de la libido entraînait un dédoublement du narcissisme en primaire et secondaire, le premier étant l’état premier du sujet et le second un désinvestissement postérieur de l’objet. Or, autant les névroses étaient une pathologie du narcissisme secondaire, autant les psychoses touchaient le narcissisme primaire, donc étaient enracinés beaucoup plus profondément et primitivement dans l’histoire du sujet.
Désormais, la culpabilité ne relevait plus du meurtre fantasmé du père (et du désir lui aussi fantasmé de la mère), mais, plus radicalement, de la contemplation de son image. C’est dire si l’homme était habité par un désir profond de se détruire.
Quoi qu’il en soit du contenu de cet article qui fit date et est toujours étudié avec attention aujourd’hui, on ne peut qu’admirer cet homme qui, à soixante ans, est encore capable non seulement de se renouveler, mais de se remettre en question.
5) Précisions de la première théorie psychanalytique
a) L’évolution psychique
1’) Le stade oral
Il se caractérise notamment par la fusion avec l’objet et avec la mère donatrice.
Pour Freud, relu par Lacan, la relation du nourrisson à sa mère est avant tout fusionnelle. De cette première caractéristique se déduisent quatre autres : le monde de la petite-enfance est un monde sans altérité, un monde de l’immédiateté, de la toute-puissance et de l’invulnérabilité. Voici comment le moraliste et psychanalyste Xavier Thévenot présente de manière vulgarisée mais sans simplisme :
« Ce monde originel méconnaît en effet les deux plus grandes différences qui existent au monde : celle du temps qui marque toutes nos vies et celle de la présence de l’autre à laquelle il faut nécessairement s’affronter pour vivre. Par ailleurs, ce monde fusionnel ne recèle aucune médiation puisqu’une médiation présuppose que l’on soit marqué par des différences. C’est aussi un monde sans faille et notamment sans les deux grandes failles que nous rencontrons dans nos vies : la faille de l’échec et la faille radicale de la mort. Enfin c’est un monde où existe un rêve de toute puissance, puisque l’infans [l’enfant] ne connaît pas encore l’autre et vit dans le registre pur du même ou de l’identique. Il lui semble donc que rien ne peut résister à son pouvoir [57] ».
Que penser de cette description ? Elle me semble juste, moyennant deux précisions d’importance qui portent toutes deux sur le concept clé de fusion [58]. Tout d’abord, pour nos auteurs, l’indifférenciation est la notion première. Je dis que cette notion n’est pas première mais seconde. Si le tout-petit vit dans la fusion, c’est parce qu’il vit dans le sensible. Vous me direz peut-être que c’est là un débat de mots. Nullement. Il y va de toute une vision de l’homme.
Seconde critique. Même si je fais occasionnellement appel à ce terme, je trouve le concept-même de fusion ambigu. La fusion est une proximité sans altérité, immédiate ; or, du fait de la présence en lui des ouvertures spirituelles, l’enfant n’est jamais en relation d’indifférenciation totale avec sa mère : dès le commencement, il y a non pas fusion, mais communion. Le bébé manifeste qu’il est différent, qu’il ne veut ni engloutir ni se laisser engloutir par la mère : l’attachement ne nie pas la distance, mais l’instaure.
2’) Le stade anal, à deux ans, se caractérise par plusieurs caractéristiques
– la bipédie est l’affrontement de l’environnement ;
– l’acquisition du langage ;
– le premier exercice, embryonnaire de la liberté : le plaisir nouveau de pouvoir dire oui ou non à une demande. Or, l’une des premières demandes portera sur la propreté.
– L’apprentissage de l’erreur à travers celui du déchet.
3’) Le stade phallique
– L’enfant fait l’expérience que les deux parents ne sont pas ses esclaves à son service : ils peuvent être heureux sans lui (puisqu’ils ont leur lit à part) ; ils agissent parce qu’ils s’aiment.
– Il fait l’expérience de la relation que les deux parents ont entre eux, indépendamment de lui. Ils sont époux.
– Dès lors, l’enfant quitte la préhistoire pour entrer dans une histoire. Il cesse d’être le « petit sauvage » dont parle Diderot.
b) Règles en thérapie
Double règle de haute valeur thérapeutique en psychanalyse :
– au plan du langage : la non-intervention pour permettre le transfert ;
– au plan de l’action : l’abstinence pour permettre l’accès à l’âge adulte.
L’abstinence du psychanalyste n’est pas d’abord une règle éthique mais une règle thérapeutique. En effet, dans le transfert, le patient, l’analysant revit avec son psychanalyste les désirs et les conflits de la petite enfance ; or, le petit enfant est dans une toute-puissance qui exige la réalisation de ses désirs ; si donc le psychanalyste passe à l’acte, il maintient son patient en position régressive. Inversement, en se voyant refuser de et donc en refusant de vivre l’amour comme la haine « pour de vrai » [59], l’analysant va apprendre à vivre le manque ; or, on ne sort de la toute-puissance que par le renoncement ; et l’arrachement à la toute-puissance permet le passage à la maturité ; la réserve du psychanalyste éduque donc l’analysant à l’ascèse nécessaire à l’accès à l’âge adulte.
Cela éclaire la chasteté et le refus de toute intrusion, de tout inceste, même dans une relation entre adultes, à partir du moment où l’un des deux adultes adopte une position dominante, investie comme tel.
c) Le transfert [60]
« Quant au transfert, il est une véritable croix [61] ». Ainsi s’exprimait Freud au sujet de ce processus qui, pour être possiblement le plus thérapeutique, est aussi le plus difficile à vivre.
Dans le cadre d’une critique de la position éthique et canonique de l’Église catholique à l’égard du mariage et du refus du divorce, le « théologien » allemand Eugen Drewermann propose une étude du transfert amoureux. La grande pédagogie de son exposé explique les longues citations [62].
1’) Présupposés génétiques
a’) Genèse chez l’enfant
« Psychologiquement, il n’est d’amour qui ne commence par être amour des parents, donc amour de dépendance. Les parents sont les premiers capables de combler le vide ressenti par tout être qui vient au monde. C’est leur présence qui garantit à l’enfant la chaleur, la protection, la nourriture, la sécurité, l’accueil et la compréhension qui lui sont nécessaires, et quand on dit qu’il ‘dépend’ d’eux dans son amour, on désigne par là une ‘dépendance’ radicale [63] ».
« Dans la suite de sa vie, il tentera de vérifier la valeur de ces attitudes sur d’autres personnes, ce qui le conduira à les renforcer ou à en changer, selon que cela l’aura conduit au succès ou à l’échec ; mais toute relation à autrui se trouvera fondamentalement imprégnée par ces premières expériences faites auprès du père et de la mère. En un sens, on peut donc dire que, psychologiquement, l’amour adulte non seulement éloigne des parents, mais aussi reconduit à eux. D’une façon ou d’une autre, un tel amour adulte est dans la continuité d’un amour parental qu’il prolonge [64] ».
b’) À l’âge adulte
« Les caractères du transfert de l’amour parental
« Rien ne lui apparaît digne d’amour ou de haine sans que n’intervienne implacablement quelque trace mnésique de l’enfance. La fascination que peut exercer une femme, ou, pour parler en termes plus usuels, son ‘étrangeté’ [65], repose finalement sur la proximité qu’elle entretient avec l’image de la mère, image qui continue à agir. Un homme semble avoir une personnalité d’autant plus ‘séduisante’ et ‘impressionnante’ qu’elle reproduit en filigrane les traits du père. Il suffit manifestement de quelques traits infimes de ressemblance avec l’image inconsciente que l’on maintient de ses parents pour faire ressurgir avec toute leur vigueur les sentiments, les idées et les comportements que l’on avait eus envers ceux-ci des années plus tôt, au cours d’une enfance oubliée depuis longtemps. Pour ressusciter l’imago parentale, nul besoin de correspondances affirmées entre l’être aimé et les parents [66]. La liaison s’opère plutôt à la façon dont on peut remettre en route une cassette enregistrée vingt ans plus tôt : il suffit d’appuyer sur un bouton pour ramener un lointain passé au présent.
2’) Définition : qu’est-ce que le transfert ?
a’) Enoncé
« Tout comme Freud, nous désignerons par ‘amour de transfert’ [67] un tel amour, celui qui ne consiste qu’à transférer sur un partenaire les images que l’on a gardées des parents ; et nous devrons alors nous demander comment il naît et quelles conséquences morales, juridiques et théologiques nous devons en tirer.
b’) Précision
« Il importe en premier lieu de voir que le transfert amoureux ne porte pas sur l’aimé, mais que celui-ci n’est rien d’autre qu’un prétexte à la répétition [68] des positions enfantines. Sa force invincible, bienfaisante ou destructrice, tient uniquement au fait qu’il ne porte absolument pas sur l’être apparemment aimé, mais fait de celui-ci la surface réfléchissante du transfert infantile. Il provoque la régression de l’amoureux vers une forme infantile de dépendance et d’inquiétude. Il ne lui permet pas de voir l’autre tel qu’il est vraiment ; il ne le lui laisse entrevoir q’à travers le voile des transferts qu’il interpose inconsciemment entre lui et le réel.
« Du fait qu’il détourne ainsi de la réalité, le caractère infantile du transfert amoureux comporte un fort coefficient de narcissisme [69].
c’) Conséquences par rapport à l’autre
« C’est ce qu’on peut déceler dans les blessures et les déceptions qu’éprouve l’amoureux dès que l’’aimé’ ose visiblement s’écarter des attentes infantiles qui sous-tendent son amour ; il lui oppose alors instantanément reproches démesurés, accès de désespoir et chantages menaçants, et il ne retrouve la paix que quand il a réussi à faire rentrer l’ »aimé » dans le corset du comportement attendu. En un sens, celui qui aime par transfert se montre incapable d’admettre activement l’autre : il ne fait que se retrouver lui-même [70] ».
« Dans la genèse d’un transfert amoureux, le facteur le plus actif, c’est l’angoisse. Avec l’âge, un enfant parvient à se libérer de la force des images parentales ; mais cela à condition d’échapper à l’emprise de la peur – et du sentiment de culpabilité qui lui correspond, autrement dit à la peur de la punition – qui a pu le submerger au cours des premières années de son développement psychologique, donc au moment où il se trouvait contraint de s’identifier à des parents qui multipliaient prescriptions morales et exigences psychiques. Pour ne pas perdre ses parents, apparemment tout-puissants, et donc pour échapper à la pire forme de punition, l’angoisse de la perte [71], l’enfant s’est désespérément raccroché au modèle parental en en introjectant les figures au point d’être écrasé par elles [72]. On ne peut comprendre le souci ultérieur de l’adulte de retrouver dans l’aimé le substitut du père ou de la mère perdus que si on comprend de quelle angoissante mélancolie est saisi un enfant à l’idée de perdre toute valeur, de se trouver sans père ni mère, d’être donc réduit à rien [73]. Un mariage conclu dans ces conditions comporte donc toujours une terrible ‘erreur sur la personne’, dans la mesure où l’autre ne répond jamais totalement, et le plus souvent même pas du tout, à la figure des parents qu’on regrette : l’amour de transfert repose précisément sur ce faux espoir de correspondance totale entre l’imago parentale et le conjoint [74] ».
3’) Difficulté
a’) Objection
« Une personne bienveillante sera peut-être tentée de mettre en doute le caractère fatal et forcé de l’amour de transfert : un tel transfert de l’amour du père ou de la mère, avec toute l’absence de liberté qu’il comporte, est-il vraiment possible ? Mais il faut bien finalement admettre que cette notion n’a rien d’une pure hypothèse spéculative : elle ne fait qu’expliquer des faits.
b’) Réponse par des exemples
« Qui n’a pas un jour ou l’autre fait l’expérience d’une femme de son entourage qui, contre toute raison, se donne au séducteur bien connu et envoie tout promener du jour au lendemain, à la grande surprise de tous ceux qui la connaissent, se lançant ainsi dans une aventure absolument sans issue, dangereuse, et finalement fort peu attrayante ? En tournant l’Histoire d’Adèle H. [75], François Truffaut a bien mis en valeur l’espèce de magie, l’étrange hypnotisme, le délabrement intérieur qui ont conduit la fille du célèbre Victor Hugo, personne fort belle, très douée et extrêmement sensible, à se précipiter comme une folle, en dépit de toutes les rebuffades, des froideurs et des déceptions, dans la folie de son premier amour pour un snob insignifiant et indigne d’elle, auquel elle gardera toujours une fidélité qui n’est pas payée de retour. À aucun moment de son film Truffaut ne propose quelque explication que ce soit à la passion effrénée d’Adèle. Mais il est parfaitement clair que la malheureuse fille de Hugo, sans jamais tenir aucun compte de la réalité, admire et porte aux nues comme elle le faisait de son père l’homme pour lequel elle gâche sa vie. Et il est vraiment tragique de voir qu’un homme comme Victor Hugo, si sensible, si humain, si bon, soit capable de tout comprendre, sauf sa propre contribution, due à son éminente personnalité, à la faillite de sa fille bien-aimée. La littérature ne cesse de multiplier de tels exemples de transfert amoureux : qu’on songe par exemple à la nouvelle de Stephan Zweig Vingt-quatre heures de la vie d’une femme, où il décrit l’irrésistible irruption d’une connaissance d’hôtel dans la vie jusque-là apparemment si bien ordonnée et si morale d’une femme [76] ».
4’) Application à l’amour. Le transfert amoureux
Freud a porté le fer de la déconstruction au cœur de l’amour. Au nom du transfert qui n’est que la répétition d’une image archaïque et inconsciente.
« L’expérience montre que, parmi les émois qui déterminent la vie amoureuse, une partie seulement parvient à son plein développement psychique ; cette partie, tournée vers la réalité, forme un des éléments de la vie conscience qui en peut disposer. Une autre partie de ces émois libidinaux a subi un arrêt de développement, se trouve maintenue éloignée de la personnalité consciente comme de la réalité et peut, soit ne s’épanouir qu’en fantasmes, soit rester tout à fait enfouie dans l’inconscient ». Or, « tout individu auquel la réalité n’apporte pas la satisfaction entière de son besoin d’amour se tourne inévitablement avec un certain espoir libidinal, vers tout nouveau personnage qui entre dans sa vie et il est dès lors plus que probable que les deux parts de sa libido, celle qui est capable d’accéder au conscient et celle qui demeure inconsciente, vont jouer leur rôle dans cette attitude [77] ».
Freud a porté le fer de la déconstruction au cœur de l’amour. Au nom du transfert qui est d’essence amoureuse et répète un événement archaïque et inconsciente : « Cet état amoureux [Freud parle d’un cas pathologique] n’est qu’une réédition de faits anciens, une répétition des réactions infantiles, mais c’est là le propre de tout amour et il n’en existe pas qui n’ait son prototype dans l’enfance [78] ». Ainsi le roi Lear nous donne à voir au terme de sa vie « l’amour de la femme », non pas en lui-même, mais « tel qu’il l’a reçu d’abord de sa mère », et cela le conduit à la troisième des « relations inévitables de l’homme à la femme », non pas « la génitrice » ou « la compagne », mais « la destructrice [79] ».
5’) Application au contre-transfert [80]
Il fallut attendre le début des années 1950 pour que le contre-transfert commence à être pensé comme un outil technique dont dispose l’analyste via son psychisme. Bien que des précurseurs s’engagèrent sur cette voie dès les années 1920 et 1930, aucun ne parvint à théoriser le contre-transfert au niveau où le firent Paula Heimann (en Angleterre) et Heinrich Racker (en Argentine). Dans le travail de Racker, le plus exhaustif jamais réalisé par un analyste, le contre-transfert apparaît comme une névrose : névrose de contre-transfert ou névrose à deux. Racker établit une classification rigoureuse des différentes formes de contre-transfert et des identifications qui y sont associées. Il s’attaque au mythe de l’analyste ‘sain’ qui recevrait un patient ‘malade’. Cette conception du contre-transfert implique par ailleurs une nouvelle vision de l’auto-analyse, celle d’un travail jamais achevé.
Pascal Ide
[1] Cf. Les premiers psychanalystes. Minutes de la Société psychanalytique de Vienne. Tome 1. 1906-1908. Tome 2. 1908-1910. Tome 3. 1910-1911. Tome 4. 1912-1918, trad. Nina Schwab-Bakman, Paris, Gallimard, 1976, 1978, 1978, 1983.
[2] Ludwig Binswanger, Discours, parcours et Freud, trad. Roger Lewinter, Paris, Gallimard, 1970, p. 271.
[3] Élisabeth Roudinesco, Sigmund Freud…, p. 147.
[4] Comment ne pas déplorer qu’une édition critique – et même seulement complète en français – des multiples ouvrages du plus doué des disciples de Freud n’existe pas encore ?
Sur la vie de Jung, cf. d’abord son autobiographie : Carl Gustav Jung, Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées, recueillis par Aniéla Jaffé, Paris, Gallimard, 1966. À compléter par la monumentale étude de Deirdre Bair, Jung. Une biographie, trad. Martine Devillers-Argouarc’h, coll. « Grandes Biographies », Paris, Flammarion, 2007 et la présentation remarquable qu’offre Henri F. Ellenberger, dans l’ouvrage cité en F.1.
Sur ses œuvres principales, cf., notamment, Carl Gustav Jung, Psychogenèse des maladies mentales, trad. Josette Rigal, Paris, Albin Michel, 2001 ; Dialectique du moi et de l’inconscient, trad. Roland Cahen, coll. « Les Essais », Paris, Gallimard, 1964 ; L’homme à la découverte de son âme, trad. Roland Cahen, coll. « Petite Bibliothèque », Paris, Payot, 1966, rééd., Paris, Albin Michel, 1987.
[5] Sigmund Freud et Karl Abraham, Lettre du 3 mai 1908, Correspondance complète, 1907-1926, trad. Françoise Cambon, Paris, Gallimard, 2006, p. 71.
[6] Cf. Élisabeth Roudinesco, « Carl Gustav Jung. De l’archétype au nazisme. Dérives d’une psychologie de la différence », L’infini, 63 (automne 1998) ; cf. aussi Id., Sigmund Freud…, p. 455-461. Il faut le dire, Jung a fait preuve d’un antisémitisme de plus en plus grand.
[7] Cf. Deirdre Bair, Jung, p. 115.
[8] Il existe plusieurs versions de cette importante première rencontre, chez Jung (Ma vie), Deirdre Bair (Jung, p. 182-189), Linda Donn (cf. plus bas), etc. Il est significatif que Freud n’en parle pas.
[9] Élisabeth Roudinesco, Sigmund Freud…, p. 166 ; cf. p. 165-168.
[10] Ludwig Binswanger, Discours, parcours et Freud, p. 268-269.
[11] Sigmund Freud, Lettre du 17 janvier 1909, dans Sigmund Freud et Carl Gustav Jung, Correspondance 1906-1914. Tome 1. 1906-1909, éd. William McGuire, trad. Ruth Fivaz-Silbermann, Paris, Gallimard, 1975, p. 271.
[12] Carl Gustav Jung à Sigmund Freud, Lettre du 28 octobre 1907, p. 149.
[13] Élisabeth Roudinesco, Sigmund Freud…, p. 167.
[14] Ernest Jones, La vie et l’œuvre de Sigmund Freud. Tome 2. Les années de maturité. 1901-1919, p. 36.
[15] Sigmund Freud et Carl Gustav Jung, Correspondance 1906-1914. Tome 1. 1906-1909. Tome 2. 1910-1914, éd. W. McGuire, trad. R. Fivaz-Silbermann, Paris, Gallimard, 2 volumes, 1975.
[16] Sur la rupture avec Freud, la bibliographie est abondante. Outre les titres déjà cités, cf. surtout Linda Donn, Freud et Jung. De l’amitié à la rupture, 1988, trad. Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, p.u.f., 1995.
[17] Carl Gustav Jung, Ma vie, p. 189.
[18] Sur l’introduction de la psychanalyse aux États-Unis, cf. Nathan George Hale, Freud et les américains. 1. L’implantation de la psychanalyse aux Etats-Unis, 1876-1917, 1971, trad. Paul Rozenberg, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 2001 ; Éli Zaretsiky, Le siècle de Freud. Une histoire sociale et culturelle de la psychanalyse, 2004, trad. Pierre-Emmanuel Dauzat, coll. « Sciences humaines », Paris, Albin Michel, 2008.
[19] Cf. Samuel Huntington, « The Clash of Civilizations », Foreign Affairs, 27 (1993) : « Le choc des civilisations », Commentaire, 66 (été 1994). Cet article retentissant a fait l’objet d’un ouvrage : The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York, Simon & Schuster, 1996 : Le choc des civilisations, trad. Jean-Luc Fidel et Geneviève Joublain, Patrice Jorland et Jean-Jacques Pédussaud, Paris, Odile Jacob, 1997.
[20] Cf. Sigmund Freud, « La morale sexuelle ‘civilisée’ et la maladie nerveuse des temps modernes », 1908, La vie sexuelle, p. 28-46.
[21] Sur le voyage effectué par les trois hommes, cf. Vincent Brome, Les premiers disciples de Freud. Les luttes de la psychanalyse, 1967, trad. Pierre Sullivan, Paris, p.u.f., 1978 ; Jung. Man and Myth, New York, Atheneum, 1981 ; Saul Rosenzweig, Freud, Jung and Hall the King-Maker. The Historic Expedition to America (1909), Seattle, Toronto et Berne, Hogrefe & Huber, 1992.
[22] Cette phrase est rapportée par Jung dans son entretien avec Kurt Eissler, 29 août 1953, Library of Congress, box 114, folder 4 ; cf. Vincent Brome, Les premiers disciples de Freud, p. 117.
[23] Sur l’origine de la légende, cf. Élisabeth Roudinesco, « Lacan, the Plague », Psychoanalysis and History, Teddington, Artesian Books, 2008.
[24] Sigmund Freud, Lettre du 10 janvier 1909, Sigmund Freud et Sandor Ferenczi, Correspondance, 1908-1933, éd. André Haynal, trad. par le Groupe de traduction du Coq-Héron, Paris, Calmann-Lévy, 3 vol., Tome 1. 1908-1914, Paris, Calmann-Lévy, 1992, p. 40.
[25] Elles ont été rédigées par Freud en un second temps : Cinq leçons de psychanalyse, 1910, trad. Yves le Lay, coll. « Petite Bibliothèque Payot », Paris, Payot, 1977 ; Cinq conférences, trad. Cornélius Heim, Paris, Gallimard, 1991. Leur succès fut telle qu’elles furent rapidement traduites en diverses langues.
[26] Sigmund Freud, Sigmund Freud présenté par lui-même, 1925, trad. Françoise Cambon, Paris, Gallimard, 1984, p. 88.
[27] Barbara Low, Témoignage, sans date, Library of Congress, box 121, folder 5.
[28] Sigmund Freud, Lettre du 17 octobre 1909, in Sigmund Freud et Carl Gustav Jung, Correspondance. tome 1, p. 336.
[29] Sigmund Freud, Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci, 1910, trad. Janine Altounian, André Bourguignon, Pierre Cotet et René Lainé, Paris, Gallimard, 1987 : OCF.P, tome 10, p. 79-164.
[30] Ibid., p. 89.
[31] Sigmund Freud, « D’un type particulier de choix d’objet chez l’homme », in OCF.P, tome 10, p. 197.
[32] Ibid.
[33] Voutch, Personne n’est tout blanc, coll. « La bibliothèque du dessinateur », Paris, Éd. Le cherche midi, 2002, p. 32.
[34] Michel Leeb, Le meilleur de l’humour français, coll. « Le sens de l’humour », Paris, Éd. Le cherche midi, 1992.
[35] Silvano Arieti, Creativity : the Magic Synthesis, New York, Basic Books, 1976, p. 151-152.
[36] Alexandre Dumas, Vingt ans après, coll. « Folio classique », Paris, Gallimard, 1975, p. 7-15.
[37] Cf. Ibid., p. 12-13.
[38] Ibid., p. 14-15.
[39] Ibid., p. 15.
[40] Bruno Bettelheim, The Use of Enchantment, New York, Vantage, 1977, p. 195.
[41] Paul Ricœur, Le conflit des interprétations. Essais d’herméneutique, coll. « L’ordre philosophique », Paris, Seuil, 1969, p. 188.
[42] Cf. Sigmund Freud, Totem et Tabou. Quelques concordances entre la vie psychique des sauvages et celle des névrosés, 1912, trad. Marielène Weber, Paris, Gallimard, 1993 : OCF.P, tome 11, p. 189-385.
[43] Cf. Charles Darwin, La filiation de l’Homme et la Sélection liée au sexe, trad. coordonnée par Michel Prum, Paris, Syllepse, 1999.
[44] Cette théorie de la récapitulation aussi appelée la « loi biogénétique fondamentale » fut formulée par le biologiste allemand polygraphe Ernst Haeckel, dans Generelle Morphologie der Organismen, Berlin, Reimer, 1866. Cf. Stephen Jay Gould, Ontogeny and Phylogeny, Harvard (Mass.), Belknap Press of Harvard University Press, 1977. Cf. l’article classique de Louis Vialleton, « La loi biogénétique de Hackel », Revue de Métaphysique et de Morale, 16 (1908) n° 4, p. 448-465.
[45] Cf. James Georg Frazer, Le cycle du rameau d’or, 1911-1915, trad. Nicole Belmont et Michel Izard, coll. « Bouquins », Paris, Laffont, 4 vol., 1981-1984.
[46] William Robertson Smith, Lectures on the Religion of the Semites. The Fundamental Institutions, 1889, New York, McMillan, 1927.
[47] Cf. James Jasper Atkinson, « Primal Law », in Andrew Lang (éd.), Social Origins, London, Longmans, Green & Co, 1903, p. 209- 294.
[48] Cf. Edward Alexander Westermack, Histoire du mariage humain, 1891, trad. Arnold Van Gennep, Paris, Mercure de France, 1934-1945, 6 vol.
[49] Cf. Paul Ricœur, De l’interprétation. Essai sur Freud, coll. « L’ordre philosophique », Paris, Seuil, 1965, p. 232.
[50] Ibid., p. 232-234.
[51] Ibid., p. 234-237.
[52] Ibid., p. 237-239.
[53] Cf. Sigmund Freud, Totem et Tabou, ch. 4.
[54] Ibid., p. 238-239.
[55] Freud cite notamment beaucoup l’ouvrage de l’historien français Salomon Reinach, Cultes, mythes et religions, Paris, Ernest Leroux, 1905.
[56] Sigmund Freud, « Pour introduire le narcissisme », 1914, La vie sexuelle, p. 81-105 : OCF.P, tome 12, p. 213-247.
[57] Xavier Thévenot, Les péchés, que peut-on en dire ?, Mulhouse, Salvator, 1983, p. 29.
[58] Pour le détail de la critique, je renvoie à l’Annexe I.
[59] « La pratique analytique se fonde sur l’abstinence des relations réelles analyste/patient : l’amour ou la haine ne doivent jamais y être ‘pour de vrai’ » (Nicole Jeammet, La haine nécessaire, coll. « Le fait psychanalytique », Paris, p.u.f., 21995, p. 13).
[60] Cf., par exemple, Le transfert en psychanalyse, Dossier dans Revue d’éthique et de théologie morale. « Le Supplément », n° 211 (décembre 1999) et n° 212.
[61] Sigmund Freud, Lettre du 5 juin 1910, in Correspondance avec pasteur Pfister 1909-1939, trad. Lily Jumel, « Tel », Paris, Gallimard, 1969, p. 75.
[62] Eugen Drewermann, Ethique et psychanalyse, II. L’amour et la réconciliation, trad. Jean-Pierre Bagot, Paris, Le Cerf, 1992.
[63] Léopold Szondi, Triebpathologie. I. Elemente der exakten Triebpsychologie und Triebpsychiatrie, Bern, Hans Huber, 1952, p. 419-420.
[64] Eugen Drewermann, Ethique et psychanalyse, II. L’amour et la réconciliation, p. 41.
[65] Cf. Sigmund Freud, « L’inquiétante étrangeté », 1919, Essais de psychanalyse appliquée, trad. Marie Bonaparte et Mme E. Marty, coll. « Idées », Paris, Gallimard, 1933, p. 163-210.
[66] Sigmund Freud a lui-même recouru à cette expression dans « La dynamique du transfert », 1912, trad. Anne Berman, coll. « Bibliothèque de psychanalyse », La technique psychanalytique, Paris, p.u.f., 1953, p. 50-60.
[67] Sigmund Freud, « Observations sur l’amour de transfert », 1915, Ibid., p. 116-130.
[68] Sigmund Freud, « Remémoration, répétition et élaboration », 1914, ibid., p. 105-115.
[69] Sigmund Freud, « Pour introduire le narcissisme », 1914.
[70] Eugen Drewermann, Ethique et psychanalyse. II. L’amour et la réconciliation, p. 42-43.
[71] Cf. Sigmund Freud, « Deuil et mélancolie », 1916, Métapsychologie, p. 147-174.
[72] L’expression vient de Sandor Ferenczi, « Transfert et introjection », 1909, trad. Judith Dupont et Philippe Garnier, Œuvres complètes. I. 1908-1912, Paris, Payot, 1990, p. 93-125.
[73] Sigmund Freud, Deuil et mélancolie (1916), ibid.
[74] Eugen Drewermann, Ethique et psychanalyse. II. L’amour et la réconciliation, p. 44-45.
[75] 1975, avec Isabelle Adjani dans le rôle-titre.
[76] Cf. Stefan Zweig, Vingt-quatre heures de la vie d’une femme, trad. Olivier Bournac et Alzir Hella, coll. « Le Livre de Poche » n° 4340, Paris, Stock, 1992
[77] Sigmund Freud, « La dynamique du transfert », La technique psychanalytique, trad. Anne Berman, Paris, p.u.f., 1953, respectivement p. 50-60, ici p. 50-51. Cf. « Observations sur l’amour de transfert », Ibid., p. 116-130
[78] Sigmund Freud, « Observations sur l’amour de transfert », La technique psychanalytique, p. 116-130, ici entre p. 121 et 127. Cf. « La dynamique du transfert », Ibid., p. 50-60.
[79] Sigmund Freud, « Le motif du choix des coffres », L’inquiétante étrangeté et autres essais, trad Bertrand Féron, Paris, Gallimard, 1985, p. 80-81.
[80] Heinrich Racker est le grand spécialiste du contre-transfert. Sur les phénomènes de transfert et de contre-transfert, cf. Heinrich Racker, Transference and countertransference, Madison (Connecticut), Madison Connecticut International University Press, 71995 : Transfert et contre-transfert. Études sur la technique psychanalytique, Lyon, Césura Lyon, 2000. Cf. Angela Goyena, « Heinrich Racker ou le contre-transfert comme un nouveau départ de la technique psychanalytique », Revue française de psychanalyse, 70 (2006) n° 2, p. 351-370.