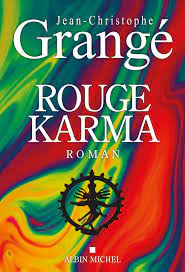S’il est parfaitement construit, ou plutôt mécaniquement très huilé (cinq parties se distribuant géographiquement et narrativement avec une rigueur de métronome [1]), le dernier Grangé [2] n’est pas pour autant bien maîtrisé et comporte de multiples failles qu’il serait lassant d’énumérer. Quelques incohérences parmi beaucoup : alors qu’il annonce que le Royaume envoûte les âmes, le récit ne montre rien de la manipulation psychique de ces communautés gouroutisées, à cause de l’impatience convulsive d’un JL qui conduit tout à son tempo hyperstressé ; alors qu’il met en scène une passion naissante entre Hervé et Abha, la plus belle femme qu’il ait rencontrée, ce qui est la trouvaille la plus inattendue du roman, celui-ci la défigure de la manière la plus sauvage à la scène suivante ; alors que le tantrisme est présenté comme la clé ultime de la violence, rien ne nous sera jamais dit de cette pratique et de cette philosophie ; alors que Grangé est connu et reconnu pour la limpidité (ce qui ne signifie pas la simplicité !) de ses intrigues, quel lecteur ne s’est-il pas un moment senti perdu dans la valse passablement arbitraire des noms de famille qui finit par perdre toute validité explicative ? ; la profondeur irréversible de la perversion narcissique affectant les méchants à la sauce « JCG », comment s’expliquer leur besoin compulsif de se livrer, en direct et même à distance (par téléphone) à des confessions prolixes et véridiques, de surcroît à de quasi-inconnus ? Sans rien dire de ce cardinal se pavanant en permanence en rouge, jusqu’à confesser dans cet habit non liturgique, et surtout professant un credo totalement incompatible avec la foi catholique, alors qu’il est présenté comme un proche de Paul VI et l’un des maîtres d’œuvre de Vatican II. Au fait, de quel Dicastère est-il préfet ou président ?
Si les personnages sont, comme toujours, riches, forts et torturés comme son auteur les aime, ils ne sont pourtant pas pleinement exploités. C’est ainsi que, introduite avec fanfare, la surdouance proche de la génialité d’Hervé ne se donne jamais à voir comme un atout, ni comme une pièce narrative, ni même comme un handicap. De même, le personnage féminin de Nicole, bienvenu dans le monde surviriliste de Grangé, n’apparaît pas narrativement déterminant, tant les affaires de famille, donc ici les deux demi-frères, Hervé et Jean-Louis, face à leurs géniteurs aux identités brouillées, constituent toujours le cœur des intrigues. C’est ainsi que la scène finale du meurtre du Prêcheur serial killer aurait été plus heureusement confiée à Hervé, ne serait-ce que pour des raisons de symétrie.
Si le rythme est toujours aussi nerveux et l’attention toujours aussi sous tension, l’emballement final confine avec la précipitation et le brouillon. Par exemple, plus on avance et moins le décor urbain, toujours important pour Grangé, au point de constituer un personnage à part entière, mérite son attention. Voire, selon une inquiétante loi d’accélération linéaire, Calcutta occupe prend deux fois moins de place que Paris, Bénarès que Calcutta, Rome que Bénarès…
Si le style est toujours aussi créatif, il comporte des répétitions [3] dont on s’étonne que l’éditeur ne s’en soit alarmé (par exemple, au moins quatre usages de la métaphore inventive « biotope » ou du verbe épatant « enquiller »).
Si l’idée de passer de la fiction à l’histoire, autrement plus riche en ressources hyperviolentes, depuis le dernier roman portant sur l’Allemagne nazie (Les promises, 2021), ne serait-ce que pour renouveler un genre qui finit par s’épuiser, l’intention n’est pas mise à exécution avec rigueur, le respect de l’unité de lieu et d’action n’est pas du tout au rendez-vous : Mai 68 qui constitue une vraie histoire au tout début (jusqu’au premier meurtre sordide), devient une toile de fond dans le reste de la première partie, commence à s’estomper dans la deuxième, et s’évanouit presque définitivement dans les trois autres.
Si le cynisme pessimiste de Grangé ne lui interdit pas son intuition de humer (au sens olfactif du verbe) et de procéder à quelques justes observations (par exemple, sur le quartier de Saint-François-Xavier qui est le mien depuis quatre années…), les fascinations bien connues qui sont la marque de fabrique de Grangé, finissent par rimer avec obsession et donc répétition : l’hyperviolence des meurtres perpertrés en miroir de celle pratiquée par le flic mué en justicier meurtrier (qui se paie le luxe d’ouvrir le roman en assassinant quatre de ses confrères lors des manifestations étudiantes…), les descriptions systématiquement défaitistes des pays émergents (ici, l’Inde dont on ne sait si elle osera traduire un tel roman), la vision tragique de la nature (incapable de se réjouir d’un rayon de soleil [4] ou de la bénédiction qu’est la mousson), la déconstruction négativiste des religions [5] (si l’hindouisme est ici principalement visé, le christianisme est épinglé au début avec le personnage de la mère désincarné et au terme avec celui, autrement plus inquiétant, du technopère et technocardinal de la Curie).
Surtout, si notre auteur a enfin la « bonne » idée de faire de la perversion non point subie, mais agie (en l’occurrence, transmise du père à ses fils), le ressort ultime de la violence, il ne la fait émerger qu’à la toute fin, en ce lieu éminemment symbolique qu’est un confessionnal, et ne l’exploite en rien. Nous sommes loin, infiniment loin de Dante, Dostoïevski. Grangé consomme l’énigme du mal, il n’en contemple pas le mystère. Il construit des mécaniques (nous l’avons rappelé au tout début), trop, et de plus en plus vite, il ne pénètre pas dans le dynamisme intime. Un fait est hautement révélateur : le statisme, voire l’entropie de l’auteur. Alors qu’un Bernanos n’a cessé d’approfondir le mysterium iniquitatis, depuis le trop spectaculaire Sous le soleil de Satan jusqu’au très secret et si prophétique M. Ouine, notre faiseur de thrillers n’a fait que se répéter depuis le saisissant Vol des cigognes (1994), voire, il n’a jamais fait mieux que ce premier roman où tous les thèmes sont déjà mis en musique, orchestrés avec une sobriété que ne retrouveront pas les suivants (hors quelques exceptions comme Le serment des limbes, 2007). Bref, ce qu’il dit de ces héros s’applique en fait au récit lui même : n’ayant pas compris que le mal commis est infiniment plus grave que le mal subi, il en demeure au seul premier ordre (celui des corps, qui englobe les psychismes englués dans le déterminisme), ne fait que deviner, à de rares moments, le tragique du deuxième ordre (celui des esprits) [6] et ignore tout du troisième ordre (celui de la charité) qui seul ouvre également à la rédemption miséricordieuse [7]. Pour le dire en termes plus éthiques : ne cherchant qu’à « éprouver l’intensité de l’existence [8] », les protagonistes – les justiciers comme les bourreaux – ne se décentrent au fond jamais d’eux-mêmes vers l’autre, ni a fortiori, ne se surcentrent sur le Tout-Autre [9].
Il est aussi extrêmement éloquent que les plus grands comme Kierkegaard, Bernanos ou Tolkien (avec le personnage de Shelob-Arachne : cf. « Arachne, figure du démoniaque »), ne s’attardent pas sur les puanteurs glauques émanant des crimes de sang et de stupre, mais, bien en amont, s’interrogent sur les ténèbres des âmes orgueilleuses qui s’adorent elles-mêmes jusqu’à se dévorer. Autrement dit, ils commencent là où, depuis longtemps, JCG et consorts finissent, épuisés et vides. On sort d’un « Grangé » fasciné (au sens étymologique), excité, embrouillé, parfois écœuré, en tout cas jamais instruit ou ragaillardi. Au pire, l’on se sent dépendant, en besoin de replonger en apnée dans un autre hors-monde qui ne dégoûte même pas du monde (au sens évangélique) ; et surtout pas affranchi ou du moins éclairé sur ce « péché qui nous entrave si bien » (He 12,1).
Faut-il le préciser, le livre est à formellement déconseiller aux âmes sensibles douées d’une imagination fertile. Mais, au fond, ne doit-il pas l’être aussi à tout esprit que passionnent les seules aventures dignes de ce nom, les pâques qui nous font passer « des ténèbres à son admirable lumière » (1 P 2,9) – ce qui ne signifie surtout pas les seuls témoignages de conversion ou les romans explicitement chrétiens [10] ?
Sans surprise, mais non sans déception, notre évaluation converge avec celle faite lors de l’analyse plus spécifique de Miserere (« Miserere de Grangé ou la tentation du manichéisme ») et de l’autre, plus générale, à propos des Promises (« Le paroxysme de la violence n’est pas sa profondeur »). Plus encore qu’au voyeurisme et au sadisme, celui que l’on présente trop généreusement comme « notre Stephen King national » cède à un pessimisme qui confine au manichéisme.
Pascal Ide
[1] L’on peut distribuer ainsi l’histoire :
- Constitution de l’équipe (Paris)
- Mise en présence des trois protagonistes : Première partie.
- Première interaction : Deuxième partie.
- Mission proprement dite (hors Paris)
- Relation à la mère (Calcutta) : Troisième partie.
- Relation au premier père (Varanasi) : Quatrième partie.
- Relation au second père (Rome) : Cinquième partie.
[2] Cf. Jean-Christophe Grangé, Rouge Karma, Paris, Albin Michel, 2023.
[3] Je ne parle pas de cette manie de juxtaposer deux adjectifs, deux verbes, etc., séparés par une virgule et non pas composés par une conjonction de coordination.
[4] « Cette pénombre, c’était déjà l’été qui s’annonçait, la bienveillance du soleil qui culminait en ces jours bénis mais éphémères. L’été, Nicole lui avait toujours trouvé un goût amer – après tout, ce bonheur portait déjà en lui sa chute, sa déchéance » (Ibid., p. 211).
[5] C’est un jésuite qui ose cette équation : les sectes en Inde « sont les multiples visages d’une même foi, oui, d’une même maladie » (Ibid., p. 318). Un peu plus tard, un maître spirituel qui ne veut pas l’être cite : « Quand vous êtes au théâtre et que vous croyez que tout est vrai, c’est que vous êtes à l’église » (Ibid., p. 359).
[6] Lors de ce qui se présente comme le sommet de la révélation (opérée par la Mère et transmise par le Père), à savoir ce qu’est la « lumière noire » qu’est le « Mal » (Ibid., p. 557. Avec une majuscule dans le texte), il est d’abord identifié à « Satan » qui est aussitôt immanentisé et psychologisé – « Mère l’avait trouvé au fond d’elle-même, Satan » (Ibid., p. 558) –, et surtout il est encore plus euphémisé en étant reconduit à la fascination pour le mal subi : « Qu’est-ce que le Mal ? Le viol de l’innocence. […] Le Mal tire sa force de la profanation, du sacrilège » ((Ibid.).
[7] Une seule exception, mais qui demande à être reconstruite, parce qu’elle n’est pas explicitée : la mère spiritualiste que Jean-Louis condamne sans appel s’avère au final être grandement excusable, elle qui fut atrocement abusée par un gourou.
[8] Ibid., p. 294. Et Hervé partage exactement la même impression qui devient motivation : « Sa vie ne lui avait jamais semblé aussi intense, aussi concrète, que depuis qu’elle ne tenait qu’à un fil… » (Ibid., p. 543).
[9] Voilà pourquoi, quelques lignes plus bas, l’héroïne pense aux vers finaux du « Voyage », poème des Fleurs du mal (CXXVI) qui annule la différence entre la Terre et le Ciel au nom d’une nouveauté toute apparente car elle est mesurée par le seul poète.
[10] Dans une lettre, Tolkien explique que son intention est d’écrire des contes implicitement inspirés par le christianisme, et non pas explicitement comme son ami Lewis.