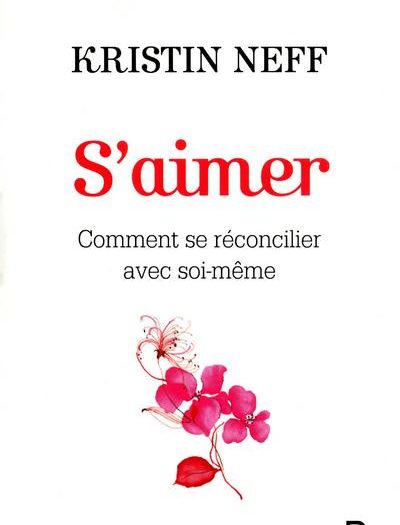1) Bref exposé
Psychologue de l’université américaine d’Austin, au Texas, Kristin Neff a introduit un concept nouveau : l’autocompassion. Elle l’expose dans un ouvrage dont, trompeur, ni le titre français ni le sous-titre n’expriment adéquatement le contenu : S’aimer. Comment se réconcilier avec soi-même [1]. En revanche, l’américain qui livre l’objet même du livre et son originalité : Self-compassion, que traduit le néologisme : « Autocompassion ». son sous-titre précise : Stop Beating Yourself Up and Leave Insecurity Behind : Arrêtez de vous flageller et laissez votre insécurité derrière vous.
Dans la première partie, Kristin Neff part du constat que presque tout le monde passe son temps à poser des auto-jugements négatifs sur soi, et ces jugements sont tellement habituels et justifiés qu’ils passent inaperçus. L’une des toute-premières raisons de ces auto-flagellations est que, si nous perdons ces jugements, nous perdons le moteur de notre changement, nous devenons laxistes à notre égard. Pourtant, tout au contraire, les études montrent que ceux qui progressent le plus sont ceux qui nourrissent la meilleure estime à l’égard d’eux-mêmes et de leurs capacités.
Pour remédier à ce comportement délétère habituel (autrement dit, ce vice), l’auteur propose, dans une deuxième partie, l’attitude d’autocompassion. Celle-ci comporte trois composantes qui sont trois actes : se considérer avec bienveillance (chap. 3) ; reconnaître notre interdépendance ou, dans les mots de l’auteur : que nous sommes « tous dans le même bateau » (chap. 4) ; consentir à ce qui est, en pleine conscience (chap. 5).
La deuxième composante est la plus originale et la plus mystérieuse. Elle détient aussi la clé de l’apport spécifique de notre auteur. Il est éclairant de la comprendre, elle et, plus généralement, l’auto-compassion, par opposition à l’estime de soi. Celle-ci comporte toujours une part d’évaluation : estimer, c’est juger que quelque chose est bon (ou moins bon, ou carrément mauvais), que nous possédons des qualités et non pas seulement des défauts. Or, estime notre auteur, se juger nous fait courir le risque de l’attitude contraire, se déjuger et donc de se déprécier, si jamais nous défaillons ou nous sentons insuffisants. En revanche, la deuxième attitude nous connecte aux autres humains et à notre humanité commune ; or, celle-ci se caractérise par la fragilité, la vulnérabilité, la défaillance ; en l’adoptant, nous cessons donc de s’autoexclure en s’isolant. « En se polarisant sur ses défauts sans prendre en compte la nature humaine en général, on réduit son champ de vision. […] Par exemple, si l’on a perdu son emploi à la suite d’une récession économique, il y a de fortes chances que l’on s’imagine être seul à passer ses journées assis devant des rediffusions alors que le reste du monde travaille dans la joie et la bonne humeur » (p. 76). Ainsi, nous nous interconnectons avec les autres non pas en célébrant nos vertus, mais en reconnaissant nos limites et nos imperfections.
Les trois autres parties de l’ouvrage retiendront peu notre attention. La troisième considère les différents bienfaits de l’autocompassion, la quatrième quelques domaines d’application (les autres, les enfants dans l’éducation, le couple) et la cinquième certains moyens pour la mettre en œuvre.
2) Évaluation critique
Adhérer à cette doctrine de l’autocompassion, n’est-ce pas faire l’éloge de la médiocrité ? Consentir à ce que tout le monde soit faillible, n’est-ce pas se disposer prochainement à faillir, voire s’excuser de pécher ? Se connecter avec l’universelle misère humaine, n’est-ce pas faire l’apologie du misérabilisme ? Le risque est réel, et insuffisamment épinglé par l’ouvrage. Pourtant, il en manque la pointe. Cette objection est d’ailleurs aussi souvent adressée à la méditation de pleine conscience : accepter la réalité (extérieure et, plus encore, intérieure) sans juger, c’est disqualifier toute éthique.
En réalité, il convient de distinguer deux temps dans tout jugement éthique : l’accueil du fait et son évaluation. En effet, autre l’être et autre, le devoir-être. Or, le constat accueille l’être, alors que l’évaluation éthique considère non pas l’être, mais le bien. Le fait demande à être accueilli le plus adéquatement, sans déformation, pour pouvoir ensuite être jugé et jaugé. Or, la méditation pleine conscience rend présent à ce qui est hors tout jugement et la connexion avec la condition commune de l’humanité redouble cette attitude non jugeante. Ainsi l’auto-compassion ne nie en rien l’évaluation éthique, mais conjure seulement une évaluation première, préalable qui la déformerait.
Toutefois, la méthode de Kristin Neff, et donc son ouvrage semblent très influencés par la mindfulness, dont ils semblent être une application. Mais, contrairement à l’ouvrage fondateur de la méditation de pleine conscience [2], le découplage avec l’origine bouddhiste ne semble pas ici totalement accompli. Comment s’en étonner ? L’auteur s’est fait connaître du public français par l’expérience très étonnante qu’elle a vécue, avec Rupert, son mari et Rowan, leur fils autiste âgé de huit ans [3]. Face à l’inefficacité des remèdes proposés en Occident pour celui-ci, ils ont décidé tous les trois de partir en Mongolie pour pouvoir bénéficier d’un traitement proposé par différents chamans. Rupert et Kristin vécurent des expériences douloureuses, mais aussi bouleversantes. Et des résultats qu’elle résume ainsi : « Une nette amélioration, pas une guérison complète. Rowan est toujours autiste, mais il ne souffre plus des dysfonctionnements liés à son trouble » (p. 305). Or, le dernier chapitre de son livre sur l’autocompassion résume cette expérience. Elle n’est donc pas sans avoir une incidence sur la vision que Kristin Neff propose de l’autocompassion et ses conseils qui suspectent trop le jugement éthique.
Un exemple en est la distinction que, au terme, elle propose entre « auto-appréciation » et « estime de soi ». « L’estime de soi est un jugement de valeur qui intervient au niveau de la représentation de soi : on se colle une étiquette » ; elle conduit donc « à se définir comme ‘bon’ ou ‘mauvais’ ». En regard, « l’auto-appréciation ne requiert ni jugement ni catégorisation » (p. 317. Souligné dans le texte). Se réduire à telle qualité éthique et se figer-fixer, assurément, non ! Mais évaluer tel défaut, voire tel péché ou tel vice, oui ! Ce jugement est nécessaire à notre changement éthique et notre conversion spirituelle. Nous ne sommes pas que ce que nous sommes maintenant. Nous sommes appelés à beaucoup plus vaste et beaucoup plus beau. Disons-le dans les termes de la Bible relus par une large part de la Tradition patristique et médiévale : l’homme a été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu (cf. Gn 1,26-28) ; or, si, par le péché, l’homme a perdu la ressemblance, en revanche, il a conservé l’image. Son chemin consiste donc à reconquérir, par la grâce, cette ressemblance. Ainsi, en demeurer à cette auto-appréciation ou cette connexion avec la commune humanité en ses fragilités, c’est en rester à l’image. En revanche, intégrer de manière ajustée le jugement éthique et spirituel sur nos défaillances, c’est nous rappeler notre décalage à l’égard de la ressemblance et introduire le hiatus dynamique entre ce que je suis et ce que suis appelé à être, entre le présent et l’avenir promis, entre la nature et la grâce, entre le péché et la vertu, entre notre misère et notre grandeur, entre nos pauvres plaisirs et la profuse béatitude – toutes différences qui manquent cruellement à une vision bouddhisée de la condition humaine.
Pascal Ide
[1] Kristin Neff, S’aimer. Comment se réconcilier avec soi-même, trad. Patricia Lavigne, Paris, Belfond, 2013.
[2] Cf. Jon Kabat-Zinn, Au cœur de la tourmente, la pleine conscience. MBSR, la réduction du stress, basée sur la mindfulness : programme complet en 8 semaines, trad. Chalude Maskens, Paris, J’ai Lu, 2009. Voilà pourquoi, en elle-même, cette méthode ne pose aucun problème pour un chrétien. J’aborderai cette question dans un très prochain ouvrage.
[3] Elle est racontée dans l’ouvrage de Rupert Isaacson, L’enfant cheval. La quête d’un père aux confins du monde pour guérir son fils autiste, trad. Esther Ménévis, Paris, Albin Michel, 2009.