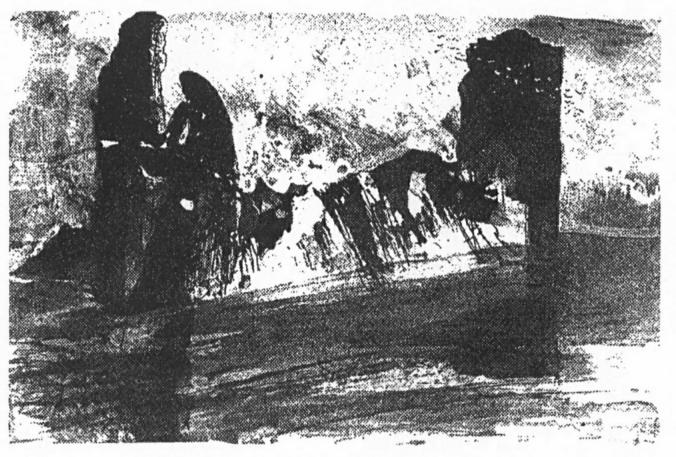Au terme des Travailleurs de la mer, Victor Hugo nous offre une scène d’amour qui, assurément romantique, transcende le romantisme. Gilliat contemple le couple heureux de Déruchette et d’Ebenezer à l’avant du sloop Cashmere :
« Il y avait sur le pont un coin plein de soleil. C’était là ce qu’il regardait. Dans ce soleil étaient Ebenezer et Déruchette. Ils étaient assis dans cette lumière, lui près d’elle. Ils se blottissaient gracieusement côte à côte, comme deux oiseaux se chauffant à un rayon de midi, sur un de ces bancs couverts d’un petit plafond goudronné que les navires bien aménagés offrent aux voyageurs et sur lesquels on lit, quand c’est un bâtiment anglais : For ladies only. La tête de Déruchette était sur l’épaule d’Ebenezer, le bras d’Ebenezer était derrière la taille de Déruchette ; ils se tenaient les mains, les doigts entre-croisés dans les doigts. Les nuances d’un ange à l’autre étaient saisissables sur ces deux exquises figures faites d’innocence. L’une était plus virginale, l’autre était plus sidérale. Leur chaste embrassement était expressif. Tout l’hyménée était là, toute la pudeur aussi. Ce banc était déjà une alcôve et presque un nid. En même temps, c’était une gloire ; la douce gloire de l’amour en fuite dans un nuage [1] ».
Certes, cette scène est éminemment romantique – de ce romantisme qui, d’ailleurs, n’est pas seulement désirable, mais sauvable, c’est-à-dire porteur d’aspirations pleinement humaines – : noces institutionnelles qui sont d’abord des épousailles éminemment personnelles ; communion indéfectible et virtuellement éternelle des âmes immaculées (« exquises figures faites d’innocence ») du jeune pasteur et de la nièce toute aérienne, voire pneumatique du Mess Lethierry [2] ; embrassement des cœurs qui réconcilie la plus grande proximité (« Tout l’hyménée était là ») et la plus juste distance (« la pudeur aussi »), la plus grande intimité, donc la plus haute pureté (« L’une était plus virginale »), et la plus grande élévation, donc la plus fructueuse des fécondités (« l’autre était plus sidérale »), le plus féminin, donc le plus chaleureusement enveloppant dans la finitude (l’image du banc couvert d’un plafond que le « bâtiment anglais » dédie aux seule femmes, et qui, plus encore, est « déjà une alcôve et presque un nid ») et le plus masculin, donc le plus audacieusement ouvert à l’infini (ils sont assis non pas l’un en face de l’autre, mais « côte à côte », face à l’horizon océanique « plein de soleil ») ; « chaste embrassement » qui est « expressif », c’est-à-dire exprimé [3], au plus près par l’exquis en(tre)lacement des corps, lui-même fractalement reproduit dans l’entrecoisement des doigts ; et au plus large par la résonance avec le moins qu’humain qu’est la création évoquée en sa réalisation la plus élevée et la plus diffusive, le soleil qui rayonne (« dans cette lumière ») et qui réchauffe (« se chauffant »), voire par l’harmonie secrètement évoquée avec le plus qu’humain qu’est l’ange (« les nuances d’un ange à l’autre »). Autant de ressemblances qui sont des correspondances entre différents ordres, autant de signes qui cachent des causes encore trop inexplorées.
Pourtant, ne le nions pas, cette scène est aussi romantique parce que celui qui la contemple, assis dans ce siège naturel creusé à même le roc du rivage, la « Chaise Gild-Holm-’Ur », va se laisser submerger par le flot de la marée montante et mourir. Suicide désespéré, mais suicide irrecevable. Mais qui ne doit pas recouvrir et faire oublier un acte, lui, admirable, et qui hisse l’amour bien au-delà du romantisme : un don de soi héroïque. Rappelons brièvement la trame du roman.
Mess Lethierry est propriétaire de La Durande, un vapeur en possession d’un moteur révolutionnaire. Malheureusement, la machination criminelle de Clubin, son capitaine, fait s’échouer son steamer sur un écueil inaccessible, entre les deux rochers de l’écueil Douvres au large de Guernesey. Désirant par-dessus tout récupérer son moteur, Lethierry promet de donner la main de sa nièce Déruchette à qui le récupérera sur l’épave. Tout à l’opposé de celui qui a donné son nom à la première partie du livre, « le sieur Clubin », celui qui donne son nom à la deuxième, « Gilliatt le malin » est un pêcheur robuste, idéaliste et généreux qui accepte le défi. Mais c’est une autre polarité qui explique son choix : autant Clubin ne chérit que sa propre personne, autant Gilliatt est épris de Déruchette. Or, après avoir surmonté les éléments déchaînés [4] et réussi sa mission, le courageux marin découvre à son retour que Déruchette est tombée amoureuse du jeune pasteur Ebenezer qui l’aime en retour.
Face à ce drame, Gilliatt va se sacrifier doublement. Une première fois, passivement, en se retirant pour offrir toute sa place au bonheur de Déruchette. Une seconde fois, activement, en mettant tout en œuvre pour que les jeunes gens puissent se marier en cachette et embarquer à bord du Cashmere. Ainsi, « la douce gloire de l’amour » qui se déploie au terme et au sommet des Travailleurs de la mer, n’est pas celle, secrètement égocentrée, de la passion amoureuse, mais celle, totalement décentrée, du don extatique de soi. Et cette fin extrême, qui est un achèvement extrême (au sens de Jn 13,1), est d’autant plus signifiante que le roman couronne lui-même la trilogie que Victor Hugo a voulu consacrer à la condition humaine [5].
Pascal Ide
[1] Victor Hugo, Les travailleurs de la mer, Troisième partie, L. III, V, Paris, Flammarion, s. d., p. 428. Souligné par moi.
[2] Je fais allusion à la manière dont Victor Hugo présente Déruchette : « Un oiseau qui a la forme d’une fille » (Première partie, L. III, I, p. 88).
[3] Le même passage que la note précédente commence par cette affirmation très hugolienne : « Le corps humain pourrait bien n’être qu’une apparence. Il cache notre réalité. Il s’épaissit sur notre lumière ou sur notre ombre. La réalité c’est l’âme. À parler absolument, notre visage est un masque. Le vrai homme, c’est ce qui est sous l’homme. […] L’erreur commune, c’est de prendre l’être extérieur pour l’être réel » (Première partie, L. III, I, p. 88). Traduite en termes métaphysiques, cette loi spéculaire (l’extérieur reflète l’intérieur) est celle de la constitution ontophanique, et en termes politiques, elle est celle de l’espérance que nourrit Hugo en la bonté du cœur humain, surtout s’il est aliéné par la misère.
[4] Victor Hugo consacre à cette lutte mythique, cette quasi théomachie (comme il les aime) qui a duré « près de vingt heures », pas moins d’une vingtaine de pages (Deuxième partie, L. III, VI, p. 325-343, ici p. 342).
[5] Voici comment Victor Hugo ouvre son roman : « La religion, la société, la nature ; telles sont les trois luttes de l’homme. Ces trois luttes sont en même temps ses trois besoins ; il faut qu’il croie, de là le temple ; il faut qu’il crée, de là la cité ; il faut qu’il vive, de là la charrue et le navire. Mais ces trois solutions contiennent trois guerres. La mystérieuse difficulté de la vie sort de toutes les trois. L’homme a affaire à l’obstacle sous la forme superstition, sous la forme préjugé, et sous la forme élément. Un triple anankè [nécessité, fatalité] règne sur nous, l’anankè des dogmes, l’anankè des lois, l’anankè des choses. Dans Notre-Dame de Paris, l’auteur a dénoncé le premier ; dans Les Misérables, il a signalé le second ; dans ce livre, il indique le troisième. À ces trois fatalités qui enveloppent l’homme, se mêle la fatalité intérieure, l’anankè suprême, le cœur humain. Hauteville-House, mars 1866 » (Les travailleurs de la mer, p. 2).