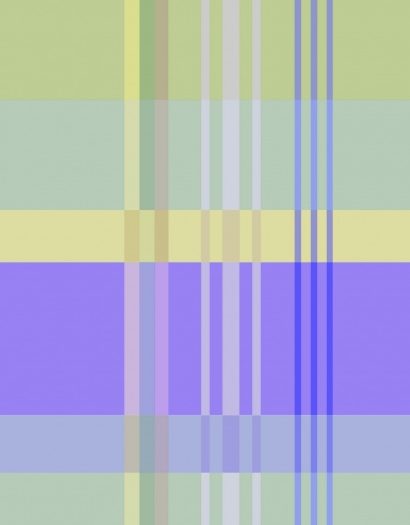E) Détermination philosophique.
Nature et culture, donné et construit, inné et acquis
Il reste à élaborer une philosophie de l’inné et de l’acquis. En l’occurrence à éclairer par les données philosophiques les faits collectés par les sciences biologiques, psychologiques et sociales. En fait, derrière l’opposition de l’inné et de l’acquis se rencontre d’autres couples, plus fondamentaux : nature et culture, donné et construit, aujourd’hui génétique et épigénétique.
Nous nous aiderons d’un article rédigé pour un collectif sur la nature humaine comme fondement de la morale [1]. Il reprend nombre des notions importantes pour cette détermination.
« Pour les éveillés il y a un monde un et commun. Mais parmi ceux qui dorment, chacun s’en détourne vers le sien propre [2] ».
« Ceux qui nient l’existence d’une nature humaine nous font perdre beaucoup de temps. Ils multiplient les discours et se réfutent eux-mêmes : à qui s’adressent-ils, en effet, s’ils n’ont ni semblable ni prochain, si nous ne sommes que de faibles masses de gélatine que chacun peut modeler à sa guise ? Ils ne sont malheureusement pas inoffensifs ; et ils nous exposent aux entreprises de la première brute étatique venue, qui saura nous donner, elle, la forme qui lui convient le mieux, celle de la non-résistance et de la lâcheté la plus fluide [3] ».
La question que se pose cet article est la suivante : la nature – et j’entends ici la nature humaine – peut-elle être normative pour l’éthique, c’est-à-dire être source de prescriptions pour l’agir humain ? L’enjeu est d’importance pour tout homme : une telle nature serait un terrain d’entente pour toute personne de bonne volonté ; elle constituerait aussi le fondement des droits de l’homme. L’enjeu est aussi d’importance pour le chrétien. Notamment parce que les prises de position de l’Église en matière morale, singulièrement en bioéthique, se font non pas d’abord, comme on le croit souvent, au nom de ses convictions chrétiennes, en se fondant sur l’Évangile, mais au nom de ce qu’elle appelle parfois la « loi naturelle », commune à tous les individus de l’espèce humaine. « Voici donc la règle de l’activité humaine : qu’elle soit conforme au bien authentique de l’humanité, selon le dessein et la volonté de Dieu et qu’elle permette à l’homme, considéré comme individu ou comme membre de la société, de s’épanouir selon la plénitude de sa vocation [4] ».
Je n’ignore pas les multiples difficultés posées par les différents termes mêmes de la question : « nature » – le mot « nature » se dit des réalités les plus variées, du yaourt nature (qui ne contient rien !) à la nature de Dieu (qui « contient » tout !) –, « fondement » – la crise de la philosophie en général et de l’éthique en particulier est, pour une bonne part, une crise des fondements : que peut-il demeurer de ceux-ci après les critiques de Nietzsche et de Heidegger ? –, « morale » – dans la société pluraliste où nous vivons, on est droit de se demander si un tel mot peut encore se décliner au singulier. Face à ces difficultés majeures, mon propos ne pourra qu’être introductif.
Le plan adopté sera simple. Schématiquement, du point de vue qui est le nôtre, deux visions opposées des fondements de la morale s’affrontent : une vision constructiviste refuse que la nature humaine non seulement fonde toute capacité prescriptive, mais existe (1) ; cette perspective culturaliste à la fois réagit contre une éthique fondée sur la nature humaine et a engendré une réaction naturaliste (2). La faillite de ces deux conceptions (3) invite à réinterroger ce que l’on peut entendre par nature en général (4) et nature humaine en particulier (4). En montrant comment celle-ci constitue l’un des fondements de l’éthique, nous répondrons à la perspective culturaliste (5). En faisant appel au second pilier qu’est l’appropriation de la nature par la raison et la liberté, nous prendrons nos distances à l’égard du naturalisme (6).
1) Une morale sans nature humaine
La grande majorité des réflexions éthiques – et bioéthiques – actuelles ne fondent pas leur norme sur la nature humaine, voire suspectent grandement cette notion. Nous en ferons d’abord le constat à partir de l’exemple des deux théories bioéthiques anglosaxonnes les plus en vogue actuellement – au moins dans le monde anglosaxon. Puis, nous chercherons à comprendre les raisons de cette allergie en élargissant le débat à la question du constructivisme, avant d’en proposer une évaluation critique.
a) Illustrations
1’) La théorie de Beauchamp et Childress
Les anglosaxons Tom L. Beauchamp et James K. Childress ont élaboré la plus ancienne théorisation de bioéthique dans un ouvrage toujours non traduit Principles of Biomedical Ethics [5]. Leur réflexion se situe dans le cadre de la science médicale actuelle. Celle-ci, en effet, soulève des questions nouvelles et pose des dilemmes éthiques. Or, la bioéthique a pour objet de réfléchir aux principes susceptibles d’éclairer l’action de l’homme. Appliquée à la biomédecine, l’éthique (devenue bioéthique) s’interroge donc : existe-t-il des principes qui puissent la guider ?
Pour répondre à cette question, Beauchamp et Childress énoncent quatre principes :
– Le principe d’autonomie énonce que l’individu humain est doué de la capacité de s’autodéterminer. Une telle capacité suppose d’une part l’absence de trop grandes contraintes extérieures pour que l’action soit possible, d’autre part une information suffisante pour que l’action soit connue.
– Le principe de bienfaisance énonce que l’individu doit faire le bien d’autrui ; appliqué à la médecine, ce principe demande que l’on recherche le bien du patient et que, notamment, on mesure les bienfaits et les inconvénients d’une action sur ledit malade.
– Le principe de non-malfaisance énonce que la personne n’inflige pas de dommage à autrui ; ce troisième principe n’est pas identique au second, seulement positif, et donc plus contraignant. Appliqué à la biomédecine, il requiert que le soignant ne nuise pas à l’autre (c’est le sens du fameux adage : primum non nocere).
– Le principe de justice – en l’occurrence distributive – énonce que l’autorité compétente apporte à chacun le bien qui lui est dû ; appliqué aux questions médicales, ce principe demande que le traitement soit équitable pour tous (notion de fair opportunity).
Ces principes sont encore très universels et très formels. Or, la réalité est concrète et les cas de conscience, les dilemmes ont pour objet des cas singuliers, ici les cas cliniques. Les principes sont donc insuffisants pour éclairer l’action. Aussi nos auteurs ont-ils mis en place des règles en vue de dégager des solutions dans des situations données : par exemple la règle de consentement, de confidentialité, de secret. En quelque sorte, les principes sont aux règles ce que la théorie est à la pratique.
La conception bioéthique de Beauchamp et Childress présente d’indéniables mérites, entre autres : sa perspective universelle se soustrait à l’arbitraire des choix individuels et des intérêts et aux particularismes culturels ; le principe d’autonomie présente le grand mérite de revaloriser le rôle et la place du patient face à une vision unilatéralement paternaliste où le corps soignant, en particulier le médecin est conçu comme possesseur de la totalité du savoir et du pouvoir (donc des droits) sur le patient.
Cette vision présente toutefois une grande limite. Elle en reste volontairement à des principes dénués de contenu concret, précis. Formaliste et universaliste, elle est d’ascendance kantienne. Or, l’on sait combien le philosophe Emmanuel Kant a déconnecté la raison pratique de la raison pure : l’éthique ne peut se fonder sur l’anthropologie, un impératif moral sur une donnée humaine. Autrement dit, sur une vision de la nature humaine.
2’) La théorie d’H. Tristam Engelhardt
L’autre grand moraliste américain, H. Tristam Engelhardt Jr., élabore une théorie éthique – dans son ouvrage clé, là encore non traduit, The Foundations of Bioethics [6] – qui ajoute à la précédente une dimension procédurale, donc plus concrète. En effet, ce penseur orthodoxe d’origine, mais sécularisé de conviction, a une vive conscience des difficultés à type de conflit et de dilemme (par exemple entre liberté et intérêt) rencontrées par les praticiens. Il veut donc, lui aussi, établir une éthique générale toute orientée vers la réponse aux questions que pose l’éthique biomédicale.
Tristam Engelhardt se refuse aux solutions opposées du dogmatisme et du scepticisme. La première prétend qu’une position unique existe, qu’un critère suffit à résoudre les questions ; or, à l’évidence, règne aujourd’hui le pluralisme : plusieurs conceptions éthiques du bien coexistent ; de plus, la sécularisation a entraîné la disparition d’un système prévalent de croyances [7]. La seconde réponse, en revanche, dissout toute éthique dans le nihilisme ; or, chacun cherche à bien vivre.
Comment sortir de l’impasse ? L’erreur commune des deux positions ci-dessus est d’envisager l’éthique comme le discours relatif à la fin bonne. Or, selon Engelhardt, l’éthique est d’abord une manière de résoudre les controverses. Et la résolution se fait par un accord librement consenti – donc un respect mutuel – versus la violence [8]. Mais cet accord se fonde soit sur des principes éthiques partagés, soit sur des procédures de négociation du conflit. Comme il n’existe plus de conviction commune relative au bien, la seule option demeure procédurale. Mais quelles peuvent être les règles en vue de mener à bien l’accord entre les sujets humains ?
Engelhardt propose différents principes qui ne sont pas sans rappeler ceux énoncés par Beauchamp et Childress [9].
– Le principe d’autonomie (« permission ») énonce que l’on doit toujours respecter la liberté individuelle d’autrui.
– Le principe de bienfaisance (« beneficence ») énonce qu’il faut rechercher le meilleur intérêt de l’autre et, pour la médecine, du patient. Son énoncé présente une forme positive : « Fais aux autres leur propre bien ». Mais ce bien relève de la conception du patient et du soignant ; or, cette conception est relative. Par conséquent, autant le premier principe est contraignant, absolu, autant ce second principe est conditionné par la décision du bénéficiaire.
– Le principe de justice doit s’entendre dans le sens de la justice distributive développée par Beauchamp et Childress.
La conception bioéthique d’Engelhardt présente différents traits positifs. D’abord, elle prend résolument acte du pluralisme et de la sécularisation de la société. Ensuite, à l’instar de celle de Beauchamp et Childress, elle se veut universaliste : alors qu’un certain nombre d’éthiques se limitent à une casuistique visant à règler les conflits qui se posent, elle prétend énoncer des principes valables pour tout être humain. Mais, à l’opposé de cette vision bioéthique, elle se refuse à être seulement formelle : le principe de bienfaisance présente un certain contenu.
Mais la construction d’Engelhardt tient-elle ses promesses ? Procédurale, elle fait du consensus des sujets la norme ultime. Or, ce consensus ne présente plus aucun réel contenu éthique substantiel. Par conséquent, on ne sort du formalisme que pour sombrer dans l’individualisme le plus arbitraire. Comme le note Gilbert Hottois, nous sommes désormais en présence « de volontés subjectives débordantes de contenus mais irrationnelles qui, après avoir tenu compte des contraintes objectives suffisamment pour survivre, sont radicalement libres de faire n’importe quoi et de croire n’importe quoi, de produire n’importe quelles règles morales promouvant n’importe quelle conception de leur «bien» [10] ».
D’ailleurs, cette éthique à prétention universaliste est en réalité très culturellement située : en effet, pour Engelhardt, il suffit à l’individu de trouver le groupe ethnique, culturel, religieux dans lequel il désire s’insérer pour agir éthiquement avec le consensus requis ; or, on sait qu’une telle structure à la fois pluraliste, éclatée et ghettoïsée, caractérise la société américaine.
Enfin, lorsqu’Engelhardt s’autorise à entrer dans le détail du contenu des normes bioéthiques, son choix est discutable. Prenons la manière dont il traite le concept clé de personne. Celle-ci, au sens strict et propre, se définit à partir de trois caractéristiques : l’autoconscience, la rationalité et le sens moral. Or, ces traits doivent s’entendre non pas comme des capacités mais dans leur exercice actuel. En toute rigueur, il faut en conclure que ni les individus en état avancé de sénilité, ni les malades dont le cerveau est gravement lésé, ni les handicapés mentaux profonds, ni enfin les embryons, ne peuvent être des personnes au sens propre [11]. Mais la conception de personne qu’Engelhardt se donne, note Georges Cottier, « est taillée selon les besoins de la cause » ; elle « n’est pas capable d’obtenir le consensus ». Au fond, elle est volontariste : « qui décide de la frontière entre la personne «au sens strict» et la personne «au sens large» [12] ? »
De nouveau, la conception d’Engelhardt a congédié toute nature humaine, celle-ci se trouvant dissoute soit dans un formalisme sans contenu, soit dans des règles procédurales sans fondement autre que l’arbitraire des opinions, soit dans le coup de force d’une réduction de la personne à un agir précalibré.
b) Les critiques adressées à la nature humaine
Les arguments opposés à la notion de nature humaine sont multiples. On en rencontre principalement deux : le changement et la diversité.
Le premier vise l’anhistoricité de la notion de nature humaine. Celle-ci est invariable, fixée. Or, les contenus et les normes sont essentiellement impermanents et historiques. « S’il y avait un ‘ordre naturel’, écrit Alain de Benoist, les valeurs et les formes seraient les mêmes en tous temps et en tous lieux. Sans rallumer la querelle des universaux, il suffit de se référer à l’expérience historique pour constater qu’il n’en est rien. Il existe une relativité générale des mœurs, des idéaux, des règles morales, des aspirations esthétiques, etc. et ce sont ces formes qui sont le produit du spécifiquement humain [13] ». Proche de cet argument est celui tiré de la critique de l’immutabilité. La nature humaine, si elle existe, se caractérise par des inclinations naturelles inamissibles. Or, l’expérience montre bien qu’aucune prétendue propension attribuée à l’homme n’est définitivement fixée. Par exemple, l’évidence précoce de l’homosexualité chez certaines personnes dénie toute naturalité à une prétendue inclination hétérosexuelle. Même la persévérance dans l’être qui est l’inclination la plus fondamentale de la personne peut être contredite, puisque des hommes peuvent décider de mettre fin à leur jour. C’est, on se le rappelle, le grand argument que Fénelon opposait à Bossuet et sa thèse d’une inclination naturelle de l’homme au bonheur [14] : « Combien de Grecs et de Romains se sont-ils dévoués librement à une mort certaine ? » C’est donc qu’une « inclination violente du fond de la nature » peut être vaincue, en l’occurrence par la « volonté dominante ». Voilà pourquoi, concluait l’évêque de Cambrai contre l’évêque de Meaux, il n’y a pas de « pentes ou inclinations naturelles dans les hommes [15] ».
Le second argument vise le monolithisme de la notion de nature humaine. Celle-ci constitue une réalité uniforme. Or, la réalité humaine, les normes, comme les pratiques sont multiples, hétérogènes, dans le temps et dans l’espace. En un mot, le concept de nature congédie toute culture. Dit autrement, la nature humaine est une notion universelle ; mais l’universel efface la particularité : c’est une abstraction qui n’intègre pas la concrétude des spécificités régionales [16]. Proche est l’argument tiré de l’innéité prétendue de la nature. Ce que l’on croit être naturel est, bien souvent, au fond, de l’ordre de l’habitude. Tel est, on le sait, l’argument de Pascal : « La coutume est une seconde nature qui détruit la première. Mais qu’est-ce que la nature ? Pourquoi la coutume n’est-elle pas naturelle ? J’ai grande peur que cette nature ne soit elle-même qu’une première coutume, comme la coutume est une seconde nature [17] ». En un mot, le naturalisme offusque la capacité donatrice de sens caractéristique de la raison humaine.
À ces deux objections fondamentales, il s’ajoute une ambiguïté qui grève bien des débats. D’un côté, le terme nature exprime le monde matériel, dans sa différence d’avec l’homme. De l’autre côté, le terme « nature » s’applique à ce qui est spirituel, donc humain, mais inné, préalable à tout acte libre. Cette ambivalence se retrouve dans la manière d’entendre des expressions comme « morale naturelle » ou « nature humaine ». C’est ainsi que le moraliste américain Richard Gula [18] oppose deux manières d’entendre le terme de « nature » dans le Magistère – « selon la nature » et « selon la raison » – selon la source des normes, la nature dont Dieu est l’auteur ou la raison, qui est aussi de Dieu ; or, dans le premier cas, la loi morale se lit à travers un donné autant biologique que spirituel (et psychologique) et dans le second cas, cette loi se déchiffre à l’intérieur de la conscience et de la raison ; Gula oppose donc bien deux manières irréductibles d’entendre la loi naturelle, la première tendant vers un certain biologisme moral.
c) Le constructivisme social
Les sciences humaines et sociales sont extrêmement méfiantes à l’égard de la notion de nature humaine, par exemple en sociologie [19], en histoire [20] ou en ethnologie [21]. Ces critiques négatives constituent l’envers de ce que l’on appelle aujourd’hui le « constructivisme ».
En un mot, celui-ci énonce que tout ce que nous croyions naturel est construit. Prenons l’exemple de la sexualité [22]. Déjà, Sigmund Freud avait montré toute la part d’acquisition éducative, culturelle, symbolique, présente dans l’orientation sexuelle de l’adulte : il avait très intentionnellement choisi le terme de Trieb (« pulsion ») et non d’Instinkt (« instinct ») pour parler de la sexualité ; or, autant l’instinct évoque un comportement animal fixé par l’hérédité et préorienté vers une fin, autant la pulsion évoque une poussée (le verbe allemand treiben signifie « pousser ») indifférente à son objet qui constitue désormais une construction culturelle [23]. Dans son Histoire de la sexualité, empruntant sa grille de lecture notamment à Nietzsche, Michel Foucault accentuera encore davantage la part de construction présente dans la sexualité : « Il ne faut pas concevoir la sexualité comme une sorte de donné de nature que le pouvoir essaierait de mater, ou comme un domaine obscur que le savoir tenterait peu à peu de dévoiler [24] ». Désormais, les catégories sexuelles comme hétérosexualité ou homosexualité apparaissent comme un dispositif construit par au moins deux types d’instances : scientifiques (la physiologie, la sexologie, la psychiatrie) et politiques (les relations de force). Or, un tel dispositif est fonction d’un état donné de l’histoire de la culture ; plus encore, il est un instrument de domination entre les mains du pouvoir dont la tendance est toujours à l’uniformisation et à l’exclusion. La sexualité, les orientations sexuelles ne sauraient donc plus être considérées comme une réalité naturelle, allant de soi, universellement partagée. La conséquence est évidente : ce qui est construit peut être déconstruit et reconstruit autrement. On comprend pourquoi le lobby gay et notamment les militants gays d’Act-Up New-york ont fait de La Volonté de savoir leur livre culte…
À travers l’exemple de la sexualité, il est possible de percevoir combien les sciences humaines et sociales ont conduit à construire une réalité considérée naguère comme naturelle. En effet, le naturel est donné, tout fait ; or, le « à faire » s’oppose au « tout fait » ; voilà pourquoi le construit s’oppose au naturel. Mais quelle activité, quelle instance élabore cette construction ? Dans les termes de la philosophie classique, celle-ci est le fruit de deux activités intérieures – l’intelligence et la liberté [25], cette dernière se présentant aujourd’hui sous la forme archaïque du désir [26] – relayées par trois médiations extérieures – la technique, le droit [27] et les sciences humaines et sociales [28] – le tout s’exerçant sur une donnée considérée comme illisible et passive – la nature en général et le corps humain en particulier [29].
d) Évaluation critique
Incontestablement, l’approche constructiviste honore la capacité créatrice de l’homme. Elle permet aussi de refuser les perspectives naïvement naturalistes. Par exemple, la psychanalyse freudienne a définitivement permis de critiquer la conception monolithique et anhistorique d’un prétendu instinct sexuel. Un enfant, s’il n’est pas toujours adoptif, doit toujours être adopté par ses parents.
Mais dans cette haine de l’homme moderne à l’égard de la part originaire, naturata, en lui [30] et dans cette volonté de lui substituer à tout prix un dire créateur ordonnant un matériau humain déclaré comme chaotique, ne doit-on pas lire un coup de force, plus encore, un ressentiment caché à l’égard de l’origine, ce que, avec profondeur, Hannah Arendt appelait un ressentiment contre le fait d’être né [31] ? L’homme d’aujourd’hui, plus encore que sans qualité, est « sans nombril [32] »
À Emmanuel Levinas « la naissance non choisie et impossible à choisir [33] », il faut administrer le remède d’un émerveillement plein de gratitude qui caractérisait le penseur Georg Keith Chesterton [34]. La revue du Mauss (Mouvement Anti-Utilitariste en Sciences Sociales) ne s’y trompe pas, qui écrit : « Le constructivisme combat et dissout tous les naturalismes. De là viennent sa force et sa séduction. Mais la question qui se pose est celle de savoir si ce constructivisme déconstructionniste est l’allié ou bien l’ennemi de la perspective écologique dont nous ne pouvons pas nous passer par ailleurs. Car quelle nature défendre et comment si de part en part elle est réputée artificielle ? construite ? non naturelle [35]? »
2) Une morale tirée de la nature
Tout unilatéralisme engendre son contraire ; toute pensée abstraite refoule une partie du concret. Voilà pourquoi, face au constructivisme, au culturalisme, se dresse une réaction naturaliste. Avec toutes les limites des réactions et tous les extrêmes des défoulements. En réalité, le constructivisme lui-même se positionne face à toute une antique tradition, des Grecs jusqu’à la fin de la Renaissance, selon laquelle la nature règle l’ordre de l’agir humain.
a) La sagesse du monde
Pendant plus de vingt siècles, la sagesse anthropologique s’est inscrit dans une sagesse plus vaste : la sagesse du monde, pour reprendre le titre de l’ouvrage que Rémi Brague consacre à ce sujet [36].
En effet, pour les Grecs (et les Romains), l’homme est inséré dans le cosmos. Or, celui-ci est régi par des règles. Donc, de même, l’homme est-il soumis à des règles. C’est ainsi que Platon parle de « notre art politique, celui qui existe authentiquement selon la nature [37] » et Aristote compare la classification des constitutions politiques à celle des animaux ; enfin, le stoïcien Lucrèce « enseigne les lois qui président à la création de chaque réalité et la nécessité pour chacune de demeurer soumise [38] ».
Ne nous trompons pas toutefois : cette cosmonomie n’est pas cosmocentrée, elle n’exclut ni Dieu (les dieux) ni l’esprit de l’homme. D’une part, la raison profonde de ce naturalisme est théologique : en se soumettant aux lois naturelles, l’homme obéit non point à des êtres qui lui seraient inférieurs mais à une sagesse supérieure. À Calliclès qui prône la force contre la justice, Socrate répond : « À ce qu’assurent les doctes, Calliclès, le ciel et la terre, les dieux et les hommes sont liés entre eux par une communauté, faite d’amitié et de bon arrangement, de sagesse et d’esprit de justice, et c’est la raison pour laquelle, à cet univers, ils donnent, mon camarade, le nom de cosmos, d’arrangement, et non celui de dérangement non plus que de dérèglement [39] ». Voilà pourquoi l’astronomie est à la fois, nous dit toujours Platon, « utile pour l’État [la cité] et cher de toute façon à la Divinité [40] ». D’autre part, la nature n’est pas contraire à la liberté : en effet, celle-ci appartient à l’essence de l’homme. Voilà pourquoi un Aristote peut affirmer que « si les vertus se trouvent en nous ce n’est ni par nature ni contre nature. Leur présence s’explique au contraire par le fait que, naturellement aptes à les recevoir, nous parvenons à leur plein épanouissement grâce à l’habitude [41] ».
Ce qui est vrai de l’Antiquité païenne l’est, mutatis mutandis, du Moyen-âge chrétien : la cosmologie y conserve une pertinence anthropologique et éthique. Non sans toutefois des changements. 1. Au plan anthropologique, la dignité suréminente de l’homme est plus clairement affirmée, sans que, pour autant, il soit arraché au monde où il vit ; par ailleurs, son origine est clairement interprétée comme divine et non cosmique (Gn 1,26). 2. Au plan éthique, l’homme trouve sa finalité dans celui qui est son origine ; en outre, il est appelé à imiter la nature non pas en sa régularité mais dans sa soumission à la Volonté divine et dans le comportement ordonné des divers corps la composant. Principe et terme sont cosmiques chez les Grecs ; ils deviennent résolument théologiques, sans nier la médiation physique, chez les médiévaux. Ils deviendront anthropologiques avec le monde moderne.
En se référant à Dieu, l’éthique et l’anthropologie médiévales conjurent le cosmocentrisme. En même temps, leur position peut aisément s’interpréter comme une prise de recul à l’égard de la cosmonomie antique. En ce cas, le monde moderne sera vu comme la radicalisation de l’attitude chrétienne et la déclaration de la non-pertinence totale du cosmos à édicter des normes éthiques. Précisément l’univers newtonien perd toute compétence éthique et anthropologique pour au moins cinq raisons : 1. La perte de la différence hiérarchique entre les deux mondes, céleste et sublunaire, ôte toute supériorité exemplaire au premier. 2. L’univers est le jeu de forces aveugles que ne conduit aucune finalité. 3. Son infinité accroît le sentiment d’indifférence, d’insignifiance, voire fait naître une inquiétude. 4. Le monde apparaît de plus en plus comme le théâtre de violence (que l’on songe aux luttes entre animaux). 5. La station droite n’est plus un appel à contempler, donc à recevoir, mais à dominer.
Voilà pourquoi, encore aujourd’hui, la nature se trouve éthiquement neutralisée. Son exclusion du champ éthique qui trouve son achèvement dans le constructivisme des sciences humaines et sociales ne pouvait que conduire à une réaction naturaliste.
b) Le retour de la nature dans la sociobiologie
L’origine du naturalisme éthique est, là encore, américaine. Ce courant est apparu dans l’orbe de la sociobiologie fondée en 1975 par l’entomologiste de Harvard, Edward O. Wilson dans un ouvrage programmatique qui a connu un franc succès dans les pays anglophones [42].
Au point de départ, ces thèses très biologisantes eurent peu de retentissement en France, sauf chez les théoriciens de la Nouvelle Droite. Mais de récents ouvrages traduits de l’américain leur ont donné une certaine audience
À noter que la toute dernière livraison de la sérieuse revue Pour la science propose un article où la jalousie est interprétée comme un comportement adaptatif sélectionnée par l’évolution [43]. Empruntons une illustration à l’anthropologue Robert Wright. Dans un livre intitulé L’animal moral, l’auteur estime que notre comportement notamment sexuel (mais aussi social et professionnel) est inscrit dans nos gènes [44]. Des sentiments que l’on qualifie de moraux, comme l’altruisme, la fidélité, etc., ont une cause non pas culturelle, mais naturelle. L’argumentation est tout entière fondée sur la théorie darwinienne de la survie du plus apte : « Il est désormais démontré que la sélection naturelle rend compte, de façon plausible, de tant d’aspects de la vie en général, et de l’esprit humain en particulier, que je n’ai guère de doutes quant au reste [45] ».
Prenons l’exemple de l’adultère. Sa fréquence dans la société humaine pose la question de l’existence d’une tendance inscrite dans les gènes. On constate que certains animaux sont infidèles et que, chez les chimpanzés et les gorilles, leur infidélité se mesure au poids des testicules. Or ce poids est à peu près le même chez l’homme. La taille et le poids des animaux entrent également en ligne de compte : plus ils sont imposants, plus ils sont polygames. Ces faits biologiques invitent à élaborer l’hypothèse évolutionniste suivante : le gène est égoïste [46], c’est-à-dire qu’il travaille donc à sa propre transmission d’une génération à la suivante. Or, et là se situe le naturalisme, l’être humain n’échappe pas à cette loi universelle. Mais l’esprit humain a aussi pour fonction d’assurer cette transmission. Nos attitudes et nos émotions sont donc le résultat d’une lente sélection qui a retenu parmi tous nos comportements ceux qui sont le mieux adaptés à la reproduction de l’espèce. Or, le mâle qui répand sa semence en autant de femmes que possible maximise ses chances de reproduction. Donc l’infidélité est une attitude plus adaptée à la survie. Voilà pourquoi elle a été sélectionnée. Et si le mâle s’en vante ensuite, c’est, constate Wright, « pour impressionner les autres mâles », mais aussi pour séduire les femelles qui, fascinées par tant d’énergie, recherchent avant tout le meilleur parti possible c’est-à-dire le mâle le plus apte à assurer la subsistance de la couvée. Ergo, l’adultère est un comportement adaptatif commandé par nos gènes ! Généralisons : la nature est génératrice de normativité.
D’une autre façon, le courant non-spéciste, à la suite du chercheur australien Peter Singer est source d’une morale et d’une bioéthique qui se fonde sur la nature, ici la présence d’un système nerveux qui rend capable de souffrir et appelle donc le respect de l’être apte à souffrir [47]. Comme ce système est commun aux hommes et aux animaux présentant un certain degré d’organisation, le créateur de la philosophie animale transforme « les différences constatées entre les autres animaux » en des « différences de degré et non d’espèce [48] ». Il ouvre aussi la porte au refus de la distinction entre nature et culture jugée trop simpliste. Telle est l’opinion du zoologue spécialiste des chimpanzés Frans de Waal : la transmission culturelle, c’est-à-dire la transmission de connaissances et de pratiques par des moyens non génétiques, explique-t-il, n’est pas propre à l’espèce humaine, mais s’observe aussi chez certains animaux. « la théorie selon laquelle nature et culture seraient deux choses radicalement opposées, théorie chère à Thomas Henry Huxley mais aussi à Freud et à Lévi-Strauss, est totalement dépourvue de fondement, explique-t-il dans une interview. Même si l’homme est un être culturel, il n’a jamais abandonné sa nature, et ne pourra jamais l’abandonner. Quant à la tendance à construire une culture, elle existe déjà chez les animaux. En d’autres termes, il y a de la nature et il y a de la culture, et nous avons un pied dans chacune des deux, comme beaucoup d’autres animaux d’ailleurs [49] ».
c) Évaluation critique
Là encore, on ne saurait nier la part de vérité contenue dans la thèse naturaliste, symétrique de la vérité de la thèse constructiviste. L’homme n’est pas à ce point auteur du sens qu’il ne le reçoive. Le naturalisme, en soulignant les conditionnements de l’humain, l’enracinement du volontaire dans l’involontaire, dénonce la naïveté et le prométhéisme latent du culturalisme. Le naturaliste matérialiste. Dan Sperber, coauteur sous la direction de Jean-Pierre Changeux des Fondements naturels de l’éthique [50] écrit dans un article : « aussi divers soient-ils, les systèmes moraux mettent en œuvre certaines aptitudes cognitives et typiquement humaines : notamment la capacité qu’ont les êtres humains de se représenter non seulement des états de choses, mais aussi d’attribuer des états mentaux à autrui. […] si un chien peut penser à un os, il ne peut pas penser à un chien pensant à un os. L’être humain, si. […] Or, la capacité de se représenter des états mentaux ne peut pas être intégralement acquise grâce à la culture, car c’est une précondition de la communication humaine et donc de la culture elle-même ». D’où un nécessaire « substrat psychologique […] de la morale ». Il rappelle que « le neuropsychologue américain Antonio Damasio a ainsi étudié le cas d’un patient qui, à la suite d’une lésion frontale, se révélait incapabe de prendre des décisions compétentes dans ses rapports sociaux [51] ». Certes, l’auteur, matérialiste à l’instar de Jean-Pierre Changeux, identifie la nature au substrat neurologique. Il souligne du moins le fondement naturel de toute prescriptivité.
Il demeure d’abord qu’à trop donner à la nature, c’est la dignité même de l’homme, être d’esprit, qui s’efface, cet homme qui justement est le seul à pouvoir reconnaître sa juste place à la nature ; de sorte que l’argumentation naturaliste s’auto-réfute.
Par ailleurs, l’argument tiré de l’adaptation naturelle est infalsifiable, au sens poppérien du terme [52]. Montrons-le à partir d’un exemple. En annexe de son ouvrage, Wright se demande si le suicide est une conduite biologiquement adaptative [53]. D’un côté, on peut échafauder un scénario qui rend compte du comportement autolytique : l’individu qui se juge un fardeau pour sa famille, optimise l’aptitude globale du groupe en se rayant délibérément de la carte. De l’autre côté, on peut tout autant dire que, l’adaptation sélectionnant les organes mentaux et non les conduites, le suicide est un déficit, non de l’organe, mais de la conduite, lié à l’environnement : « l’organe conçu pour que nous sentions contents de nous-mêmes de nous-mêmes peut aussi avoir des ratés ». L’application du critère d’irréfutabilité à l’argument concluant à la moralité de l’adultère montre qu’il peut tout autant conclure en sens contraire : celui-ci trahit le lien de confiance ; or, la société se fonde sur la confiance ; donc, la fidélité est un comportement adaptatif puisqu’il assure la cohésion du lien social. En outre, dans les cultures où l’adultère est acceptée, la douleur d’être trompé par son ou sa partenaire conjugal n’est en pas moins présente. Ainsi les Kuikurus d’Amazonie, très libéraux et volontiers fanfarons dans leurs exploits extramatrimoniaux, ne le font jamais quand les époux concernés sont présents. À trop prouver, on ne prouve plus rien !
En outre, « la théorie de la sélection naturelle, avoue Wright avec une naïveté confiante, est si élégante et si puissante qu’elle entraîne une adhésion voisine de la foi – sans qu’il s’agisse pour autant d’une foi aveugle, puisque cette adhésion repose sur ma capacité reconnue de cette théorie d’expliquer beaucoup de ce qui fait la vie. Toute question de foi mise à part, il est un point au-delà duquel rechercher encore quelque élément qui viendrait contredire la théorie dans son ensemble n’est plus nécessaire. Et je dois reconnaître que j’ai atteint ce point [54] ». Ce simplisme totalisant explique la renaissance constante du physicisme social, tentation politique dont on ne saurait minimiser la gravité [55].
Enfin, ces éthiques dites naturelles entretiennent une équivocité fondamentale sur le sens du terme « nature » : s’agit-il d’une nature seulement matérielle que l’homme partage avec les autres êtres humains ou s’agit-il d’une nature proprement humaine ? Il semble qu’il faille opter pour le premier membre de l’alternative ; mais cette perspective ne risque-t-elle pas alors de dissoudre l’originalité de l’homme ? Autant le constructivisme idolâtre la raison humaine, autant le naturalisme idolâtre la nature, contre-distinguée de la personne. Décidément, les contraires appartiennent au même genre…
3) Les raisons d’une crise
L’antagonisme de ces deux perspectives éthiques exclusives – constructivisme et naturalisme – constitue en fait l’avatar de deux conflits typiques de notre monde actuel : entre la liberté et la nature ; entre la liberté et la vérité.
a) Le divorce nature-liberté
On se souvient du mot de Jules Lachelier : « Pour moi l’opposition de la liberté et de la nature, comprise pour la première fois par Kant, est l’opposition fondamentale de la philosophie ». Edmund Husserl l’a montré, depuis Descartes, nous vivons dans un monde dualiste où la matière qui est toute extériorité s’oppose de manière irréconciliable avec la pensée qui est toute intériorité. Aujourd’hui le philosophe Luc Ferry peut écrire que l’homme est une force d’ »anti-nature », que la vertu est « une lutte de la liberté contre la naturalité en nous [56] ».
En réalité, cette déchirure n’est pas d’aujourd’hui ; elle accompagne chaque époque. Prenons l’exemple de l’exposition des nouveaux-nés. Elle a toujours existé : chez les Grecs (à Sparte [57] et ailleurs [58]) et les Romains [59], mais aussi en Mésopotamie [60] ou en Chine [61]. Or, dans l’exposition de l’enfant, montre Nicole Belmont [62], on dissocie les deux fonctions parentales essentielles qui sont la mise au monde et l’éducation. En effet, dans le rituel romain de légitimation du nouveau-né mâle, la sage-femme prend l’enfant « encore rouge du sang de sa mère » et le dépose sur le sol. De deux choses l’une : soit le père prend l’enfant et le relève ; soit il le laisse, auquel cas l’enfant est emporté par un esclave qui le dépose dans une corbeille sur une place publique ; il peut alors être recueilli par un couple d’humble condition qui l’adopte. On retrouve d’ailleurs cela dans le mythe du héros. Et cette dissociation entre parenté biologique et parenté éducatrice est une application de l’opposition de la nature et l’esprit.
Cette pratique courante dans la culture antique se poursuit dans l’Europe moderne. Que l’on songe au recours aux nourrices, à l’envoi des nouveaux-nés dans les campagnes, source de surmortalité, à la séparation immédiate des nouveaux-nés de leurs mères aussitôt après la naissance, à l’emploi de gouvernantes ou de précepteurs privés pour l’enseignement [63]. Sur 21.000 enfants nés en 1780 à Paris, une enquête faite par le lieutenant général de police Lenoir, montre que 19.000 sont envoyés en nourrice hors domicile. Or, l’enfant part loin, à la campagne, et en moyenne 4 à 5 ans, bien plus longtemps que ce que requiert le sevrage [64]. Or, ces pratiques ont des répercussions graves sur l’enfant. En chiffres absolus, Rousseau estime que « la moitié des enfants qui naissent périt avant la huitième année [65] » et Prost de Royer compte qu’à Lyon, « il naît 6.000 enfants toutes les années » et « il en périt plus de 4.000 en nourrice [66] ». En chiffres relatifs, Flandrin a évalué que la mise en nourrice a doublé la mortalité infantile. Marie-France Morel estime que la mortalité des bébés placés en nourrice fut de 25 à 40 %, alors qu’elle est « seulement » de 18 à 25 % pour les enfants allaités par leur mère [67]. À chaque fois on dissocie l’opération naturelle sur laquelle l’homme n’a que peu de prise et l’action libre, rendant illisible le lien profond entre le don de la vie et le don de l’amour.
Dans son encyclique sur les fondements de la morale, Jean-Paul II confirme ce diagnostic historique et l’importance de la dissociation nature-liberté : « Les débat sur la nature et la liberté ont toujours accompagné l’histoire de la réflexion morale, prenant un tour aigu au temps de la Renaissance et de la Réforme, comme on peut le remarquer dans les enseignements du Concile de Trente. L’époque contemporaine est marquée par une tension analogue, bien que dans un sens différent : le goût de l’observation empirique, les processus de l’objectivité scientifique, le progrès technique, certaines formes de libéralisme ont amené à opposer les deux termes, comme si la dialectique – sinon même le conflit – entre la liberté et la nature était une caractéristique qui structure l’histoire humaine [68] ». Le pape propose donc trois observations : 1. la dissociation nature-liberté est constante ; 2. elle s’est acutisée au xvie siècle ; 3. elle prend une tournure particulière aujourd’hui : ce que les siècles antérieurs ont pratiqué, pour la première fois, notre époque le théorise et le met en œuvre systématiquement.
b) Le divorce liberté-vérité
Au constat de cette première brisure, l’encyclique Veritatis Splendor joint celui d’une autre déchirure, tout aussi redoutable, entre liberté et vérité : « Sous l’influence des courants subjectivistes et individualistes invoqués ci-dessus, certaines tendances de la théologie morale actuelle interprètent d’une manière nouvelle les rapports de la liberté avec la loi morale, avec la nature humaine et avec la conscience ; elles proposent des critères inédits pour l’évaluation morale des actes. Malgré leur variété, ces tendances se rejoignent dans le fait d’affaiblir ou même de nier la dépendance de la liberté par rapport à la vérité [69] ». Comme la liberté, comme puissance enracinée dans la volonté [70], est tournée vers le bien, la séparation de la liberté et de la vérité est donc l’autre nom d’une incommunicabilité métaphysique entre les deux transcendantaux bien et vrai.
Ce conflit aigu se nourrit aujourd’hui d’une grave suspicion à l’égard de la vérité : celui-ci ne fait-il pas secrètement le jeu de la violence ? N’est-ce pas au nom de la vérité que des idéologies comme le communisme et le nazisme ont commis les pires pogroms de l’histoire de l’humanité ? [71]
Mais cette suspicion à l’égard de la vérité, là encore, ne date pas d’aujourd’hui. Le cardinal Joseph Ratzinger développe ce thème qui lui est cher [72] dans un discours sur le fondement éthique de l’exercice de la liberté prononcé à l’Institut de France où il fut élu comme membre associé au fauteuil d’Andreï Sakharov [73]. Le Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi reprend l’opinion de P. Bayle, à la fin xviie siècle. Il vaut la peine de citer longuement son analyse, qui rejoint d’ailleurs celle d’autres observateurs [74]. « À la fin des guerres sanglantes dans lesquelles les grandes querelles de la foi avaient précipité l’Europe, la métaphysique, estimait-il, n’intéressait pas la vie politique : la vérité pratique suffisait. Il n’existait, selon lui, qu’une unique morale, universelle et nécessaire, qui était une claire et vraie lumière que tous les hommes perçoivent dès qu’ils ouvrent un peu les yeux. Les idées de Bayle reflètent la situation spirituelle de son siècle : l’unité de la foi s’était désagrégée [puisqu’à côté des catholiques on trouvait les protestants], on ne pouvait plus tenir comme un bien commun les vérités du domaine métaphysique. Mais les convictions morales fondamentales et essentielles avec lesquelles le christianisme avait formé les âmes, étaient toujours les certitudes sans discussion dont il semblait que la seule raison pouvait percevoir la pure évidence ». L’expérience traumatisante des guerres de religion a donc conduit l’homme à perdre confiance dans la raison métaphysique – autrement dit dans le vrai – et à ne plus l’accorder qu’aux évidences pratiques – autrement dit au bien.
Mais comment une liberté dénuée de tout fondement s’oriente-t-elle ? On connaît la réponse : le consensus démocratique. C’était la réponse de Tristam Engelhardt. Mais ce consensus peut aller jusqu’à opter pour le mal et contre la liberté, donc pour le nihilisme : « le positivisme strict qui s’exprime dans l’absolutisation du principe de la majorité se renverse inévitablement un jour ou l’autre en nihilisme ». C’est déjà ce que montre l’épreuve des faits. Le nihilisme fut en œuvre dans le nazisme : seul l’intérêt du parti était normatif, les valeurs morales absolues n’existaient pas. « Ainsi, pendant des décennies entières, on assista à un écroulement du sens moral qui devait nécessairement se transformer en nihilisme complet le jour où aucun des buts précédents n’eut plus de valeur et où la liberté se réduisit à la possibilité de faire tout ce qui peut, pour un instant, rendre captivante et intéressante une vie devenue vide ». Plus généralement, « les développements de ce siècle nous ont appris qu’il n’existe pas une évidence qui soit une base fixe et sûre de toutes les libertés. La raison peut très bien perdre de vue les valeurs essentielles ». C’est ainsi que l’esclavage a été accepté pendant des siècles. En effet, la suspicion à l’égard du vrai rejaillit tôt ou tard sur l’évidence de la raison pratique. Auto-fondée, la liberté est « vide et sans direction » et s’affaisse tôt ou tard sur elle-même. Le positivisme qui refuse toute valeur métaphysique rime avec le nihilisme. « La liberté, explique le cardinal Ratzinger, peut s’abolir elle-même, se dégoûter d’elle-même, une fois qu’elle est devenue vide ». En positif : la liberté doit être nourrie et plus encore fondée : sur le vrai et sur le bien.
Pascal Ide
[1] Pascal Ide, « La nature humaine, fondement de la morale », Coll., Handicap, clonage… La dignité humaine en question, Actes du colloque de bioéthique de Paray-le-Monial de mai 2003, Paris, Éd. de l’Emmanuel, 2004, p. 79-155.
[2] Héraclite, Fragments B lxxxix, in Les Présocratiques, éd. Jean-Paul Dumont, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, Gallimard, 1988, p. 166, cité par Plutarque, De la supersition, 3, 166 c. Autrement dit, la connaissance de l’universel comme bien commun, communiqué, requiert plus de conscience, d’éveil que la seule perception du fragment, de la particularité.
[3] André Frossard, Défense du Pape, Paris, Fayard, 1993, p. 87.
[4] Concile œcuménique Vatican II, Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps Gaudium et spes, n. 35, § 2.
[5] Tom L. Beauchamp et James K. Childress, Principles of Biomedical Ethics, New York, Oxford University Press, 1979, 41994.
[6] H. Tristam Engelhardt, Jr., The Foundations of Bioethics, New York, Oxford, Oxford University Press, 1986, 21996. Il existe une trad. italienne : Manuale di biœtica, Milan, 1991.
[7] A noter que, avec cohérence, Engelhardt vient d’écrire un ouvrage où il présente l’éthique orthodoxe dans sa logique interne, mais aussi dans sa particularité en rien universalisable.
[8] « If one cannot establish by sound rational argument a particular concrete moral viewpoint as canonically decisive (and one cannot, because the establishment of such a viewpoint itself presupposes a moral viewpoint, and that is exactly what is at stake), then the only source of general secular authority for moral content and moral direction is agreement ». (Ibid., p. 68)
[9] Cf. Ibid., chap. 3.
[10] Gilbert Hottois, Aux fondements d’une éthique contemporaine. H. Jonas et H. T. Engelhardt en perspective, Paris, Vrin, 1993, p. 27.
[11] « Le début de la vie humaine biologique n’est pas suivi immédiatement par le début de la vie d’une personne. Au contraire, dans l’ontogenèse humaine, il se passe des mois de vie biologique avant que l’on ait l’évidence de la vie d’un esprit (mente) et il se passe des années avant que soit donnée la preuve de la vie d’une personne. En conséquence, le statut moral des zygotes, embryons, fœtus et même des enfants, est problématique ». J’emprunte ici la référence au Père Cottier qui cite la traduction italienne (Manuale di bioetica, Milan, 1991, p. 248).
[12] Georges Cottier, « Mort de l’humanisme ? », Nova et Vetera, 78/4 (2003), p. 5-17, p. 16-17.
[13] Alain de Benoist, Vu de droite, Paris, 1974, p. 90. L’orientation politique de l’auteur montre que les adversaires de la notion de nature humaine se recrutent autant à droite qu’à gauche.
[14] Jacques-Bénigne Bossuet parle aussi d’instinct et même de « cri » (Principes communs de l’oraison chrétienne, in Instruction sur les états d’oraison. Second traité, éd. E. Levesque, Paris, Firmin-Didot, 1897, p. 96).
[15] Sur cette question, cf. Fénelon, Œuvres, éd. Jacques Le Brun, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, Gallimard, tome 1, 1983, p. 657-659. A proprement parler, Fénelon ne songe pas à nier l’existence d’inclination naturelle par un argument du type : ce qui est naturel ne peut être ni corrompu ni même altéré, c’est-à-dire diminué ; or, l’expérience montre que des hommes peuvent ne pas suivre certaines inclinations ; c’est donc que ces inclinations ne sont pas naturelles. Cette problèmatique n’est pas celle de son temps. Il veut seulement montrer que le fond d’inclination dans l’homme ne le détermine pas : ce fond instinctif peut peser sur lui, non le contraindre. Or, la force qui s’oppose à la nature, on vient de le voir, est la liberté. Aussi Fénelon ne veut-il considérer que les « actes libres », non la « nature ». En ce sens, il ne se livre pas à une véritable déconstruction avant la lettre de la notion de nature, mais il en prépare l’avènement de manière prochaine, en établissant une opposition irréductible entre nature et liberté.
[16] Sans compter que bien des discours universels (par exemple sur les droits de l’homme) se sont avérés être des discours ethnocentriques déguisés (cf. Geneviève Médevielle, « Pérennité et universalité des droits de l’homme », Seminarium. Cinquantième anniversaire de la Déclaration des Droits de l’homme, 38/3 (juillet-septembre 1998), p. 555-582, ici p. 557)
[17] Ed. Brunschvicg, fr. 93. Pierre Bourdieu commente, élargissant de la coutume à l’histoire, ce qui permet de retrouver le premier argument : « Le seul fondement possible de la loi est à chercher dans l’histoire qui, précisément, anéantit toute espèce de fondement […]. A l’origine, il n’y a que la coutume, c’est-à-dire l’arbitraire historique de l’institution historique qui se fait oublier comme telle en tentant de se fonder en raison mythique ou, plus banalement, en se naturalisant ». (Méditation pascaliennes, Paris, Seuil, 1997, p. 114. Cf. Id., La domination masculine, Paris, Seuil, 1998, p. 90).
[18] Richard Gula, Reason informed by Faith, New York, Paulist Press, 1989. Cf. le tableau distinguant les deux lignes d’interprétation p. 239-240. Il est repris par Geneviève Médevielle, Le bien et le mal, coll. « Tout simplement », Paris, Ed. de l’Atelier, 2004, p. 105.
[19] Marx refuse que les lois des économistes classiques soient « naturelles » et renvoie à l’histoire ce que certains prétendent identifier comme naturel. L’histoire, en effet, permet d’éviter la double illusion inverse et perverse du « jamais vu » et du « toujours ainsi », qui ont longtemps permis de fonder une métaphysique identitaire et éternitaire des essences naturelles (cf. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Le métier de sociologue. 1. Nature et culture, Paris, Mouton, 1968, p. 172s).
[20] L’historien Fernand Braudel explique l’enracinement de l’homme dans son milieu géographique pour aussitôt annuler toute valeur actuelle à la notion de nature : « le milieu géographique ne contraint pas les hommes sans rémission puisque, précisément, toute une part de leur effort […] a consisté pour eux à se dégager des prises contraignantes de la «Nature», comme ils ont dit longtemps avec un respect mêlé de gratitude et de terreur ». (La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Paris, Armand Collin, 1949, p. 5. C’est moi qui souligne)
[21] Selon Lévi-Strauss, l’homme est sa culture, y compris dans ses activités les plus apparemment enracinées dans le terreau biologique. En effet, l’ethnologie « essaie de faire, dans l’ordre de la culture, la même œuvre de description, de classification et d’interprétation que le zoologiste ou le botaniste fait dans l’ordre de la nature », de sorte que cette discipline « aspire à se constituer à l’exemple des sciences naturelles ». (Claude Lévi-Strauss, Entretiens avec Georges Charbonnier, coll ».10/18 », Paris, U.G.E., 1959, p. 181) Les invariants culturels manifestés permet de voir dans l’esprit « sa nature de choses parmi les choses ». (Le cru et le cuit, Paris, Plon, 1964, p. 18)
[22] On aurait aussi pu prendre l’exemple de la famille. Le sociologue Pierre Bourdieu fait de celle-ci une construction socialement et historiquement située : elle est le fruit de conventions sociales intériorisées par les acteurs sociaux, ce que Bourdieu appelle des habitus (cf. Raisons pratiques, Paris, Seuil, 1994, p. 135-145).
[23] Cette distinction apparaît dans l’essai de Sigmund Freud de 1905, Trois essais sur la théorie de la sexualité (trad. N. Reverchon-Jouve, coll. « Folio », Paris, Gallimard, 1962) et se systématise, dix ans plus tard dans « Pulsions et destins des pulsions » (trad. Jean Laplanche et Jean-Baptiste Pontalis, coll. « Folio », Paris, Gallimard, 1968, p. 11-43, notamment p. 18-20).
[24] Histoire de la sexualité. 1. La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p. 139.
[25] Chez un Jean-Paul Sartre, la liberté dévore même l’intégralité de l’être humain – selon ses propres mots, l’existence précède l’essence – : « Ma liberté […] n’est pas […] une propriété de ma nature ; elle est très exactement l’étoffe de mon être […]. On ne saurait trouver à ma liberté d’autre limite qu’elle-même ». (L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Paris Gallimard, 1955, p. 514)
[26] Par exemple, en matière de procréation médicalement assistée, « l’irrésistible désir de naissance » (cf. le titre de l’ouvrage de Robert Frydman, Paris, PUF, 1986).
[27] Cf. Marcela Iakub, Penser les droits de la naissance, Paris, PUF, 2002. « … la nature, qui n’est autre chose que la loi elle-même » (Id., Le crime était presque sexuel, Paris, EPEL, 2002, p. 157).
[28] Contrairement à ce que l’on croit parfois, les sciences humaines et sociales ne se contentent pas de décrire ou même de critiquer. A côté de ce pôle plus théorique de compréhension, elles sont aussi porteuses d’une justification et d’un projet pratiques, à savoir la libération des processus d’aliénation ; en particulier toute situation immuable est oppressive, on doit soupçonner sa mise en place de servir des enjeux occultes de pouvoir et de classe : aucune donnée ne peut justifier une structure soustraite aux aléas de la contingence, du temps ; mais ce que l’intelligence ne voit pas, la volonté peut l’imposer ; par conséquent, toute réalité tenue comme définitivement acquise est le fruit d’une instance volontariste, autrement dit à un petit groupe qui souhaite garder acquis ses privilèges. Sur les fondements de la critique constructiviste, cf. Ian Hacking, Entre science et réalité, la construction sociale de quoi ?, trad. B. Jurdant, Paris, La Découverte, 2001, notamment p. 20s.
[29] Sur la place de ces différents pôles, je me permets de renvoyer à Pascal Ide, Le corps à cœur. Essai sur le corps, coll. « Enjeux », Versailles, Saint-Paul, 1996, 1ère partie, chap. 3-5. Je n’accordais alors pas assez de sens et de place aux instances juridique, politique et au jeu des sciences humaines et sociales.
[30] Stephen Toulmin illustre bien ce coup de force quand il affirme : « la culture a le pouvoir de s’imposer de l’intérieur à la nature ». (« Back to nature », New York Review of Books, 9 juin 1977, p. 3 à 6, p. 4)
[31] Hannah Arendt, The Burden of Our Time, Londres, Secker and Warburg, 1951, p. 438. Cf. Alain Finkielkraut, De l’ingratitude. Conversation sur notre temps, Paris, Gallimard, 1999 et L’Humanité perdue. Essai, coll. « Points », Paris, Seuil, 1996.
[32] Alain Finkielkraut, L’ingratitude, p. 116.
[33] Totalité et infini, La Haye, Martinus Nijhoff, 1961, p. 199. Cf. Jean-Louis Chrétien, L’appel et la réponse, coll. « Critique », Paris, Minuit, 1992, p. 99.
[34] Cf. Mariano Fazio, « Chesterton : la filosofia del asombro agradecido », Acta Philosophica, 11 (2002/1), p. 121-142.
[35] « Présentation », Alain Caillé, Philippe Chanial et Frédéric Vanderberghe, Revue du Mauss. Chassez le naturel. Écologisme, naturalisme et constructivisme, n° 17 (2001), Paris, La Découverte, p. 6.
[36] Rémi Brague, La sagesse du monde. Histoire de l’expérience humaine de l’univers, coll. « L’esprit de la cité », Paris, Fayard, 1999.
[37] Le Politique, 308 c, trad. Léon Robin, Œuvres complètes, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, Gallimard, 1950, 2 tomes, vol. 2, p. 424.
[38] De la nature, V, 56 et 57, trad. Alfred Ernout, coll. « Guillaume Budé », Paris, Les Belles Lettres, 1947, p. 199. Trad. légèrement modifiée.
[39] Gorgias, 507 e-508 a, Œuvres complètes, tome 1, p. 461.
[40] Les Lois, L. VII, 821 a, Ibid., tome 2, p. 912. Trad. légèrement modifiée.
[41] Ethique à Nicomaque, II, 1, 1103 a 23, trad. Jean Tricot, coll. « Bibliothèque des textes philosophiques », Paris, Vrin, 31972, p. 88.
[42] E. O. Wilson, Sociobiology. The New Synthesis, Harvard University Press, 1975 et On Human Nature, Harvard University Press, 1978. Pierre-Paul Grassé s’est attaché à longuement les réfuter dans L’homme en accusation. De la biologie à la politique, Paris, Albin Michel, 1980.
[43] Christine Harris, « Comment naît la jalousie », Pour la science, n° 319, mai 2004, p. 54-59.
[44] Robert Wright, L’animal moral. Psychologie évolutionniste et vie quotidienne, trad. Anne Béraud-Butcher, Paris, Ed. Michalon, 1995. Cf. aussi l’ouvrage de l’anthropologue Helen Fischer, Anatomie de l’amour, trad., Paris, 1994.
[45] Ibid., p. 367.
[46] Selon le titre du célèbre ouvrage de Richard Dawkins (L’horloger aveugle, trad. Bernard Sigaud, coll. « La fontaine des sciences », Paris, Robert Laffont, 1989).
[47] Pour le détail, cf. Pascal Ide, « L’homme et l’animal. Une différence sans indifférence », Liberté politique, n° 20. Le nouvel âge écologique, juillet-août 2002, p. 73-99.
[48] Peter Singer, Pratical Ethics, Cambridge University Press, 21993 ; Questions d’éthique pratique, trad. Max Marcuzzi, Paris, Bayard, 1997, p. 78.
[49] Frans de Waal, « Les chimpanzés et nous », La Recherche, n° 341 (avril 2001), p. 103-106, ici p. 106.
[50] Paris, Odile Jacob, 1993. Changeux parle dans la préface d’une « nature humaine » (p. 7) et des « fondements naturels de l’éthique », par-delà la diversité des cultures.
[51] « D’où vient la morale ? Le mal est cérébral », Libération, 22 décembre 1993.
[52] Je rappelle que la réfutabilité (falsifiability, en anglais) est, pour Sir Karl Popper, le critère principal de la scientificité. Est réfutable un énoncé dont une expérience ou une expérimentation peut démontrer la validité ou la fausseté. Est donc non-réfutable l’affirmation qu’aucun fait ne peut invalider. Or, c’est typiquement le cas d’une assertion qui englobe la totalité du réel ou tire des traites sur l’avenir (par exemple : « On n’a pas réussi à démontrer, mais un jour on y arrivera ».).
[53] Ibid., p. 372 et 373.
[54] Robert Wright, L’animal moral, p. 367. Cf. son ouvrage The Ape and The Sushi Master.
[55] Cf. la remarquable analyse de Thomas Fleming, « La paupérisation culturelle des États-Unis », Catholica, n° 81, automne 2003, p. 16-21.
[56] Qu’est-ce que l’homme ?, écrit en collaboration avec Jean-Didier Vincent, Paris, Grasset, 2000, p. 48.
[57] Cf. Plutarque, La vie de Lycurgue, § 30, in Les vies des hommes illustres, trad. J. Amyot, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, Gallimard, 2 tomes, tome 1, 1951.
[58] Au point qu’à Thèbes, l’autorité politique doit juguler les abus (cf. Gustave Glotz, « L’exposition des enfants », Etudes sociales et juridiques sur l’Antiquité grecque, 187-227. Cf. A. Cameron, « The Exposure of Children and Greek Ethics », The Classical Review, 46 (1932), p. 105-114).
[59] Cf. Philippe Caspar, Le peuple des silencieux. Une histoire de la déficience mentale, coll. « Pédagogie psychosociale », Paris, Fleurus, 1994, p. 38-41.
[60] Cf. Jean Botéro, Babylone. A l’aube de notre culture, coll. « Découvertes », Paris, Gallimard, 1994, p. 85.
[61] Cf. Marcel Granet, La civilisation chinoise, coll. « L’évolution de l’humanité » n° 2, Paris, Albin Michel, 1968, p. 350-352.
[62] « L’enfant exposé », Anthropologie et société, 4 (1980), p. 1-17.
[63] Cf. « D’amour et de lait », Cahiers du nouveau-né, n° 3, Paris, Stock, 1980.
[64] Cité par par Elisabeth Badinter, L’amour en plus, Paris, Flammarion, 1980, p. 57.
[65] Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Paris, Ed. Sociales, 1987, p. 49.
[66] Cité par Jean-Louis Flandrin, Familles : parenté, maison, sexualité dans l’ancienne société, Paris, Hachette, 1976, p. 196.
[67] M.-F. Morel, « Enfances d’hier, approche historique », M. Guidetti, S. Lallemand et M.-F. Morel, Enfances d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, Paris, Armand Collin, 1997, p. 58-112.
[68] Encyclique Veritatis Splendor, 6 août 1993, n. 46.
[69] Ibid., n. 34.
[70] Cf. S. Thomas d’Aquin, Somme de théologie, Ia, q. 83, a. 4.
[71] Theodor Litt a voulu montrer à juste titre, contre positivisme et historicisme, que l’universel moral n’est pas une construction (L’universel dans les sciences morales, coll. « Humanités », Paris, Le Cerf, 1999).
[72] Cf. par exemple Joseph Ratzinger, « Vérité du christianisme ? », Colloque 2000 ans après quoi ?, Sorbonne, 25-27 novembre 2000, La Documentation catholique, n° 2217, 2 janvier 2000, p. 29-35. Repris dans Christianisme. Héritages et destins, sous la dir. de Cyrille Michon, Paris, Librairie générale française, Le livre de poche. Biblio essais, 2002, p. 303-324.
[73] Joseph Ratzinger, Discours de réception du cardinal à l’Académie des Sciences morales et politiques de l’Institut de France, 6 novembre 1992, in La Documentation Catholique, 20 décembre 1992, n° 2062, p. 1082 à 1084.
[74] Cf. Reinhart Koselleck, Le règne de la critique, trad. Hildenbrand, coll. « Arguments », Paris, Minuit, 1979 ; Albert O. Hirschman, Les passions et les intérêts. Jusitications politiques du capitalisme avant son apogée, trad., coll. « Sociologies », Paris, PUF, 1980 ; Norbert Elias, La société de cour, trad. Pierre Kamnitzer et Jeanne Etoré, coll. « Champs », Paris, Flammarion, 1985.