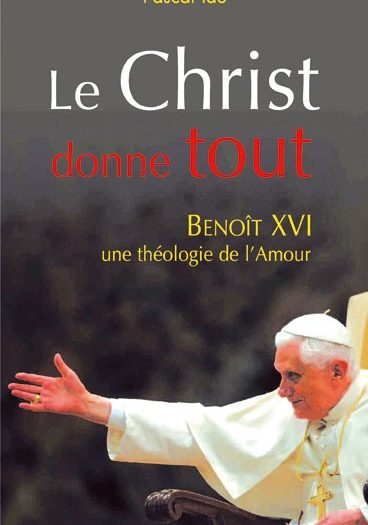4) L’Église, interpersonnalité horizontale
Parti du Christ qui constitue la porte d’entrée de la foi chrétienne, étant remonté jusqu’au mystère trinitaire qu’il révèle et qui en retour le fonde, considérons maintenant le mystère de l’Église qui le prolonge et le transmet.
Le pape envisage l’Église comme une réalité interpersonnelle. Nous en avons déjà traité à propos de l’Église communion et « famille de Dieu ». Ici, nous concrétisons encore le propos, en montrant qu’il renvoie à la relation entre les personnes composant l’assemblée ecclésiale. Benoît XVI parle une fois du « de l’Église [1] ». Cette interpersonnalité s’illustre, autant qu’elle s’effectue, dans l’agir collégial qui doit être celui de l’Église. Une illustration exemplaire en est fournie dans la manière dont Paul travaille avec ses compagnons. L’Apôtre a toujours fait appel à des compagnons : d’abord Barnabé ; puis, lorsqu’il s’est séparé de lui, Silas. Et il cite expressément leur action dans la prédication de l’Évangile aux chrétiens de Corinthe : il parle du « Christ Jésus, que nous avons prêché parmi vous, Silvain, Timothée et moi » (2 Co 1,19). Actualisant son propos, Benoît XVI en déduit la nécessaire coopération entre les personnes dans l’Église : « Paul n’agit pas , en pur individu, mais avec ses collaborateurs, dans le de l’Église. Ce de Paul n’est pas un isolé dans le de l’Église, dans le de la foi apostolique [2]. »
Notre époque est celle de l’individu [3]. Et cet individualisme s’est aussi fortement développé au sein de la théologie protestante libérale, notamment chez Adolf von Harnack dans ses leçons sur L’essence du Christianisme [4]. Tout au contraire, et cela dans le prolongement de l’Écriture, de la tradition patristique et de la grande scolastique [5], Benoît XVI ne sépare jamais la personne de la communauté, concrètement, il ne sépare jamais le chrétien de l’Église. L’étymologie grecque du terme Église, ekklésia, signifie « assemblée » et ce terme vient du verbe kaléo, « appeler », appeler pour rassembler, pour être ensemble : « Même si sa prédication est toujours un appel à la conversion personnelle, il [Jésus de Nazareth] vise en réalité continuellement à la constitution du Peuple de Dieu qu’il est venu rassembler, purifier et sauver [6] ».
Comprenons bien le sens de cet appel de l’Église, donc de la forme ecclésiale de l’interpersonnalité. Il ne s’agit pas d’affirmer que le Christ ne peut sauver un homme sans l’autre : le salut relève du consentement libre et intime de chacun. Cela ne signifie pas non plus, en tout cas pas seulement, que Dieu veut racheter tous les hommes ou qu’il nous veut responsable les uns des autres [7]. En sa signification radicale, l’expression renvoie au désir qu’a le Sauveur de constituer l’ensemble des élus en un peuple, en un corps organique et différencié, constitué en une communauté d’alliance. « Un signe évident » de ce que Dieu a comme intention non seulement le salut de chacun, mais aussi celui de l’Église, est l’Institution des Douze. En effet, explique Benoît XVI dans sa première catéchèse sur le Christ et l’Église, « le nombre Douze rappelle de toute évidence les douze tribus d’Israël » qui, justement, constituaient le peuple élu, mais circonscrit dans la particularité d’un lieu, d’une époque, d’une culture. Par conséquent, « en choisissant les Douze, […] Jésus veut dire qu’est arrivé le temps définitif où se constitue de nouveau le Peuple de Dieu, le peuple des douze tribus », désormais sans limite a priori, un peuple « qui devient à présent un peuple universel, son Église [8] ». Reprenant un thème qui lui est cher, Benoît XVI montre que ce « peuple universel » n’a rien à voir avec la fraternité des Lumières : l’injonction « Peuples, unissez-vous » demeure abstraite, car elle nie la réalité des communautés concrètes et surtout leurs tensions, leurs oppositions [9]. En regard, le peuple de l’Église se constitue à partir de la réalité concrète de la communauté ecclésiale toujours particulière et s’étend, au nom de l’amour, et parfois même du sacrifice de soi, aux non-chrétiens [10].
Ce que Benoît XVI professe, il le confesse. Il est en effet animé par un sentiment très vif, j’oserais dire expérimental, de la communio sanctorum, la « communion des saints » [11]. Cela paraît dans la manière dont il demande la prière et remercie pour elle : « je me remets à vos prières », disait-il le soir de l’élection, le 19 avril 2005. Quelques jours plus tard, lors la messe d’inauguration du pontificat, il précise : « Je ne dois pas porter seul ce que, en réalité, je ne pourrais jamais porter seul [12] ». À l’audience du premier anniversaire de son élection, le Saint Père rappelle cette parole, puis l’approfondit : « Et je sens toujours plus que seul, je ne pourrais pas mener à bien cette charge, cette mission. Mais je sens aussi que vous la portez avec moi : ainsi, je me trouve dans une profonde communion et, ensemble, nous pouvons accomplir la mission du Seigneur. La protection céleste de Dieu et des saints constitue pour moi un soutien irremplaçable, et je suis réconforté par votre proximité, chers amis, qui ne manquez pas de m’offrir le don de votre indulgence et de votre amour [13] ». Ce témoignage émouvant que je me suis permis de citer un peu longuement force l’attention. Il porte les traits de ce qu’un père de l’Église d’Alexandrie, Origène, appelait l’anima ecclesiastica [14], ce qui se traduit non par « âme ecclésiastique » – ce semblerait la limiter aux seuls clercs –, mais par « âme d’Église » [15]. Cette formule doit se comprendre dans un sens généreux, voire audacieux : elle désigne une personne qui non seulement sait pouvoir compter sur les trésors de l’Église, mais se sait le réceptacle, si indigne et si médiocre soit sa vie, de la sainteté de toute l’Église : l’anima ecclesiastica est, en quelque sorte, toute l’Église à elle seule [16]. Et Benoît XVI l’exprime ici dans le vocabulaire de la « communion », lui-même traduit dans le lexique concret du pronom personnel « nous ». On notera aussi que le pape fait volontiers appel à la grammaire de l’expérience : « je sens », « je suis réconforté ». On soulignera enfin que la largeur de l’âme ecclésiastique se mesure à son humilité et à sa confiance, c’est-à-dire à la certitude que le soutien de Dieu vient au secours de sa faiblesse, par la médiation des fidèles.
Cette dilatation ecclésiale ne cesse de croître avec l’approfondissement de l’union au Christ. Pourtant cet effacement de la frontière entre individualité et socialité, entre le « pour soi » et le « pour l’autre » se produit dès le baptême. Il s’y réalise une profonde mutation de la personne, ainsi que nous le redirons : « alors – explique le pape dans l’importante homélie de la veillée de Pâques 2006 – mon moi existe de nouveau, mais précisément transformé, renouvelé, ouvert par l’incorporation dans l’autre, dans lequel il acquiert son nouvel espace d’existence [17] ».
5) L’Église, interpersonnalité verticale
Jusqu’à maintenant nous avons considéré l’interpersonnalité entre les membres de l’Église. Mais, de même que la communion comporte, à côté de la composante horizontale, une composante verticale, de même l’Église est-elle structurée, à côté des relations entre ses membres, par la relation interpersonnelle entre l’Église et le Christ, entre l’Église et Dieu. Autrement dit, le « je » du chrétien peut et doit entrer en relation avec le « je » divin.
Cette relation verticale s’observe singulièrement en Marie. En effet, se fondant sur ce que l’évangéliste saint Luc dit de la Vierge – elle « conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur » (2,19 ; cf. 2,51) –, Benoît XVI affirme : « Elle était une personne en dialogue avec Dieu, avec la Parole de Dieu, ainsi qu’avec les événements à travers lesquels Dieu parlait avec elle [18] ». Or, non sans continuité avec l’admirable livre qu’il avait co-écrit avec Balthasar, Marie première Église [19], le pape voit dans la Mère de Dieu, l’Église en personne : « Marie – dit-il au sanctuaire d’Altötting qui lui est dédié – guide l’Église naissante dans la prière ; elle est presque l’Église priante en personne [20] ». Par conséquent, à l’instar de Marie et à sa suite, l’Église, chaque chrétien est appelée à vivre de cette interpersonnalité, à entrer en dialogue avec Dieu. Ici réside le mystère intime de l’Église : tout autre regard lui est inadéquat.
Une question pourrait se poser : la relation interpersonnelle suppose un échange, donc une certaine égalité. L’introduire entre Dieu et l’homme ne contredit-il pas la foncière asymétrie existant entre eux ? En fait, Benoît XVI sauvegarde la différence car il pense la relation dialogale à partir du couple déjà rencontré : écoute-réponse ; plus exactement : écoute puis réponse. C’est ainsi qu’il dit de la liturgie qu’elle est « d’abord écoute puis réponse ». Et il en donne trois exemples : « le Psaume responsorial », « la prière de l’Église » ou « la grande prière eucharistique » (qui doit être célébrée « d’abord comme écoute, puis comme réponse [21]« ). Les deux composantes de l’interpersonnalité ecclésiale ne doivent donc pas être considérées comme équivalentes : la relation entre les hommes se fonde sur la relation avec Dieu, comme la réponse suppose l’écoute. Si l’Église met les hommes en relation entre eux, cela tient ce qu’elle les met d’abord en relation avec Dieu. Une nouvelle fois, le Saint-Père souligne la finalité et l’essence de l’Église, toujours menacée d’oubli, qui est sacrement de la communion avec la Trinité. Certes, la réponse humaine est libre, à l’instar du don divin qui la suscite. Toutefois, on ne saurait symétriser les deux libertés. C’est toujours Dieu qui prend l’initiative : « Le mot latin adventus se réfère à la venue du Christ, et met au premier plan le mouvement de Dieu vers l’humanité, auquel chacun est appelé à répondre à travers l’ouverture, l’attente, la recherche et l’adhésion. Et comme Dieu est souverainement libre dans sa révélation et son don de soi, car il n’est poussé que par l’amour, de même, la personne humaine également est libre de donner son assentiment, toutefois nécessaire : Dieu attend une réponse d’amour [22] ». Cette dernière parole apporte une précision qu’il ne faut pas négliger. L’accent porte autant sur « réponse » que sur son complément d’objet, « d’amour ». Chez celui qui appelle comme chez celui qui répond, la liberté n’est pas première, elle trouve son fondement dans une attitude plus fondamentale et même première : l’amour. La venue de Dieu, en effet, est pur don gratuit ; et la réponse de l’homme, en retour, est elle aussi, « réponse d’amour ». Nous sommes ainsi reconduits au centre de la théologie de Benoît XVI ; et cette primauté vaut non seulement de Dieu mais aussi de l’homme : le noyau, le foyer de l’anthropologie théologique réside, lui aussi, dans l’amour.
La dernière citation pourrait faire rebondir le débat. Benoît XVI affirme que la réponse de l’homme, si elle est « libre », est aussi « nécessaire ». Comment un acte libre peut-il aussi être nécessaire, donc déterminé ? L’accolement de ces deux épithètes antagonistes n’engendre-t-il pas une contradiction ? Le texte et le contexte ne l’éclairent pas. En revanche, celle-ci, au moins apparente, éclaire en plein l’asymétrie dont il était parlé : l’adventus, la venue du Christ est, en regard, à la fois libre et non nécessaire. Pour lever quelque peu la contradiction, je ferais appel à une distinction classique, celle de la liberté comme décision et de la liberté comme consentement [23]. La décision place face à plusieurs possibles : l’être libre peut faire ceci ou cela. Le consentement restreint le choix à une seule possibilité ; mais, face à un choix unique, il demeure encore une double option : consentir ou non. Par exemple, j’ai le choix d’épouser telle ou telle personne ; en revanche, je ne peux décider de changer de parents. Pour autant, ma liberté n’est pas aliénée par cette dépendance, ainsi qu’un certain discours l’a répété, car il me reste la possibilité, décisive, de consentir ou non à cette réalité qui m’est imposée [24]. Partant de cette distinction, je dirais que, du côté de Dieu, la liberté est de choix (Dieu peut ou non s’incarner en Jésus) alors que, du côté de l’homme, cette liberté, bien réelle, est de consentement. De même qu’il ne peut changer de parents, de même il ne peut faire que Dieu ne lui ait pas fait le don de sa présence dans le Christ : voilà la part de nécessité. Mais il lui appartient de transformer ce donné en don pour lui-même. Concrètement, il lui revient de se l’approprier ou de le subir : voilà la part de liberté. Et comme ce don divin est bon pour l’homme, voire représente le bien par excellence (le salut et la divinisation), il est digne d’être aimé, donc aimable : voilà pourquoi le consentement est dicté par l’amour.
Pascal Ide
[1] Entretien improvisé avec les prêtres du diocèse d’Albano, jeudi 31 août 2006, troisième réponse. Le pronom personnel « nous » placé entre guillemets se retrouve 6 fois dans tous les écrits et paroles.
[2] Audience générale, mercredi 31 janvier 2007.
[3] Selon le titre de l’ouvrage d’Alain Renaut, L’ère de l’individu. Contribution à une histoire de la subjectivité, Paris, Gallimard, 1989.
[4] Leçon III, 100s. Cité par Benoît XVI dans l’Audience générale, mercredi 15 mars 2006.
[5] Cf. le premier livre de Henri de Lubac – bien connu de Joseph Ratzinger –, Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme, coll. « Unam sanctam » n° 3, Paris, Le Cerf, 1938.
[6] Audience générale, mercredi 15 mars 2006.
[7] En effet, cette interprétation ne sortirait pas de la mentalité individualiste qui juxtapose les personnes et pense l’humanité de manière jacobine comme un agrégat informe où seuls existent l’individu et l’universel.
[8] Audience générale, mercredi 15 mars 2006.
[9] « les formules sentimentales, en vogue depuis le temps de l’Aufklärung, telles que , et autres semblables, sont relativement peu abondantes dans l’ancienne littérature chrétienne ; au naturalisme sans obligation de ces formules bien frappées on ne pouvait trouver grand chose à gagner, parce qu’on voyait dans la fraternité un fait humain qui n’arrivait à être une réalité effective que par la réalisation concrète de l’existence fraternelle » (Joseph Ratzinger, « Fraternité », art. cité, col. 1158).
[10] « La ségrégation d’une fraternité chrétienne limitée n’est pas la création, voulue pour elle-même, d’un cercle ésotérique ; elle se fait au service du tout » (Joseph Ratzinger, Frères dans le Christ, p. 93. Cf. tout le développement, très pédagogique, de la deuxième partie de l’ouvrage).
[11] En latin et en langue courante, l’expression est présente 7 fois.
[12] Homélie de la messe d’inauguration du pontificat, dimanche 24 avril 2005.
[13] Audience générale, mercredi 19 avril 2006.
[14] « pour moi, mon vœu est d’être vraiment ecclésiastique » (Origène, In Lucam, hom. 2 et 16, éd. Rauer, p. 14 et 109, cité par Cardinal Henri de Lubac, Méditation sur l’Église, in Œuvres complètes, tome VIII, Paris, Le Cerf, 2003, p. 209. Cf. notamment toute la section p. 209-222).
[15] L’expression anima ecclesiastica ou sa traduction ne se rencontrent jamais sous la plume de Benoît XVI qui, patrologue réputé, ne peut cependant l’ignorer.
[16] Rappelons la parole fameuse de Paul Claudel : devenus membre du Corps mystique, « nous ne disposons pas seulement de nos propres forces pour aimer, comprendre et servir Dieu, mais de tout à la fois […]. Toute la création, visible et invisible, toute l’histoire, tout le passé, tout le présent et tout l’avenir, toute la nature, tout le trésor des saints multipliés par la Grâce, tout cela est à notre disposition, tout cela est notre prolongation et notre prodigieux outillage. Tous les saints, tous les anges sont à nous. Nous pouvons nous servir del’intelligence de saint Thomas, du bras de saint Michel et du cœur de Jeanne d’Arc et de Catherine de Sienne et de toutes ces ressources latentes que nous n’avons qu’à toucher pour qu’elles entrent en ébullition. Tout ce qui se fait de bien, de grand et de beau d’un bout à l’autre de la terre, tout ce qui fait de la sainteté comme un médecin dit d’un malade qu’il fait de la fièvre, c’est comme si c’était notre œuvre. L’héroïsme des missionnaires, l’inspiration des docteurs, la générosité des martyrs, le génie des artistes, la prière enflammée des clarisses et des carmélites, c’est comme si c’était, c’est nous ! » (Paul Claudel interroge le Cantique des cantiques, cité par Henri de Lubac, Méditation sur l’Église, p. 207).
[17] Homélie de la veillée de Pâques, dimanche 16 avril 2006.
[18] Rencontre avec le clergé du diocèse de Rome, jeudi 22 février 2007, réponse à la première question.
[19] Cf. Cardinal Joseph Ratzinger, Hans Urs von Balthasar, Maria, Kirche im Ursprung, trad. : Marie, première Église, trad. Robert Givord, Joseph Burkel et Charles Chauvin, Paris, Apostolat des Éditions, 1981. Rééd. : Paris-Montréal, Médiaspaul, 2005.
[20] Homélie de la messe au Sanctuaire d’Altötting, lundi 11 septembre 2006. Le « presque » indique une réserve à l’égard d’une identification trop grande entre Marie et l’Église.
[21] Rencontre avec le clergé du diocèse de Rome, jeudi 22 février 2007, réponse à la première question.
[22] Angélus du deuxième dimanche de l’Avent 4 décembre 2005
[23] Cette distinction s’enracine elle-même dans une distinction plus profonde, empruntée à la scolastique, celle de la liberté d’exercice et de la liberté de spécification (cf. Thomas d’Aquin, De malo, q. 6, c.). Pour une récente explicitation dans le cadre d’une philosophie de la personne, cf. Jean-Miguel Garrigues, « La personne humaine dans sa réalité intégrale selon saint Thomas », in Coll., Thomistes ou de l’actualité de saint Thomas d’Aquin, coll. « Sagesse et cultures », Paris, Parole et Silence, 2003, p. 99-111.
[24] Le théologien méthodiste américain Stanley Hauerwas souligne fortement cette dimension d’humble acquiescement face à la conception héritée des Lumières d’une toute-puissante liberté de décision : « Quand nous réfléchissons sur notre vie passée, nombre de nos décisions, que nous avions cru prendre tout à fait librement, nous apparaissent désormais beaucoup plus prédéterminées que nous ne le pensions […]. Nous avons tendance à penser que la vie morale et la réflexion éthique concernent les décisions futures […]. Nous ne voyons pas que la position morale la plus importante est rétrospective, précisément parce que, par le souvenir et l’acceptation, nous apprenons à nous approprier notre vie – y compris les décisions qui, après coup, apparaissent comme moins libres » (Le Royaume de paix. Une initiation à l’éthique chrétienne, trad. Pascale-Dominique Nau, coll. « Theologia », Paris, Bayard, 2006, p. 50).