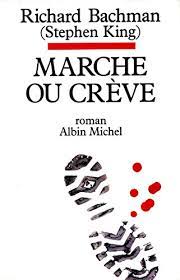Dans un roman très original, violent et cru, dont la titulature française, Marche ou crève, rend bien non point le titre anglais (The long walk), mais le contenu [1], le romancier à succès mais non dénué de profondeur Stephen King raconte l’histoire d’une course qui, chaque année, rassemble cent jeunes entre 16 et 20 ans, et sur laquelle on mise… deux milliards de dollars. Pourtant, il ne s’agit pas de franchir une distance donnée à une vitesse donnée. Quelle épreuve peut justifier un tel gain ? Il s’agit, pour les concurrents, de marcher à une vitesse minimale de 6,5 km/h. Il n’y a aucune distance limite. Mais, si l’on s’arrête, quel que soit le motif (comme satisfaire ses besoins ?), des soldats placés le long du chemin, inexorablement, vous tirent une balle dans la tête. Le vainqueur est l’ultime survivant. En effet, dès que le roman commence, l’attention se focalise sur un jeune homme, Raymond Garraty ; on devine donc qu’il sera le vainqueur. Mais à quel prix ? Peut-on se relever indemne d’une telle épreuve, non pas d’abord physiquement, mais psychiquement ?
Il s’agit plus que d’une simple critique de l’institution ou plutôt des institutions – la politique, la société américaine, la famille, la religion – si l’esprit objectif est intégralement disqualifié, à aucun moment, le sujet n’est déculpabilisé : ces jeunes hommes ont choisi librement, pour autant que la liberté existe encore chez cet explorateur de l’ombre, notamment des bas-fonds humains, qu’est King. Pour moi, cette longue marche est un résumé ou plutôt une fable d’une conception post-moderne de la vie.
1) L’homme déraciné
Ces jeunes sont sans racine. Les lieux traditionnels d’éducation et de structuration sont soit absents, soit déboulonnés : la famille (le héros, Ray Garraty, est orphelin de père et sa mère est une figure évanescente) l’école (l’instance est à peine évoquée), la société civile (les militaires sont présentés comme des kill-machine et le commandant comme un dangereux inconscient avide d’esbrouffe, doublé d’un père indigne), la religion (la sensibilité américaine de King ne manque pas de l’évoquer mais pour la réduire à une pure donnée sociologique et à un « Je vous salue Marie » répété mécaniquement par un des participants, Hank Olson, de surcroît prétentieux [2]). Il n’y a que la nature qui trouve grâce, quelques instants, dans l’univers de Garraty [3]. Mais à titre d’évasion ; comment pourrait-elle faire le poids face à la violence omniprésente des instances extérieures ? D’ailleurs, la marche ne témoigne-t-elle pas plutôt de la robotisation du corps, d’un esprit plus fort que la matière [4].
2) L’homme émietté
Évoluant dans un univers désintégré, insignifiant et agressant, ces jeunes hommes sont eux-mêmes pulvérisés. Ils sont en proie à des pulsions partielles anarchiques, autant agressives (l’un d’eux, Barkovitch, par sa seule parole, suffit à conduire un autre à une attitude suicidaire) qu’érotiques (en fantasme, en parole et en action). Le vocabulaire, dans sa désarticulation, accompagne, reflète et démultiplie cette dislocation. Les corps suent, souffrent et meurent. Les relations entre les jeunes sont à l’image de leur chaos intérieur : fluctuantes, désabusées, passionnelles. Les individus (sur)vivent dans un univers intérieur et extérieur indifférencié, à l’image de la foule qui, à partir d’un certain moment de la marche, se trouve sur les bords de la route, « masse anonyme » présentant « un seul visage » se reproduisant « kilomètre après kilomètre [5] ».
Ce n’est pas un hasard si les héros de Stephen King sont – souvent – des adolescents et des adolescents qui ne semblent guère avoir dépassé ce que la psychanalyse freudienne appelle le stade sadique-anal, à en juger par leur manière de parler et de se comporter ! Ces êtres en situation limite, en crise, déconstruisent, voire détruisent ce d’où ils viennent mais n’ont pas encore construit leurs propres maisons intérieures. Un signe en est que, si la mort est cliniquement décrite, elle n’est pas véritablement regardée en face comme une possibilité : ces jeunes sont dans la toute-puissance tant qu’ils n’en sentent pas l’odeur toute proche ou n’ont pas entendu leur troisième avertissement.
3) L’homme déboussolé
Sans origine, ni unité, comment ces jeunes auraient-ils une destination ? Les valeurs traditionnelles, les idéaux généreux sont tristement bousculés. L’amitié ? Peter McVries qui sauve plusieurs fois la vie de Garraty, apparemment sans raison, s’avère possiblement être homosexuel en quête de rencontre : en tout cas, King laisse volontairement planer un doute sur la pureté de ses intentions. L’amour ? Garraty aime Cathy. Pourtant, au terme, il n’avance plus pour elle, il ne rêve plus à elle. La solidarité ? Certes, il se crée des microclans [6] ; mais le rassemblement des différents « segments » n’est que la sommation des intérêts bien calculés : se soutenir face aux autres ; mais ceux-ci une fois éliminés, le groupe s’émiette. De fait, lorsque le nombre diminue, « le retour à [la loi de] la jungle [7]« prévaut et chacun maximise ses bénéfices. D’ailleurs, dans cette situation qui hypostasie l’individualisme, toute forme d’attachement accroît la douleur au lieu de la consoler : « Garraty regretta – une fois de plus – de s’être fait des amis sur la Longue Marche. Ça rendrait tout plus dur [8] ». La générosité ? Un moment, un élan de solidarité se crée autour de Scramm, un des cent concurrents, marié, qui fait la course pour aider sa femme et leur enfant ; mais cet élan est-il véritablement si gratuit ? Comme le dit Stebbins avec sa lucidité déprimante : « Aucun de nous n’a rien à perdre. Comme ça, c’est plus facile de donner [9] ».
L’idéal de dépassement de soi, la folle audace ? Certains, au début, ne pouvaient croire à ce jeu de la mort et s’imaginaient que les règles étaient une invention destinée à leur faire peur [10]. Au fur et à mesure que la route se déroule, les rares fois où la question fondamentale du but se pose, il apparaît qu’aucun jeune ne peut formuler la finalité qui lui fait mettre un pas devant l’autre : « Pourquoi est-ce que tu es ici, Garraty ? – Je ne sais pas [11] ». La Marche est sans raison, comme la vie. Lorsqu’une autre fin de course est racontée, à la question de Garraty sur la motivation du vainqueur, aucune réponse n’est faite [12]. Une fois, une seule, une motivation sera explicitée : par un étrange et antipathique concurrent, Stebbins qui refuse de se mêler au groupe. Or, son but n’est rien moins que le meurtre symbolique de son père qui est… le commandant. D’ailleurs, cette haine est suffisamment puissante pour le conduire à la seconde place. Mais celle-ci aussi est mortelle.
Alors, sans « carotte [13] », que reste-t-il ? A marcher. Et nous en arrivons enfin au sujet du livre : marcher. Sans raison. Sans espérance. Et derrière cette acédie, un goût de mort. Comme le dit un moment McVries : « Nous voulons tous mourir. C’est pour ça que nous faisons ça [14] ». Et si le néant attend devant, c’est qu’il est déjà présent au fond. Ainsi que l’explique Stebbins invitant le héros à « sonder les profondeurs insondables de Garraty » : « Tu t’enfonces jusqu’à ce que tu trouves le fond. Et puis tu creuses dans le lit de l’abîme. Et, finalement, tu arrives au fond du fond. Et tu crèves [15] ».
Non, la vie n’est pas belle pour Stephen King. Non, il ne faut pas imaginer Sisyphe heureux. Non, il ne faut pas croire que quelque rédemption attend après l’effondrement d’un univers kafkaïen. Quand enfin, après cinq jours d’une horreur sans nom, Garraty se retrouve seul, à la toute dernière page – alors que le plus intéressant commençait : comment vivre avec une telle culpabilité d’avoir laissé 99 jeunes derrière lui, sur l’asphalte ? comment donner sens à un tel gâchis ? –, il pleut, c’est la nuit : que va faire Garraty ? « L’ombre lui faisait signe […] Il était temps de partir. La route allait être longue [16] ».
4) Une relecture de la postmodernité à la lumière du don
L’histoire de King est irréaliste. Mais l’auteur n’en a cure. Moi non plus. Plus importante est la cohérence d’un univers où le désarrimage de tout don originaire conduit non pas à l’hypertrophie de l’ego, à l’affirmation triomphante du sujet, mais à sa désintégration et à une an-éthique exodale sans terre promise. Donc sans histoire : le lecteur a-t-il constaté que si le récit est vaguement situé dans le Maine, nul repère chronologique ne lui est fourni ? Par exemple, se déroule-t-elle dans un avenir lointain ou proche ?… [17] Redisons-le avec les catégories de la dynamique dative : ne se recevant de rien (premier moment du don) et destiné à rien (troisième moment du don), le jeune ne peut que s’affaisser et s’effacer dans le rien (deuxième moment du don).
Pascal Ide
[1] Stephen King (Richard Bachman), Marche ou crève, trad. France-Marie Watkins, Paris, Éd. J’ai lu, 1989.
[2] Cf. sa présentation au début (Ibid., p. 12).
[3] Par exemple, Ibid., p. 84 : « La seule chose qui important, c’était le vent frais soufflant au sommet de la colline. Et un chant d’oiseau ».
[4] Strebbins dit : « C’est ahurisant ce que l’esprit fait marcher le corps ». (Ibid., p. 217) Déjà, après douze heures, Garatty se demande jusqu’où ses jambes le porteraient d’elles-mêmes, combien de temps avant que son cerveau prenne la relève et les condamne aux travaux forcés, au-delà de toute limite raisonnable » (Ibid., p. 91).
[5] Ibid., p. 170. « On arrive à un certain point où la foule n’a plus d’importance » (Ibid., p. 174).
[6] Cf. Ibid., p. 134.
[7] Ibid., p. 316.
[8] Ibid., p. 230.
[9] Ibid., p. 253.
[10] Cf. l’explication de McVries (Ibid., p. 99-100).
[11] Ibid., p. 187. Et lorsque, plus tard, Garraty reprend pour lui la question de Stebbins, « la réponse lui vint : Trop profond pour voir dehors. Il [quoi ?] se cache là dans le fond, dans les ténèbres et c’est trop profond pour voir dehors ». (Ibid., p. 193)
[12] Ibid., p. 88.
[13] Ibid., p. 218.
[14] Ibid., p. 160.
[15] Ibid., p. 175.
[16] Ibid., p. 346.
[17] Je renvoie à l’étude d’un autre roman de King, Rage.