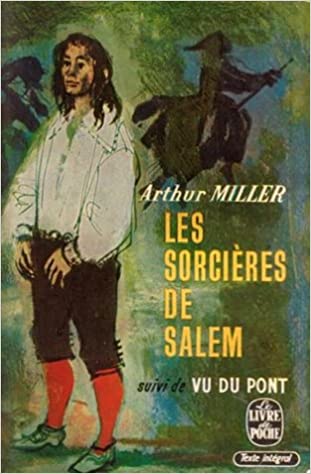Les Sorcières de Salem (The Crucible) est, avec Mort d’un commis voyageur (Death of a Salesman), la pièce de théâtre la plus fameuse du dramaturge et essayiste américain Arthur Miller. Usuellement, l’on propose une lecture allégorique sociopolitique du chef d’œuvre de 1953 :
« La pièce est fondée sur les événements entourant le procès en sorcellerie en 1692 à Salem, dans le Massachusetts. Miller décrit l’événement comme une allégorie du maccarthysme. Il sera lui-même mis en cause par le Comité sur les activités anti-américaines en 1956. Ce livre lui permet de critiquer le maccarthysme indirectement car beaucoup de membres de son entourage ont été censurés et soupçonnés d’être communistes. Le Comité sur les activités anti-américaines n’avait aucune preuve contre les accusés et c’est ici que l’on voit les similarités entre les années 1950 et 1692. Les sorcières elles aussi ont été accusées sans preuve. Arthur Miller pense que les gens répètent les mêmes erreurs tout le temps et l’a donc dénoncé dans sa pièce [1] ».
Pour notre part, nous proposerons des Sorcières de Salem une approche au croisement du psychologique et de l’éthique. Or, Miller lui-même nous ouvre la voie.
1) Une autre approche
Dans l’introduction qu’il a rédigée sur sa pièce, Miller affirme plusieurs choses d’importance. Systématisons son propos.
a) Approche psychologique
D’abord, les dégâts de la culpabilité dans la conscience des habitants de Salem, de John Proctor en particulier : la soumission à l’autorité, les mécanismes d’aveu et de pardon sont une manière de se cacher son propre sentiment de culpabilité, « cette culpabilité qui tue la personnalité [2] ».
b) Approche éthique
Mais Miller avait déjà analysé ce sentiment dans ses pièces précédentes. Aussi s’attaque-t-il à une autre dimension du mal, plus profonde. Il se refuse à voir dans celle-ci un destin qui fait payer le coupable. D’où son refus du diable conçu comme une force étrangère et, à la limite, excusante. « Je n’affirme pas l’existence d’une force métaphysique du mal qui prendrait totalement possession des individus [3] ».
Pour Arthur Miller, la culpabilité est « la plus réelle de nos illusions, et cependant susceptible d’être maîtrisé [4] ». Et c’est en étudiant les documents du procès de l’affaire des sorcières de Salem, consigné mot pour mot, qu’il l’a compris. Certes, il y a la culpabilité de John Proctor qui ressort de ce qu’Abigaïl Williams, l’origine de l’hystérie collective de Salem, au moins celle des enfants, évitant systématiquement d’accuser Proctor, alors qu’elle accusait Elizabeth, lors de l’interrogatoire du procureur.
Mais il ne pouvait nier, en lisant les procès-verbaux minutieux, un
« attachement continu et sans réserve au mal chez les juges et les accusateurs. Une longue étude des documents m’a montré l’incroyable perfection dont ils faisaient preuve dans ce domaine. Je me rappelle, presque comme dans un rêve, la façon dont on a tiré hors de son lit une vieille femme malade, pieuse et universellement respectée, Rébecca Nurse, et avec quelle férocité on la soumit à l’interrogatoire. […] On passait sur les contradictions les plus évidentes qui étaient presque risibles même à cette époque-là, en intimant l’ordre de ne plus les répéter. Il y a eu là un sadisme qui consterne [5] ».
Ce fait montre à l’évidence que l’on ne peut nier l’impact du mal : « J’analyserais l’existence de cette malignité en tant que réalité ». Miller avoue d’ailleurs avoir, sans raison historique fondée dans les documents, bonifié Danforth. C’est là une faiblesse, une concession sans raison. Il le regrette : « je pense maintenant, quatre ans après avoir écrit l’ouvrage, que j’ai eu tort de tempérer la malignité de cet homme – et celle des juges qu’il représentait. Au contraire, je porterais sa nature méchante à sa plénitude pour en poser ouvertement le problème et en faire un thème de la pièce [6] ».
Conclusion : « Le mal n’est pas une erreur du hasard, mais un fait en lui-même [7] ». « J’ai acquis maintenant la certitude que l’une des faiblesses cachées de toute notre tentative de psychologie du théâtre réside dans notre incapacité d’accepter ce fait, c’est-à-dire de concevoir des Iago [8] ».
c) Psychologie et morale
Autrement dit, Miller conjugue les conditionnements de l’homme et sa liberté. Il se refuse au théâtre réaliste qui objective l’homme. Jamais le réseau des conditionnements n’annulera le mystère de la liberté et donc du mal.
« Non seulement au théâtre, mais encore en sociologie, en psychologie, en psychiatrie et en religion, le dernier demi-siècle a fourni une documentation écrasante sur l’homme, considéré comme une création presque passive du milieu, et comme le résultat d’impulsions psychologiques familiales. Ne serait-ce que du point de vue théâtral, cette opinion ne peut être reçue comme définitive et réaliste, pas plus que la condition dernière de l’homme ne peut être mise au service effectif de l’État ou d’un corps constitué. […] Le déterminisme, qu’il soit fondé sur les nécessités inéluctables de l’Économie ou sur les théories de la psychanalyse vues comme un cercle hermétiquement fermé, contredit l’idée même du théâtre telle qu’elle est arrivée jusqu’à nous jusqu’à son plein développement ». En effet, on ne peut se passer de « l’existence de la volonté de l’homme qui est une réalité aussi patente que sa défaite [9] ».
D’où la possibilité du bien et du salut. « Je crois que mon refus – et celui des critiques – de croire à cette plénitude du mal est concomitante de notre refus de croire au bien ». Et plus clairement encore : « Je crois maintenant […] qu’il y a des gens voués au mal et que, sans l’exemple de leur perversité, nous n’aurions pas la connaissance du bien [10] ». Ce qui est naïvement dialectique. Heureusement, Miller ajoute : « je n’ai jamais été étranger […] à cette conception humanitaire sinon humaniste de l’homme, bon par essence et chez qui le mal ne représente qu’une perversion de son amour frustré ». Il ajoute :
« Je ne nie pas que, doté d’une sagesse, d’une patient et d’un savoir infinis, un homme ne puisse se sauver de lui-même ; je crois simplement que des hommes, même apparemment aimables et normaux, peuvent se vouer au mal, sans le prendre pour le bien, mais au contraire sachant que c’est le mal, et l’aimant comme tel [11] ».
Aussi Miller appelle-t-il de ses vœux « un poème neuf » qui se refuse et au déterminisme et à l’éloge d’une illusoire toute-puissante liberté. Ce poème viendra de ce
« qu’un nouvel équilibre aura été atteint, qui embrasse à la fois le déterminisme – et le paradoxe – de la volonté. S’il existe un but invisible vers lequel tendent toutes les pièces de ce livre, c’est cette découverte même et sa preuve que nous sommes déterminés et que pourtant nous dépassons ce déterminisme [12] ».
2) Chemin des personnages
L’évolution admirable des deux personnages, John et Élisabeth, manifeste toute l’espérance de rédemption possible.
Certes, le poids sociologique du puritanisme est loin d’être nié par Miller. En effet, il excuse Abigaïl, autant que Proctor. De même, Abigaïl accuse John et Élisabeth :
« Je vous ai vu plier l’échine devant cette femme pâle et glacée que vous n’avez sûrement jamais désirée. […] Prenez garde, John, elle est en train de vous façonner à son image et, à force de l’écouter et de ramper devant elle, vous finirez comme elle par ne plus voir dans l’amour que l’horreur du péché. Elle fera de vous un lâche [13]! »
a) Évolution d’Élisabeth : de l’accusation à l’amour de l’autre
Élisabeth qui, dans sa dureté, juge John et l’enferme encore davantage dans sa culpabilité, par l’épreuve et la proximité de la mort, devient un être bon qui se refuse à juger.
Au début, Élisabeth vit d’accusation, ainsi que nous le dirons plus bas. Mais au terme, pacifiée, elle a pu pardonner : « Je ne peux pas vous juger, John [14] ».
Et, lorsque John demande le pardon à sa femme, celle-ci a cette admirable réponse. Ayant compris qu’elle devait cesser d’accuser, elle peut voir clair dans la culpabilité écrasante de Proctor : « Ce n’est pas à moi de vous le donner, John. […] à quoi peut-il servir que je vous pardonne ? Vous pardonneriez-vous à vous-même ? Tout doit se passer dans votre âme, John ». Plus que cela, elle lui redit toute sa confiance : « Mais vous pouvez en être sûr, quoi que vous fassiez, vous ferez œuvre d’honnête homme ».
Plus que cela encore, elle accepte de se remettre en question et de s’accuser elle-même :
« J’ai lu dans mon cœur durant ces trois mois, John. J’ai commis des péchés, moi aussi. Les charmes d’une fille rusée et coquette n’auraient pas tenté un homme tel que vous s’il n’y avait eu d’abord la froideur de votre femme. […] Je me suis vue telle que je suis, si laide, si gauche, qu’aucun amour vrai ne pouvait venir à moi [15] ».
Alors, elle peut lui dire la vérité que Proctor ne peut et ne veut entendre : « Sachez-le, John, vous prenez mes péchés sur vous [16]! » Surtout, cessant de le juger, elle l’enfant à sa liberté : « Faites ce que vous voudrez, mais ne laissez personne être votre juge. Il n’y a pas de plus grand juge sous le ciel que Proctor lui-même ! » Et, alors elle implore son pardon : « Pardonnez-moi, John, pardonnez-moi. Je n’ai jamais connu de bonté pareille à la vôtre [17] ».
b) Évolution de Proctor : de la culpabilité à l’amour de soi
1’) Au début, la culpabilité
Élisabeth hautaine, fait sentir à John tout son péché : « Peut-être avez-vous le désir sincère de l’oublier, John, mais vous n’êtes pas encore à la veille d’y parvenir. Un peu plus de franchise avec vous-mêmes et avec moi vous y aiderait certainement ».
Et John le lui rend bien :
« S’il vous plaît, épargnez-moi d’en entendre davantage. Ah ! Vous n’oubliez rien, vous, et vous ne pardonnez pas ! Quand donc apprendrez-vous la charité ? C’est à peine si j’ai osé lever la tête dans cette maison depuis sept mois qu’elle est partie. Je n’ai rien entrepris, et je n’ai même pas fait le moindre geste sans songer à vous être agréable, mais vous ne démordez pas de vos soupçons, et chacun de vos regards est pour moi un reproche. Je ne peux pas ouvrir la bouche sans que vous mettiez ma parole en doute et, quand je pénètre dans cette maison, je sens peser sur moi l’accusation du mensonge, comme si j’entrais dans un tribunal [18] ».
2’) Au terme, la dignité retrouvée
Proctor, laissé à la nudité de sa conscience, est déchiré. Il s’agit, pour lui, d’accepter son imperfection, insoutenable pour la conscience culpabilisée : « Je crois être honnête, je le crois, mais je ne suis pas un saint [19] ».
Il va signer, mais son âme n’est pas en paix. Il songe soudain à ses enfants : c’est ni Rébecca, ni même sa femme Élisabeth, mais le fruit de ses entrailles qui lui fait prendre conscience de l’infamie, du mensonge, donc le sens du temps : « J’ai trois enfants. Comment voulez-vous que je leur demande d’être des hommes s’ils savent que j’ai vendu mes amis ? » Et de là, il reflue sur lui et la valeur unique de la personne révélée par le nom : s’il refuse de signer, c’est à cause du nom qu’implique la signature. Celle-ci prend soudain une signification gigantesque : « Parce que c’est mon nom. Parce que je n’en aurais pas d’autre dans la vie. […] Comment pourrais-je vivre sans mon nom ? Je vous ai donné mon âme, laissez-moi mon nom [20] ».
L’âme déchirée, il déchire le papier de son aveu. Hale l’accuse d’orgueil, mais Proctor répond calmement : « Non, monsieur Hale. C’est en moi quelque chose de bon et de clair qui m’apparaît tout à coup et que je veux préserver ». Enfin, la délivrance de toute culpabilité. Et il donne à Élisabeth le courage face aux juges iniques : « Ne leur donnez pas de larmes. Ne leur faites pas ce plaisir. Montrez-leur maintenant votre honneur et la fermeté de votre cœur [21] ». Parris ne comprend pas, tente maîtresse Proctor de courir après son mari. De même Hale : « Priez pour lui, puisque vous n’avez pas lutté pour lui ».
Et la réponse réside dans l’espérance et le don qu’Elisabeth fait de son amour : « Monsieur Hale, j’ai lutté de toutes mes forces. Et grâce à Dieu mes efforts n’ont pas été vains [22] ».
3) Conclusion
Dans le drame de Miller, qui est libre ? Rébecca Nurse et Jim Correy. Qui devient libre ? John et Élisabeth, grâce à leur amour. L’adaptation cinématographique (je ne me souviens plus de laquelle) le souligne symboliquement en montrant l’infini de leur amour ouvert sur l’océan. Encore faut-il ajouter : un amour articulé à la vérité. Le film pose au terme un intéressant dilemme de conscience : la vérité ou la vie ? Or, John n’est vraiment libéré que lorsqu’il choisit la vérité. « Amour et vérité se rencontrent », disait le psalmiste (Ps 84,11).
Pascal Ide
[1] Notice Wikipédia en français : « Les Sorcières de Salem (pièce de théâtre) ».
[2] Arthur Miller, Les sorcières de Salem, Adaptation française de Marcel Aymé, Théâtre, Paris, Robert Laffont, 1959, p. 50.
[3] Ibid., p. 54.
[4] Ibid., p. 51.
[5] Ibid., p. 52 et 53.
[6] Ibid., p. 53.
[7] Ibid., p. 53.
[8] Ibid., p. 54.
[9] Ibid., p. 64.
[10] Ibid., p. 53.
[11] Ibid., p. 54.
[12] Ibid., p. 65.
[13] Ibid., Acte I, p. 394.
[14] Ibid., Acte V, p. 523.
[15] Ibid., p. 524.
[16] Ibid., p. 524.
[17] Ibid., p. 525.
[18] Ibid., Acte II, p. 427.
[19] Ibid., Acte V, p. 526.
[20] Ibid., p. 531. C’est moi qui souligne.
[21] Ibid., p. 533.
[22] Ibid., p. 534.