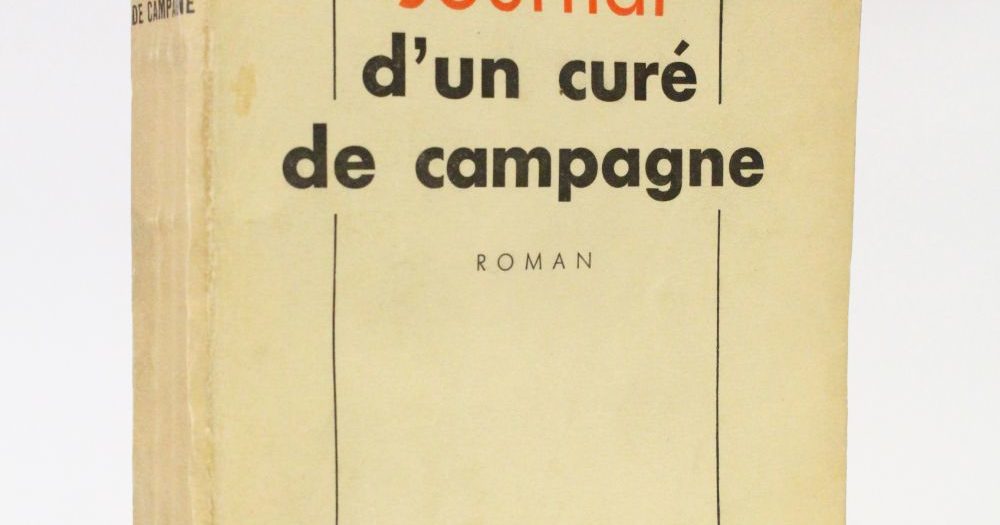« La mort, c’est la solitude tout court, tandis que la solitude où l’amour ne peut plus pénétrer, c’est l’enfer [1] ».
La rencontre du curé de campagne et de la comtesse d’Ambricourt est un des sommets de la littérature mondiale et de l’espérance chrétienne [2]. En cette vingtaine de pages – que tout disciple du Christ devrait relire chaque année –, Bernanos dit l’essence de la solitude douloureuse et sa sortie vers la communion, par l’espérance.
1) Le point de départ ou la solitude révoltée
La vie de la comtesse est le modèle de la perfection chrétienne. Du moins, vue de l’extérieur. Car la pratique est froide. Cette femme est convaincue de sa bonne foi. Sa fille lui voue une haine mortelle. Son mari la trompe. Elle est donc la victime rêvée.
En réalité, elle est habitée par une profonde révolte contre Dieu et une haine de Dieu et des hommes – qui englobe sa propre personne. Elle n’aime qu’un seul être, ainsi que nous le comprendrons mieux tout à l’heure. Mais le plus terrible est que, se voilant à elle-même son péché, elle n’a plus besoin de Dieu. Cet enfermement est celui de l’enfer. En effet, l’âme de la comtesse n’est pas seulement forclose par le péché mortel et par le péché mortel habituel, mais par le pire de tous, un péché contre la vertu théologale la plus essentielle au salut : l’espérance. Cela aussi, nous le comprendrons tout à l’heure.
C’est ce que va lui révéler, presque à son corps défendant, le jeune curé de campagne. En effet, il vient trouver la comptesse pour lui parler de sa fille Chantal qui est révoltée contre elle : « Ne la poussez pas au désespoir [3] ».
2) Le chemin ou la vulnérabilité
La comtesse va passer de la solitude extrême à une véritable communion. D’une désespérance noire à une très heureuse espérance. De la tristesse à la paix profonde.
Ce chemin opère par la vérité : « Elle semblait redouter que je la quittasse et en même temps lutter contre l’envie de tout dire, de livrer son pauvre secret. Elle ne le retenait plus. Il est sorti d’elle enfin [4] ». Le thème du secret est important chez Bernanos : ce secret est ce que l’on garde jalousement pour soi et qui empêche l’accueil de la grâce. La comtesse commence à quitter son masque, à montrer qu’elle n’est pas ce qu’elle semble être. Sa voix devient criarde alors qu’elle dit son dégoût de la famille. L’orgueil commence donc à perdre du terrain, car elle se rend compte de l’impression qu’elle donne : « elle souffrait terriblement de ne pouvoir se dominer [5] ».
La comtesse a commencé à parler, à dire sa souffrance : « je vous confie ces secrets de ma vie [6] ». Elle n’arrête plus. Elle dit la dureté de sa fille qui a aussitôt régné en reine sur la maison et l’a supplantée, puis les infidélités de son mari.
Mais cela ne suffit pas pour qu’entre l’espérance et la paix. Car la comtesse n’a dit et vu que la souffrance de sa blessure. Une beaucoup plus profonde souffrance l’habite : celle de son péché et de sa révolte. C’est une parole qui a presque échappé au jeune curé qui décide du basculement : « J’ai moins peur de ma mort que de la vôtre [7] ». Alors, la comtesse se trahit, ou plutôt se dit à elle-même toute sa haine, contre son mari qui l’a si longtemps et souvent humiliée, contre sa fille Chantal : « Ce que j’ai enduré, ne peut-elle donc l’endurer à son tour [8] ? » Avec le sens tout surnaturel qui l’habite, le curé discerne dans sa phrase non pas matière à compassion, à pitié, mais à jugement. Brusquement, il voit l’ampleur du péché où cette femme s’entête : « Madame, lui dis-je, prenez garde [9] ! » La comtesse ne peut supporter cette lumière et essaye de trouver refuge, justification, excuse : « Ce sont là des sentiments dont je ne suis pas maîtresse ». Elle multiplie ses défenses habituelles, comme si elles pouvaient abuser le curé d’Ambricourt : elle croit que son foyer est « chrétien », ce qui fait sursauter son interlocuteur : « Certes, madame, vous y accueillez le Christ, mais qu’en faites-vous ? Il était aussi chez Caïphe [10] ». Il faudrait tout citer. Peu à peu, les différentes barrières s’abattent. Elle met en avant la pseudo-justification morale d’une vie absolument fidèle : « Trompée tant de fois, j’aurais pu être une épouse infidèle. Je n’ai rien dans mon passé dont je puisse rougir. – Bénies soient les fautes qui laissent en nous de la honte [11] ! » Puis une autre justification : j’ai au moins évité le scandale. Là encore, le curé explose cette fausse raison par laquelle la femme se donnait une bonne conscience à bon marché. « Croyez-vous les pauvres aveugles et sourds ? Hélas ! la misère n’a que trop de clairvoyance [12] ! »
La comtesse continue à refuser de reconnaître son péché, donc le regret : « Quelle faute ai-je commise [13] ? » Certes, un moment, le prêtre voit « l’aveu monter malgré elle des profondeurs de son âme sans pardon [14] ». Mais ce n’est pas encore le moment de la grâce, car quelque chose doit être dit : qu’elle est brisée par la mort de son enfant. Or, c’est cette mort qui est la cause de sa révolte : « Il m’a pris mon fils. Je le crains plus ». Alors, le curé peut toucher au cœur, car la comtesse n’avait plus espérance que dans la relation à son fils, qu’en étant un jour réunie à lui : « La dureté de votre cœur peut vous séparer de lui pour toujours [15] ».
S’il n’y avait cette vulnérabilité, s’il n’y avait cet espoir, toute parole serait vaine. Et le curé a la clairvoyance de le voir et de toucher cet amour maternel, seule réalité qui ne soit pas encore morte dans le cœur de la comtesse, seule réalité qui la tient encore en vie. Alors, elle se révolte, car elle ne peut supporter cette lumière : être séparée, haïe de ce fils qu’elle a porté et nourri ? « Vous ne vous haïrez pas, vous ne vous connaîtrez plus [16] ». Elle lui demande de se taire.
Alors, le curé lui parle de l’enfer : « qu’est-ce que vous avez fait de l’enfer, vous autres ? » Et d’en donner une vision véritablement théologale, bien plus profonde que celle que l’on en a en général : « L’enfer, madame, c’est de ne plus aimer. […] Ne plus aimer, ne plus comprendre, vivre quand même, ô prodige [17] ! » Le curé ne prononce pas sa tirade capitale sur l’enfer en termes triomphants, mais de manière humble : « J’étais brisé ». C’est pour cela que la comtesse peut la recevoir (cf. plus bas..
Elle ne peut supporter ce « chantage abominable » : rien ne peut la séparer « de ce que nous avons aimé plus que nous-mêmes, plus que la vie [18] ». Mais, enfin, elle accepte de passer de sa révolte à son possible péché : « vous me parlez comme à une criminelle [19] ». Certes, elle veut encore jouer le rôle de l’accusée injustement : « Autant dire que je suis la cause de tout [20] ». Le curé lui demande de se résigner, un mot qui, aujourd’hui, nous échappe : « Il faut vous résigner à… à la volonté de Dieu, ouvrir votre cœur [21] ». Là, il touche la question fondamentale : le péché que la femme ne veut plus voir est sa révolte contre la mort de son fils. Il abat une dernière défense : la comtesse se croyait résignée et croyante : « Si je ne m’étais résignée, je serais morte [22] ». Et d’avouer, sans s’en rendre compte son hypocrisie : « Je vais à la messe, je fais mes pâques, j’aurais pu abandonner toute pratique, j’y ai pensé. Cela m’a paru indigne de moi. – Madame, n’importe quel blasphème vaudrait mieux qu’un tel propos. Il a, dans votre bouche, toute la dureté de l’enfer [23] ».
Désormais, enfin, elle peut voir son péché, proprement satanique : son refus de Dieu. « Vous lui fermez votre cœur ». Alors, toute sa fausse paix s’écroule : « Dieu m’était devenu indifférent ». Cette indifférence glacée qui, chez Bernanos, est la forme achevée, métallique, de la haine chez le cœur endurci. « Lorsque vous m’aurez forcée à convenir que je le hais, en serez-vous avancé, imbécile ? » Et le curé a cette parole sublime : « Vous ne le haïssez plus. La haine est indifférence et mépris. Et maintenant, vous voilà enfin face à face, Lui et vous [24] ».
A l’acmé du combat, une « terreur » saisit l’homme de Dieu. Il mesure soudain combien la lutte est surnaturelle, combien les mots lui ont échappé, combien il a frôlé la mort, le suicide. Il éprouve son absolue impuissance. Et aussi la tentation. Seul Dieu peut intervenir : « C’est alors – non ! cela ne peut s’exprimer – tandis que je luttais de toutes mes forces contre le doute, la peur, que l’esprit de prière rentra en moi [25] ». Le curé de campagne n’a plus rien à dire ni à faire. Ce combat n’est plus le sien.
Enfin, la comtesse quitte la solitude sans nom et sans fond où son péché d’orgueil l’avait enfermé.
3) L’aboutissement ou le moment de l’espérance
Tout orgueil est brisé, toute résistance est vaincue. Les mots ne servent plus de rien. Un geste souligne l’abandon : la comtesse tire de son corsage un médaillon qui contient une mèche blonde. Elle veut être assurée d’être réunie avec son fils. Elle veut encore mettre une condition à son espérance, ce qui avait été la cause profonde de sa révolte (son fils, aimé plus que Dieu.. Mais le curé sait que la mesure d’espérer est d’espérer sans mesure : « Ma fille, on ne marchande pas avec le bon Dieu, il faut se rendre à lui, sans condition. Donnez-lui tout, il vous rendra plus encore ». Et d’annoncer sa foi qui est la seule source d’espérance (cf. He 11,1) : « il n’y a pas un royaume des vivants et un royaume des morts, il n’y a que le royaume de Dieu, vivants ou morts, et nous sommes dedans [26] ».
Le signe qui ne trompe pas est la surabondance de la paix : par la brèche ouverte dans le cœur de la comtesse, « la paix rentrait de toutes parts », « une paix inconnue de la terre [27] ». Dans cette paix, elle peut enfin voir toute l’étendue de son péché et combien toute la désespérance qui ceinturait son cœur était liée à la disparition de son fils : il y a un instant, elle se demandait : « S’il existait quelque part, en ce monde ou dans l’autre, un lieu où Dieu ne soit pas – dussé-je y souffrir mille morts, à chaque seconde, éternellement – j’y emporterais mon… (elle n’osa pas prononcer le nom du petit mort. et je dirais à Dieu : ‘Satisfais-toi ! écrase-nous !’ [28] ».
Il reste à planter dans cette âme désolée l’espérance véritable : « si notre Dieu était celui des païens ou des philosophes (pour moi, c’est la même chose. il pourrait bien se réfugier au plus haut des cieux, notre misère l’en précipiterait. Mais vous savez que le nôtre est venu au-devant. Vous pourriez lui montrer le poing, lui cracher au visage, le fouetter de verges et finalement le clouer sur une croix, qu’importe ? Cela est déjà fait, ma fille [29]… ».
Or, le moyen par excellence de nourrir l’espérance, ou plutôt de la faire naître est la prière et la prière par excellence, le Notre Père : notamment le « Que votre volonté soit faite », dit « du fond du cœur [30] ».
Alors, sur fond de miséricorde enfin reconnue, elle peut dire jusqu’au bout son péché qui est la désespérance nue : « Oui, je crois maintenant que je serais morte avec cette haine dans le cœur. […] Il y a une heure, ma vie me paraissait bien en ordre, chaque chose à sa place et vous n’y avez rien laissé debout, rien [31] ».
Cette parole est éclairante : nous croyons souvent le cœur du païen qui s’est volontairement fermé à Dieu tourmenté. Non : une terrible paix l’habite, il se convainc d’un pseudo-ordre. « Donnez-la telle quelle à Dieu. – Je veux tout donner ou rien, nous sommes des filles ainsi faites. – Donnez tout ». Alors, face à son immense péché de présomption, la guette la désespérance : « Oh ! vous ne pouvez comprendre, vous me croyez déjà docile. Ce qui me reste d’orgueil suffirait bien à vous damner [32] ! »
En effet, au-delà même de son enfant, une dernière chose pourrait retenir la comtesse d’espérer en Dieu : son péché. Avec une assurance et une audace toutes inspirées de Thérèse de Lisieux, le curé répond : « Donnez votre orgueil avec le reste, donnez tout [33] ». Alors, dans un geste incontrôlable, intempestif, la comtesse jette au feu le médaillon contenant la mèche dorée des cheveux de son fils, quelle gardait sur elle comme un témoignage muet contre Dieu.
Le curé plonge la main dans le feu, ne prenant garde à la brûlure, mais la petite mèche lui échappe. Désormais, elle est enracinée dans l’humilité : « ‘Je vous demande pardon’, a-t-elle dit d’une voix humble [34] ». Il explique que cette réaction est encore une ignorance de la grande bonté de Dieu qui a déjà tout réparé : « Prenez-vous Dieu pour un bourreau ? Il veut que nous ayons pitié de nous-mêmes ». Puis : « Soyez donc en paix, ma fille [35] » et il la bénit. Lui aussi est paisible.
Autre signe de la conversion, c’est-à-dire du retour à l’espérance et à l’humilité : la réconciliation avec l’Église. « Elle m’a demandé de l’entendre demain en confession [36] ». Mais, nous le verrons, les événements en décideront autrement.
4) La médiation ecclésiale
Comment le miracle de cette conversion – parce qu’il s’agit d’une véritable conversion – s’est-il réalisé ? Par la médiation ecclésiale et sacramentelle du curé d’Ambricourt. L’essence nue du sacerdoce se dévoile ici : « j’étais seul, seul debout, entre Dieu et cette créature torturée [37] ». Médiation infiniment pauvre, donc infiniment fructueuse : « C’est à vous que je me rends ». En effet, la comtesse reconnaît volontiers qu’elle a offensé Dieu et que le péché gainait son cœur : « Mais je ne me rends qu’à vous [38] ».
Tout d’abord, le curé de campagne est habité par un sens extrême de la vérité : « Vous n’aimez pas votre fille [39] » Et ce sens de la vérité lui donne une autorité qui impressionne la comtesse : la vérité vient d’au-delà de lui. C’est pour cela qu’il a « l’impression que ma seule présence fait sortir le péché de son repaire [40] ».
Or, la vérité objective s’exerce d’abord sur lui, autrement dit est l’autre nom de l’humilité : « tout amour-propre était comme mort en moi [41] ». Cette humilité, essentielle, lui permet d’accueillir sans même s’en rendre compte les coups et les blessures que, blessée, la comtesse décoche. « Vous ne connaissez rien de la vie [42] ». Elle le traite de « rusé [43] », d’« idiot », d’« imbécile [44] ». Aussi ne répond-il pas, ne rend-il pas les coups. Comme le Christ de la Passion.
C’est à cause de cette humilité, donc de la certitude de son impuissance à sauver, donc de son espérance, qu’il est incapable de juger. Aux moments où ils prononcent les paroles les plus radicales, où il ose évoquer la possibilité de la damnation, il s’en estime si peu digne, et lui-même tellement capable, que jamais la comtesse ne se sent jugée. « Vous me prenez pour une mauvaise mère, une marâtre ? – Je ne me permets pas de vous juger [45] ». Contemplant dans ce jeune prêtre l’humilité même de Dieu en Jésus, elle finit par se rendre.
De cette espérance jaillit le courage dont l’acte par excellence est la persévérance. Combien de personnes se seraient découragées et auraient fui. Peut-être au nom même du respect et de la délicatesse : afin de ne pas causer une double peine à la comtesse, en ajoutant la culpabilité à sa tristesse. Mais le jeune curé veut beaucoup plus que sa seule tranquillité : il espère son salut. Aussi reste-t-il, ose-t-il tout dire.
Sa foi inébranlable prend ici la figure de l’impuissance et de la tristesse : il se sait incapable de la sauver, de la rassurer. Aussi évite-t-il tous les pièges de la psychologie, du rassurement. Car le combat qui se joue est uniquement spirituel : il s’agit d’arracher une âme à l’enfer. « Je crois que cette impuissance, qui l’avait d’abord irritée, finissait par l’inquiéter [46] ». Car elle aborde un monde qu’elle ignore et qui est celui de la grâce reçue à genoux. Elle, si fine au plan psychologique, est désarçonnée par un prêtre qui se situe toujours à un plan supérieur et ne réagit jamais comme elle sait que les hommes réagissent, par amour-propre ou par désir.
Enfin, seul le meut la charité, c’est-à-dire l’amour divin : « on est toujours le serviteur de quelqu’un. Moi, je suis le serviteur de tous [47] ». Et le jeune curé a une compassion toute particulière pour les pauvres, les misérables, ceux qui souffrent : « Un prêtre n’a d’attention que pour la souffrance, si elle est vraie [48] ». Et cette compassion vaut pour les plus pauvres que sont les pécheurs endurcis : « J’avais voulu réchauffer d’un coup ce cœur glacé [49] ». La tristesse immense du curé face au péché où la femme s’enferme fait monter une larme : « A ce moment, Dieu m’a aidé : j’ai senti tout à coup une larme sur ma joue [50] ».
Le fruit, du côté du jeune curé est la naissance à sa paternité, qui va bien au-delà des classes sociales. Il s’étonne lui-même de l’appeler « ma fille » : « le mot est venu de lui-même à mes lèvres [51] ».
5) Conclusion
Laissons la comtesse conclure. Après la rencontre, elle transmet par le vieux Clovis un petit paquet au curé. Le paquet contient le petit médaillon désormais vide et une lettre où elle dit tous les fruits surnaturels qui ne peuvent tromper : « Je ne suis pas résignée, je suis heureuse. Je ne désire rien ». Ces quelques mots contiennent tout le secret de la vraie paix intérieure. « Ne m’attendez pas demain. J’irai me confesser à l’abbé X…, comme d’habitude. Je tâcherai de le faire avec le plus de sincérité, mais aussi avec le plus de discrétion possible, n’est-ce pas ? Tout cela est tellement simple ! Quand j’aurai dit : ‘J’ai péché volontairement contre l’espérance, à chaque heure du jour, depuis onze ans’, j’aurai tout dit ». En effet, rien n’est plus simple, au sens évangélique du terme, que le geste de la confession. Elle continue : « L’espérance ! Je l’avais tenue morte entre mes bras, par l’affreux soir d’un mars venteux, désolé…, j’avais senti son dernier souffle sur ma joue […]. Voilà qu’elle m’est rendue. Non pas prêtée cette fois, mais donnée. Une espérance bien à moi, rien qu’à moi […]. Une espérance qui est comme la chair de ma chair. Cela est inexprimable ; il faudrait des mots de petit enfant [52] ».
Que Dieu agrée cette conversion du cœur, en témoignent la paix et le bonheur. Cette lettre est un remerciement de « la paix que j’ai reçue de vous [53] ». Plus encore, son âme est comme toute prête à voir Dieu. En effet, écrit le curé de campagne sur son journal, juste après la lettre, brutalement, comme la douleur voire la révolte : « Six heures et demie. Mme la comtesse est morte cette nuit ».
Pourquoi ? Toute la logique de Bernanos est résumée dans ces quelques mots : sans doute nulle consolation n’est-elle promise en ce monde, car l’homme est pour le bonheur du ciel ; mais surtout, à cause de la mystérieuse communion des saints. L’homme qui offre ses souffrances n’est plus jamais seul, par la médiation du Christ. C’est ce que vont montrer les pages suivantes. Au fond, c’est maintenant que la véritable histoire du curé de campagne commence. Les pages qui suivent vont décrire le combat de cette âme qui s’arrache à la désespérance pour s’élever au véritable sens spirituel de la vie et de la fraternité.
Mais c’est une autre histoire. Restons-en à cet épisode qui prend un sens singulier à l’égard de l’expérience de la solitude : cette femme terriblement seule, ligotée dans la désespérance – la « paix terrible des âmes refusées, qui est la forme la plus atroce, la plus incurable, la moins humaine, du désespoir [54] » –, se trouve, grâce à la médiation dialogale d’un humble prêtre, pauvre de lui-même et riche de tous les trésors de l’Église, qui sont ceux du Christ, de nouveau rendue à elle-même, c’est-à-dire à la vérité nue de son être, et à Dieu, c’est-à-dire à la présence de l’Innocence souffrante de Dieu.
Pascal Ide
[1] Joseph Ratzinger, La foi chrétienne hier et aujourd’hui, trad. Eugène Ginder et Pierre Schouver, coll. « Traditions chrétiennes », Paris, Le Cerf, Mame, 1969, 21985, p. 212-213.
[2] Georges Bernanos, Journal d’un Curé de Campagne, Paris, Plon, 1936, repris dans Œuvres romanesques, suivies de Dialogue des carmélites, éd. Michel Estève, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, Gallimard, 1961, p. 1145-1166.
[3] Ibid., p. 1146.
[4] Ibid., p. 1148.
[5] Ibid., p. 1149.
[6] Ibid., p. 1150.
[7] Ibid., p. 1152.
[8] Ibid., p. 1153.
[9] Ibid., p. 1153.
[10] Ibid., p. 1153.
[11] Ibid., p. 1154.
[12] Ibid., p. 1154.
[13] Ibid., p. 1155.
[14] Ibid., p. 1155.
[15] Ibid., p. 1156.
[16] Ibid., p. 1156.
[17] Ibid., p. 1156-1157.
[18] Ibid., p. 1158.
[19] Ibid., p. 1158.
[20] Ibid., p. 1158.
[21] Ibid., p. 1159.
[22] Ibid., p. 1160.
[23] Ibid., p. 1160.
[24] Ibid., p. 1160.
[25] Ibid., p. 1161.
[26] Ibid., p. 1161.
[27] Ibid., p. 1162.
[28] Ibid., p. 1162.
[29] Ibid., p. 1162. Souligné dans le texte.
[30] Ibid., p. 1163.
[31] Ibid., p. 1163.
[32] Ibid., p. 1163.
[33] Ibid., p. 1163.
[34] Ibid., p. 1164.
[35] Ibid., p. 1164.
[36] Ibid., p. 1164.
[37] Ibid., p. 1162.
[38] Ibid., p. 1163.
[39] Ibid., p. 1147.
[40] Ibid., p. 1149.
[41] Ibid., p. 1145.
[42] Ibid., p. 1148.
[43] Ibid., p. 1151.
[44] Ibid., p. 1160.
[45] Ibid., p. 1147.
[46] Ibid., p. 1151.
[47] Ibid., p. 1146.
[48] Ibid., p. 1148.
[49] Ibid., p. 1160.
[50] Ibid., p. 1158.
[51] Ibid., p. 1161.
[52] Ibid., p. 1164.
[53] Ibid., p. 1166.
[54] Ibid., p. 1160.