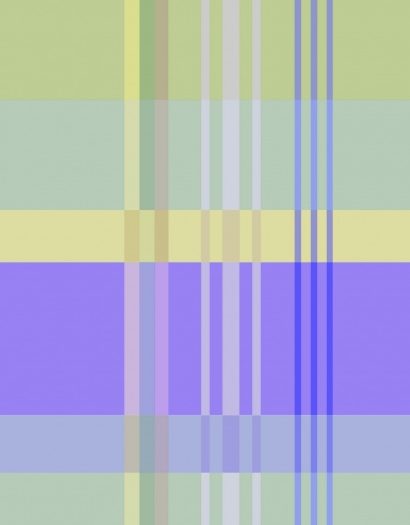2) Évaluation de la méthode
a) Évaluation difficile ou impossible ?
Il est singulièrement difficile d’évaluer la psychanalyse pour trois raisons :
1’) L’impossible expérimentation
D’un côté, la psychanalyse a toujours affirmé l’impossibilité d’une expérimentation validante. En effet, expérimenter dit comparer et accumuler des cas comparables pour que, par induction, on puisse passer du singulier à l’universel ; or, chaque cure est unique ; donc, la psychanalyse ne peut être soumise à la méthode expérimentale.
De plus, expérimenter suppose que l’on puisse décrire le phénomène ; or, la cure ne se décrit pas, elle se raconte, elle est racontée par l’analysant.
Pourtant, lorsqu’Otto Rank, le disciple bien-aimé, proposa un ouvrage iconoclaste, Le traumatisme de la naissance, où il revenait à l’idée selon laquelle l’origine du traumatisme était réelle, ici le trauma de la naissance, aussi universel que l’Œdipe et plus angoissant que lui [1], Jones et Abraham s’opposèrent vivement au nom de l’orthodoxie freudienne, mais Freud réagit d’une manière inattendue : « Il faudrait tout d’abord exiger et avant toute application étendue, la preuve statistique que les premiers-nés ou les enfants nés difficilement, en état d’asphyxie, manifestent en moyenne dans leur enfance une plus grande disposition à la névrose ou au moins à la production d’angoisse [2] ».
2’) La folie interprétative ou la réduction de la vérité à la cohérence
Un signe et une conséquence de cet affaiblissement du sens du réel au profit de la seule interprétation est la confusion entre la vérité et l’illusion, voire le peu d’intérêt pour la demande de validation. Un exemple éloquent autant que triste fut la cécité de Freud à l’égard de Hermine von Hug-Hellmuth, membre de la WPV. En 1919, celle-ci fabriqua de toutes pièces à partir de ses souvenirs d’enfance un journal présenté comme authentique d’une adolescente nommée Grete Lainer et le publia. Or, Freud accepta de préfacer l’ouvrage et en fit l’éloge, y affirmant qu’il s’agissait d’un « joyau témoignant de la sincérité dont était capable l’âme enfantine dans l’état présent de la civilisation [3] ».
Freud s’est laissé berner car il a réduit le critère de vérité à la seule cohérence, ici avec la doctrine psychanalytique, oubliant le second critère qui est l’adéquation au réel, ce qui aurait supposé un minimum de preuve documentaire.
Ce n’est pas d’ailleurs la première fois que Freud se laisse abuser, lui qui avait promu psychanalyste un psychotique comme Horace Frink, ainsi que nous l’avons vu.
3’) L’impossible comparaison avec d’autres approches
La psychanalyse refuse et résiste à toute comparaison avec d’autres approches, notamment scientifiques. C’est ce qu’atteste le récent débat ou plutôt la récente absence de débat avec les TCC (thérapies cognitives et comportementales) [4]. Pour en rester à un seul exemple : aujourd’hui, la psychanalyse ne peut fournir aucun exemple de guérison de TOC (troubles obsessionnels compulsifs) par cure, alors que les TCC obtiennent des résultats probants ; or, cette maladie affecte pas moins de 2 % de la population. Par ailleurs, la conception freudienne affiche aussi un mépris vis-à-vis des objections venant des sciences neurobiologiques [5]. Assurément, certaines affirmations sont excessives, comme celle-ci : « La neurobiologie tend à supplanter la psychanalyse et à la discréditer en la déclarant non scientifique, donc peu crédible [6] ». Mais celle-là ne fait que répondre à l’attitude de rejet de celle-ci [7]. Celui qui exclut ne doit pas s’étonner un jour d’être exclu par ce qu’il a exclu.
4’) L’impossible réfutation
Multiples sont les exemples de « la manie interprétative [8] » de Freud et des psychanalystes. Par exemple, si Rank a voulu quitter Vienne avec sa femme, développer une autre vision de la psychanalyse (prendre en compte le traumatisme de la naissance, plus tenir compte de la relation océanique avec la mère, proposer des thérapies brèves), Jones et Abraham l’accusèrent de ne pas avoir résolu son conflit avec le père. Voire, celui qui est critiqué peut en venir à intérioriser lui-même ces critiques. C’est ainsi que le même Rank, après avoir quitté Vienne en décembre 1925, revint sur ses pas et fit son autocritique en reconnaissant être atteint d’un complexe de rébellion contre le père…
On pourrait aussi reprendre l’argument classique avancé par la psychanalyse : seul peut la critiquer celui qui la connaît ; or, seul la connaît celui qui a bénéficié d’une psychanalyse didactique. Mais seul bénéficie d’une telle analyse celui qui adhère en profondeur aux thèses freudiennes [9].
« Aucune description que ce soit d’un quelconque comportement humain ne peut être donnée, qui s’avérerait incompatible avec les théories psychanalytiques de Freud, ou d’Adler ou de Jung [10] ».
b) Critique pratique. Efficacité de la psychanalyse ?
Autant l’interprétation de la psychanalyse a valorisé la faille jusqu’à sombrer dans un dolorisme ou un fatalisme, autant l’interprétation des thérapies brèves nourrit la toute-puissance en rêvant de remède immédiatement efficace et définitif. L’une des premières questions du patient n’est-elle pas : « En combien de temps j’irai mieux ? »
1’) Du point de vue diagnostique
a’) Les erreurs de Freud
Expliquant ce qu’est le mécanisme de défense, Laplanche et Pontalis estiment que, « quelles que soient les différentes modalités du processus défensif dans l’hystérie, la névrose obsessionnelle, la paranoïa, etc., les deux pôles du conflit sont toujours le moi et la pulsion ». Cela, car le moi se protège contre une menace interne. Mais qu’en est-il du ressort dernier de la défense du moi ? Pourquoi la motion pulsionnelle n’est-elle pas intégrée, apparaît-elle comme déplaisir ?
Trois explications sont proposées dont aucune ne semble satisfaisante. La plus proche de la nôtre est celle qui fait du moi « une sorte de forme, réplique intrasubjective de l’organisme, réglé, comme celui-ci, par un principe d’homéostase ». Mais comment le penser et le concevoir ? Freud ne le dit pas.
b’) L’inflation de l’interprétation
Pie XII observait : « Le principe rebattu que les troubles sexuels de l’inconscient, comme toutes les autres inhibitions, ne peuvent être supprimés que par leur évocation à la conscience, ne vaut pas si on le généralise sans discernement [11] ».
En effet, comment être assuré de la connexion entre ce conflit passé et le présent ? Déjà, il faut être assuré qu’il n’est pas reconstruit (je ne parle bien entendu pas de la cause endo-ou exo-psychique ; je reste dans les limites de la psychanalyse qui se refuse au réalisme de la cause et ne veut pas dépasser la scène psychique). Ensuite, la continuité passé-présent est une reconstruction, autrement dit une interprétation. Or, toute interprétation n’aboutit qu’à un énoncé possible ; en termes logiques, le raisonnement prend la forme non démonstrative d’un enthymème. Même une convergence d’arguments rend l’interprétation plus possible, voire probable. Mais quel degré lui donner ? Quelle est la proximité d’avec la certitude ? Or, l’analyse n’ayant que cette interprétation à se mettre sous la dent, fait comme si c’était la vraie cause, le véritable mécanisme. Et, par la force de la répétition et la grille épistémologique de la psychanalyse, ce « comme si » acquiert progressivement force de vérité.
Il n’est d’ailleurs pas rare que cette interprétation s’accompagne de la mise en évidence de causalités notamment parentales. Même si la psychanalyse se refuse à passer de la responsabilité ressentie à la responsabilité réelle, le discours (joint à d’autres facteurs comme la tendance à projeter sur l’autre, à rejouer, généraliser, etc.) se transforme assez souvent en des rétrécissements de la vision de l’autre (souvent en bourreau) et donc en des accusations-condamnations. Or, une telle attitude n’est pas seulement injuste au plan moral (elle rend quasiment impossible la vertu de pietas filiale et l’application adaptée du quatrième commandement), mais est stérile et même destructeur au plan psychologique, relationnel.
Toujours dans le même registre de la causalité antérieure, la psychanalyse s’avère très limitée dans la remontée aux traumas originaires. Dès que toute conscience est refusée, les reconstructions et les réinterprétations se multiplient. Or, il semblerait, par de multiples biais et en cohérence avec la grande vulnérabilité du tout jeune enfant voire embryon, qu’un certain nombre de blessures remontent aux toutes premières étapes de la vie depuis la conception. De plus, une conception trop mécaniste de la causalité nous a incités à un univocisme (une cause-un effet) ; or, bien des constats et la systémique nous invitent à complexifier ce schéma et à envisager plutôt une convergence et une série de traumatismes à l’origine de nos comportements blessés aujourd’hui. Ces conclusions rendent les interprétations encore plus fragiles et si l’on fait de la prise de conscience la cause de résolution des difficultés, le patient ou le sujet est alors invité à une remontée sans fin vers le passé, à une recherche illimité des dysfonctionnements originaires, ce qui risque d’inhiber toute véritable initiative et ouverture vers l’avenir.
Au fond, il y va pour moi du statut épistémologique de l’herméneutique psychanalytique ; il serait essentiel d’évaluer la fréquence et les conséquences de ces glissements permanents du possible au probable voire au certain. Cette tendance est largement accru par des modèles de pensée souvent fermés, voire idéologiques (toute personne qui n’a pas bénéficié d’une psychanalyse didactique est disqualifiée : Ricœur, dans un article célèbre, a rendu justice de cette posture non réfutable et terroriste) et aussi dénués de toute réflexion épistémologique ou d’anthropologie philosophique.
Enfin, le modèle anthropologique et éthique sous-jacent est celui de la philosophie cartésienne, ainsi que Michel Henry l’avait noté, mais pour d’autres raisons. L’homme selon Descartes est à la fois totalement transparent à lui-même et totalement maître de ses passions (dans l’idéal). Or, le modèle freudien corrèle la guérison à cette auto-connaissance sans ombre, à la mise en évidence du conflit primordial. Maritain avait taxé cette vision du réformateur philosophe d’angélique ; aujourd’hui, on la qualifierait de toute-puissante. Quoi qu’il en soit, elle offusque la véritable nature, entre ombres et lumière de l’homme. Selon une perspective théologique, on pourrait dire qu’elle anticipe la vision béatifique où nous pourrons vivre de la science de Dieu pour qui « la ténèbre n’est point ténèbre, la nuit comme le jour est lumière ». À moins qu’il ne faille inverser la perspective et passer de l’eschatologique au protologique : Descartes nous fait revenir à un état pré-lapsaire où l’homme ignorerait l’ignorance et la faiblesse que l’on compte parmi les blessures liées à la chute originelle.
2’) Du point de vue thérapeutique
a’) Les mensonges de Freud
La correspondance de Freud avec Fliess montre que Freud a menti sur ses résultats et qu’il a inventé des patients. En 1896, il fait une conférence à la Société de psychiatrie et de neurologie de Vienne. Freud affirme avoir « guéri » 18 hystériques grâce à la mise au jour d’expériences sexuelles « subies au temps de la première enfance », toutes refoulées. Pour lui, c’est la preuve que l’étiologie sexuelle se vérifie dans tous les cas (in allen Fällen). On lit dans les lettres que son cabinet est vide et qu’il n’a terminé aucun cas. En 1898, il affirme avoir vérifié sur « plus de 200 neurasthéniques » que la cause de cette maladie est dans tous les cas la masturbation excessive. A nouveau, les lettres à Fliess montrent que Freud ment [12].
b’) Une absence d’efficacité
La cure psychanalytique a pour but de traiter les névroses. Est-ce le cas ?
L’efficacité de la psychanalyse freudienne n’est pas objectivement validée [13]. Autrement dit, nous ne possédons pas d’études démontrant l’efficacité, en soi ou comparativement, de la psychanalyse. Même si l’analysant va mieux, nous ne pouvons affirmer qu’il va mieux à cause de la psychanalyse ou à cause de l’écoute du psychanalyste.
Face à cet argument, le psychanalyste répond généralement que, chaque analyse étant unique, il est impossible de procéder à une statistique universalisante. Dont acte. La méthode n’est pas scientifiquement validable, donc vérifiable.
Parmi les recherches apparemment solides effectuées par des psychanalystes, on peut citer celle de Peter Fonagy et son équipe. Voici la conclusion de leur large revue de la littérature :
« Il n’y a pas d’étude qui permette de conclure sans équivoque que la psychanalyse soit efficace par rapport à un placebo actif ou à une autre forme de traitement. Il n’y a pas de méthodes disponibles qui pourraient, d’une manière incontestable, indiquer l’existence d’un processus psychanalytique. La plupart des études ont des limitations majeures qui pourraient conduire ceux qui critiquent la discipline à ne pas prendre en compte leurs résultats. D’autres études ont des limitations si graves que même un évaluateur qui a de la sympathie pour la psychanalyse pourrait être enclin à ne pas tenir compte de leurs résultats [14] ».
Plus encore, Freud semble douter de cette efficacité dans un article justement fameux, écrit deux ans avant sa mort, à 81 ans. Peut-être plus connu sous le titre : « Analyse terminée ou analyse interminable », il fut republié sous le titre : « L’analyse avec fin et l’analyse sans fin ». Freud y affirme que la pratique de la psychanalyse est une « tâche impossible » et, plus encore, que l’effort thérapeutique est sans fin et la guérison jamais acquise. En effet, le travail cherche à conscientiser quelque chose du ça ; en même temps, il cherche à corriger le moi ; il oscille donc entre l’analyse du ça et l’analyse du moi ; or, ce qui oscille ne parvient pas à un équilibre stable. Freud en tire la conséquence pratique :
« tous les cinq ans, le praticien devrait se faire à nouveau l’objet de l’analyse sans avoir honte de cette démarche. Cela signifierait donc que l’analyse personnelle, elle aussi, et pas seulement l’analyse thérapeutique pratiquée sur le malade, cesserait d’être une tâche ayant une fin, pour devenir une tâche sans fin [15] ».
Ensuite, nous avons vu que Freud s’est de moins en moins soucié d’efficacité ; en même temps que nous verrons que sa compassion ne semble pas non plus s’accroître avec le temps.
Enfin, et la France l’ignore encore trop, nous possédons d’autres outils, dont l’efficacité, elle, a été démontrée ou est démontrable : les thérapies brèves.
Pourquoi la psychanalyse freudienne est-elle inefficace ? Elle corrèle la guérison à la claire vision du conflit, voire à son abréaction. Or, un certain nombre d’éléments semblent indiquer que, tout au contraire, un trauma inconscient, ancien et parfois très important, peut être résolu, guéri, totalement, en demandant simplement au cerveau (à l’inconscient) de mobiliser sa capacité thérapeutique. Les faits l’établissent avec recul : nul déplacement, nul retour, etc. À ce constat se joint un raisonnement analogique : âme et corps présente tous deux un aspect naturel (hérité) et un aspect culturel, acquis (construit). Or, dans la partie naturelle se trouve la capacité d’auto-construction et d’auto-reconstruction ; ainsi que la nature nous le montre, les êtres naturels ont besoin de cette autonomie qui lui permet de se réparer en cas de traumatismes. Or, et voilà la pointe, le corps s’auto-répare sans avoir besoin de connaître l’origine de la pathologie ; par exemple, face à un début de tumeur maligne, les cellules immunitaires la font régresser sans rien savoir de l’agent spécifique (d’ailleurs psychique) qui l’a fait naître. Eh bien de même le psychisme peut auto-réparer des excroissances blessées sans avoir besoin de recourir à l’élucidation de son origine. D’ailleurs cette ignorance des traumas et de leur réparation fait partie, plus généralement, de cette nescience de l’origine, cette tache aveugle qui, en plein, dit que l’homme est un être originé.
Le schéma freudien accorde beaucoup d’importance à la parole et fait de la médiation langagière le passage obligé de toute guérison. Mais, c’est mettre de côté toute une capacité corporelle qui est aussi dépositaire à la fois d’efficace et de sens. Au fond, Cette critique du tout-représentationnel au détriment du pulsionnel et de l’incarné rejoint l’une des deux grandes critiques adressées par Deleuze-Guattari dans Anti-Œdipe. La seconde, on s’en souvient, était la réduction de tout conflit à la dimension « papa-maman » et oubliait son horizon plus social, plus collectif. De fait, une thérapie fondée sur l’hypnose fera appel à des images, des méthodes puisant aux ressources communes de l’humanité.
De plus, la conscientisation du conflit s’oppose au processus par lequel le psychisme l’a enfoui. Or, ce mécanisme, loin d’être pervers, est d’abord souvent une heureuse protection qui permet de survivre. Au point que Erickson mettait certains patients profondément traumatisés en transe pour aller découvrir ce traumatisme puis le réenfouissait pour, sans en dire la nature au sujet, prendre les moyens pour le traiter. Celui qui serait choqué par une telle méthode devrait s’interroger sur la confiance à accorder au thérapeute et à l’analogie avec la chirurgie : pour toute opération grave, le chirurgien procède ainsi, prenant des décisions irréversibles dont il n’informe le patient qu’a posteriori. Nietzsche, cet anti-Descartes, avait profondément noté que le souvenir n’est pas seulement un mécanisme négatif d’anti-mémoire mais un dynamisme vital qui seul permet à la créature incarnée et postlapsaire de pouvoir avancer dans les tourbillons parfois dramatiques de la vie.
En outre, le schéma freudien fait du thérapeute le médiateur obligé de la guérison. Certes, le vrai thérapeute est l’analysant et non pas l’analyste. Il n’empêche que celui-ci joue souvent le rôle du SSS (« sujet sensé savoir ») lacanien, donc est investi d’une toute-puissance fort discutable. Ce modèle ne reproduit-il pas un autre schème post-cartésien où la relation patient-médecin est conçu sur le modèle : malade ou sujet en souffrance absolument passif et thérapeute totalement actif. En regard, le schéma par exemple hypnotique valorise beaucoup plus les capacités d’auto-guérison du patient.
Il ne s’agit bien entendu pas de nier les lumières et les libérations reçues lorsque le sujet établit des connexions entre tel trauma initial et tel comportement actuel inadapté. Il s’agit simplement d’interroger l’unicité de ce schéma.
c’) Un inquiétante gonflement de l’égo
Le principal bénéfice louable de la psychanalyse semble être l’amélioration de l’image de soi chez beaucoup de patients. Cela a été le cas chez la célèbre journaliste de L’Express Françoise Giroud. Elle résumait le bilan de sa cure chez Lacan en ces termes :
« C’est dur une analyse et ça fait mal. Mais quand on croule sous le poids des mots refoulés, des conduites obligées, de la face à sauver, quand la représentation que l’on se fait de soi devient insupportable, le remède est là. […] Ne plus rougir de soi, c’est la liberté réalisée. C’est ce qu’une psychanalyse bien conduite enseigne à ceux qui lui demandent secours [16] ».
Malheureusement, chez les habitués du divan, la préoccupation du moi déborde habituellement la poursuite, essentielle pour le bonheur, d’une bonne estime de soi. Serge Moscovici, au terme de son enquête sur l’image de la psychanalyse en région parisienne auprès d’environ deux mille personnes, constatait que les interviewés qui connaissaient des analysés soulignaient fréquemment l’augmentation de l’égocentrisme comme une conséquence de la cure. Il résumait les réponses en écrivant que le psychanalysé apparaît « arrogant, fermé, adonné à l’introspection [17] ».
L’enquête de la sociologue Dominique Frischer, auprès d’une centaine d’analysés parisiens, conclut dans le même sens : « Le bilan exprimé par la plupart des analysés révèle que la psychanalyse renforce l’individualisme, l’égocentrisme, voire le nombrilisme et la démobilisation politique [18] ».
d’) Une cruelle carence d’amour dans la cure
La passionnante correspondance entre Freud, le maître viennois, et Sandor Ferenczi, son brillant disciple hongrois, montre notamment la complémentarité vivifiante et symbolique de leurs tensions. Par exemple, du point de vue thérapeutique, on sait que Freud centre le sujet sur le passé dans une longue cure et préconisait la mise à distance de l’affect contre-transférentiel, donc l’abstention du psychanalyste. En revanche, Rank propose en 1926 des cures courtes et actives recentrant le sujet sur le présent où l’analyste manifeste à l’analysant de la tendresse, voire des baisers… Freud répond à Ferenczi le 13 décembre 1931 qu’il est impossible de donner ces satisfactions érotiques : « Imaginez quelle sera la conséquence de la publication de votre technique. Il n’y a pas de révolutionnaire qui ne soit surpassé par un plus radical encore. […] Il en viendra de plus hardi qui feront le pas supplémentaire jusqu’à montrer et regarder et bientôt nous aurons inclus dans l’analyse tout le répertoire de la demi-virginité et des ‘petting-parties’ ». Il ajoute : « Comme vous jouez volontiers le rôle de mère tendre envers d’autres […], il faut que vous entendiez, par la voix brutale du père, le rappel […] que la tendance aux petits jeux sexuels avec les patiente ne vous était pas étrangère aux temps préanalytiques [19] ». On voit Freud user de tout son ascendant, voire de sa méthode soupçonneuse, comme il l’a fait à d’autres occasions.
Commentons ce passionnant échange. D’abord, Ferenczi a très bien perçu les manques de la cure freudienne, même s’il est extrême et partiel dans sa propre logique réactive. Ensuite, les deux analystes se situent dans les deux logiques complémentaires de la masculinité et de la féminité. Et c’est ce que note Élisabeth Roudinesco :
« Cet échange montre bien que tout système de pensée a besoin d’un maître incarnant la loi et d’un rebelle capable de la transgresser au nom d’une avancée sans laquelle la théorie risquerait de périr. Le mouvement psychanalytique n’a pas tranché entre ces deux pôles. Il a hérité à la fois des innovations férencziennes [pôle plus féminin] et de l’autorité freudienne [pôle plus masculin]. À cet égard, la correspondance entre les deux hommes est une formidable leçon sur la nécessité du conflit qui seul permet à une discipline de critiquer ses dogmes et de se transformer [20] ».
Autrement dit, la cure analytique requiert l’intégration des valeurs masculines, paternelles et féminines, maternelles.
À titre de confirmation, Jones, le célèbre biographe et ami de Freud, traitait Ferenczi de malade mental et donc réagissait sur le pôle masculin mais sans ouverture à une symbolique complémentaire, plus féminine.
Autre confirmation : Sandor Ferenczi, le grand ami de Freud, défend que le lien à la mère est bien plus profond et bien antérieur au complexe d’Œdipe. Selon lui, dans une perspective darwinienne, l’homme a la nostalgie du sein maternel et, pour cela, cherche à régresser à l’état fœtal dans les profondeurs maritimes [21].
3) Évaluation de la doctrine psychologique
a) La première topique psychique : l’inconscient [22]
Assurément, l’existence de l’inconscient est attestée. Assurément aussi, et c’est l’apport principal de Freud, l’inconscient dynamique existe et il est constitué de manière active par le refoulement – même si, dans la position freudienne, « le refoulé ne recouvre pas tout l’inconscient [23] », puisque la pulsion, par nature, dans sa distinction d’avec la représentation (l’image dont je dis qu’elle la fonde), « ne peut jamais devenir objet de la conscience [24] ».
Toutefois, j’adresse deux critiques de fond.
1’) L’interprétation de l’inconscient
La première concerne l’interprétation de cet inconscient. On a vu que pour Freud, la distinction conscient-inconscient (et subconscient) est la distinction fondamentale : elle divise l’homme en différentes zones qui seraient l’équivalent de ce que sont pour nous les ouvertures. Plus encore, l’inconscient l’emporte largement sur la conscience qui est seconde, et temporellement et en importance.
Je poserai deux questions à la conception freudienne de l’inconscient : quelle relation existe-t-il entre la distinction du conscient et de l’inconscient (actif) et la pyramide des facultés ? Quelle est la distinction première ?
Partons d’un simple exemple. Un sentiment (l’amour, la colère, la culpabilité) peut être conscient ou inconscient ; plus encore, il passe du conscient à l’inconscient. Mais il serait absurde de dire que l’inconscient passe de l’affectivité (un sentiment amoureux) à la connaissance (une sensation inconsciente). C’est donc que conscience et inconscience qualifient l’ouverture, ici l’affectivité mais non l’inverse. Les ouvertures sont donc plus fondamentales.
Les deux distinctions (première topique freudienne, les six facultés) n’ont pas la même importance. La distinction des puissances exprime la structure de l’homme. En revanche, la différence conscient-inconscient dit deux modalités de l’acte humain : elle qualifie la manière d’exercer les puissances. Donc, pour nous, les distinctions premières concernent les niveaux de vie (végétatif, sensible et intellectif) et les puissances ou facultés (par exemple, cognitives et affectives). Mais chacune des puissances distinguées s’actualisent selon une double modalité : consciente ou inconsciente. Précisément, plus on monte dans la pyramide, plus l’activité est consciente, sans jamais l’être tout-à-fait (il existe une vie préconsciente de l’esprit). Inversement, plus on descend, plus le régime opératif est inconscient, sans jamais l’être totalement (la respiration est, par exemple, contrôlable). En d’autres termes, ce n’est pas l’inconscient qui est tantôt cognitif tantôt affectif, mais bien plutôt c’est l’imagination (ou l’affectivité sensible) qui s’exerce tantôt selon une modalité consciente tantôt sur un mode inconscient.
La distinction conscient-inconscient est donc moins profonde que la distinction des ouvertures, elle la qualifie. Si Freud lui donne la primauté, c’est en raison de sa conception topique du psychisme : il note « l’identité du souvenir communiqué et du souvenir refoulé du patient », mais il en fait une différence de nature, car « la même représentation » est « sous une double forme et en des endroits différents de son appareil psychique [25] ».
Il me semble qu’il y a un réel danger d’hypostasier l’inconscient si on veut tenir une vision équilibrée de l’homme, et cela sans en rien nier ni son existence ni son efficace ; il s’agit ici de sa « quiddité ». Cette distinction demeure toutefois capitale : je dirai même qu’après la distinction des facultés et des actes, elle est, au plan psychologique, une distinction décisive, bien qu’elle n’affecte que la modalité. Si on voulait à tout prix faire coller le schéma de la pyramide et celui de la première topique freudienne, on pourrait représenter celle-ci en superposant au triangle un grisé allant s’atténuant du bas vers le haut, l’inconscient étant symbolisé par le plus sombre.
J’ai répondu chemin faisant à la seconde question : étant admise la distinction (seconde mais capitale) conscience-inconscient, les deux termes ont-ils même importance ? Sans nier l’entrelacement étroit du conscient et de l’inconscient, du volontaire et de l’involontaire, il serait erroné de renvoyer symétriquement dos à dos psychologisme et moralisme. La conscience est première car elle est le lieu du jugement (pour l’intelligence) et de la décision (pour la volonté) ; or, seules ces deux ouvertures spirituelles (intelligence et volonté) sont capables de gouverner et d’assumer les richesses des sensations, des images et de l’affectivité.
2’) Confirmation : la critique de Balthasar
On peut en rapprocher la critique qu’adresse H. U. von Balthasar à Freud [26]. Le reproche que fait le théologien est situé. En effet, sa perspective est d’ établir le statut du sujet dans le drame, plus précisément son rôle. Balthasar ne traite donc pas de la critique freudienne de la religion ; il précise d’ailleurs expressément qu’il ne s’intéresse pas à Moïse et le monothéisme, notamment au processus de transmission héréditaire de la culpabilité du meurtre primitif [27].
En un mot, le « diagnostic » de Balthasar est le suivant : Freud (à l’instar de Jung et d’Adler qui sont étudiés plus loin) réduit le rôle du sujet à une résignation. En effet, chez lui,
« le ‘Moi’ repose sur un fonds vital (et y reste ordonné de manière ou d’autre), qui le conditionne et le supporte, et auquel il se rapporte […] comme la ‘surface’ à la profondeur [il renvoie ici aux Essais de psychanalyse], la ‘façade’ au bâtiment [il renvoie à Malaise dans la civilisation] [28] ».
Aussi Freud va-t-il « recommander l’acceptation de ce que l’homme est, et […] regarder l’incorporation dans l’ensemble environnant comme le but dernier de la thérapie ». D’ailleurs, « la résignation est déjà (chez Freud) une très profonde attitude de vie personnelle [29] ». Balthasar présente la psychanalyse comme une lente dissolution du sujet : déjà « le moi conscient n’est qu’un fragment de l’ancienne monade [30] » ; et cela ira jusqu’à « la désignation de l’inconscient non seulement comme polymorphe mais comme enfermant en soi la contradiction [31] ». Ou plus précisément, le pauvre moi est appelé à se résigner de plus en plus, car il « est sans rémission possible le siège de l’angoisse devant la toute-puissance des trois monstres conjurés : ça, sur-moi, et monde extérieur. Il n’y a là pour le rationaliste Freud que des ‘objets’, mais non pas un ‘Toi’ qui, par-dessus les solitudes pourrait jeter un pont [32] ».
3’) D’autres formes d’inconscient
Pour finir, l’inconscient ne peut se réduire au refoulement. Cette conception conduit à la vision négative de l’inconscient. Or, nous verrons avec Milton Erickson qu’il existe une autre conception de l’inconscient, positive : l’inconscient dépositeur de nos ressources, notamment d’autoguérison et de créativité.
De plus, Jacques Maritain [33] propose de distinguer deux inconscients : d’une part l’inconscient qu’il appelle « de chair et de sang » et qui comprend tout le monde des pulsions, des images archaïques ; c’est, dit notre auteur, l’inconscient dont parle Freud ; d’autre part l’inconscient (et il préfère parler de préconscient) spirituel. Celui-ci se manifeste de manière privilégiée dans l’intuition créatrice, mais aussi lors des lentes germinations de la découverte ou a fortiori dans l’expérience mystique. Autant l’inconscient pulsionnel est infra-conceptuel autant le préconscient spirituel est supra-conceptuel.
Enfin, c’est au sein même de l’esprit qu’il faut aussi porter la distinction de la conscience et de l’inconscient. Mais il convient alors d’inverser les perspectives et d’accorder son primat à la vie lumineuse de la conscience. Balthasar a écrit sur ce sujet des pages décisives. Il permet de donner une tout autre profondeur à la distinction conscient-inconscient spirituel (ainsi qu’au symbole au sens que lui donne Ricœur) par le biais de sa dynamique voilement-dévoilement, elle-même fondée sur la distinction de l’essence et de l’existence. Nous ne retiendrons qu’un point, qui n’est pas d’ailleurs le plus important, mais qui demeure très suggestif pour situer le jeu du conscient et du préconscient spirituel :
« La comparaison avec la peau du corps est au contraire parfaitement appropriée, car l’aspect extérieur d’un homme révèle sa nature d’être humain bien mieux que n’importe quelle dissection qui permettrait de jeter un regard à l’intérieur de son corps. Il en est exactement de même pour son âme et pour son esprit qu’on apprend à connaître bien mieux par les relations humaines ordinaires que par cette sorte de vivisection spirituelle qui se nomme psychologie et psychanalyse. Si l’on veut connaître une maison, il vaut mieux s’y introduire par la porte d’entrée faite pour les visiteurs que par la porte de service située à l’arrière [34] ».
b) Théorie de la sexualité (cf. chap. 5)
c) La deuxième topique psychique : les pulsions de mort [35]
Sigmund Freud parlait du noyau le plus obscur des différentes strates de la psyché, « les contours de Luzifer-Amor » [36]. Nous avons vu combien Freud était convaincu de la présence en l’homme d’une « part maudite », pour employer l’expression de Georges Bataille.
Critiquons la thèse, puis l’un de ses arguments, la répétition. Le cours s’est longuement interrogé sur la présence d’une inclination naturelle (spontanée) de l’homme au mal. Je n’ai malheureusement pu reprendre tous les développements faits à cette occasion.
1’) Critique de la thèse
D’abord, ce thème d’une mort plus puissante que la vie n’est pas propre à Freud, mais est bien connu du romantisme, en particulier du romantisme allemand.
Ensuite, la psychanalyse est profondément pessimiste sur l’homme. Elle prétend me montrer que « je suis moi-même jusqu’au fond de mes demandes et désirs, incertain, décentré, divisé [37] ». Sans permanence, nous sommes « des sujets en procès, perdant sans cesse notre identité [38] » et « en quête de stabilisation perpétuelle [39] ». De plus, « êtres parlants, toujours déjà potentiellement parlants, nous sommes depuis toujours aussi clivés, séparés de la nature [40] ». C’est ainsi que Julia Kristeva relit la Genèse comme une œuvre de séparation et qu’elle voit dans l’offrande une compensation. Les langues indo-européennes portent la trace d’une rupture dramatique de l’homme avec le cosmos et l’autre [41]. D’ailleurs, la sexualité nous livre l’image d’une « perversion intrinsèque. Le mot est sans doute trop péjoratif pour s’appliquer avec sérénité à l’état général de la sexualité humaine. Et pourtant c’est comme ça : nous sommes narcissiques, incestueux, masochiques, sadiques, parricides, spontanément attirés et révulsés par les caractères physique ou moraux qui diffèrent des nôtres, donc nous sommes spontanément agressifs à l’égard d’autrui [42] ». Enfin, Freud refuse toute gratuité, par exemple de la connaissance [43].
Par ailleurs, la pulsion du mort est-elle seulement une transposition psychologique d’une dualité biologique, ce qui relèverait, après tout, de l’induction analogique, méthode à laquelle j’adhère ? Ou bien s’agit-il plutôt d’un transfert métaphorique ? Sachant la fascination freudienne pour la mythologie, il semblerait plus juste de lire dans le duel-dualisme Éros-Thanatos l’intériorisation de « deux entités mythologiques, voire des déesses ou des demi-déesses [44] ». À propos de la conception freudienne de la pulsion de mort, Frank J. Sulloway parlera d’une « fable biogénétique [45] »
Enfin, la psychanalyse est très marquée par la négativité (le refoulement, la rupture) et la métaphore de la canalisation. La liberté, la volonté, l’esprit, semblent naître de ce double processus : en canalisant l’énergie, en la frustrant aussi, on ne peut pas ne pas faire apparaître ces structures. Or, tout au contraire, « nous n’avons pas la puissance du non-être, s’il est vrai que les puissances sont des qualités, et que le non-être n’en est pas une [46] ». Autrement dit, il n’existe pas de pulsions de mort. Dans le même ordre d’idées, en son livre remarqué sur Freud [47], Marie Balmary montre que le père n’est pas seulement celui qui cherche à dévorer l’enfant ; il est aussi celui qui interdit le sacrifice. Et c’est la Bible qui le montre, corrigeant le pessimisme partiel du mythe et de la tragédie grecs. Ce que Marie Balmary dit de la lecture freudienne de la religion vaut de sa vision de tout l’homme : Freud n’a décrit « que la première phase de […] la maladie dont souffre l’âme humaine, la maladie de nos relations hommes-femmes, parents-enfants, la maladie de la Parole ». Il a oublié « la deuxième étape, celle qui libère la femme de l’homme, l’homme de son père et sa mère… » Il a parlé « seulement » de « la maladie » de l’homme, non de « sa guérison [48] ».
2’) Critique de l’argument de la répétition
Les phénomènes de répétition compulsifs sans aucune satisfaction libidinale (ainsi que des agressivités et des haines irréductibles à la libido) s’expliquent, estime Sigmund Freud, par la présence de pulsions de mort ; plus encore, selon ses propres mots, la haine est une relation aux objets « plus ancienne que l’amour [49] ». Le fondateur de la psychanalyse a accordé une importance croissante à ces pulsions (Thanatos n’est pas un mot de son vocabulaire) et au principe de nirvana (d’abolition de tout plaisir), à partir de sa dernière théorie des pulsions, élaborée dans Au-delà du principe de plaisir, en 1920. Cette théorie, très controversée de son vivant, toujours contestée aujourd’hui, énonce que l’homme est habité par un principe qui tend à réduire complètement toute tension et à ramener l’être vivant à l’état amorphe de l’inorganique, autrement dit une pulsion de mort.
Qu’en penser ? À mon sens, il n’existe pas de pulsion de mort ou de nirvana qui soit symétrique du principe de vie. Celui-ci, grosso modo, s’identifie aux dynamismes d’ouverture et d’unité. Déjà la satisfaction libidinale est toujours présente dans la compulsion de répétition, comme Freud lui-même l’affirme : « Toujours et encore nous faisons l’expérience que les motions pulsionnelles, lorsque nous pouvons en retrouver le parcours, se révèlent être des rejetons de l’Eros [50] ».
Par ailleurs, je reconnais volontiers l’existence et l’importance des processus de répétition relevés par Freud. Mais autre le fait, autre l’interprétation : on peut en rendre compte en faisant appel non pas « à une bipolarité originaire de son être propre [51] », mais au dynamisme d’unité, tournant ici à vide. L’unité qui, en période saine, est source de nouveauté créatrice, sauvegarde l’unité et donc le travail d’assimilation, conduit ici à un morne retour du même. Le dynamisme d’unité intérieure se trouve, en retour, validé par le phénomène de compulsion.
Dans la vision de l’homme que nous proposons, la mort est donc effet, et non pas cause. Exit le profond pessimisme de Freud.
4) Évaluation de la philosophie sous-jacente
a) Une philosophie masquée
Freud, anti-philosophe ? Comment ne pas observer que, dans sa seconde topique, il refond et refonde la psyché à partir des deux instances que sont le surmoi et le ça, qui sont elles-mêmes les deux intériorisations des deux philosophes marquants : Kant pour le surmoi, et Nietzsche pour le ça [52] ?
Freud, homme des Lumières ? Oui, mais des Lumières sombres, selon le mot d’Adorno déjà cité !
b) L’incompétence métaphysique
1’) Vérité du manque… Exemple de la prière
Quelques citations suffiront :
« En admettant qu’il y ait des moments où un cœur reconnaissant et touché au vif fait éclater tous les cadres de prières, la chose, toutefois, n’est pas fréquente. Être en ferveur n’est pas l’état ordinaire de l’âme : l’extraordinaire n’existe que de temps en temps. Bien plus, il ne doit pas être l’état ordinaire de l’âme, et, si nous encourageons en nous cette ferveur, cette précipitation incessante et cette alternance de sentiments, pensant qu’en cela et en cela seul, consiste la ferveur en religion, nous nuisons à nos âmes et, en un sens, je peux même dire que nous attristons l’Esprit [53] ».
« Dans les autres (manières de prier), on parle à Dieu et à soi-même, on réfléchit, on raisonne, on connaît distinctement qu’on agit, qu’on opère avec la grâce tous les actes qui exercent l’activité de l’esprit et de la volonté, qui entretiennent sensiblement la vie de l’un et de l’autre, ce qui plaît au cœur humain, d’où naissent les satisfactions intérieures, qui toutes saintes qu’elles sont par elles-mêmes, n’ont pas empêché saint François de Sales de s’écrier que ‘nos misérables satisfactions ne font pas le contentement de Dieu’ ; mais dans l’oraison dont il s’agit, l’esprit, la volonté, toutes les puissances s’y trouvent liées et comme mortes par rapport aux opérations distinctes et ordinaires ; ce ne sont que de simples actes directs, si peu connus et si confusément aperçus, qu’on n’y craint rien tant que d’être oisif, d’y perdre son temps ; d’où naissent, au lieu de complaisances pendant et après l’oraison, les plus fortes tentations de l’abandonner [54] ».
« Se tenir en un profond recès, franchir un à un les cercles infernaux de la sensation, des images, des sentiments, des idées ordinaires, avoir la longue patience de supporter la privation : du dénuement même naîtrait peut être l’homme. Mais, pour ne point éprouver le fond de désert et de soif, l’esprit s’agite : ce ne sont qu’objets, projets, travaux, changements, plaisirs, espoirs et craintes, battements de cœur, mille battements d’ailes pour trouver sans cesse un nouveau point d’appui. Aller de l’avant à pas précipités : c’est une fuite. Prendre de la hauteur : c’est une chute. Tout est bon qui voile l’abîme. Qui s’arrêterait à le contempler tomberait peut être dans le bonheur comme une pierre [55] ».
« Il n’y a pas de réussite satisfaisante dans l’oraison, quelle que soit par ailleurs la ferveur de notre prière. Nous serons même d’autant moins satisfaits de nous dans la prière que celle-ci nous aura davantage rapprochés de Dieu. Ce sentiment d’insatisfaction fait partie de la prière : il est la preuve d’un désir non comblé, qui ne peut que grandir avec la charité. […] La prière loin d’apaiser cette soif ne fait que l’attiser davantage [56] ».
2’) … mais cécité vis-à-vis de la puissance
L’introduction a rappelé un certain nombre des caractéristiques de la psychanalyse dont une bonne partie relève de la doctrine, c’est-à-dire de l’interprétation, plus que de la méthode, c’est-à-dire de l’outil qui demeure neutre [57] : son besoin de comprendre, sa fascination pour la part obscure, voire maudite de l’homme, son pessimisme, son matérialisme, etc. Nous n’avons toutefois pas fait état d’un trait encore plus décisif et très souvent inaperçu : l’anthropologie de Freud manque d’une notion essentielle, celle de potentialité ; elle propose une vision seulement actuelle ou plutôt actualiste de la personne, soulignant l’acte au détriment de la puissance [58]. Autrement dit, Freud a étiqueté « déterminé » ce qui était encore indéterminé.
« Freud manque absolument de la notion […] de potentialité déterminable […]. La différenciation progressive n’est pas pour lui le passage de l’indifférenciation à la détermination, elle est la domination d’une détermination déjà existante sur d’autres déterminations existantes qui se trouvent refoulées, enfouies, mais existent toujours [59] ».
Prenons l’exemple de la théorie psychanalytique bien connue selon laquelle l’enfant est un pervers polymorphe : Freud « conçoit donc que l’enfant a déjà en lui, en acte, toutes les fixations possibles de l’instinct sexuel », d’où le terme de « pervers polymorphe » [60]. Qu’en penser ? Certes, le petit d’homme peut acquérir telle ou telle perversion (au sens freudien : fétichisme, sadisme, etc.), mais cela ne signifie pas qu’il les a vécues, contractées en acte. Il faudrait donc parler non pas de « pervers polymorphe » mais de « pervertible polymorphe [61] ». Or, entre les deux expressions, il y a toute la différence introduite par le suffixe « ible », c’est-à-dire la distance existant entre la possibilité et sa réalisation, entre ce qui est encore indéterminé et ce qui ne l’est plus. « Et qu’on ne dise pas qu’il n’y a là qu’une question de mots. Quel pathologiste consentirait à taxer de verbalisme la distinction entre le rôle du germe et celui du terrain [62] ? ».
Cependant, pour être précis, cette critique s’adresse encore davantage à Jacques Lacan (et par là à Louis Beirnaert). Ce dernier dit par exemple qu’« il n’y a pas de coupure entre le discours courant et un discours non accessible à la conscience ». La pensée lacanienne (et plus généralement) ne s’alimente-t-elle pas de manière implicite à une métaphysique hénologique ? En effet, la distinction du même et de l’autre est une conséquence, tire sa prime intelligibilité du transcendantal unum. Lacan aurait ainsi substitué la distinction de l’altérité et de la mêmeté (toujours en acte) à la distinction plus radicale de l’acte et de la puissance.
Déjà Augustin notait, après l’avoir lui-même expérimenté, combien il est plus facile de penser le néant que la pure potentialité (« Car j’arrivais plus vite à penser qu’une chose n’était pas, si elle était privée de toute forme qu’à concevoir une chose qui fût entre la forme et le néant, ni forme ni néant, une chose informe proche du néant [63] ».
3’) Durcissement du par accident en par soi
Souvent sous l’influence de Lacan, certains auteurs soulignent préférentiellement la privation constitutive du désir [64]. Platon affirmait déjà qu’« on ne désire que ce dont on manque [65] ». Et saint Augustin demandait : « Qu’est-ce que le désir, sinon l’appétit de posséder ce qui fait encore défaut [66] ? » L’étymologie du mot n’évoque-t-elle pas le manque ? « On pense que desiderare est un verbe formé sur considerare. Il aurait signifie d’abord : ‘cesser de voir’, ‘constater l’absence de’. D’où ensuite : ‘chercher’, ‘désirer’. Désirer indique le mouvement qui délie de la sidération astrale et qui transforme son ouverture en chemin vers une rencontre [67] ».
Mais si l’absence expliquait le désir, tout être en manque ne devrait-il pas désirer ? Le singe souhaiterait apprendre à parler et le chêne à marcher. « Le désir n’est pas seulement le sentiment d’un manque – écrit le philosophe Louis Lavelle – il est aussi aspiration vers ce dont il est privé [68] ».
Saint Thomas fait du désir le sentiment éprouvé lorsque le bien n’est plus ou pas encore présent. L’attrait suppose donc bien une carence. Mais la question est de savoir non pas si elle existe mais si c’est elle qui, comme telle, engendre l’attrait. Le Docteur angélique répond : oui, mais par accident. Pour bien comprendre ce point essentiel, il est nécessaire de faire un détour par la philosophie de la nature : en effet, le désir est un mouvement qui n’est pas différent des autres devenirs [69]. Comme celui-ci, il suppose trois principes : au point d’arrivée, une forme, au point de départ, une privation, et, assurant la continuité, un sujet [70]. Ainsi, pour qu’advienne un réchauffement, il faut la chaleur (c’est-à-dire la forme au sens de qualité) au terme, la froideur (c’est-à-dire la privation de la chaleur, car l’eau ne saurait se réchauffer si elle est déjà chaude) au principe, et l’eau ou tout autre sujet qui peut se réchauffer pendant le processus. Or, en une distinction très précieuse, Aristote dit que la forme est cause par soi du changement alors que le manque en est seulement la cause par accident [71].
Appliquons ces considérations au désir. Dans le cas de l’homme, le sujet, loin d’être passif face à la qualité à acquérir, la désire activement. Certes, il doit ignorer le piano pour désirer l’apprendre, mais l’attrait naît d’abord, par soi, de ce que jouer de cet instrument lui apparaît comme un bien (une forme) précieux à acquérir. En termes concrets, la personne n’agit pas à partir de ses manques mais de ses ressources. La pédagogie française qui souligne d’abord les défauts se fonde sur le par accident. Elle ferait bien, ici, de s’inspirer de l’éducation anglaise qui met en avant les talents, autrement dit le par soi.
L’insistance de Lacan sur le négatif est liée à l’influence de la dialectique hégélienne ou plutôt de sa relecture matérialiste (de gauche, comme l’on dit) opérée par un philosophe dont on ne saurait minimiser l’ascendant, Alexandre Kojève : d’abord, car il a introduit Hegel (ou plutôt sa propre version) en France ; ensuite, car, avec une ingratitude dont ce n’est pas le seul exemplaire, Lacan n’a avoué qu’une seule fois sa dette à son égard, ce qui en creux en signale l’importance [72].
Cette inflation du négatif se rencontre aussi chez Freud, mais pour une autre raison : son incapacité à penser la potentialité et la tendance corrélative à réduire toute réalité à ce qu’elle est actuellement. Qui, par exemple, ignore l’affirmation détestable du médecin viennois selon laquelle l’enfant est un « pervers polymorphe » ? Tout change et devient – presque – acceptable, si l’on écrit : « l’enfant est un pervertible polymorphe ». Or, entre « pervers » et « pervertible », il y a toute la différence existant entre l’acte et la puissance. Voilà pourquoi Freud durcit le manque au point d’en faire un principe moteur, au lieu d’y lire une réalité en creux, donc en puissance [73].
4’) La vérité en psychanalyse
La conception psychanalytique de la vérité diffère considérablement de celle de Thomas (au plan éthique, s’entend) ; mais pas sur tous les points :
a’) Divergences
Pour S. Thomas, la vérité est adéquation au réel. Nullement en psychanalyse : « Le grand paradoxe du rel tient en effet au fait que, s’il est le ‘contraire’ de la vérité, il n’est pas pour autant la fausseté : la fausseté, elle, n’est pas le contraire de la vérité puisqu’elle est, par l’intermédiaire de la dénégation, le chemin privilégié par lequel peut précisément être posée la question de la vérité en tant que niée [74] ».
Dit autrement, pour la psychanalyse, le mensonge est le mécanisme de défense par lequel je me cache ma propre vérité ; or, ce processus est involontaire. De plus, la vérité est déjà là. Comme le note R. Bodei : le faux est un « débordement de la vérité, une manière pour la vérité d’aller au-delà d’elle-même, un déplacement du sentiment de conviction (ou de certitude) du ‘grain de vérité’ vers son ‘substitut’ [75] ».
De plus, Freud donne trop de poids au négatif, au mensonge.
Enfin, pour Freud, l’inconscient ignore la distinction vérité-erreur, voire le négatif. En effet, l’inconscient métabolise le désir ; or, le désir est ou n’est pas, il n’est pas bon ou mauvais, vrai ou faux : « Il n’y a pas dans l’inconscient de quoi distinguer la vérité de la simple fiction investie d’affect – explique Cornelius Castoriadis. Ce qui est porté par un désir est : il n’est ni ‘vrai’ ni ‘faux’ [76] ».
b’) Convergences
Les deux penseurs estiment que la non-vérité (ignorance, etc.) ne peut jamais être totale. Même le phénomène délirant « recèle un grain de vérité », contient toujours « une part de vérité [77] ».
Le sujet a moins de recul que l’analysant. Mais celui-ci peut déterminer la part de vérité ou de tromperie. Il existe donc une référence extérieure. C’est Lacan lui-même qui le note : « Dans le chemin de tromperie où le sujet s’aventure, l’analyste est en posture de formuler ce tu dis la vérité, et notre interprétation n’a jamais de sens que dans cette dimension [78] ».
c) Le tout à l’égo
1’) Preuve
Ainsi que Michel Henry l’a montré en détail dans la Généalogie de la psychanalyse, Freud est fils de Descartes. Or, la philosophie cartésienne place l’ego au centre. Donc, l’anthropologie freudienne est guettée par le solipsisme : dans la psychodynamique freudienne, l’accès du sujet à l’objet demeure toujours problématique [79]. C’est ainsi que le philosophe Gilles Lipowetzky critique le narcissisme présent dans la psychanalyse :
« Plus ça interprète, plus les énergies refluent vers le Moi, […] plus l’intériorisation et la subjectivation de l’individu gagnent en profondeur ; plus il y a de l’inconscient et d’interprétation, plus l’autoséduction s’intensifie. Machine narcissique incomparable, l’interprétation analytique est un agent de personnalisation par le désir et du même coup un agent de désocialisation, d’atomisation systématique et interminable au même titre que tous les agencements de la séduction [80] ».
Telle est aussi la critique de fond, pratique autant que théorique, que John Bowlby a adressée à Freud dans sa remarquable théorie de l’attachement.
2’) Première conséquence : l’effacement de l’origine
- L’origine immanente est le père. Or, même si la psychanalyse cherche à « sauver le père [81] », finalement, elle en gomme la figure [82]. Le signe le plus évident est la nécessité de s’arracher, de le tuer réellement (la horde primitive) ou symboliquement (chaque génération, chaque individu). Alors que la première génération acceptait la place du père, la seconde l’a disqualifié au nom du primat de la mère.
Ulrich répond à l’athéisme et au nihilisme contemporain, à la mort du père, constatant l’épuisement, l’auto-effacement de cet effort inefficace d’auto-divinisation : « Là où l’homme veut devenir son propre père par ses propres forces », et de citer Marx et Nietzsche,
« il retombe sur soi dans l’acte même de la naissance de son oui absolu dans le monde. Il devient l’esclave de son identification au père, il ne peut pas se donner, puisqu’il ne s’admet pas comme donné. Il lui faut se légitimer sans cesse comme le ‘commencement sans commencement’. Il ne peut se débarrasser du ‘je veux’, car il ne peut s’en remettre à aucun ‘autre’ [83] ».
- L’origine transcendante est Dieu. Or, la psychanalyse refuse le don dans la religion. Si ouverte soit la non-croyante Julia Kristeva [84], elle refuse que l’homme en général et l’homme religieux en particulier soient ouverts à la gratuité du don. Pour elle, le fond de la religion, sauf peut-être la religion chinoise, certes invite à un don, mais dans l’espérance d’une récompense : « la confiance en un dieu est à charge de revanche, la ‘foi’ comporte la certitude de la rémunération [85] ». Pour le chrétien dont elle parle surtout, le Credo est l’expression de l’attente d’une « récompense que nul don humain ne saurait égaler [86] ». Et de passer en revue les différents articles du Credo qui sont autant de « fantasmes fondamentaux » que Julia Kristeva « rencontre journellement dans la réalité psychique » de ses patients : cela va du père tout-puissant à la mise à mort du Dieu-homme (révélateur des « désirs meurtriers à l’égard du Père », le seul inconvénient étant que c’est le Fils et non le Père qui meurt ici…), de la dépression fondamentale de l’enfant abandonné par sa mère que traduit l’abandon du Christ sur sa Croix à la mère vierge qui allège l’imaginaire d’un père consubstantiel au père du fardeau écrasant d’une sexualité procréatrice. Bref, le Credo de l’orant sont des fantasmes qui révèlent des désirs ou des traumatismes essentiels, mais en aucun cas des dogmes [87] ».
On peut s’offusquer d’une telle interprétation qui déréalise ou mythologise la foi. Ou bien, si on ne veut pas faire de Julia Kristeva une nouvelle adepte des thèses de Ludwig Feuerbach, on soulignera que la foi chrétienne s’inscrit dans la droite ligne des désirs fondamentaux de l’homme.
Aussi la foi présente-t-elle une analogie avec l’analyse, ou du moins le début de celle-ci, à savoir l’amour transférentiel : « Je te fais confiance et j’attends un retour ». En revanche, Julia Kristeva continue : « L’analyse se termine avec le constat que je ne saurais attendre de retour sans m’aliéner à mon bienfaiteur ; que la demande mais aussi le désir rendent le sujet esclave de son objet [88] ».
En regard, la foi n’abolit jamais la relation d’obéissance, mais sa conviction profonde – et son expérience – est que l’obéissance de la foi est libératrice et non aliénante.
3’) Seconde conséquence : minimisation du don de soi
En perspective psychanalytique, tout amour est une recherche secrète de jouissance, de fusion avec l’origine. Par conséquent, tout don de soi sera suspecté d’être miné par une inconsciente quête de reconnaissance.
Est-ce que la psychanalyse a surinvesti le lien transférentiel car elle a trop minimisé l’apport du lien originaire identifié à une fusion afin de le suspecter ? Tôt ou tard, la psychanalyse doit réinjecter de la réceptivité et de l’origine. Or, en bonne fille de Descartes, elle place la relation à soi avant la relation à l’autre et rend orphelin le cogito. Elle n’a pas assez vu à quel point toute souffrance est un « Maman ne m’abandonne pas » [89].
d) Le scientisme
1’) Freud, un moderne
Freud accorde un primat constant, quoique ambivalent, à la science. « Le travail scientifique est le seul chemin qui puisse nous mener à la connaissance de la réalité extérieure [90] ». Freud souhaitait fonder une discipline scientifique. Aussi Anzieu peut-il affirmer : « Si Freud n’avait pas existé, un autre l’eût faite [la découverte de la psychanalyse], qui n’aurait pu la faire qu’à la condition de présenter certains traits créateurs communs avec Freud, mais l’aurait faite à sa façon et qui l’aurait marquée autrement en raison d’autres particularités de sa personnalité propre [91] ». Comme toujours il faut faire valoir la tripartition des caractéristiques singulières (la trajectoire de Freud), particulières (liées à l’époque, au type caractériel dépressif de Freud) et universelles (tout homme est doué d’un inconscient dynamique, de pulsions sexuelles, etc.).
En ce sens, Freud est un moderne. En voici une illustration. Qui ignore la phrase attribuée à Freud : « Le destin, c’est l’anatomie [92] » ? Pour une fois, il ne s’agit pas d’une légende freudienne. Toutefois, il ne s’agit en rien d’un plaidoyer anti-gender, d’une sorte de fatalité inscrite dans le corps. Tout au contraire, pour Freud, l’anatomie ne suffit pas à déterminer ce qui est masculin et féminin. Plus encore, si l’anatomie fait partie de notre destin, il s’agit de s’en émanciper [93]. En ce sens, Freud est résolument un moderne : la nature est ce à quoi je m’arrache pour conquérir ma liberté. D’ailleurs, cette phrase est une reprise transformée d’une phrase de Napoléon lors de sa rencontre avec Goethe à Erfurt, le 2 octobre 1808 : « Que nous importe aujourd’hui le destin, avait dit l’empereur à propos des tragédies du destin, le destin c’est la politique ». Ainsi Freud pensait à la sexualité, à la différence entre masculin et féminin, à l’instar de la guerre des peuples, comme d’un drame.
Pourtant, Freud est ambivalent : notamment, parce qu’il veut lire le destin de la psychanalyse à sa propre personne.
2’) Le naturalisme
Georges Cottier critique à juste titre certaines tendances de la psychanalyse : le naturalisme et le refus de la responsabilité [94]. Mais, en disciple de Maritain, il propose un discernement entre méthode (ou techniques) et doctrine (ou idéologie) : « cette idéologie naturaliste n’est pas inhérente aux techniques psychanalytiques et psychothérapiques prises en elles-mêmes ». D’ailleurs, les concepts explicatifs dont usent la psychanalyse (l’école freudienne) sont d’ordre pratique », au point qu’il accepte que la seconde topique soit « un modèle opératoire […] dans la conduite du traitement [95] ».
On pourrait ajouter deux signes : le matérialisme professé par Freud [96] ; le terme « volonté » n’apparaît pas dans l’index de la Standard Edition [97].
3’) Le déterminisme
Une conséquence du primat du modèle positiviste est le déterminisme. Nous l’avons maintes fois souligné. En voici une autre illustration. Freud était convaincu que la femme n’était comblée que dans la relation à son enfant, précisément son fils. Voici comment il l’explique, bien entendu de manière psychanalytique :
« Sur le fils, la mère peut transférer l’ambition qu’elle a dû réprimer chez elle, attendre de lui la satisfaction de ce qui lui est resté de son complexe de masculinité. Même un mariage n’est pas assuré avant que la femme ne soit parvenue à faire du mari aussi son enfant et à se comporter vis-à-vis de lui en mère [98] ».
Or, cette explication lit tout à partir du passé et lie tout au passé. Le déterminisme conduit donc Freud à refuser à la femme une relation d’amour plénier avec son époux. Inutile de dire qu’une telle conclusion, idéologique, est largement démentie.
Freud, selon Arthur Kœstler venu le visiter à Londres, murmura à propos des nazis : « Vous savez, ils n’ont fait que déclencher la force d’agression refoulée dans notre civilisation. Un phénomène de ce genre devait se produire, tôt ou tard. Je ne sais pas si, de mon point de vue, je peux les blâmer [99] ». Gêné (ainsi qu’on peut l’imaginer) par une telle affirmation, Ernest Jones souligne que Koestler fit paraître deux compte-rendus différents de sa visite et que, à chaque fois, il commet des erreurs [100]… Quoi qu’il en soit, si une telle assertion ne témoigne en rien d’un philonazisme quelconque, elle montre d’une part une incompréhension en profondeur du nazisme, qui est un phénomène spirituel, d’autre part, les conséquences profondément erronées et néfastes, de l’anthropologie freudienne, à savoir son déterminisme et son pessimisme.
Didier Anzieu cite cet aveu de Freud :
« Quand il s’agit de prendre une décision d’importance secondaire, j’ai toujours retrouvé utile de peser le pour et le contre. Mais dans les questions vitales, comme le choix d’une femme ou d’une profession, la décision doit venir de l’inconscient, de quelque part à l’intérieur de nous [101] ».
Cet aveu est capital pour comprendre combien, chez le fondateur de la psychanalyse, l’inconscient demeure vraiment premier et supérieur à la conscience ; il demeure dans le courant, la logique des mystiques de l’immanence.
Pour Ricœur, « il n’y a jamais qu’une libido et seulement des destins variés de la même libido [102] ». L’hylétique (au sens husserlien) est une, seules les visées sont diverses.
e) La déconstruction
Selon l’expression fameuse de Ricœur, Freud est l’un des trois maîtres du soupçon, avec Nietzsche et Marx. De fait, nombreuses sont les formulations où le fondateur de la psychanalyse souligne la destitution du sujet. Nous avons évoqué son article fameux sur la triple humiliation de l’homme [103]. Voici un bouquet :
« Le moi n’est pas maître dans sa propre maison [104] ».
« Ce n’est pas seulement ce qu’il y a de plus profond en nous qui peut être inconscient, mais aussi ce qu’il y a de plus élevé [105] ».
« La différence qui ouvre mon questionnement sur moi-même, c’est le ‘je’ qui la creuse […]. le nom m’identifie à l’intérieur de la béance que le «je» ouvre dans ma quête vers ma propre identité ».
« Dès que le ‘je’ surgit, le plein de l’être naturel se scinde et de la division du ‘je’ d’avec lui-même naît une interrogation qui plus jamais ne pourra boucler sur elle-même le ‘je’ qui se questionne [106] ».
« Le tabou, dans nos sociétés modernes, bien que conçu de façon négative et portant sur des objets tout à fait différents, […] n’est, au point de vue psychologique, pas autre chose que l’’impératif catégorique’ de Kant, à la différence près qu’il veut agir par la contrainte en écartant toute motivation consciente [107] ».
Freud lui-même reconnaît sa proximité avec Nietzsche, ce qui, paradoxalement, l’a conduit à peu le lire. C’est d’ailleurs pour cela que Rank lui offrit les Œuvres complètes de Nietzsche (23 volumes reliés de cuir blanc) comme cadeau de rupture : « Les pressentiments et les aperçus [de la philosophie de Nietzsche] coïncident souvent de la manière la plus étonnante avec les résultats laborieux de la psychanalyse. Je l’ai longtemps évité précisément pour celle raison ; la priorité dans la découverte m’importait moins que de rester sans prévention [108] ».
Le grand romancier allemand Thomas Mann, qui entretint une relation chaleureuse avec Freud, au terme de sa vie, écrivit sur celui-ci un texte flatteur qui, bien que Freud ne s’y reconnût pas, fait avec justesse de lui un désillusionneur héritier de Nietzsche et de Schopenhauer, un passionné de l’irrationnel et du romantisme [109]. Sans surprise, Freud se défendit… en affirmant que cet essai parlait plus de Mann que de lui [110].
f) La fascination pour l’occulte
Freud « fit pénétrer la Kabbale dans la science [111] ».
1’) Les faits [112]
Sigmund Freud qui reprochait vivement à Jung son goût pour l’occultisme, a pourtant consacré une importante part de son temps, de ses recherches à partir de 1920 à une interprétation du phénomène de la télépathie.
En 1921, à un spécialiste américain du spiritisme lui demandant son avis sur les phénomènes occultes, Freud fait l’aveu : « Si je me trouvais au début de ma carrière scientifique, au lieu d’être à sa fin, je ne choisirais peut-être pas d’autres domaines de recherche ». Toutefois il ajoute que d’abord il ne croit pas à la « survivance de la personnalité après la mort », ensuite qu’il faut distinguer la psychanalyse comme science de « ce champ de connaissance encore inexploré [113] ».
En fait, une nouvelle fois, Freud est ambivalent. Si, à partir de 1910, il avait pris ses distances avec Jung notamment à cause de l’hermétisme, s’il avait condamné sans appel les expériences télépathiques du professeur Roth invité par Ferenczi à la WPV, en revanche, à partir de 1920 et jusqu’en 1933, Freud ne s’est pas contenté de défendre la télépathie, de se livrer à des expériences de transmission de pensée, mais il pratiqua l’occultisme en faisant tourner des tables, il joua au médium – même si c’était pour l’explorer avec sa méthode : l’association verbale.
Ces intérêts se soldèrent d’abord par un texte sans titre sur la psychanalyse et la télépathie. Eitington et Jones l’ayant dissuadé de le lire au congrès de Berlin, il ne fut publié qu’à titre posthume, en 1941 [114]. Toutefois, la même année, 1921, Freud publia un autre article, « Rêve et télépathie » dans l’une de ses revues [115] ; enfin, en 1931, il donnera une conférence « Rêve et occultisme » qui a la taille d’un livre [116]. Le contenu montre à l’évidence que Freud adhère fermement au phénomène télépathique : il croit qu’il y a des transmissions de pensée, même s’il tente d’expliquer les symptômes de ses patients à partir de la psychanalyse.
Il faut toutefois ajouter que Jones a fermement argumenté auprès de Freud : la psychanalyse suscitait encore de vives résistances dans le milieu anglophone à cause de son ancrage dans le vieux monde austro-hongrois peuplé de tsiganes et de magiciens ; si l’on percevait un quelconque intérêt de son fondateur pour l’occulte, elle serait assimilée à l’œuvre d’un charlatan. Freud se rendit à cette raison et consentit à bannir ses recherches sur l’occultisme, non pas de ses intérêts personnels, mais des congrès internationaux. Cet échange verbal de 1926 résume bien les postures réciproques du fondateur et de son plus fidèle transmetteur : « Vous pourriez être bolchevique, mais vous ne favoriseriez pas l’acceptation de la psychanalyse en l’annonçant ». Réponse :
« Il est vraiment difficile de ne pas froisser les susceptibilités anglaises. Aucune perspective de pacifier l’opinion publique en Angleterre ne s’ouvre à moi, mais j’aimerais au moins vous expliquer à vous mon apparente inconséquence pour ce qui est de la télépathie […]. Quand on allèguera devant vous que j’ai sombré dans le péché, répondez calmement que ma conversion à la télépathie est mon affaire personnelle, comme le fait que je sois juif, que je fume avec passion et tant d’autres choses, et que le thème de la télépathie est par essence étranger à la psychanalyse [117] ».
2’) Interprétations
Freud, démoniaque ? Ou plutôt, orgueilleux ? Le démon tente Freud sur son principal point faible : la curiosité, voire le désir d’être original, et l’invitant à explorer ce qu’il aurait dû rejeter, si lui, Freud, n’avait rejeté ce qui eût été son garde-fou, le sens juif, religieux, de l’idole et du démon. Bref, l’intention de Freud est plutôt positiviste : faire entrer l’occulte dans la science (et non pas la science dans l’occulte). Tout en conjurant le risque permanent de la science qui est d’imposer sa rationalité à ce qui lui échappe. C’est ce qu’affirme Jacques Derrida : « La psychanalyse, alors […], ressemble à une aventure de la rationalité moderne pour avaler et rejeter à la fois le corps étranger nommé Télépathie, l’assimiler et le vomir sans pouvoir se résoudre à l’un ni à l’autre [118] ».
Ensuite, l’occultisme partageait avec la psychanalyse un même statut : le rejet méprisant par la science officielle. Or, l’on sait l’autre ligne de fragilité freudienne : le sauvetage de l’impossible, autant que la victimisation, sinon la paranoïa. Nous reviendrons sur ce point.
Troisième interprétation possible : Freud est un héritier du romantisme allemand tout autant que du positivisme ; or, la Naturphilosophie fut toujours fascinée par la part obscure, voire maudite de l’âme humaine.
5) Une défense de la critique freudienne de la religion
Reprenons brièvement et systématisons un exposé de Dalbiez dans le deuxième tome de son grand ouvrage. Et enrichissons-le de quelques autres développements.
a) Exposé des arguments freudiens selon Dalbiez
1’) Argument de contenu
Pour Freud, la religion est un délire collectif.
a’) Preuve par la phylogénèse
En effet, la religion a pour but de déformer l’image du réel : d’une part, elle refuse à l’homme de suivre le principe de plaisir, ce qui l’empêcherait de s’élever vers Dieu ; d’autre part, elle lui propose des simulacres de vérité, se réfugiant dans le mystère quand survient la contradiction. Or, le délire est la déformation du réel, et la religion est un phénomène collectif. Donc, la religion est un délire collectif.
Ensuite, la religion est l’origine du totem. Or, celui-ci est la transcription magique, délirante, du complexe d’Œdipe (cf. exposé de la religion selon Freud). Donc, là encore, la religion est un délire.
b’) Preuve par l’ontogenèse
La religion a une origine affective.
Tout d’abord, ce qui arrive le plus souvent est le fruit d’une connexion nécessaire. Or, les délires à double thème érotique et mystique sont bien plus fréquents que les délires à thème unique. Or, la maladie n’est pas créatrice mais vient de la nature, rend plus perceptibles ses blessures. Donc, il y a naturellement une connexion essentielle entre religion et sexualité.
Ensuite, il existe un rôle compensateur de la religion vis à vis de la détresse humaine : car l’homme adulte se rend compte qu’il sera toujours faible (par rapport aux faits extérieurs et même internes). Or, l’adulte est déterminé psycho-génétiquement par son enfance. Or, quand il était enfant, faible, il se réfugiait chez son père. Donc, l’homme adulte va se constituer une image du père : Dieu (car l’évolution adulte est la rationalisation). Or, pour Freud, c’est le complexe d’Œdipe qui détermine l’attitude de l’enfant vis à vis du père. Donc, le complexe d’Œdipe est la racine de toute la religion.
c’) Argument de Reik
Selon Theodor Reik, la croyance est comme obsession, rêve ; or, l’obsession, rêve plonge ses racines dans l’inconscient où il trouve sa cause ; donc, de même pour la croyance. Bref, Reik dit qu’il faut expliquer la cause de la croyance !
2’) Argument de méthode
La réussite pratique de la méthode.
Si ôter quelque chose en l’homme malade le guérit, cela montre que cette chose est pathologique. De plus, la cause des maladies est en conflits endopsychiques. Or, en débarrassant l’homme de ses croyances religieuses (qu’il considère comme des obsessions), Reik prétend avoir guéri des gens. Donc, la religion est pathologique ; c’est un conflit endopsychologique, et ultimement un délire.
3’) Systématisation à partir des trois vertus théologales
On pourrait apporter une triple critique à l’égard de la psychanalyse et celle-ci peut se synthétiser autour des trois théologales qui, implicitement, à un degré moindre, structurent toute relation à l’autre :
1.Critique de la foi : la psychanalyse discerne toujours une secrète volonté de savoir, donc de ne pas faire confiance, dans bien des discours amoureux.
- Critique de l’espérance : la vie est une espérance déçue car le seul bonheur, celui de l’origine, est à jamais perdue : « On disait quand j’étais en analyse – confie Marc-François Lacan, frère cadet du célèbre psychanalyste et moine bénédictin, à Marie Balmary –, […] que toute promesse ne pouvait qu’être déçue, et que l’accepter, c’était être adulte. Moi, je ne pouvais pas renoncer au principe de la promesse tenue, d’autant moins que j’en avais déjà quelque expérience. Pour devenir adulte, je voulais bien être un enfant mûri, pas un enfant trahi [119] ».
- Critique de l’amour : au fond, la psychanalyse n’y croit pas vraiment, le réduit à un jeu narcissique de pulsions peu durables et trompeuses, imaginaires. En revanche, « ce qui manque à l’analyse, c’est le pardon [120] ». Ainsi, les personnages christiques de Dostoïevski comme le prince Muichkine, Aliocha, Sonia ne nourrissent aucune rancune : « Aliocha ignorait la rancune : une heure après avoir été offensé, il répondait à l’offenseur qui lui adressait lui-même la parole, d’un air confiant et tranquille, comme s’il ne s’était rien passé entre eux. Loin de paraître avoir oublié l’offense, ou résolu à la pardonner, il ne se considérait pas comme offensé et cela lui gagnait le cœur des enfants [121] ».
b) Ambivalence de Freud
Une fois, Freud a la lucidité d’écrire au pasteur Pfister :
« En soi, la psychanalyse n’est pas plus religieuse qu’irréligieuse. C’est un instrument sans parti dont peuvent user religieux et laïcs, pourvu que ce soit uniquement au service de la délivrance d’êtres souffrants. Je suis très frappé de n’avoir pas songé moi-même à l’aide extraordinaire que la méthode psychanalytique est capable d’apporter au travail des prêtres ; mais cela tient sans doute à ce qu’étant un vilain hérétique, tout ce domaine de notions m’est étranger [122] ».
Toutefois, le plus souvent, Freud propose des interprétations, qui sont autant de réductions de la religion à la psychanalyse. Au point que Pfister l’accuse de se tromper parce qu’il méconnaît le christianisme, lui suggérant de mieux s’informer. Par exemple : « Votre substitution de la religion est, en substance, la pensée des Lumières du xviiie siècle, orgueilleusement revue et modernisée [123] ». Comme souvent, Freud répond très vite, en l’occurrence le surlendemain. Pourtant, il ne fait aucune allusion à la critique. De même, son ami genevois lui fait part d’une critique qui devrait le toucher, puisqu’elle convoque des arguments psychologiques : « La différence repose sans doute sur le fait que vous avez grandi dans le voisinage de formes pathologiques de religion et que vous les regardez comme ‘la religion’, cependant que j’ai eu le bonheur d’avoir pu me tourner vers une forme de religion libre, qui vous paraître être un christianisme vidé, alors que j’y trouve le noyau et la substance de l’Évangile [124] ». Et le fondateur de la psychanalyse procède de même, en lui répondant quatre jours plus tard sans évoquer le contenu embarrassant de la correspondance.
Vous avez dit déni ?
c) Effets purificateurs de la psychanalyse
Concluons en faisant appel au principe de distinction opéré ci-dessus avec Dalbiez entre méthodes et doctrine : « En soi, la psychanalyse n’est pas plus religieuse qu’irréligieuse. C’est un instrument sans parti dont peuvent user religieux et laïques [125] ».
Maintenant, la psychanalyse peut opérer une purification non pas de la foi, mais du croyant. À la question : « Que vous a appris votre propre analyse ? », Maurice Bellet répond : « l’analyse a déplacé le lieu même de la foi. Elle a mis cette foi dans l’espace de la Voie et pas dans la posture d’un bastion qui se défend contre l’investigation. Il y a un certain style de christianisme qui dit : «Vous pourrez poser des questions mais n’allez pas trop loin.» Ce faisant, me semble-t-il, on souligne la fragilité de la foi. Ce qui m’intéresse, moi, c’est de trouver une façon de croire et une façon de vivre qui soient au-delà de tout ébranlement [126] ». De même, le philosophe Étienne Borne parlait d’un « athéisme purificateur », face à des pages athées qui ne sont au fond que des panthéismes [127]. En ce sens, la psychanalyse nous apprend combien l’homme, dans sa toute-puissance, veut se prendre pour Dieu [128]. C’est ainsi qu’un autre philosophe chrétien, Gustav Siewerth, salue chez la psychanalyse une double vérité : le sens du « mystère de l’unique amour », et cette unicité considérée « dans son enracinement profond [129] ». Enfin, Paul Ricoeur renchérit : « La psychanalyse est nécessairement iconoclaste », mais « cette ‘destruction’ de la religion peut être la contrepartie d’une foi purifiée de toute idolâtrie [130] ».
Reste que, pour aujourd’hui, les pathologies se sont déplacées : « Pour le xixe siècle, le modèle initial de la folie sera de se croire Dieu, alors que pour les siècles précédents, il était de refuser Dieu [131] ». C’est Michel Foucault lui-même qui l’affirme.
d) Réponse aux différents arguments selon Dalbiez
1’) Au premier argument
La notion même du délire collectif est discutable. En effet, le délire est autistique, l’aliéné est alienus, « étranger », « autre ».
Ensuite, la religion ne déforme pas le visage du réel et donc ne délire pas. En effet, le délire est une croyance irréductible dont la fausseté est évidente. Or, la religion est croyance irréductible, oui ; mais il faut démontrer qu’elle est fausse : or, cela, la psychiatrie ne le peut pas. D’abord, car les plus hautes intelligences de l’humanité se sont divisées sur ce sujet ; ensuite, car comme dans le cas des paranoïaques inventeurs, il faut se référer à un fait extérieur scientifique extra psychiatrique. Ensuite, la Psychiatrie ne peut juger que son domaine ; mais la religion fait appel à un autre domaine ; et le psychiatre n’a pas compétence universelle, à moins de sortir du domaine psychiatrique). Donc, la religion n’est pas délirante.
2’) Au deuxième argument
Il prétend établir la corrélation fréquente pathologie-religion.
D’abord, la raison pour laquelle la religion est si fréquente dans les délires. En effet, la religion fait vibrer à son maximum l’affectivité humaine. Or, les paroxysmes émotifs mettent à l’épreuve notre résistance avec un risque accru de déséquilibres pathogènes ; donc…
Ensuite, la fréquence d’association n’est pas pathologique. En effet, les délires persécutifs sont bien plus fréquents que les religieux. Or, le délire persécutif repose sur l’instinct de conservation excité à son comble (– jalousie…) ; mais ce dernier instinct n’est pas pathologique. Donc, à plus forte raison, la religion associée au délire qui repose parfois sur elle en ses thèmes, n’a rien de pathologique en son association.
Enfin, la corrélation de la sexualité (et pathologie sexuelle) avec la religion n’est pas nécessaire. 1. En effet, deux contraires n’ont le plus souvent aucune connexion causale entre eux ; en revanche, ils présentent une connexion logique telle que l’un peut évoquer l’autre et cela, très naturellement. Or, entre sexualité et religion, la corrélation est celle de la contrariété, du contraste, pour nombre de gens à l’éducation janséniste et ce rapport est souvent évoqué. Mais la pathologie exacerbe, porte à incandescence l’affectivité. Or, la sexualité et la religion sont des domaines où la fragilité est le plus en évidence. Donc, le délire peut souvent associer sexualité et religion sans qu’il y ait de rapport causal entre eux.
- De plus, la pathologie est une résurgence d’un conflit endo-psychique ; or, ce conflit n’est nullement signe d’une connexion universelle nécessaire ; or, la résurgence se fait par coalescence des termes du conflit ; mais le conflit intérieur : sexualité/religion est très fréquent : donc…
3’) Au troisième argument
La religion n’est pas nécessairement une sublimation de la sexualité.
En effet, la sublimation : requiert qu’un quantum d’énergie neutre non utilisé par une puissance inférieure l’est par une puissance supérieure. (le seul commun est le capital de désir) (ex : plaisir physique donne un plaisir mathématique). Mais elle n’implique pas qu’il y ait relation causale entre ces deux puissances : leurs actes sont de nature différente.
Or, la sexualité et la religion sont actes de deux puissances : la première, d’une faculté inférieure, la seconde d’une faculté supérieure. Donc, la sexualité et la religion n’ont pas un lien causal.
4’) À l’argument de Reik
Il affirme que la religion est une obsession, est une pétition de principe.
La croyance n’est pas un rêve. En effet, celui-ci est une pensée déréistique, expression psychique. Or, la croyance est une connaissance.
De plus, on ne peut pas expliquer la cause de la religion en psychiatrie. En effet, la foi comme la science est une connaissance. Or, c’est en tant que connaissance qui a son contenu objectif que la psychanalyse ne peut juger la science. Donc, il en est de même pour la religion.
« Les religions, la connaissance de Dieu naturelle et surnaturelle et son culte, ne procèdent pas de l’inconscient ou du subconscient ni d’une impulsion affective [132] ».
6) La personne de Freud
Il est impossible de dissocier la psychanalyse de son inventeur, non seulement parce qu’il est dans la logique déconstructionniste de celle-ci de lire indissociablement discours et narrateur, de chercher dans l’histoire du second la logique du premier, mais parce que Freud a fait de sa vie le matériau de sa doctrine. On ne peut nier son génie, ni sa générosité, envers sa famille, par exemple envers Minna, sœur de Martha [133]. On ne peut non plus mettre en doute sa puissante volonté [134]. Stefan Zweig, le célèbre écrivain viennois qui a approché Freud dès 1908, a dressé un portrait de lui où il ne s’y reconnaît pas ; du moins, la description physique, au terme de sa vie, dit-elle quelque chose de lui :
« Depuis que s’avance le soubassement osseux de son visage et cependant plastique de sa figure, quelque chose de dur, d’incontestablement offensif, se découvre : la volonté inexorable, pénétrante et presque irritée de sa nature. Plus profond, plus sombre, le regard jadis simplement contemplateur est maintenant aigu et perçant [135] ».
Toutefois, quelques autres traits, problématiques et tout aussi indubitables, méritent de retenir l’attention :
a) Un stoïcien chez les Autrichiens
On l’a dit, Freud était aussi impudique en écrit, dans ses intérêts sexuels qu’il était puritain dans sa vie : souvenons-nous combien il fut choqué par les affiches à Paris. Il y a plus : contrairement à une rumeur tenace, Freud fut abstinent. D’abord, l’on ne sait rien de sa vie sexuelle avant le mariage. La seule personne qui ait jamais osé lui poser une question en ce domaine, Marie Bonaparte, fut illico presto éconduite. Ensuite, après son mariage (célébré civilement le 13 septembre 1886 et religieusement, à son corps défendant, le lendemain), Martha donna le jour à six enfants, entre janvier 1887 et décembre 1895. La voyant épuisée par ses grossesses, Freud décida de recourir à l’abstinence périodique ; puis, après la conception inattendue de son dernier enfant, Anna, il se refusa aux moyens contraceptifs habituellement pratiqués à cette époque (coït interrompu, condom, etc.) et opta pour l’abstention définitive. Il libérait ainsi Martha de la crainte permanente de la maternité. Aussi et peut-être surtout, il se livrait ainsi à une expérience : renoncer à l’activité charnelle pour libérer son potentiel créatif. Il en fera la théorie plus tard : la sublimation comme source d’inventivité intellectuelle. Enfin, il se félicitait de son abstinence sexuelle, dont il pensait qu’elle était réservée à une élite. Et voilà le stoïcisme, non dénué d’orgueil, de Freud.
En revanche, il n’avait guère d’illusion sur ses pulsions sexuelles. Son abstinence ne les annulait en rien. L’extrait d’une lettre à Martha, datée du 2 juin 1884 est révélateur : « Prends garde ma princesse, quand je viendrai, je t’embrasserai à t’en rendre toute rouge […]. Et si tu te montres indocile, tu verras bien que de nous deux est le plus fort : la douce petite fille qui ne mange pas suffisamment ou le grand Monsieur fougueux qui a de la cocaïne dans le corps [136] ». D’ailleurs, lui-même n’a pas totalement renoncé, puisqu’il tenté, sans succès, de renouer charnellement avec Martha. Ainsi qu’il le confie à Jung (bonjour la discrétion !), après le voyage aux Etats-Unis :
« Le regain d’érotisme qui nous a occupés pendant le voyage a lamentablement fondu aux peines du temps de travail. Je m’accommode du fait d’être vieux et ne pense même pas constamment au vieillissement [137] ».
Quoi qu’il en soit, Freud avait à peine quarante ans et le grand théoricien moderne de la sexualité a donc eu une vie charnelle de seulement neuf années…
b) L’ambition dévorante
À l’Université, il rêve de gloire. Ce rêve s’incarne dans le désir d’entreprendre une carrière politique ou un grand naturaliste s’embarquant, tel Charles Darwin, sur un navire, pour parcourir les océans. De fait, l’homme qu’il admirait le plus était Charles Darwin : « sa doctrine promettait une extraordinaire avancée dans la compréhension du monde [138] ». De fait, lorsqu’il quitta la recherche scientifique pour la médecine, Freud espéra faire une découverte de grande envergure qui le rendrait célèbre, et il se lança dans une étude passionnée des propriétés de l’alcaloïde extrait de la plante appelée coca, la cocaïne, espérant en montrer les vertus curatives pour les affections cardiaques, la dépression et les états consécutifs au sevrage de la morphine. Il consacra cinq textes sur ce sujet entre 1884 et 1887 [139].
On a vu combien Freud s’est identifié à Hannibal. Il s’est aussi comparé à Christophe Colomb, autant parce qu’il s’aventura sur les mers que parce qu’il découvrit un nouveau continent. Il s’est aussi attribué un statut comparable, excusez du peu, à celui du prince de la littérature allemande, Goethe lui-même. Comme lui, il admirait la Weltliteratur, la civilisation gréco-latine, les peuples premiers, la résistance que l’art oppose au militantisme religieux (à l’instar de l’orfèvre Démétrius s’opposant aux Juifs et à Paul, en 54, à Éphèse [140]).
Freud a ardemment désiré le prix Nobel. Mais il paya le prix de son originalité. En effet, le Nobel couronne soit des hommes de sciences, soit des hommes de lettres, c’est-à-dire des philosophes ou des écrivains. Or, Herr Professor a toujours jalousement gardé sa discipline de ces différents champs épistémologiques.
c) Le profil caractérologique
Bien évidemment, on ne peut demander à une typologie, quelle qu’elle soit, même aussi fine que l’ennéagramme [141], qu’une détermination générale qui n’éclaire en rien le proprium d’une personnalité hors norme. Il est toutefois éclairant de voir en Freud un type 4, ayant particulièrement développé son aile 3, mais aussi son autre aile, 5. Relevons seulement deux traits du type 4 non intégré.
1’) Le culte pathologique de l’unicité
De fait, à la suite de la figure mythique d’Hannibal et de tant d’autres héros solitaires, Freud cultivait le mythe du génie solitaire affronté à un monde ennemi ou du « splendide isolement », selon le terme que lui inspira Fliess et qui, à l’époque, désignait la politique extérieure britannique (« splendid isolation ») [142]. Freud lui-même souscrit explicitement à cette vision dans cette présentation de lui-même publiée en 1914 :
« Je me représentais ce destin de la manière suivante : je réussirais probablement à me maintenir grâce aux succès thérapeutiques dus à la nouvelle méthode ; cependant, de mon vivant, la science ne prendrait pas note de moi. Quelques décennies plus tard, un autre tomberait infailliblement sur les mêmes choses, à présent intempestives, imposerait leur reconnaissance et m’honorerait en tant que précurseur nécessairement malchanceux. En attendant, tel un Robinson, je m’installai aussi commodément que possible sur mon île déserte [143] ».
Ce souci démesuré de sa singularité caractérise le type 4 dans ses étapes de non intégration. En revanche, lorsqu’il est intégré, la même base honore au maximum la singularité de chacun. Or, n’est-ce pas l’ambition freudienne que de décrire et d’expliquer l’histoire de chaque personne, d’avoir éclairé les ressorts secrets par lesquels chacun se construit.
2’) L’excessive dramatisation
Freud présente une nette tendance pessimiste, ainsi que nous l’avons relevé à plusieurs reprises. C’est ainsi qu’il présente des points communs fondamentaux avec Schopenhauer, notamment trois : la conception irrationnelle de l’homme ; l’identification de l’élan vital à l’instinct sexuel ; le pessimisme anthropologique radical.
Par ailleurs, il cultive une tendance à la dramatisation, sinon à la paranoïa. Ainsi lorsqu’il devient mondialement célèbre, dans les années 1920, que le mouvement se développe par lui-même, grâce aux disciples autant qu’aux admirateurs, il en vient à regretter le temps où il était un inventeur (découvreur) solitaire. Voici ce qu’il écrit à Sandor Frenczi :
« Dans votre dernière circulaire, je trouve excellent le passage où vous dites que cela va mal pour nous tous, mais pour notre cause très bien. C’est vraiment ainsi : la cause nous dévore et nous sommes, en quelque sorte, dissous en elle. Et c’est probablement bien ainsi : j’aurais simplement souhaité à la deuxième génération analytique, la plus jeune, pouvoir résister encore un certain temps à la dissolution [144] ».
Autre exemple de dramatisation, la manière dont Freud conduit et aime conduire la cure. Pour cela, écoutons le témoignage d’un des patients de Freud, James Strachey, connu pour avoir entrepris la traduction de ce qui fut la première édition de référence, la Standard Edition. Cela nous donnera aussi d’entendre à la fois la notoriété (le patient vient des Etats-Unis et s’installe à Vienne en août 1920 avec sa toute jeune épouse Alix, le temps de la cure), l’impact considérable et la manière de faire de Freud (qui est tout sauf passif et silencieux) :
« Tous les jours, sauf le dimanche, je passe une heure sur le divan de Freud […], un homme très affable et un artiste stupéfiant. Pratiquement, chaque séance est bâtie comme un tout organique et esthétique. Parfois, les effets dramatiques sont déconcertants, voire fracassants […]. Vous sentez des choses terribles qui se déroulent à l’intérieur de vous, et vous n’arrivez pas à savoir de quoi il s’agit ; puis Freud donne une toute petite indication, et quelque chose s’éclaire, puis vous saisissez une autre petite chose, et enfin toute une série de phénomènes deviennent plus clairs ; ils vous pose encore une question, vous lui donnez une dernière réponse – et tandis que toute la vérité se dévoile ainsi à vous, il se lève, traverse la pièce jusqu’à la sonnette et vous reconduit à la porte [145] ».
d) L’identité juive
Précisons d’emblée, surtout aujourd’hui. Il faut fermement récuser les critiques antisémites de Freud. De ce point de vue, ce n’est certainement pas un titre de noblesse de Heidegger que d’avoir, pendant la seconde Guerre mondiale, critiqué Freud au nom de son judaïsme. C’est ainsi qu’il parle de la psychanalyse du « Juif ‘Freud’ [Juden ‘Freud’] » qui reconduit l’homme aux instincts [146] ; le pire est que, dans cette critique sans nuance et sans vérité, le philosophe allemand emploie la fameux jargon du Troisième Reich, le LTI (Lingua Tertii Imperii) [147].
Pendant ses études à l’Université, Freud rencontre l’antisémitisme. On le traite de « sale Juif ». Plusieurs fois, il fit fuir des canailles qui l’injurie. En même temps, s’installe progressivement en lui l’identité d’un exclu, qui conservera son indépendance d’esprit. Il exécrait par-dessus tout les « liturgies du corps social, les chorales protestataires, les slogans anonymes clamés à l’aveuglette [148] ». Pour autant, Freud se définit comme un Juif sans Dieu [149] : c’est-à-dire un Juif moderne, un Juif du savoir, mais non de la foi, un Juif appartenant à la communauté qu’est la judéité, sans la haine de soi juive si fréquente.
1’) L’ambivalence de Freud
Si Freud refuse de faire de la psychanalyse une « science juive », d’autant que c’est en raison de cette appellation que le nazisme la combattra, toutefois il reconnaît dans la judéité une des raisons principales de sa naissance. D’un mot, pour lui, le Juif est celui qui, depuis son départ d’Égypte, a perdu son territoire et s’invente, avec une ténacité jamais défendue, un substitut de ce qu’il a perdu [150]. Il déduisait de là les différentes caractéristiques de la discipline qu’il faisait naître laborieusement : le sentiment d’être en exil ; mais la quête d’un héritage, d’une généalogie perdu ; une quête permanente ; une transmission universelle de cette mémoire et de cette quête ; la tension vers un au-delà qui est une sorte d’immortalité ; l’impossible assimilation ou intégration [151].
Cette ambivalence se rencontre singulièrement dans la question posée par le sionisme qui, à l’époque, était celle posée par le projet de fonder un « État des Juifs ». Chaim Wiesmann ayant souhaité créer un enseignement officiel de la psychanalyse en Israël, Freud déclina la proposition, notamment en se positionnant sur la question susdite : « Je ne crois pas que la Palestine puisse jamais devenir un État juif ni que le monde chrétien, comme le monde islamique, puissent un jour être disposés à confier leurs Lieux saints à la garde des Juifs. Il m’aurait semblé plus avisé de fonder une patrie juive sur un sol historiquement non chargé [152] ».
2’) Son goût pour le secret et la déconstruction
Pour Freud, les choses ne sont jamais ce qu’elles paraissent être, mais toujours le substitut en général d’une pulsion ou d’un ancêtre : une nourrice qui est en réalité une mère, un frère qui pourrait être un père, un fils de roi qui est un imposteur (bien sûr insu), etc. Bref, toute histoire est un roman familial. Et tout récit est structuré comme un rêve.
Aussi a-t-on souvent rapproché Freud de Sherlock Holmes : non seulement pour son goût de l’énigme à démasquer, mais aussi à cause de la passion de son inventeur, Arthur Conan Doyle, pour le spiritisme.
Comme si, lorsqu’on a perdu le sens du mystère divin, mais pas celui de l’infini, la personne ne pouvait que substituer l’apparence à l’apparition. Je m’interroge aussi, une nouvelle fois si le juif Freud a tout perdu, sans cette judéité qui est un tropisme adorateur pour l’ehad, le Dieu unique.
e) La névrose de Freud
1’) Les signes somatiques
D’ailleurs, cette névrose se somatisait et, dans sa correspondance, Freud raconte volontiers ses multiples maladies : malaises, syncopes, migraines, névralgies, troubles cardiaques, troubles digestifs, colites [153]. C’est d’ailleurs à cause de ces douleurs physiques qu’il devint adepte de la nicotine, sous la forme de la cigarette puis du cigare, à raison d’une vingtaine par jour – ce qui se soldera par le cancer que l’on sait. Et, plus encore, de la cocaïne : il en consomma quelques années régulièrement jusqu’en 1887, puis définitivement en 1892 ; mais il compensa par le tabac.
2’) Les multiples paradoxes
Je ne parle pas des contradictions de Freud, par exemple dans son explication de l’homosexualité : successives, elles font partie de la vitalité intellectuelle qui doit explorer toutes les hypothèses et se remettre en question en permanence.
Mais je parle des contradictions touchant des points essentiels de la doctrine, comme la réalité extérieure ou fantasmée des traumatismes. Or, nous avons vu ci-dessus, à propos de l’ouvrage de Rank, Le traumatisme de la naissance, que Freud revenait sur ce point.
Mais des attitudes. Par exemple, cet homme révolutionnaire est aussi un conservateur : la « révolution freudienne » « vit le jour dans un lieu qui en est l’antithèse, où ses drapeaux et slogans demeurent invisibles [154] ».
Freud n’a cessé de se contredire, affirmant par exemple que la passion du cigare n’était pas du ressort de la psychanalyse, alors que lui ne cessait d’interpréter le moindre lapsus de son entourage en termes psychanalytiques et qu’il y a dans sa tabagie un indice évident – du moins pour un freudien – de « masochisme ». Roudinesco en conclut : à l’âge de 61 ans, « malgré des années de travail sur lui-même, Freud était toujours aussi névrosé [155] ».
Freud, on le sait, inspira une partie de la modernité littéraire, mais aussi du cinéma. Or, il ne comprit ni l’un ni l’autre. Pour le premier, il suffit de se souvenir de son incompréhension de Proust – ayant lu Du côté de chez Swann, Freud dit à Marie Bonaparte, le 4 janvier 1926 : « Je ne crois pas que l’œuvre de Proust puisse être durable. Et ce style ! Il veut toujours aller vers les profondeurs et ne termine jamais ses phrases [156]… » – qui le lui rendit bien – puisqu’il n’a jamais fait allusion à l’œuvre freudienne qui, pourtant, à l’époque, est accueillie avec ferveur par le milieu littéraire parisien, notamment chez les deux André, Gide et Breton. Pour le second, il ne comprit pas ce chef d’œuvre du cinéma expressionniste, Les mystères d’une âme, qui, projeté pour la première fois à Berlin le 25 mars 1925, fut pourtant le premier film inspiré par la psychanalyse : « D’image en image, on découvre la pensée de Freud […]. Les élèves de Freud peuvent se réjouir. Rien au monde ne pouvait leur faire de publicité avec autant de tact [157] ».
Je parle enfin des contradictions entre la parole et l’attitude. Nous en avons donné de multiples exemples, l’une des plus englobantes étant le paradoxe entre son attitude révolutionnaire (au plan philosophique ou psychologique) et son attitude conservatrice (au plan politique). Une autre est brillamment résumée par Edmundson de la manière suivante : « Freud fut un patriarche qui œuvre avec un talent incomparable à déconstruire le patriarcat [158] ».
3’) La manie de la collection
Depuis 1900, Freud nourrissait une passion pour les antiquités, romaines, grecques, égyptiennes. Elles avaient envahi son appartement, le transformant en musée : on a dénombré trois mille objets. Plus encore, Freud ne pouvait s’en passer : lorsqu’il dut partir en Angleterre, dans l’urgence, il en emporta néanmoins deux mille ! Au point que l’on a pu parler d’une compulsion pour les antiquités [159]. Selon la classification même de Freud, sa névrose relèverait plus de l’obsession que de l’hystérie.
4’) Les fixations
Par exemple, contre l’Amérique. Après une brève période d’enthousiasme, Freud a manifesté une américanophobie toujours plus virulente. Elle lui valut d’ailleurs cette réponse cinglante de Jones qui est à la fois juste dans son discernement (posant une juste distinction entre le singulier et l’universel), prophétique dans sa vision et altérisante (non-fusionnelle) dans sa posture (différenciant heureusement son accord avec la psychanalyse de son désaccord ponctuel avec son fondateur) :
« Je me souviens de ce mot de Pitt : On ne met pas une nation en accusation. Ce sont des êtres humains, avec les mêmes potentialités que d’autres […]. Dans cinquante ans, ils seront les arbitres du monde, si bien qu’il est impossible de les ignorer. Quoi qu’il en soit, je persévérerai dans mes efforts pour consolider là-bas l’implantation encore discrète de la psychanalyse [160] ».
5’) Les relations conflictuelles
Rappelons-nous les joutes constantes et projectives auxquelles se sont livrés les deux plus grands représentants européens de la psychanalyse, donc de cette nouvelle conception de la psyché, alors qu’ils allaient bientôt s’adresser aux plus hautes autorités académiques du Nouveau-Monde ou plutôt de la Nouvelle-Angleterre pour leur faire connaître leurs travaux cliniques.
6’) La paranoïa
Nous en avons déjà vu des symptômes. Le plus flagrant est peut-être l’incapacité de Freud à se réjouir de son succès et de sa reconnaissance pourtant mondiale. Avant 1920, il craignait de n’être pas reconnu, après 1920, d’être trahi. Selon un mécanisme bien connu de la psychanalyse, la crainte s’était simplement déplacée… Et la joie n’était toujours pas au rendez-vous.
7’) Les conséquences sur la psychanalyse
Anzieu pointe avec finesse certaines limites qui sont liées à la structuration psychique de Freud :
« À la structure hystérophobique de l’homme Freud, la technique psychanalytique doit l’instauration d’une situation très particulière : le patient est installé à la bonne distance du psychanalyste, qui peut le voir mais non le toucher ; […] l’aménagement freudien de l’espace psychanalytique, avantageux dans beaucoup de cas de psychonévroses, a prou conséquence de limiter la conduite des cures et le choix des patients en faisant de toute inadaptation à cet espace une contre-indication à la psychanalyse ».
« C’est pour lutter contre ses tendances dépressives que Freud a entrepris son auto-analyse et que l’élaboration de la théorie psychanalytique, particulièrement de ses aspects dynamique et économique, a correspondu à l’établissement de défenses obsessionnelles contre l’angoisse dépressive. Les psychanalystes dont la problématique personnelle se situe plutôt dans le registre schizo-paranoïde seront très mal acceptés tout au long de l’histoire du mouvement psychanalytique, et les plus brillants d’entre eux, à commencer par Victor Tausk, à continuer par Wilhelm Reich, seront rejetés et leur évolution peut-être inévitable vers le suicide ou la folie en tout cas n’aura pas su être arrêtée, de la part de leurs collègues, par une attitude thérapeutique appropriée à leur structure [161] ». Bref, « la conception contraphobique et antidépressive de la psychanalyse se révèle face à l’angoisse de morcellement et de persécution non seulement inopérante mais contre-indiquée. […] C’est être fidèle à l’esprit et au génie de Freud que de prendre conscience des contingences historiques qui handicapent ses conceptions de la cure [162] ».
Enfin, « la nouvelle ère scientifique et industrielle a produit, en Occident, une société de consommation, de vulgarisation, de tolérance. Les mœurs ont évolué, la sexualité s’est affranchie, la famille s’est rétrécie, l’éducation s’est libéralisée […]. Par ailleurs l’humanité manque de grands projets pour son avenir et les menaces ont changé de provenance : la nature, maîtrisée, n’incite plus à la lutte ; mas de nouveaux dangers visent l’humanité entière, l’explosion démographique ou atomique, l’encombrement par les objets, la pollution par les déchets, la destruction des équilibres naturels. […] Plus généralement, la vie économique est plus investie que les relations humaines […]. L’homme moderne se sent mal dans son corps ; il est étouffé par l’étude, le langage, les communications de masse, les institutions ; il se trouve déchiré par les désaccords dans les couples, les groupes […] D’où le désir de plus en plus répandu de dégager l’humain de la tyrannie des réalités économiques. D’où la fréquence croissante des excès et des déficits narcissiques, de la dépression [163] ».
Le diagnostic est clair : « la problématique narcissique est devenue plus importante, plus répandue que la problématique œdipienne. Le Surmoi post-œdipien n’est du même coup qu’ébauché, laissant le champ libre au Surmoi archaïque, persécutif et destructeur ». Ainsi le système freudien n’est pas remis en question, mais il « ne fonctionne plus à l’heure actuelle chez la majorité des humains comme Freud l’a vu sur la plupart des gens auxquels il avait affaire [164] ».
f) Une personnalité narcissique ?
Nous avons évoqué plus haut plusieurs signes, comportementaux ou plus intimes, chez Freud : son orgueil ; sa difficulté à reconnaître ses dettes (mais pas totalement, nous l’avons aussi vu) ; sa volonté de créer un cercle d’admirateurs ; la transformation de tout dissensus en inimitié, donc la réduction de toute relation à l’admiration ou à l’exclusion ; sa difficulté, voire son impossibilité à pardonner – par exemple à Adler qui, jusqu’à sa mort, traita Freud d’escroc et de comploteur [165] ; en effet, Freud dit de lui à sa mort en mai 1937 : « Pour un jeune garçon juif sorti des faubourgs de Vienne, mourir à Aberdeen [en Écosse] est une fin inespérée et la preuve du chemin qu’il a parcouru. Les gens l’ont réellement bien récompensé de s’être chargé d’apporter la contradiction à la psychanalyse [166] » – ; etc.
Revenons sur ou attardons-nous sur d’autres symptômes.
1’) La fusion-fission avec ses amis
Freud avait le génie de l’amitié, jusqu’à la fin de sa vie (que l’on songe à l’amitié nouvelle qu’il noua, en 1930, donc à 76 ans, avec William Bullitt, diplomate et journaliste dandy américain, et qui s’est soldée par l’écriture à deux mains d’un ouvrage sur le Président américain Wilson, précisément une psychobiographie entièrement fondée sur la théorie typiquement analytique des substitutions [167]). Nous avons vu combien les relations de Freud étaient intenses et fusionnelles. De fait, dans son immense activité épistolaire avec tous ses disciples, Herr Professor demandait des nouvelles de leur santé, des épouses, des enfants, ne manquait jamais de fêter les anniversaires. Plus encore, il parlait à l’un des autres, certes, pour souder des liens, mais dont il était le médiateur obligé, et non sans parfois commettre « de véritables indiscrétions », surtout, donnant ainsi à chacun « l’impression d’être le préféré du maître [168] ». Ce qui constitue une des plus efficaces et des plus aliénantes manipulations, quand on sait combien est grande la soif d’être reconnu par une autorité, en général et en particulier, à une époque où l’autorité paternelle était autant en crise.
Freud a suscité des admirations-adorations, allant jusqu’à la fascination et l’identification. Le cas le plus typique est Theodor Reik, l’enfant terrible de la psychanalyse, le « Simili-Freud » : analysé par le maître, il portait la même barbe, fumait les mêmes cigares, parlait comme lui, etc. [169]
Le signe par excellence de la fusion est sa conséquence nécessaire, la fission. Or, Freud a rompu avec presque tous ses amis. En voici encore un exemple. Rank, si aimé, a fini par rompre et quitter Vienne. Freud s’est senti trahi et écrivit à Ferenczi toute son amertume : « On lui a beaucoup donné, mais en retour il a beaucoup fait pour nous. Nous sommes donc quittes ! Lors de sa dernière visite, je n’ai pas eu l’occasion de lui exprimer l’affection particulière que je lui voue. J’ai été honnête et dur. Aussi pouvons-nous faire une croix sur lui. Abraham avait raison [170] ».
Or, si nous avons vu la place qu’occupent les amitiés dans la vie de Freud, pourtant, Roudinesco n’hésite pas à écrire que, « en 1920, Freud songeait beaucoup plus à la valeur de ses découvertes qu’à ses amitiés [171] ». Bref, Freud aime l’autre comme un prolongement de lui-même.
2’) La fusion avec sa fille Anna
C’est peut-être avec Anna (1895-1982), le seul de ses enfants qui soit demeurée célibataire, que la toxicité des relations de Freud avec sa fille se manifeste au plus haut point. Il la surnommait « ma fille unique » (alors que Freud en eut trois, mais, rappelons-le, Anna est la dernière). S’inquiétant de voir Anna demeurer célibataire, de son refus des hommes, il lui proposa de « réveiller sa libido » en la prenant en analyse, en octobre 1918. Elle accepta et fit une longue cure en deux temps : de 1918 à 1920, de 1922 à 1924. Certes, à l’époque, les règles déontologiques n’étaient pas fixées ; mais comment ne pas noter que l’absence de tout cloisonnement (for interne-for externe !) conduit à la manipulation, surtout dans une famille aussi endogame ?
Surtout, ce n’est que très tardivement que Freud prit conscience de ce que, pour parler le « psychanalytique », le « choix d’objet » d’Anna n’était en rien les hommes. Bref, qu’il reconnut son homosexualité. D’ailleurs, lorsque, en 1923, Anna décida officiellement de renoncer au mariage, son père la surnomma « Antigone » ! Anna rencontra vers 1924 la compagne de sa vie, Dorothy Tiffany Burlingham, américaine qui avait épousé un chirurgien atteint de psychose maniaco-dépressive.
3’) La fusion avec les patients
Nous en avons vu différents exemples ci-dessus, chez Freud et chez ses disciples.
Entre 1895 et la fin de sa vie, Freud, en fait, traita environ 160 patients [172] – ce qui, sur la longue durée de son activité professionnelle, est très peu. Pourtant, il travaillait à raison de huit séances quotidiennes de cinquante minutes et de six jours par semaine. La moyenne des patients étant de la grande ou de la moyenne bourgeoisie, juifs, névrosés, provenant d’Europe (et, à partir de 1920, de l’Amérique du Nord). Mais le point intéressant est ailleurs : Freud reçut en cure les analystes eux-mêmes, c’est-à-dire ses proches, puisque nous avons vu qu’il entretint d’étroites relations d’amitié avec tous les premiers psychanalystes ; plus encore, il analysa sa fille Anna et les conjoints et proches de ses disciples. Or, à partir de 1918, les sociétés psychanalytiques établirent des règles interdisant une telle proximité. Donc, Freud viola ces interdits avec constance ; plus encore, personne, au sein de ces sociétés, ne s’estima le droit de demander à Freud de respecter cette déontologie.
En fait, la méthode de Freud était beaucoup plus interactive et originale qu’on ne le pense. Freud cherchait bien entendu à soigner ses patients, non pas en annulant le traumatisme, mais en canalisant son énergie, afin qu’il réalise mieux ses désirs. Or, l’abréaction d’un souvenir refoulé lui semblait beaucoup moins efficace que la sublimation, cela par le retour aux origines de l’humanité. Ainsi, il racontait des légendes, lisait des poèmes, résumait des romans, présentant tous des significations sexuelles cachées, de sorte que le patient était ainsi invité à se prendre pour le héros, prince ou princesse, demi-dieu, etc. d’une histoire mythique à laquelle il s’assimilait.
Notons d’ailleurs que la cure permettait à Freud de vivre plus que confortablement : entre 1900 et 1914, il s’enrichit au point de devenir aussi riche que les grands professeurs de médecine qui recevaient aussi des patients en privé [173]. La croissance du prix de l’heure est révélatrice : en 1910, il demande 10 à 20 couronnes par séance, en 1919, 200, en 1921, il songe à demander 500 ou 1000. Quelle équivalence ? Chrisfried Tögel attribue à Freud un revenu qui serait de l’ordre de un demi million d’euros annuel… [174] Freud serait-il donc aussi vénal que Lacan ?
Cette fusion-confusion s’est propagée aux autres psychanalystes, y compris féminins : elles furent analysées par leurs époux ou leurs collègues et, à leur tour, elles firent passer leurs enfants sur leur divan.
4’) La relation de séduction aux femmes
Plus haut, j’ai affirmé que Freud possédait une pente obsessionnelle. Mais il n’était pas dépourvu d’une pente hystérique… Certes, il est demeuré continent une grande partie de sa vie ; certes, il avait l’adultère en horreur et l’on n’a aucune preuve de ce qu’il ait trompé Martha. Freud dissociait d’ailleurs amour et désir : « Là où ils [les hommes] aiment, ils ne désirent pas, et là où ils désirent, ils ne peuvent aimer [175] ». Mais « puritain charmeur, il aimait follement séduite les femmes par la parole [176] ». Un signe en est l’abondante correspondance avec les femmes et son exceptionnelle qualité littéraire : Freud charmait autant par ses mots qu’il se refusait à attirer charnellement. Un autre signe en est sa relation avec deux femmes d’exception, Lou Andreas-Salomé [177] et Marie Bonaparte.
La première est une femme qui séduisit les hommes les plus en vue de son époque, de Nietzsche à Rilke. Freud lui-même va succomber à son charme. Voici comment son meilleur biographe la décrit, en 1911, lorsqu’elle va rencontrer le maître : « Sa beauté physique était égalée sinon dépassée par la vivacité de son esprit, par sa joie de vivre, son intelligence et sa chaleureuse humanité [178] ». Après s’être méfié de sa beauté et de son attirance pour cette femme d’exception, Freud fut totalement ébloui et bouleversé par cette femme qui lui ressemblait tant : « même orgueil, même démesure, même énergie, même courage, même manière d’aimer et de posséder fébrilement les objets d’élection [179] ». Mais la dévoration sexuelle en moins. Or, Freud « lui offrit la plus haute forme d’amour dont il était capable : […] un échange intellectuel comme il n’en avait jamais eu avec aucun de ses disciples » ; de plus, « pour la première fois, il ne transformera pas l’ami indispensable en un indispensable ennemi » ; enfin, elle était aussi joyeuse que Freud était dépressif et tragique. Bref, « Freud était amoureux d’elle [180] », sans toutefois éprouver d’attirance érotique. D’ailleurs, Freud fut préservé : alors que Lou embrassa… de manière exclusive la cause du freudisme, elle tomba amoureuse de l’homme le plus beau et le plus mélancolique du cercle de Freud, Viktor Tausk. Lou prit soin d’Anna et en devint la seconde thérapeute. Freud et Lou demeurèrent toujours amis et, en 1931, pour son 75e anniversaire, elle lui témoigna sa gratitude en lui consacrant un ouvrage où elle n’hésite pas non plus à exprimer ses points de désaccord, sur le dogmatisme et ses propos sur la création artistique [181].
De Marie Bonaparte, je ne dirai qu’une chose : la princesse française névrosée (au point d’être suicidaire), exceptionnelle traductrice et ambassadrice dévouée à la cause freudienne, réconcilia Freud avec la France qu’au fond il aimait. Un signe en est qu’elle formula une originale typologie psychologique de la féminité, qui s’écartait autant de l’école viennoise que de l’école anglaise : les femmes revendicatrices, qui veulent s’approprier le pénis ; les femmes acceptatrices, qui s’adaptent à leur réalité biologique et sociale ; les femmes renonciatrices, qui se détachent de la sexualité [182].
J’ajouterai que, à la Berggasse, Herr Professor est entouré par des femmes. Ainsi, en 1930, il ajouta une troisième femme de service, âgée de 27 ans, Paula Fichtl [183], aux deux autres, Anna et Maria, de sorte que cela porte le nombre des femmes à six – si l’on compte Martha et sa sœur Minna, et enfin Lou !
5’) Amour de l’autre, notamment des patients ?
Freud éprouvait-il une véritable compassion pour ses patients ? En tout, cas, comme Lou Andreas-Salomé, Freud ne comprit jamais la misère des peuples et leur besoin de réagir : « Je crois – lui écrit Freud – que l’on ne peut pas avoir de sympathies pour les révolutions tant qu’elles ne sont pas finies. C’est pourquoi elles devraient être courtes. La bête humaine a quand même besoin d’être domptée. Bref, on devient réactionnaire comme l’était déjà devenu ce rebelle de Schiller en face de la Révolution française [184] ». Et l’on sait que, dans son Journal clinique, Ferenczi reproche à Freud son détachement progressif pour la dimension thérapeutique de la psychanalyse (au profit de son interprétation du champ anthropologique) et son manque de compassion dans la cure, sans parler de son désintérêt pour les patients psychotiques [185]. Ce journal ayant été publié longtemps après la mort du disciple hongrois (1933), Freud ne sut jamais ces critiques.
6’) L’autoritarisme
Si, on l’a dit, Freud faisait preuve d’une réelle générosité, en hébergeant dans l’appartement de deux étages de la Berggasse sa famille élargie et en l’entretenant, en retour, il régnait sur elle comme un patriarche à l’ancienne : sur tout le monde qui y vivait (enfants, famille, les deux, voire trois domestiques), en particulier sur Martha : Freud « avait voulu ‘façonner’ Martha pour obtenir qu’elle fût absolument conforme à l’image de l’épouse dont il rêvait ». Roudinesco ajoute que ce fut « en vain », même si Martha n’entra jamais en conflit ouvert : « Quand il lui cherchait querelle, elle se repliait sur elle-même. Aussi lui reprochait-il de refouler son agressivité tout en lui vouant une sorte d’adoration [186] » ! Et c’est dans cette permanente application du soupçon psychanalytique que réside le plus grand abus de son autorité, à la limite de la manipulation mentale.
Un signe, presque un symbole, de cet autoritarisme : Freud aimait autant les chiens (qu’il introduisit dans la famille au point qu’il écrit : « Nos deux chiens […] représentent l’accroissement le plus récent de la famille [187] ») qu’il détestait les chats (Freud s’en prendra un jour méchamment à Mirra Eitington, l’épouse de son dévouée disciple en écrivant : « Je ne l’apprécie pas. Elle a la nature d’un chat et je ne les apprécie pas non plus [188] »). Or, pour lui, le chien est masculin et ouvert à l’autre, alors que le chat est féminin et narcissique. [189]
7’) Conclusion
Tous ces symptômes se rencontrent dans le tableau clinique (et même psychiatrique), à l’époque inconnu, des personnalités narcissiques… Faut-il en conclure qu’il rentre dans ce cadre ? Que Freud soit génial peut cohabiter avec une telle pathologie psychique. Souvent, les personnalités narcissiques conjoignent le soleil rayonnant et attirant d’un grand talent pour lequel elles sont reconnues avec le trou noir d’un ego boursouflé qui fait souffrir le sujet à son insu et son entourage, beaucoup moins à son insu.
Élargissons et osons poser une question. Qu’un homme soit un empoisonneur ou un névrosé ne prouve rien contre son discours scientifique, même s’il est prix Nobel en physique ; en est-il de même pour un discours sapientiel comme la philosophie ou la théologie ? Or, la psychanalyse se meut à la lisière, à la frontière entre science psychologique, art médical et nouvelle vision de l’homme, voire réinterprétation de la religion.
Le juif athée, voire militant, qu’était Freud, loin d’abolir la religion, l’a déplacée du vrai Dieu au faux dieu de la psychanalyse (qui se propose véritablement comme la cure, voire le salut délivrant l’homme de tous les maux et, plus encore, la religion, c’est-à-dire l’explication nouvelle et totalisante de la psyché et du monde) – peut-être même de son propre moi.
G) Conclusion
Selon Roland Dalbiez, la pensée de Freud se résume en quatre principes : l’existence d’une cause psychologique spécifique ; l’existence d’un inconscient psychique ; l’existence d’une instance refoulante, la censure ; la libido [190]. Selon Jacques Lacan, il y a quatre concepts fondamentaux : l’inconscient ; la répétition ; le transfert ; la cure [191].
Proposons une évaluation intégrative de l’apport freudien, du double point de vue, philosophique et théologique.
1) Une synthèse intégrative
On a parfois dit que le vingtième siècle est le siècle de Freud. Il est en tout cas impossible et dommageable de parler en profondeur de l’homme et surtout de sa psychologie (au sens précisé dans l’introduction) en faisant l’impasse de la psychanalyse freudienne ou en se démarquant systématiquement de ses positions. Cette dernière thèse, qui est celle du Freud-bashing, risquerait fort d’être réactive, donc d’être secrètement minée par le ressentiment.
Comment se positionner à l’égard de Freud en en sauvant la profonde vérité sans se laisser piéger par son pessimisme et son réductionnisme ? Que notre positionnement puisse être à son tour lui-même soupçonné par des psychanalystes de métier est sans doute inévitable, surtout si l’on part du principe selon lequel seul peut parler de psychanalyse celui qui est pratiquent. Paul Ricœur a fait justice, à mon sens définitivement, de cette prise de position passablement idéologisée et qui est non-réfutable au sens poppérien du terme.
Comme nous le verrons au chapitre 5, la blessure comme fermeture et désunité (mise en péril de l’unité intérieure) est le principe explicatif de la vie psychique traumatisée – principe, non pas au sens d’axiome permettant de déduire a priori des conséquences abstraites, mais lumière donnant d’éclairer des effets que seule l’expérience nous enseigne. Ce qui signifie que Freud nous parle non pas de ce qui, en l’homme, n’est pas l’homme (ainsi que le pensait Dalbiez), ni, tout à l’opposé, de ce qui est dans l’homme et en est son unique grandeur, mais de ce qui, dans l’homme, relève de son statut vulnérable, éclaté, anarchique, en un mot, de la blessure de l’homme. Ce qui fait le génie de Freud en fait aussi sa limite et permet un discernement immédiat sur ses dernières œuvres relatives à la naissance de la morale, de la civilisation, de l’art et de la religion : elles n’en explicitent que l’origine blessée, mais elles sont impuissantes à en révéler la nature profondément spirituelle.
Freud nous délivre du moralisme (entendu comme réduction de l’involontaire au volontaire, comme construction de la liberté à partir d’un déni du conditionnement psychologique), mais il menace de nous enfermer dans le psychologisme (entendu comme tentation opposée de réduction du volontaire à l’involontaire, comme déconstruction de la liberté à partir de prétendus déterminismes psychologiques).
Généralisées, les conclusions de Freud relèvent de l’idéologie psychologisante et scientiste ; elles induisent en outre au pessimisme et minimisent l’existence de la liberté comme maîtrise de soi. En revanche, systématiquement niées, elles sont la proie d’une idéologie symétrique et opposée, de nature moralisante qui oublie, à son tour, que l’homme est blessé, profondément. Le pseudo-optimisme qui en résulte se transforme souvent en désespoir ou en manichéisme. Voilà pourquoi il convient de réserver aux analyses de Freud – qui ne sont surtout pas figées, mais demandent prolongements et corrections – la place qui leur convient et qui me semble parfaitement situées par le discernement proposé : Freud ne nous parle ni de l’homme en sa prime ouverture, ni de l’homme régénéré, plus, reconstruit et guéri, mais de l’homme blessé.
2) Un discernement spirituel
Le discernement suppose d’opérer un tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et cette ligne de partage se doit de sauver le plus possible la proposition de Freud. Alors que le dialogue ne requiert pas ce discernement, l’intégration, elle, le suppose, car elle requiert l’unité de la vérité.
Un premier discernement s’opère entre méthode et doctrine. Et, de là, entre ce qui est de l’homme (actus humanus) et ce qui est en l’homme (actus hominis), pour réserver la psychanalyse à ce seul second domaine. Un autre discernement s’opère, au sein même de l’homme, interne à l’esprit de l’homme, entre une explication archéologique et une explication téléologique. Je voudrais en proposer un troisième, plus adéquat et qui sauve encore davantage : entre essence (nature humaine) et condition blessée. D’un mot, Freud traite non pas de l’essence, mais de la condition blessée de l’homme. Pour reprendre le mot célèbre de Fénelon à propos de Phèdre, Freud est un chrétien « à qui la grâce a manqué ». Au fond, il voit l’homme après la chute originelle, mais avant la rédemption.
On peut encore préciser : Freud a analysé la blessure de cet aspect important de l’homme qu’est la sexualité. À ce sujet, Jean-Paul II – dont il est bon de se rappeler que sa prime formation est philosophique – propose un discernement comparable et passionnant [192]. Traitant du sens du corps et de la sexualité, le pape parle « de quelques prises de position contemporaines qui interprètent le sens de l’homme et de la morale » : ce sont celles de trois penseurs que le philosophe français contemporain Paul Ricœur a appelé les « trois maîtres du soupçon » : Freud, Marx et Nietzsche. En effet, ils « ont exercé et continuent à exercer une grande influence sur la manière de penser et de juger de notre époque ».
Le pape s’attarde sur Freud dont il cite en note un passage de Freud tiré de l’Abrégé de psychanalyse [193]. Pour lui, le fondateur de la psychanalyse traite des blessures de l’homme, de ce que la théologie classique appelle les « manifestations de la concupiscence de la chair ». Cependant, Freud se borne « à mettre le cœur en état de continuel et irréversible soupçon ». Or, « dans la Bible, la triple concupiscence de l’homme [194] ne constitue pas le critère fondamental, ni surtout unique et absolu, de l’anthropologie et de l’éthique, bien qu’elle soit incontestablement un élément important pour comprendre l’homme, ses actions et leur valeur morale ».
Le pape le montre, comme Freud lui-même, à partir de l’expérience intérieure que fait l’homme : celui-ci « n’éprouve-t-il pas, en même temps que la concupiscence, un profond besoin de conserver la dignité des relations réciproques qui ont leur expression dans le corps […] ? Ne ressent-il pas le besoin de les imprégner de tout ce qui est noble et beau ? N’éprouve-t-il pas le besoin de leur conférer la valeur suprême qu’est l’amour ? » Or, ces trois expériences intérieures universelles se réfèrent à la libre capacité du don qui est au cœur de l’homme. C’est donc que celle-ci n’est pas effacée par la concupiscence, contrairement à ce qu’affirme le soupçon selon lequel « l’homme [est] entièrement plongé dans la convoitise de la chair ». Pour l’herméneutique du soupçon, l’homme est « irrévocablement accusé et laissé en proie à la concupiscence de la chair », la convoitise est la réalité la plus profonde de l’homme. En regard, l’Ecriture oblige à dire que, l’homme est « appelé […] à cette valeur suprême qu’est l’amour », et il est « appelé avec énergie », c’est-à-dire avec réalité et efficacité. C’est donc que la vérité de son corps et de son cœur, le don de soi, ce que le pape appelle la signification sponsale de la personne est « plus profond[e] que la tendance au péché dont il a hérité ».
En résumé, loin de réduire ou de critiquer unilatéralement Freud, Jean-Paul II manifeste une lumineuse convergence entre sa pensée et ce que l’Evangile apprend du cœur de l’homme. Il en appelle aussi à un discernement : les « maîtres du soupçon » traitent de l’état de nature blessée et pécheresse de l’homme, laissée à ses seules forces naturelles : l’homme « abandonnant cet acte intérieur au gré des forces de la nature, […] ne peut éviter l’influence de la concupiscence de la chair ».
Pascal Ide
[1] Otto Rank, Le traumatisme de la naissance, trad. Samuel Jankélévitch, Paris, Payot, 1983.
[2] Sigmund Freud, Lettre à Ferenzi, 26 mars 1924, Sigmund Freud et Sandor Ferenczi, Correspondance. Tome 3. 1920-1933, p. 155.
[3] Cf. Hermine Von Hug-Hellmuth, Journal psychanalytique d’une petite fille, trad. Clara Malraux, coll. « L’espace analytique », Paris, Denoël, 1998.
[4] Cf. le lien avec le site de l’INSERM sur le site de l’AFTCC : aftcc.org. Sinon : http://www.inserm.fr/servcom/servcom.nsf/(Web+Startup+Page)
[5] Cf. l’intéressant article de Mark Solms, « Psychanalyse et neurosciences », Pour la science, 324 (octobre 2004), p. 76-81.
[6] André Green, Idées directrices pour une psychanalyse contemporaine, Paris, p.u.f., 2002, p. 340. Cf. Raymond Cahn, La fin du divan ?, Paris, Odile Jacob, 2002.
[7] Cf. Laurent Lemoine, « Éthique chrétienne et psychanalyse aujourd’hui : ‘garder le débat vivant’ », Le Supplément. RETL, 233 (mars 2005), p. 85-112. Si l’auteur, dominicain, propose une intéressante relecture de la psychanalyse, notamment à l’aide de Thomas d’Aquin, en revanche, il ne prend nullement en compte les difficultés faites par des disciplines appartenant à d’autres champs épistémologiques.
[8] Le mot est d’Élisabeth Roudinesco, Sigmund Freud…, p. 362.
[9] Dans Le conflit des interprétations, Paul Ricœur fait justice de cette objection qui lui a été opposée.
[10] Karl Popper, La connaissance objective, trad. Catherine Batyns, Bruxelles, Complexes, 1982, p. 48, note 5.
[11] Pie XII, Discours du 14 avril 1953, p. 146.
[12] Sur les mensonges de Freud et d’autres psychanalystes, cf. Catherine Meyer (éd.), Le Livre noir de la psychanalyse. Vivre, penser et aller mieux sans Freud, Paris, Les Arènes, 2005 ; Jacques Bénesteau, Mensonges freudiens. Histoire d’une désinformation séculaire, Bruxelles, Mardaga, 2002.
[13] Cf. Jacques Van Rillaer, Freud & Lacan, des charlatans ? Faits et légendes de la psychanalyse, Bruxelles, Mardaga, 2019.
[14] Peter Fonagy, Kächele R, Krause E, Jones R, Perron R., An open door review of outcome studies in psychoanalysis, London, International Psychoanalytic Association Press, 1999, « Conclusion ».
[15] Sigmund Freud, « L’analyse avec fin et l’analyse sans fin », p. 265.
[16] Le nouvel Observateur, 1610 (14-20 septembre 1995).
[17] Serge Moscovici, La Psychanalyse, son image et son public, coll. « Bibliothèque de psychanalyse », Paris, p.u.f., 21976, p. 143.
[18] Dominique Frischer, Les analysés parlent, coll. « Témoigner », Paris, Stock, 1976, conclusion. Cf. Id., Conférence prononcée le 12 octobre 2006 au colloque La psychothérapie à l’épreuve de ses usagers, disponible sur le site consulté le 18 novembre 2020 : http://www.ethnopsychiatrie.net/frischusagers.htm
[19] Sigmund Freud et Sandor Ferenczi, Correspondance, tome 3. 1920-1933. Les années douloureuses, éd. Eva Brabant et Ernst Falzeder, avec la coll. de Patrizia Giameri-Deutsch, sous la dir. d’André Haynal, trad. du groupe du Coq-Héron, Paris, Calmann-Lévy, 2000.
[20] Le Monde des Livres, vendredi 5 mai 2000, p. xi.
[21] Cf. Sandor Ferenczi, Thalassa.
[22] Pour le détail, je renvoie aux fins développements de Dalbiez.
[23] Sigmund Freud, « L’inconscient », in Métapsychologie, p. 65-121, ici p. 65.
[24] Ibid., p. 81.
[25] Ibid., p. 80.
[26] Hans Urs von Balthasar, La Dramatique divine. I. Prolégomènes (1973), trad. André Monchoux avec la coll. de Robert Givord et Jacques Servais, coll. « Le Sycomore », Paris, Lethielleux, Namur, Culture et Vérité, 1984, p. 426-434.
[27] Ibid., p. 432.
[28] Ibid., p. 426.
[29] Ibid., p. 426.
[30] Ibid., p. 430.
[31] Ibid., p. 432.
[32] Ibid., p. 434.
[33] Bien qu’il aborde cette question ailleurs, nous renvoyons à L’intuition créatrice dans l’art et la poésie, Paris, DDB, 1960. Des disciples ont continué dans la même voie cf. par exemple Louis Gardet et Olivier Lacombe, L’expérience du Soi, Paris, Desclée, 1981. Quant à la présentation critique du freudisme que fait Maritain dans Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle, elle est sans originalité et ne fait que gloser le gros ouvrage de R. Dalbiez.
[34] Hans Urs von Balthasar, Phénoménologie de la vérité, trad. Robert Givord, Paris, Beauchesne, 1952, p. 195-214 ; en particulier p. 197
[35] Sur la critique de la pulsion de mort chez Freud (dont l’intériorisation serait à l’origine de la culture, selon Freud), cf. Revue philosophique de Louvain, 1970, p. 373-384.
[36] Cf. Renate Sachse, « Luzifer-Amor 51 », Essaim, 32 (2014), p. 103-113. Ce nom détestable autant qu’inquiétant est celui d’une revue d’histoire de la psychanalyse, fondée en 1988 par Gerd Kimmerle et Ludger M. Hermanns.
[37] Julia Kristeva, Au commencement était l’amour. Psychanalyse et foi, suivi de À propos de l’athéisme de Sartre, coll. « Le Livre de Poche. Biblio essais » n° 4253, Paris, Hachette, 1997, p. 19.
[38] Ibid., p. 21.
[39] Ibid., p. 35.
[40] Ibid., p. 20.
[41] Cf. Ibid., p. 51-52.
[42] Ibid., p. 75.
[43] Cf. Sigmund Freud, L’avenir d’une illusion, p. 30-31.
[44] Le mot est d’Élisabeth Roudinesco, Sigmund Freud…, p. 279.
[45] Frank J. Sulloway, Freud, biologiste de l’esprit, p. 390.
[46] Évagre le Pontique, Sur les pensées, 31, éd. et trad. Paul Géhin, Antoine et Claire Guillaumont, coll. « Sources chrétiennes » n° 438, Paris, Le Cerf, 1998, p. 263. À noter qu’Evagre argumente à partir de la distinction opérée par Aristote entre les quatre sortes de qualités, la puissance étant l’une d’elle (Catégories, 9 a 14).
[47] Élisabeth Roudinesco s’oppose à la thèse défendue par Balmary (dans L’homme aux statues. Freud et la faute cachée du père, Paris, Grasset, 1979) qui, dit-elle, cherche « à christianiser la destinée de Freud ». Elle récuse la thèse centrale d’une « faute cachée » de Jacob Freud, le père de Sigmund. Elle refuse aussi l’interprétation, comme dénuée de fondement, selon laquelle, Rebekka, la mère, se serait suicidée en sautant d’un train (Sigmund Freud…, p. 22, note 1. Autre critiques, p. 23, note 1). Mais Marie Balmary se présente comme une psychanalyste agnostique et parle d’une « religion universelle […] que combattent tous les penseurs » et qui menace toutes les religions : « c’est celle du dieu obscur qui demande à l’homme le sacrifice de sa pensée, le renoncement à sa conscience ». Inversement, dit-elle « la seule religion qui pourrait m’intéresser serait celle qui donnerait aux humains deux choses que les religions d’habitude leur retirent : la conscience de ce faux dieu et surtout l’autorité pour le mettre dehors » (Le moine et la psychanalyste, Paris, Albin Michel, 2005, p. 49 et 50).
[48] Marie Balmary, Le sacrifice interdit. Freud et la Bible, Paris, Grasset, 1986, p. 282 et 283.
[49] Sigmund Freud, « Pulsions et destin des pulsions », in Métapsychologie, trad. Anne Berman et Marie Bonaparte, Paris, Gallimard, 1952, p. 25-66, ici p. 45. Cf. par exemple « Analyse terminée et analyse interminable », trad. Anne Berman, Revue française de psychanalyse, 1938-1939, 10-11, n° 1, p. 3-38, ici p. 28-29. Retraduit : « L’analyse avec fin et l’analyse sans fin », trad. Janine Altounian, André Bourguignon, Pierre Cotet, Jean Laplanche et François Robert, Résultats, idées, problèmes, tome 2. 1920-1938, Paris, p.u.f., 1985.
[50] Sigmund Freud, « Le moi et le ça », 1921, Essais de psychanalyse, p. 203.
[51] Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation, 1934, trad. Charles Odier, Paris, p.u.f., 1971, p. 55. Trad. différente de celles citées dessus.
[52] Cf. François Requet, Nietzsche et Freud. Le rapport entre cruauté, culpabilité et civilisation, Université de Franche-Compté, section de philosophie, master non publié, 2005-2006.
[53] John Henry Newman, Le secret de la prière, trad. Denis Gorce, Colmar, Alsatia, 1960, p. 69. C’est moi qui souligne.
[54] Jean-Pierre de Caussade, Bossuet, maître d’oraison, Paris, Bloud et Gay, 1931, p. 173, 193. C’est moi qui souligne.
[55] Jean Sulivan, Mais il y a la mer, Paris, Gallimard, 1964, p. 90. C’est moi qui souligne.
[56] René Voillaume, Lettres aux fraternités, Paris, Le Cerf, 1960, p. 169.
[57] Je reprends ici la distinction salutaire introduite par Dalbiez et rappelée dans l’introduction : autant la méthode est riche de compréhension de l’homme et de sa blessure, autant la doctrine, c’est-à-dire la vision de l’homme (qui s’élargit à la culture, la morale, l’art et la religion) est réductrice et idéologique.
[58] « La source profonde de son erreur [à Freud] est […] une certaine impuissance philosophique à concevoir un indéterminé réel. Son imagination magnifiquement plastique le pousse invinciblement à durcir les contours mouvants de la vie en évolution » (Roland Dalbiez, La méthode psychanalytique et la doctrine freudienne, tome 2, p. 205-206).
[59] Michel Labourdette, Théologie morale. La chasteté [Somme de théologie, IIa-IIae, q. 151 à 154], Polycopié non édité, Toulouse, Couvent des dominicains, 1, Impasse Lacordaire, 1959-1960, p. 61.
[60] « On pourrait même aller plus loin dans ce sens et définir la sexualité humaine comme ‘perverse’ en son fond, dans la mesure où elle ne se détache jamais tout à fait de ses origines qui lui faisaient chercher sa satisfaction, non dans son activité spécifique, mais dans le ‘gain de plaisir’ attaché à des fonctions ou activités dépendant d’autres pulsions » (Jean Laplanche et Jean-Baptiste Pontalis, art. « Perversion », Vocabulaire de la psychanalyse, p. 308).
[61] Roland Dalbiez, La méthode psychanalytique et la doctrine freudienne, tome 2, notamment p. 194-199.
[62] Ibid., p. 199.
[63] Confessions, XII, VI, 6 ; cf. aussi XII, XII, 15. Il ne faudrait toutefois pas trop vite rapprocher cet état informe de la puissance aristotélicienne. Aimé Solignac note en effet qu’il est plus proche de la chôra platonicienne : cf. Bibliothèque Augustinienne 14, p. 599-603.
[64] Cf. par exemple, Denis Vasse, Le temps du désir. Essai sur le corps et la parole, Paris, Seuil, 1969. Autre exemple : « Est mystique celui ou celle qui ne peut s’arrêter de marcher et qui, avec la certitude de ce qui lui manque, sait de chaque lieu et de chaque objet que ce n’est pas ça, qu’on ne peut résider ici ni se contenter de cela. Le désir crée un excès. Il excède, passe et perd les lieux. Il fait aller plus loin, ailleurs. Il n’habite nulle part. » (Michel de Certeau, La fable mystique xvie-xviie siècle, coll. « Bibliothèque des histoires », Paris, Gallimard, 1982, p. 411)
[65] Banquet, 200 a-e, trad. Léon Robin, Œuvres complètes, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, Gallimard, 1950, 2 vol., tome 1, p. 731-732.
[66] Saint Augustin, In Ps. 118, 8, 4-5, PL 37, 1522.
[67] Denis Vasse, La chair envisagée, Paris, Seuil, 1988, p. 7.
[68] Les puissances du moi, Paris, Flammarion, 1948, p. 58.
[69] D’ailleurs, quand il cherche à rendre compte en termes métaphysiques de la différence entre l’amour de concupiscence (fondé sur le désir) et l’amour d’amitié, saint Thomas explique avec une rare profondeur que, dans la premier, la relation est celle d’une puissance à un acte (concrètement, l’ami se porte vers l’autre pour combler manque, une puissance) et dans le second, d’un acte à un acte (concrètement, l’ami se porte vers son ami non par manque mais pour se donner à lui).
[70] Cf. Aristote, Physiques, L. I, ch. 6-9.
[71] Je renvoie au lumineux commentaire de Jacques de Monléon : « Des qualifications, des aspects différents peuvent relever de la constitution foncière, de l’essence d’un même sujet. Ainsi l’homme est un bipède raisonnant, politique, capable de rire. Autant d’attributs qui lui appartiennent par soi et qui ne peuvent pas lui être ôtés sans le détruire. Et puis il y a d’autres qualifications qui ne tiennent pas à l’essence, par exemple, pour l’homme d’être assis, chauve ou béat. Autant d’attributions qui peuvent apparaître sans que l’on cesse pour cela d’être un homme. De tels attributs appartiennent au sujet par accident. Eh bien ! c’est une très sérieuse question que celle-ci : la privation requise par le devenir s’y trouve-t-elle par soi ou par accident ? La réponse n’est pas simple. Nous savons que la privation intervient par soi, par définition dans le devenir : il lui est essentiel que le sujet qui devient soit privé de ce qu’il deviendra. Allons-nous en conclure comme Hegel que la privation appartienne par soi au sujet lui-même ? C’est impossible, puisqu’il ne cesse de s’en défaire au fur et à mesure qu’il revêt la forme où il tend. Jusqu’à nouvel ordre, s’enrichir c’est sortir de misère. Écrivons donc très lisiblement ceci : la privation appartient au sujet par accident. Et aussi regardons bien : une rose, l’Aurige de Delphes, une belle voûte, un beau vers, l’avant d’un navire, nous proposent une matière si pleinement accomplie dans sa forme qu’on dirait la privation totalement outrepassée, définitivement oubliée du sujet qui la subissait. Voilà peut-être la négation de la négation » (« Notes autour du 1er livre des Physiques », in Revue Thomiste, 73 [1973], p. 415-428, ici p. 418-419).
[72] Durant six ans, Lacan a suivi le séminaire de Kojève à l’École Pratique des Hautes Études. « Avide de nourriture philosophique, il [Lacan] dérobe à ce maître séducteur [Kojève], non seulement ses concepts, mais un style d’enseignement… Alors qu’il ne cite pas le nom du philosophe dans ses Écrits, Lacan reconnaît à plusieurs reprises qu’il ‘s’est formé en Hegel’ sur les bancs du séminaire de l’EPHE. » (Élisabeth Roudinesco, La bataille de cent ans. Histoire de la psychanalyse en France. 2. 1925-1985, Paris, Seuil, 1986, p. 149 à 156). Lacan parle de Kojève comme de son maître dans le premier numéro de la revue Scilicet, Paris, Seuil, 1986, p. 33.
[73] Tel est le reproche que, dans un ouvrage qui a fait date, Deleuze adresse à Freud, opposant le désir comme manque, symptomatique de la psychanalyse, au désir comme plein, caractéristique de la vie : « D’une certaine manière, la logique du désir rate son objet […] dès que nous mettons le désir du côté de l’acquisition […] qui le détermine comme manque, manque d’objet, manque de l’objet réel ». En revanche, et telle est la position du philosophe français, « le désir est producteur, et n’en peut l’être qu’en réalité et de réalité. Le réel découle du désir […]. Le désir ne manque de rien, il ne manque pas son objet » (Gilles Deleuze et Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie. L’anti-Œdipe, coll. « Critique », Paris, Minuit, 1973, p. 32 s ; tente de sauver Lacan, note 23, p. 34). Pour autant les machines désirantes que Deleuze substitue à la scène psychanalytique ne sont pas plus satisfaisantes (cf. la critique conjointe dans l’ouvrage important de Pierre Boutang, L’apocalypse du désir. Pour une restauration authentique du libre-arbitre chrétien, Paris, Grasset, 1979, réédité coll. « La nuit surveillée », Paris, Le Cerf, 2009).
[74] Alain Didier-Weill, Les trois temps de la loi, Paris, Seuil, 1995, p. 40.
[75] Logiques du délire. Raison, affects, folie, Paris, Aubier, 2000, p. 57.
[76] Sujet et vérité dans le monde social-historique. Séminaires 1986-1987. La création humaine I, coll. « La couleur des idées », Paris, Seuil, 2002, p. 362.
[77] Sigmund Freud, Le délire et les rêves dans la ‘Gravida’ de W. Jensen, trad. J. Bellemin-Noël, coll. « Connaissance de l’inconscient », Paris, Gallimard, 1986, p. 228-229.
[78] Jacques Lacan, Le Séminaire. Livre XI. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1973, p. 128.
[79] Cf. André Green, Narcissisme de vie, narcissisme de mort, Paris, Minuit, 1983.
[80] Gilles Lipowetzky, L’ère du vide. Essais sur l’individualisme contemporain, Paris, Gallimard, 1983, p. 36-37.
[81] Cf. par exemple Olivier Grignon, Le corps des larmes, Paris, Calmann-Lévy, 2002, p. 65 s.
[82] Sur l’effacement du père en psychanalyse, cf. Jacques Arènes, « Le coût psychique du non-mariage », Coll., Quel avenir pour la famille ? Le coût du non-mariage, Paris, Bayard, 2006, p. 199-230, ici p. 211s. Et les citations de Dolto, ainsi que l’historique, l’influence de Winnicot.
[83] Ferdinand Ulrich, « L’humble autorité du Père », Communio (F). La création, 1 (1976) n° 3, p. 15-20, ici p. 19.
[84] « Je ne suis pas croyante ». (p. 41). Cf. le développement biographique, p. 41-46. Elle a le courage d’affirmer : « Mon refus adolescent de la foi tenait probablement plus du refoulement ou d’un autoérotisme déculpabilisé que d’un détachement analytique ». (p. 45)
[85] Julia Kristeva, Au commencement était l’amour. Psychanalyse et foi, suivi de À propos de l’athéisme de Sartre, coll. « Le Livre de Poche. Biblio essais » n° 4253, Paris, Hachette, 1997, p. 51. Cf. p. 51s.
[86] Ibid., p. 62.
[87] Ibid., p. 62-67.
[88] Ibid., p. 80.
[89] Cf. Bernadette Lemoine, Maman, ne me quitte pas ! Accompagner l’enfant dans les séparations de la vie. Entretiens avec Anne-Marie d’Argentré, Versailles, Saint-Paul, 2000.
[90] Sigmund Freud, L’avenir d’une illusion, 1927, trad. Marie Bonaparte, Paris, p.u.f., 1971, p. 45. L’édition citée diffère de celle citée ci-dessus.
[91] Didier Anzieu, L’auto-analyse de Freud…, p. 742.
[92] Sigmund Freud, « Sur le plus général des rabaissements de la vie amoureuse », 1912, La vie sexuelle, p. 65.
[93] Cf. Sigmund Freud, « La féminité », Nouvelle suite des leçons d’introduction à la psychanalyse, 1933, trad. Rose-Marie Zeitlin, Paris, Gallimard, 1984, p. 153.
[94] « Psychothérapie et vie spirituelle », Nova et Vetera, 1986, p. 146-147.
[95] Ibid., p. 147.
[96] Sur la théorie matérialiste de Freud, cf. Marc Jeannerod, Le cerveau-machine, Paris, Fayard, 1983, p. 142 s.
[97] Pourtant, Freud parle de « conflit de volontés » dans L’interprétation des rêves, p. 251, expliquant « l’état d’une volonté à laquelle une autre volonté résiste ».
[98] Sigmund Freud, « La féminité », p. 179.
[99] Arthur Kœstler, Hiéroglyphes, trad. Denise van Moppès, coll. « Pluriel », Paris, Calmann-Lévy, 1955, p. 493.
[100] Ernest Jones, La vie et l’œuvre de Sigmund Freud, tome 3, p. 269.
[101] Cette phrase de Reik est citée par Didier Anzieu, L’auto-analyse de Freud…, p. 728
[102] Paul Ricœur, De l’interprétation, p. 494.
[103] Cf. la célèbre triple humiliation dont parle Sigmund Freud, « Une difficulté de la psychanalyse », L’inquiétante étrangeté et autres essais, trad. Bertrand Féron, coll. « Folio-essais », Paris, Gallimard, 1985, p. 173-188, ici p. 181 s. Cf. Paul Ricœur, « La psychanalyse et le mouvement de la culture contemporaine » 1965, Le conflit des interprétations. Essais d’herméneutique I, coll. « L’ordre philosophique », Paris, Seuil, 1969, p. 122-159.
[104] Sigmund Freud, Une difficulté de la psychanalyse, p. 146 (Essais de psychanalyse appliquée ?)
[105] Essais de psychanalyse, p. 193.
[106] Antoine Vergote, Interprétation du langage religieux, p. 118 s.
[107] Sigmund Freud, Préface de Totem et Tabou, Paris, PBP, 1975, p. 6.
[108] Sigmund Freud, Sigmund Freud présenté par lui-même, p. 100.
[109] Cf. Thomas Mann, Freud dans l’histoire de la pensée moderne, 1929, éd. bilingue, trad. Louise Servicen, Paris, Aubier, Flammarion, 1970, p. 107-149.
[110] Cf. Sigmund Freud, Lettre à Lou Andreas-Salomé, 28 juillet 1929, Correspondance, p. 225.
[111] David Bakan, Freud et la tradition mystique juive, Paris, Payot, 1964, p. 235.
[112] Cf. Wladimir Granoff et Jean-Michel Rey, L’occulte, objet de la pensée freudienne, Paris, p.u.f., 1983.
[113] Sigmund Freud, Lettre à Hereward Carrington, Correspondance, p. 364.
[114] Sigmund Freud, « La psychanalyse et la télépathie », 1921, OCF.P, tome 16, p. 99-119.
[115] Sigmund Freud, « Rêve et télépathie », Imago, 1922, OCF.P, tome 16, p. 119-145.
[116] Sigmund Freud, « Rêve et occultisme », Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse : OCF.P, tome 19, p. 83-269.
[117] Ernest Jones, La vie et l’œuvre de Sigmund Freud, tome 3, p. 447.
[118] Jacques Derrida, « Télépathie », 1981, Id., Psychè. Invention de l’autre, Paris, Galilée, 1987, p. 237-271.
[119] Marie Balmary, Le moine et la psychanalyste, Paris, Albin Michel, 2005, p. 186.
[120] Nathalie Sarthou-Lajus, L’éthique de la dette, coll. « Questions », Paris, p.u.f., 1997, p. 176.
[121] Les frères Karamazov, trad. Henri Mongault, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, Gallimard, 1952, p. 18.
[122] Sigmund Freud, Lettre du 9 février 1909, Sigmund Freud et Oskar Pfister, Correspondance, 1909-1939, éd. Ernst L. Freud et Heinrich Meng, trad. Lily Jumel, Paris, Gallimard, 1966, p. 47. Cette lettre est mieux traduite dans Ernest Jones, La vie et l’œuvre de Sigmund Freud. Tome 2. Les années de maturité. 1901-1919, trad. Anne Berman, Paris, p.u.f., 1958, p. 464.
[123] Lettre du 24 novembre 1927, dans Ibid., p. 169.
[124] Lettre du 20 février 1928, dans Ibid., p. 178.
[125] Sigmund Freud, Lettre du 9 février 1909, Sigmund Freud et Oskar Pfister, Correspondance, 1909-1939, p. 47.
[126] Maurice Bellet, Entretien dans Panorama, juin 2003, p. 26-32, ici p. 28.
[127] Étienne Borne, Le problème du mal, Paris, p.u.f., 1958, p. 87-108.
[128] Cf. S. Thomas d’Aquin, Somme de théologie, Ia, q. 4, a. 3 : « Utrum aliqua creatura possit esse similis Deo ? »
[129] L’homme et son corps, p. 137.
[130] Paul Ricœur, De l’interprétation, p. 226.
[131] Michel Foucault, Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Plon, 1964, p. 599.
[132] Pie XII, Discours aux participants au Congrès international de psychothérapie et de psychologie clinique, 13 avril 1953. Texte accessible sur le site du Saint-Siège (lecture conseillée) : http://w2.vatican.va/content/pius-xii/fr/speeches/1953/documents/hf_p-xii_spe_19530413_psicoterapia.html
[133] Par exemple, en 1900, Freud vendit de nombreux livres anciens de sa collection afin que Minna soignât une infection bronchique (cf. Chrisfried Tögel, « Freud Diarium », consultable en ligne).
[134] C’est aussi ce qu’affirme Julius Tandler du vieux Freud. Le témoignage est d’autant plus passionnant que, au plan doctrinal, il est l’antithèse de Freud (adepte de l’hygiénisme médical et de l’euthanasie) : « Grande ténacité intérieure, très forte vitalité qui donne à ce vieil homme la pénétation de la jeunesse » (Karl Sablik, « Freud et Julius Tandler : une mystérieuse relation », Revue internationale d’histoire de la psychanalyse, 3 [1990], p. 96).
[135] Stefan Zweig, La guérison par l’esprit, p. 52.
[136] Citée par Robert Byck, Sigmund Freud.
[137] Sigmund Freud, Lettre à Jung, 2 février 1910, p. 22.
[138] Sigmund Freud, Sigmund Freud présenté par lui-même, p. 16.
[139] Cf. Robert Byck, Sigmund Freud. De la cocaïne, Bruxelles, Complexe, 1976.
[140] Cf. l’écrit sur un poème de Gœthe : Sigmund Freud, « Grande est la Diane des Éphésiens », 1911, OCF.P, tome xi, p. 51-53.
[141] Cette typologie sera étudiée dans le chapitre en partie consacré à la caractérologie.
[142] Sigmund Freud, Lettre du 17 juillet 1899, Correspondance, p. 458.
[143] Sigmund Freud, Sur l’histoire du mouvement psychanalytique, 1914, trad. Cornélius Heim, Paris, Gallimard, 1991, p. 39. C’est moi qui souligne.
[144] Sigmund Freud, Lettre du 25 décembre 1920, Sigmund Freud et Sandor Ferenczi, Correspondance. Tome 3. 1920-1933, p. 44.
[145] Perry Meisel et Walter M. Kendrick, Bloomsbury-Freud. James et Alix Strachey. Correspondance, 1924-1925, 1985, trad. Catherine Wieder et Catherine Palmer, Paris, p.u.f., 1990, p. 43.
[146] Cahier XIV, 1940-1941, éd. Peter Trawny, Martin Heidegger, Gesamtausgabe, Frankfurt-am-Main, Klostermann, tome 96, 2014, p. 218.
[147] Cf. Victor Kemperer, Lingua Tertii Imperii. La langue du troisième Reich, 1975, trad. Élisabeth Guillot, Paris, Albin Michel, 1996.
[148] André Bolzinger, Portrait de Sigmund Freud. Trésors d’une correspondance, Paris, Campagne Première, 2012, p. 132.
[149] Cf. Peter Gay, Un Juif sans Dieu, 1987, trad. Kim Tran, Paris, p.u.f., 1989.
[150] Sigmund Freud, Lettre à Ernst Freud, 17 janvier 1938, Lettre à ses enfants, éd. Michael Schröter et al., trad. Françoise Cambon, Paris, Aubier, 2012, p. 389.
[151] Cf. Élisabeth Roudinesco, Sigmund Freud…, p. 271.
[152] Lettre du 26 février 1930. Le manuscrit est conservé à l’université hébraïque de Jérusalem. Publiée et commentée par Élisabeth Roudinesco, « À propos d’une lettre inédite de Freud sur le sionisme et la question des lieux saints », Cliniques méditerranéennes, 70 (2004) n° 2, p. 19-31.
[153] Cf. la description assez complète dans Max Schur, La mort dans la vie de Freud.
[154] Peter Gay, « Notice biographique », La maison de Freud, Berggasse 19, Vienne, photographies d’Edmund Engelman, 1976, trad. Edgar Roskis, Paris, Seuil, 1979, p. 124.
[155] Élisabeth Roudinesco, Sigmund Freud…, p. 225. C’est moi qui souligne.
[156] Entretien inédit, archives Marie Bonaparte.
[157] Cf. Patrick Lacoste, L’étrange cas du professeur M., Paris, Gallimard, 1990, p. 93-94.
[158] Mark Edmundson, La mort de Sigmund Freud, p. 116.
[159] Cf. Richard H. Armstrong, A Compulsion for Antiquity, Ithaca, Cornell University Press, 2005.
[160] Sigmund Freud, Lettre du 23 avril 1926, Sigmund Freud et Ernest Jones, Correspondance complète, 1908-1939, éd. R. Andrew Paskauskas, trad. Pierre-Emmanuel Dauzat et al., Paris, p.u.f., 1998, p. 641.
[161] Didier Anzieu, L’auto-analyse de Freud et la découverte de la psychanalyse, p. 747.
[162] Ibid., p. 748.
[163] Ibid., p. 749 et 750
[164] Ibid., p. 751.
[165] Cf. Abraham H. Maslow, « Was Adler a Disciple of Freud ? A Note », Journal of Individual Psychology, 18 (1962), p. 125.
[166] Sigmund Freud, Lettre à Arnold Zweig, 22 juin 1937, citée par Paul E. Stepanski, Adler dans l’ombre de Freud, 1983, trad. Mireille Chanteur et Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, p.u.f., 1992, p. 262.
[167] Cf. Sigmund Freud et William Bullitt, Le Président Thomas Woodrow Wilson, 1967, trad. Marie Tadié, Paris, Payot, 1990.
[168] Élisabeth Roudinesco, Sigmund Freud…, p. 154.
[169] Cf. Richard Sterba, Réminiscences d’un psychanalyste viennois, 1982, trad. Brigitte Bost, Toulouse, Privat, 1986, p. 66-67.
[170] Sigmund Freud, Lettre du 26 mars 1924, Sigmund Freud et Sandor Ferenczi, Correspondance. Tome 3. 1920-1933, p. 285.
[171] Élisabeth Roudinesco, Sigmund Freud…, p. 265.
[172] La liste n’est pas close. Pour les références, cf. Élisabeth Roudinesco, Sigmund Freud…, note 1, p. 323-324.
[173] Cf. Henri Roudier, Freud et l’argent, inédit. Cf. Élisabeth Roudinesco, Sigmund Freud…, note 1, p. 327.
[174] Le calcul a été effectué par Thomas Piketty à la demande d’Élisabeth Roudinesco, Sigmund Freud…, note 1, p. 328-329.
[175] Sigmund Freud, « Sur le plus général des rabaissements de la vie amoureuse », p. 59.
[176] Élisabeth Roudinesco, Sigmund Freud…, p. 377.
[177] Cf., parmi les nombreuses études, Angela Livingstone, Lou Andreas-Salomé, sa vie et ses écrits. Sa vie de confidente de Freud, de Nietzsche et de Rilke et ses écrits sur la psychanalyse, la religion et la sexualité, 1984, trad. Pierre-Emmanuel Dauzat, coll. « Perspectives critiques », Paris, p.u.f., 1990 ; Isabelle Mons, Lou Andreas-Salomé en toute liberté, Paris, Perrin, 2012.
[178] Heinz Frederick Peters, Ma sœur, mon épouse, 1962, trad. Léo Lack, coll. « Tel », Paris, Gallimard, 1967, p. 257.
[179] Élisabeth Roudinesco, Sigmund Freud…, p. 382.
[180] Ibid., p. 383.
[181] Lou Andreas-Salomé, Lettre ouverte à Freud, 1931, trad. Dominique Miermont et al., coll. « Bibliothèque de l’inconscient », Paris, Gallimard, 1977 ; coll. « Points », Paris, Seuil, 1994.
[182] Cf. Marie Bonaparte, Sexualité de la femme, Paris, p.u.f., 1957.
[183] Cf. Detlef Berthelsen, La famille Freud au jour le jour. Souvenirs de Paula Fichtl, 1987, trad. Lucien-Marie Robin, Paris, p.u.f., 1991.
[184] Sigmund Freud et Lou Andreas-Salomé, Correspondance, 1912-1936, p. 98.
[185] Cf. Sandor Ferenczi, Journal clinique, janvier-octobre 1932, trad. de l’équipe du Coq Héron, coll. « Science de l’homme », Paris, Payot, 1985.
[186] Élisabeth Roudinesco, Sigmund Freud…, p. 296.
[187] Sigmund Freud et Ludwig Binswanger, Correspondance, 1908-1938, éd. Gerhard Fichtner, trad. Ruth Menahem et Marianne Strauss, Paris, Calmann-Lévy, 1995, p. 278-279.
[188] Sigmund Freud, Lettre à Arnold Zweig, 10 février 1937, p. 909.
[189] Ce qui est vrai au plan familial l’est aussi au plan politique.
[190] Gilbert Durand, L’imagination symbolique, Paris, DDB, 1949, p. 43-45.
[191] Cf. Jacques Lacan, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Le séminaire, Livre XI, Paris, Seuil, 1973.
[192] Jean-Paul II, Audience générale du mercredi 29 octobre 1980, n° 46, La théologie du corps, trad. Yves Semen, Paris, Le Cerf, 2014, p. 295-299 : Le corps, le cœur et l’esprit. Pour une spiritualité du corps, Paris, Le Cerf, 1984, p. 128-133. Souligné dans le texte.
[193] Contrairement à ce qui est dit dans le texte, cet ouvrage est en fait l’avant-dernier rédigé par Freud en 1938 et non pas le dernier (qui est L’homme Moïse et la religion monothéiste) écrit en 1939.
[194] 1 Jn 2, 16.