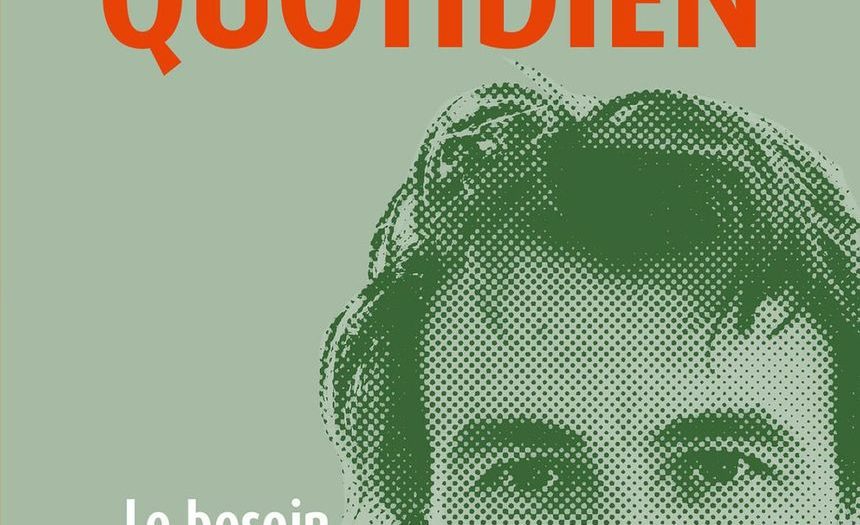Apprendre à vivre la plus grande des pertes, celle de la vie de l’être aimé, débute par l’apprentissage des multiples pertes du quotidien, à commencer par la frustration de lâcher sa série préférée ou de quitter des amis avec qui l’on se trouve si bien, parce qu’il est déjà tard et que demain, il s’agit d’être en forme [1]. Intermédiaire entre ces deux extrêmes de la perte (la plus douloureuse et la plus anodine), il y a celle d’une relation d’importance et l’entraînement à un juste « adieu » ou « au revoir » qui conjure les deux attitudes vicieuses, elles aussi extrêmes : le défaut d’adieu qu’est la fuite et le défaut qu’est le refus du deuil.
Avant de devenir maraîcher, Mathieu Yon fut pendant un temps éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse dans un centre de détention. Il fit l’expérience de l’extrême violence de ces jeunes adolescents qui étaient là pour vol, braquage, trafic d’armes ou de stupéfiants. Il fit aussi l’expérience du retentissement de cette violence sur ses collègues qui se mettaient en arrêt maladie : engagés de 7 heures à 22 heures, ils ne recevaient en retour qu’insultes et agressions physiques. Il découvrit donc une boucle de rétroaction terriblement négative : les jeunes « avaient développé une intelligence viscérale leur permettant de cerner une personne et une situation en quelques secondes seulement » et testaient donc immédiatement l’éducateur. Il faudra revenir sur cette analyse inachevée ou suspendue.
Mais il découvrit également la part de responsabilité des membres de l’équipe dans leur incapacité à dire qu’ils démissionnaient : ils partaient du jour au lendemain « sans prévenir [les jeunes délinquants] ni prendre le risque de leur dire au revoir ». Pourquoi ? « Les éducateurs avaient probablement peur que l’anonce de leur départ les pousse à décharger leur violence ». En tout cas, cet abandon actif (la fuite) ne pouvait que conduire ces jeunes, le plus souvent sans enracinement familial, à répéter leur abandon passif.
Mathieu décida de ne pas répéter ce schéma. Il annonça donc aux jeunes qu’il allait partir.
« Cette prise de risque toute simple, cette marque élémentaire de respect, eut des effets que je n’imaginais pas. Mon dernier soir avec eux fut un immense cadeau qui me fit oublier toutes les injures, toutes les violences que j’avais encaissées pendant des mois. Soudain, ces jeunes redevenaient de simples adolescents de leur âge. Le dernier soir, nous mangeâmes ensemble et pour la première fois, aucune altercation, aucune insulte n’eurent lieu. Nous étions tout simplement à table, comme si la violence et les injustices du monde étaient restées dehors, devant la porte du foyer, sans parvenir à rentrer, protégés par une marque invisible. Après le repas, nous allâmes dans le jardin du centre. Je m’assis sur une chaise et ils commencèrent à changer et à me parler de leur quartier, de leur vie, de leurs douleurs. Au moment de partir et de se dire au revoir, ils s’approchèrent de moi, ils m’attrapèrent et le soulevèrent joyeusement. Nous nous dîmes au revoir et en remontant l’allée jusqu’à ma voiture je fus saisi d’une émotion intense. J’avais les larmes aux yeux. Nous avions la preuve, eux et moi, que la violence et l’injustice n’étaient pas obligées d’avoir le dernier mot. Nous avions la preuve qu’en prenant le risque de l’autre, d’autres chemins sont possibles [2] ».
Comme toujours, nous ferons appel à cette règle d’herméneutique de demeurer au ras même des mots employés par Mathieu dans son récit, d’autant que sa sobriété rime avec vérité.
En leur disant « au revoir » et même « adieu », l’éducateur a posé un acte de courage. En effet, la fortitude est la vertu de celui qui affronte le risque et, plus encore, la peur née du risque. Or, contrairement aux autres accompagnateurs, Mathieu a « pris le risque de les prévenir », donc a surmonté (ou utilisé ?) cette peur et s’est refusé à fuir. Il a aussi posé un acte d’espérance sur ses jeunes. Ceux-ci se croient, en effet, voués de manière fatale, à « détruire » l’autre et le monde, ou à « se détruire » eux-mêmes. Or, en leur donnant l’occasion de fêter son départ, de faire mémoire des bons moments vécus dans leur quartier et même des moments douloureux, il leur a permis de voir qu’ils étaient capables de vivre sans violence, certes entre eux, mais aussi avec ces autres imposés que sont les éducateurs et le monde pour eux hostile d’où ces derniers proviennent.
Mais Mathieu a surtout posé un acte d’amour. D’ailleurs, cette force et cette espérance ne sont-elles pas une émanation de celui-ci : « La charité espère tout » ; « La charité supporte tout », la persévérance étant l’acte principal du courage (1 Co 13,7) ?
D’abord, Mathieu l’affirme expressément en doublant la « prise de risque toute simple », d’une « marque élémentaire de respect ». Or, la politesse et le respect sont des expressions de la charité. Et que l’adjectif ne minimise pas cet acte : comme ce qui est « simple », ce qui est « élémentaire », n’est pas moindre, mais préalable, c’est-à-dire fondationnel (ce qui, avec le perfectif, relève de l’ordre ontologique).
Ensuite, approfondissons les conséquences de l’absence de mise en mots de la démission, et cette « intelligence viscérale » de l’autre que Mathieu a finement diagnostiquée. La blessure la plus profonde de ces jeunes est l’absence de juste amour – juste signifiant que l’amour n’est pleinement humanisant que lorsqu’il est ajusté, c’est-à-dire chaste. Or, avec le besoin d’aimer (se donner), celui d’être aimé (se recevoir d’une personne aimante) est le plus vital et le plus nécessaire. Ainsi, la carence d’amour conduit, d’un côté, à une carence d’être, c’est-à-dire à une auto-destruction, et de l’autre, à une colère de n’avoir pas reçu le dû, c’est-à-dire à une allo-destruction (Peu importe ici le détail de métabolisation de la violence par le biais des légitimités destructrices étudiées par le psychiatre américain Iván Boszormenyi-Nagy). Or, nous voyons que les adolescents s’exceptent de leur violence usuelle. C’est donc qu’ils ont ressenti l’adieu de Mathieu comme une marque d’affection.
À ce sujet, deux observations du narrateur méritent d’être soulignées. Il note qu’ils « redevenaient de simples adolescents de leur âge ». Or, re-devenir, c’est retourner à la vérité de ce que l’on est, cesser de jouer un personnage, l’ado révolté, pour connecter avec la personne. Les jeunes révèlent ainsi que, par-delà les mécanismes de défense qui les ont blindés, ils demeurent des cœurs vulnérables assoiffés d’amour. Par ailleurs, sous la plume de Mathieu jaillit la métaphore d’une « marque invisible » séparant le dehors violent qu’est le monde du dedans qu’est le foyer, au moins la durée d’un soir, et protégeant celui-ci de celui-là. Dans les mythologies et les religions, le jardin n’est-il pas le lieu symbolique de la réconciliation homme-nature ? Or, surtout dans un groupe de jeunes qui, pour survivre, a appris à ressentir seul et ensemble personnes et événements de manière tripale, l’extérieur révèle l’intérieur. Donc, la différence extérieure foyer-monde exprime leur constitution intérieure surmoi-moi ou, mieux, persona-personne, ego (défendue)-je (désarmé). Ayant le droit de se dire sans crainte, les adolescents révèlent combien leur avenir est à la tendresse [3].
Il y a plus. Les jeunes offrent à Mathieu le cadeau de leur raconter leur existence, avec ses ombres et ses lumières ; puis, ils le fêtent en s’approchant de moi, l’attrapant et le soulevant joyeusement, trois actes progressifs, qui expriment combien il devient le centre. Or, la gratitude est la vertu de celui qui, passant du don au donateur, répond à son amour. Par conséquent, une nouvelle fois, les jeunes affirment à Mathieu, dans le langage non-verbal qui est le leur, combien ils ont été touchés par l’amour qu’il leur a manifesté dans cet « au revoir ». Sans doute, cette reconnaissance s’étend-elle à tout ce qu’il a donné pendant tous ces mois, voire s’accompagne-t-elle d’une sorte de réparation implicite pour les injustices qu’ils ont conscience d’avoir commis. Mais ces actes spontanés, provenant de cette « intelligence viscérale » repérée par Mathieu, avec tout ce qu’elle comporte d’irréflexivité, n’auraient pas jailli si le dernier acte n’était pas homogène aux précédents, donc n’était pas, lui aussi, une donation.
Enfin, l’« intense émotion » ressentie par Mathieu (ou qu’il soit secondaire, ou qu’il l’ait pudiquement retenue pour ne pas embarrasser la spontanéité des jeunes) vient, certes, de l’espérance qui germe en lui. Or, la violence n’aura pas « le dernier mot », car elle n’a pas été le premier mot : si Mathieu a pu encaisser, comme il dit, toutes les violences, multiples et répétées pendant une si longue période, c’est qu’il a exercé la patience, au sens le plus étymologique du terme, et la longanimité est une propriété de l’amour. Ne peut-on d’ailleurs ajouter que cette émotion provient aussi de la gratitude, dont la psychologie nous apprend qu’elle est la source des sentiments les plus gratifiants ? Mathieu parle en effet au début du paragraphe d’« un immense cadeau » que les adolescents du foyer lui ont fait. Mais sa reconnaissance entre aussi en résonance avec celle des jeunes, de sorte qu’elle entre dans la boucle du don et atteste le don initial de l’éducateur. L’amour qu’ils lui donnent fait donc écho à l’amour que, lui, le premier, Mathieu leur a donné et dont cette mise en absence est le révélateur. Il est comme un miroir (non pas répétitif, mais créatif) qu’ils tendent à leur éducateur.
Mathieu a donc fait de son « au revoir » un acte d’amour. Symétriquement au « bonjour » qui signifie « bonne journée », c’est-à-dire le souhait d’un bien, c’est-à-dire une donation, et, avec elle, une mise en présence du donateur, l’« au revoir » est une parole et un acte d’amour : c’est une manière d’exprimer à l’autre, donc de lui donner à connaître, sa mise en absence – tout en atténuant cette perte, de la promesse ou du moins de l’espoir d’une nouvelle venue.
Pascal Ide
[1] Sur la continuité entre l’« adieu » définitif de la mort et l’« au revoir » de la vie quotidienne, cf. le titre de l’ouvrage testament de David Servan-Schreiber, écrit en coll. avec Ursula Gauthier, On peut se dire au revoir plusieurs fois, Paris, Robert Laffont, 2011.
[2] Mathieu Yon, « Chercher sa voie », Notre lien quotidien. Le besoin d’une spiritualité de la terre, coll. « Vie de la terre », Paris, Nouvelle Cité, 2023, p. 54-55.
[3] Allusion est faite à l’ouvrage à succès du prêtre éducateur spécialisé auprès de jeunes en difficultés à Royat et Auxerre Stan Rougier, L’avenir est à la tendresse. Ces jeunes qui nous provoquent à l’espérance, coll. « Transmettre l’espérance », Mulhouse, Salvator, 1978, 14e éd. augmentée, 2005.