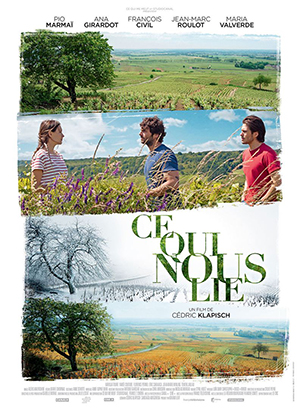
(Français) Ce qui nous lie
Year:
14 juin 2017
Duration:
1 hours 54 minutes
Director:
Cédric Klapisch
Actors:
Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil
Official sites:
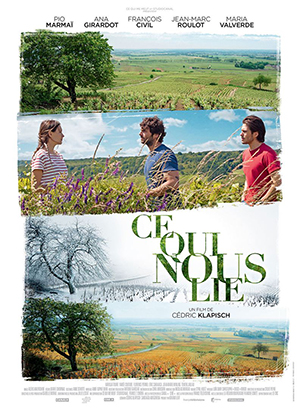
Sorry, this entry is only available in French.
Pascal Ide is proudly powered by WordPress