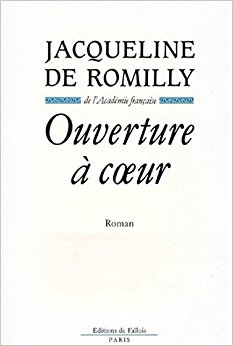Jacqueline de Romilly, Ouverture à cœur, Paris, Éd de Fallois, 1991.
Carl Milstein, juif d’origine autrichienne, est un jeune homme sans attaches et sans détour, à l’histoire douloureuse et secrète. Il n’en faut pas plus pour que Thérèse, 24 ans, s’enamoure de lui dès leur première rencontre. Lise, la mère de Thérèse et narratrice, s’attache aussi et aussitôt à ce futur gendre. Mais en quoi consiste cet attachement passionné et pourtant sans passion ?
Au début, l’on s’attend à une (malheureusement) banale histoire d’adultère déguisée en passion entre une mère et son gendre – avec la discrète retenue de cette grande dame, helléniste et deuxième femme à être élue à l’Académie française, qu’est Jacqueline de Romilly qui signe ici son unique roman. Puis, une fois (et très vite) soulagé d’avoir échappé à une version moderne et moins suicidaire de Phèdre – sur fond d’histoire européenne traumatique –, le lecteur s’attend à une tout aussi courante histoire de gendre narcissique qui serait un séducteur-manipulateur, et la pénible décomposition d’une famille qui s’aime, qui serait la chronique d’une mort annoncée, spirituelle, voire physique, celle des différents protagonistes. Cette intrigue sordide fait aujourd’hui le fond de trop de narrations qui ressemblent à des règlements de compte. Heureusement, si le gendre est blessé, il est pas ou peu blessant. Enfin, nous croyons découvrir une beaucoup moins banale mise en scène des relations blessées mère-fille, voire à leur progressif ajustement. Mais là encore, l’attente est déjouée.
Nous découvrons alors un ouvrage extrêmement original, non pas que son sujet le soit ; au contraire, celui-ci est on ne peut plus banal, car il aborde l’enjeu de toute vie et de toute une vie, de ce qui, lorsque nous nous orientons vers l’avenir, seul lui donne un sens plénier, et de ce dont, quand nous faisons mémoire, nous nous souvenons avec le plus de joie, de gratitude et d’élan. Toutefois et curieusement, s’il abonde dans les autobiographies, les témoignages, les récits de vie, ce thème si existentiel déserte presque tous les récits de fiction ; tout du moins, sa naissance et son déploiement ne sont presque jamais pris comme intrigue principale d’un roman, surtout dans le cadre de la relation familiale et conjugale. Je veux parler du don de soi, ou plutôt – car le titre parle d’un changement, à savoir d’une ouverture à et du cœur, et le paragraphe d’ouverture de même : « un jour j’ai connu Carl […]. Mon existence […] en a été changée […]. Des pans entiers de la réalité ne se sont éclairés qu’à ce moment-là » (p. 7) – de la conversion de l’égoïsme en altruisme – « Cet impossible gendre […] avait été pour moi le sourcier de l’amour d’autrui » (p. 249) –, de l’accouchement par lequel l’ego captatif se révèle moi oblatif tourné vers le toi – « J’étais sortie de mon œuf, sortie de mes limites étouffantes, qui étaient celles de mon égoïsme » (p. 289). Tel est le chemin salvateur que parcourt Lise, la mère qui est aussi la narratrice. En voici le passage (aux deux sens du terme) décisif (là encore au double sens du verbe) :
« Qu’il existe des forces inconscientes, qui s’exercent en nous, Dieu sait que cela est connu, dit, redit, et ressassé. Mais on ne le dit en général qu’à propos des forces égoïstes : on invoque le pouvoir du sexe, ou de l’ambition, de la jalousie, on invoque l’ego (comme disent si volontiers nos jeunes qui ne font plus de latin) ; mais on oublie qu’il y a d’autres forces, aussi bien cachées, et aussi puissantes, qui s’exercent en sens inverse. Elles jaillissent d’un calcul secret qui tend à tout donner. Elles aspirent à des sacrifices, à des générosités. Elles aspirent surtout à l’oubli de soi. Pourquoi donc n’en parle-t-on pas ? Parce qu’elles ne provoquent pas de maux et de désordres ? Et pourtant j’en ai fait l’expérience : elles peuvent tout conduire, tout renverser, tout modifier, comme une passion dont on n’aurait pas deviné l’existence » (p. 268).
Dans cette métamorphose de la chenille dévoreuse en papillon généreux, l’ouvrage nous parle surtout de la chrysalide. J’en retiendrai trois leçons.
D’abord, cette trans-formation (trans-figuration) travaille en nous sans nous, c’est-à-dire est une inclination innée, beaucoup plus profondément « racinée » dans le cœur que la tendance à la concupiscence dont parle l’Apôtre Jean (cf. 1 Jn 2,16). C’est ce que saint Jean-Paul II montre, dans ses catéchèses sur la théologie du corps, lorsque, à la suite du Christ, il parle de cette « origine » (cf. Mt 19,5) jamais effacée, l’appel à l’innocence originelle, qui demeure toujours présent en nous, malgré les assauts de la convoitise, au-delà de la pesanteur de « l’homme de la concupiscence ».
Ensuite, cette ouverture cordiale peut se voiler sous les masques du masochisme, de la générosité manipulatrice, de la réparation culpabilisée, du sauvetage bientôt chantage, voire de l’inceste déguisé. Aucune de ces suspicions et de ces interprétations ne sera épargnée à l’héroïne, par son entourage, voire par elle-même, même si tout restera suggéré.
Enfin, cette générosité chèrement acquise et lentement conquise est la source de la joie imprenable et de la liberté inaliénable : « Je m’étais, dans la pratique, chargée de liens ; mais, en le faisant, j’avais rejeté toutes les entraves de l’indifférence et des conventions. J’étais moi-même, libre » (p. 289). Celle-ci est l’aboutissement d’un chemin qui est un travail de purification. Après avoir vécu dans l’égoïsme et l’apparence, Lise est tentée par des formes plus subtiles d’égocentrisme, comme celles que nous avons relevées – comme « payer [s]on écot » (p. 244) ou compâtir afin de consoler sa propre souffrance de voir souffrir l’autre –. Mais, progressivement, elle détectera ces chausse-trappes, conjurera ces tentations et s’éveillera à l’amour désintéressé, c’est-à-dire sans restriction et sans retour – « Donner, c’est donner sans retour » (p. 267).
Certes, on pourra regretter telle facilité d’écriture, certaines superficialités dans l’analyse (nous ne lisons pas du Bernanos). Demeure un beau livre qui m’a rappelé le centre brûlant de cet autre grand roman qu’est La Princesse de Clèves (cf. article : Les ressources du coeur), appliqué non plus aux relations entre un époux et une épouse, mais à la relation mère-fille, la relation de soi à soi : les plus hautes décisions, celles qui scellent le dessein-destin d’une vie, se préparent dans le secret du cœur, à l’insu même de celui qui la posera – « Je peux l’affirmer : j’ignore absoluement quand ma décision avait été prise » (p. 237). Elles bouillonnent (le terme est de Maître Eckhart) à la fois dans l’inclination ineffaçable au bien et au don, et dans une disposition habituelle (vertueuse) à s’offrir jusqu’à s’oublier.
Pascal Ide